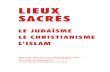PARDÈS N° 54 157 Richesse et pauvreté dans le judaïsme intertestamentaire et talmudique Aspects historiques Emmanuel Friedheim É VOQUER les différentes positions juives antiques sur les questions de richesse et de pauvreté nécessite une approche historique, visant à contextualiser les textes débattus, afin de pouvoir mieux les aborder. Pour entrer d’emblée dans le vif du sujet, il nous semble nécessaire de traiter la question sur la longue durée. On établira ainsi une trame historique se déployant de la fin de l’époque du second temple au I er siècle de notre ère, jusqu’au temps du Talmud, soit au IV e siècle, le tout en terre d’Israël. LA CONTESTATION DE LA RICHESSE À l’époque de la fin du second temple, il semblerait que les tensions sociales entre riches et pauvres se soient multipliées, dans les différentes mouvances composant la société juive. En dépit de divergences doctrinales fondamentales, ces partis, tels que les pharisiens, les esséniens/Qoumran, ainsi que les judéo-chrétiens, furent paradoxalement unis dans leur critique de la richesse et du capitalisme en général. Prenons pour exemple le second temple de Jérusalem, qui, dans les dernières décennies de son existence, à savoir jusqu’en 70 de l’ère chrétienne, n’exprimait pas seulement l’âme religieuse et cultuelle du peuple juif, tant en terre d’Israël que pour les communautés diasporiques 1 , mais constituait également le poumon écono- mique de la Judée. Le sanctuaire offrait de nombreux services financiers, tels que : entrepôts d’argent, prêts fonciers, investissements immobiliers, opérations de change de devises étrangères, notamment pour les pèlerins juifs qui se rendaient à Jérusalem à l’occasion des fêtes 2 . La richesse du temple était de notoriété publique. Elle suscitait non seulement la convoitise de gouverneurs romains dévoyés, mais motivait également la volonté

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PARDÈ S N° 54 157
Richesse et pauvreté dans le judaïsme intertestamentaire et talmudiqueAspects historiques
Emmanuel Friedheim
Évoquer les différentes positions juives antiques sur les questions de richesse et de pauvreté nécessite une approche historique, visant à
contextualiser les textes débattus, afin de pouvoir mieux les aborder. Pour entrer d’emblée dans le vif du sujet, il nous semble nécessaire de traiter la question sur la longue durée. On établira ainsi une trame historique se déployant de la fin de l’époque du second temple au ier siècle de notre ère, jusqu’au temps du Talmud, soit au ive siècle, le tout en terre d’Israël.
LA CONTESTATION DE LA RICHESSE
À l’époque de la fin du second temple, il semblerait que les tensions sociales entre riches et pauvres se soient multipliées, dans les différentes mouvances composant la société juive. En dépit de divergences doctrinales fondamentales, ces partis, tels que les pharisiens, les esséniens/Qoumran, ainsi que les judéo-chrétiens, furent paradoxalement unis dans leur critique de la richesse et du capitalisme en général. Prenons pour exemple le second temple de Jérusalem, qui, dans les dernières décennies de son existence, à savoir jusqu’en 70 de l’ère chrétienne, n’exprimait pas seulement l’âme religieuse et cultuelle du peuple juif, tant en terre d’Israël que pour les communautés diasporiques 1, mais constituait également le poumon écono-mique de la Judée. Le sanctuaire offrait de nombreux services financiers, tels que : entrepôts d’argent, prêts fonciers, investissements immobiliers, opérations de change de devises étrangères, notamment pour les pèlerins juifs qui se rendaient à Jérusalem à l’occasion des fêtes 2. La richesse du temple était de notoriété publique. Elle suscitait non seulement la convoitise de gouverneurs romains dévoyés, mais motivait également la volonté
158 PA R D È S N ° 5 4
Emmanuel Friedheim
déterminée de l’aristocratie sacerdotale sadducéenne, de maintenir envers et contre tous, son statut élitiste. Enfin, la richesse du temple déchaîna de nombreuses critiques fusant de toute part. Pour les esséniens de Qoumran, le temple, rongé par la corruption, avait fini son rôle historique et serait rapidement remplacé par un autre sanctuaire céleste empli davantage de sainteté, ainsi qu’il découle très nettement du rouleau du temple des manuscrits de la mer Morte 3. En outre, la pauvreté fut placée à Qoumran au rang de valeur suprême, qu’il fallait privilégier 4. Il est remarquable, à ce titre, que les membres de la secte essénienne devaient céder leurs biens au profit de la communauté, une sorte de « coopérative antique ». L’explication qu’ils donnèrent du psaume 37 présente d’ailleurs la secte comme une « communauté d’indigents » 5. Dans le rouleau des hymnes (VIII, 10, 30), on peut encore lire : « Une âme qui te servira, Seigneur, haïra le capital et rejettera l’argent. » Ce contexte a peut-être influencé le mouvement judéo-chrétien de Jésus, dont on connaît l’aversion qu’il pouvait porter à la richesse et au capital. En Matthieu, 6, 24, nous lisons effectivement que : « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre ; ou il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent 6. » Puis, le texte de Luc 18, 25 ainsi que les traditions synoptiques, nous apprennent qu’il est plus facile pour un chameau de passer par le chas d’une aiguille que pour le riche de pénétrer le royaume de Dieu 7. Enfin, le célèbre sermon sur la montagne débute par le verset suivant : « Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux 8. » Cette prise de position, opposant radicalement le sacré à la finance, est susceptible d’expliquer la raison profonde pour laquelle Jésus renversa les tables des vendeurs d’animaux ainsi que celles des changeurs de devises, opérant sur le parvis du temple 9. Un acte qui, selon certains spécialistes de la question du « Jésus historique » 10, fut précisément à l’origine de son arrestation par les Romains.
Cette idée de rejet de l’argent et de la richesse fut aussi, semble-t-il, partagée par les pharisiens, noyau ancestral du mouvement rabbinique s’affirmant de plus belle après 70. On lira ainsi avec intérêt une tradition d’origine judéenne 11, figurant aussi, sous quelques variantes, dans le Talmud de Babylone [= TB] Pessahim 57a, critiquant de manière virulante ces maisons de grands prêtres corrompus, alliant capitaux et pouvoir à outrance : « Abba Shaoul b. [= ben] Botnit dit au nom d’Abba Yossef b. Hanin (selon la Tosefta : Yossi b. Yohanan, homme de Jérusalem) : Malheur à moi de la maison de Baïtous, malheur à moi de leurs matraques. Malheur à moi de la maison de Hanin (selon la Tosefta :
PA R D È S N ° 5 4 159
Richesse et pauvreté dans le judaïsme intertestamentaire et talmudique
Elhanan), misère à moi de leur médisance. Malheur à moi de la maison de Katrous (selon la Tosefta : Kadrous), malheur à moi de leur plume (Rashi d’expliquer : car ils rédigent des lettres impies). Misère à moi de la maison d’Ishmael b. Phiavi, malheur à moi de leurs poings, car il s’agit de grands prêtres, leurs fils officiant comme trésoriers et leurs gendres comme armateurs. Quant à leurs serviteurs, ils molestent le peuple (selon la Tosefta : ils nous molestent) à l’aide de bâtons. » Népotisme, pouvoir et argent ou une critique populaire cinglante, attestant l’existence de profonds clivages sociaux, manifestement dus aux pratiques financières crapuleuses, qui prévalaient au sein du temple. On a coutume de dire, en invoquant la tradition talmudique babylonienne du traité de Yoma 9b, que le second temple de Jérusalem fut détruit en raison de la « haine gratuite » caractérisant les relations sociales acrimonieuses de l’époque. On a, en revanche, moins pour habitude de citer un texte en provenance de la terre d’Israël, hautement plus crédible historiquement, un passage de la Tosefta Menahot 13, 22 (éd. Zuckermandel, p. 534) stipulant que le second temple fut détruit car, « tout en appliquant les préceptes de la Torah et tout en étant scrupuleux des dîmes, ils aimaient l’argent et se détestaient les uns les autres ». Ce dénigrement de la richesse peut aussi expliquer l’idée pharisienne/rabbinique apparaissant dans une tradition mishnique de l’époque du second temple, selon laquelle le difficile chemin de l’acquisition de la Torah se résume ainsi : « Tu mangeras du pain trempé dans le sel, boiras de l’eau goutte à goutte et dormiras à même le sol. Tu vivras une vie de difficultés et t’investiras dans la Torah. Si tu te comportes ainsi, alors tu seras heureux dans ce monde-ci et dans celui à venir. Ne recherche pas la grandeur et n’envie pas les honneurs plus que ton étude. Ne convoite pas non plus les tables des rois car la tienne est plus grande que les leurs, ta couronne [à savoir l’étude] est plus grande que la leur [à savoir le pouvoir et la richesse] et il est manifeste que Dieu te rétribuera 12. » La position extrêmement critique envers la richesse et la corruption du temple apparaît aussi lors de la destruction de celui-ci. Selon les sources rabbiniques, Martha fille de Baïtous était la femme la plus riche de Jérusalem 13. Elle aurait notamment monnayé l’acquisition de la grande prêtrise pour son mari Josué b. Gamla 14, lequel fut au demeurant un grand prêtre fort apprécié des textes 15. La mort de Martha, succombant à la famine lors du siège de Jérusalem, est détaillée par les sources talmudiques qui font apparaître – en filigrane – l’idée de l’inutilité de l’argent au moment du trépas 16. Dans sa Guerre des Juifs, Flavius Josèphe nous fait part d’un épisode où les sicaires, représentant l’une des
160 PA R D È S N ° 5 4
Emmanuel Friedheim
branches armées des insurgés juifs, incendièrent les archives du temple où l’on consignait précisément les actes des transactions immobilières, notamment des prêts 17. Cette action musclée, dont l’objectif fut d’effacer délibérément les créances, afficha d’emblée l’aspect socio-économique de l’insurrection populaire, visant essentiellement les élites de Jérusalem qui maîtrisaient le temple. Certains historiens ont, du reste, montré le caractère « lutte des classes » de la révolte juive, qui n’était donc pas seulement dirigée contre Rome, mais aussi et surtout, contre les élites juives, riches et modérées de Jérusalem 18. Quelques années avant la destruction du sanctuaire, plus de 18 000 artisans juifs furent subitement congédiés, une fois les dernières finitions du temple de Jérusalem accomplies. Et Josèphe de détailler les mesures prises par le monarque juif Agrippa II, arrière-petit fils d’Hérode, nommé responsable du temple par le pouvoir romain. Ce dernier aurait immédiatement engagé de grands travaux d’intérêt général, notamment en faisant paver de marbre blanc les rues de Jérusalem, sans doute pour réinsérer professionnellement et le plus rapidement possible ces masses populaires devenues soudainement inactives 19. Il paraît donc évident que la précarité socio-économique fut l’un des principaux catalyseurs, conduisant les couches populaires à se révolter, notamment contre le système des élites juives dirigeant le temple et celui de la répartition fort inégale de ses richesses. La faillite économique de ces classes dirigeantes est d’ailleurs illustrée par de nombreuses personnalités rabbiniques, notamment Rabban Yohanan b. Zakkaï [ou R. Éléazar b. R. Zadok, l’un de ses contemporains], le premier grand restaurateur de la vie rabbinique au concile de Yabné après 70. Ce Sage aurait affirmé après avoir observé une jeune fille ramasser sous les sabots d’un étalon romain quelques épis d’orge pour se nourrir, qu’il s’agissait de la fille de Naqdimon b. Gourion, un ancien richissime de Jérusalem. Rabban Yohanan b. Zakkai d’ajouter qu’il signa le contrat de mariage (Ketouba) de cette femme, au bas duquel, on aurait consigné la somme de dix millions de deniers en or en cas de divorce 20 ! Un texte illustrant fortement l’effondrement économique d’un système, même si le montant en question est très vraisemblablement exagéré.
Là encore, le fait qu’en cette fin d’époque du second temple la protesta-tion sociale contre la richesse et ses dérivés, fut communément partagée par des courants, tels que pharisiens/esséniens/judéo-chrétiens/sicaires, que pratiquement tout opposait par ailleurs, tant d’un point de vue doctrinal que rituel, semble démontrer le profond ancrage de la contestation du capital dans l’ensemble de la société juive au premier siècle de l’ère commune.
PA R D È S N ° 5 4 161
Richesse et pauvreté dans le judaïsme intertestamentaire et talmudique
UN LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE
Mais voilà, cette protestation sociale est en réalité surprenante. Car à vrai dire, la Torah semble présenter une vision économique correspondant à ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui, les règles de « l’économie de marché ». Suivant le texte de la Genèse (XXIV, 1), « Abraham fut béni de tous les biens ». La Bible défend l’idée de propriété privée et consigne même dans les dix commandements l’interdiction d’envier le bien d’autrui 21, car il est tout à fait légitime aux yeux du législateur biblique de posséder un bien et d’en disposer librement. La prise de conscience de la place essentielle occupée par le capital dans la vie quotidienne, en bien ou en mal, apparaît explicitement dans l’Ecclésiaste, X, 19 où il est dit que « tout dépend de l’argent », c’est là un fait indéniable. Quant à R. Yohanan, décédé en 279 de l’ère commune, le plus grand Sage de la terre d’Israël, dont la tradition lui attribue la rédaction de la quasi-totalité du talmud de Jérusalem, il établit un constat semblable après avoir été détroussé par des commerçants crapuleux : « Tous les membres dépendent du cœur et le cœur dépend de la poche 22 », autrement dit, de l’argent. La Bible pérennise même l’existence de la différence des classes en affirmant explicitement en Deutéronome XVI, 11 qu’il existera toujours des indigents au pays d’Israël, qu’il faut certes soutenir, mais la pauvreté sera toujours présente, face à des privilé-giés qui le seront également. En consignant un des six ordres de la Mishna traitant des dommages et intérêts (ordre de Nezikin), les Sages démontrèrent non seulement que les méchanismes de micro/macro économie ne leur étaient pas étrangers, mais que ces rouages économiques constituaient, de surcroît, une partie intégrale de leur quotidien. En dépit de l’interdiction biblique incombant au Juif, de prêter à intérêt à ses coreligionnaires 23, les Sages finirent en définitive, par de nombreux détours halakhiques, par autoriser de facto le prêt à crédit 24. Ceci, car les Juifs à l’époque du second temple cessèrent de prêter, puisqu’ils mettaient non seulement leur patrimoine en péril, mais en outre, ne pouvaient être rétribués en vertu de l’interdit biblique excluant tout profit. En conséquence de quoi, il n’y eut tout simplement plus de crédit ou de solidarité financière selon la terminologie biblique !
Or, il est bien connu que sans possibilité de crédit, nul secteur de la vie économique de marché, ne peut fonctionner. La décision des Sages d’assouplir au maximum la loi concernant le message biblique proscrivant le crédit à intérêt prouve par conséquent que les rabbins étaient fort conscients de ces impératifs économiques. Ils décidèrent ainsi de légiférer
162 PA R D È S N ° 5 4
Emmanuel Friedheim
bon gré, mal gré, conformément à une conjoncture économique les plaçant dans l’impasse. La lucidité rabbinique concernant les questions financières apparaît nettement dans le conseil de R. Itzhak (ive siècle), figurant en TB Baba Metzia 42a : « L’homme devra toujours partager ses biens en trois : Un tiers dans l’immobilier, un tiers dans le commerce et un tiers sous sa main. R. Itzhak ajouta : La bénédiction ne réside que dans ce qui est caché du regard ». Il nous semble également que les Sages du Talmud, à la différence des mouvances sociales de la fin de l’époque du second temple et peut-être également en réponse au christianisme grandissant, ne considéraient nullement la pauvreté comme un idéal à placer en exergue, bien au contraire. Ainsi nous apprenons que : « Quatre sortes de personnes sont considérées comme mortes : le pauvre, le lépreux, l’aveugle et celui qui n’a pas de fils 25. » Ou encore lisons-nous le passage suivant : « Nos Sages ont enseigné : Trois choses rendent l’homme dément et hérétique : les idolâtres, le mauvais esprit et la pauvreté 26. »
Hormis ces raisonnements montrant des prises de position rabbiniques relativement « libérales », on se rend compte que la société juive en terre d’Israël après 70, affichait nettement sa préférence des riches et de la richesse, à la différence de la période précédant la destruction de Jérusalem et de son temple.
Après l’an 70 et jusqu’à l’époque du Talmud au ive siècle, on trouve effectivement dans les textes de nombreuses tentatives s’appliquant à défendre la richesse. Au sein du judaïsme rabbinique, on considérait en premier lieu que les dirigeants se devaient obligatoirement d’être riches. Au concile de Yabné du temps de Rabban Gamaliel II (soit entre l’an 96 et 115), on lui chercha un successeur après que le peuple l’a démis de ses fonctions de patriarche. Après plusieurs candidatures malheureuses, ce fut celle de R. Éléazar b. Azaria qui fut retenue, car : « il est érudit, riche, et constitue la dixième génération depuis Ezra le scribe 27 ». Ces trois éléments, l’érudition, l’ascendance illustre et pour notre propos la richesse, représentaient donc une condition sine qua non pour être un patriarche réussi. Les sources affirment également que quiconque aperçoit en rêve R. Éléazar b. Azaria, s’enrichira 28, ou encore que depuis la disparition de ce maître, la richesse fut abolie du monde des Sages 29. On signalera que R. Eléazar b. Azaria était prêtre /cohen, car descendant d’Ezra, et ceci nous rappelle un autre texte du iie siècle tiré d’un Midrash halakhique 30, stipulant que « la majorité des prêtres sont riches », ou comme disait R. Yohanan plus tard au iiie siècle : « Celui qui veut s’enri-chir, se joindra à la lignée d’Aharon 31. » L’immense savant talmudique
PA R D È S N ° 5 4 163
Richesse et pauvreté dans le judaïsme intertestamentaire et talmudique
qu’était Saül Lieberman commenta ce passage de la manière suivante : « Hormis les patriarches, les plus fortunés parmi les Sages de la Mishna, furent tous affiliés à la prêtrise 32. » R. Tarfon, surnommé « le maître d’Israël », au début du iie siècle, était un prêtre richissime 33. Et puisque l’on a rappelé les patriarches [nessiim], on ne peut ici faire abstraction du plus prestigieux d’entre eux, R. Judah le prince, œuvrant entre 180 et 222 de l’ère commune, à une époque où la bonne entente avec Rome parvint à son apogée. Le patriarcat étant alors officiellement reconnu par le droit romain, il octroyait à son chef nombre de privilèges, notamment l’exemption d’impôts et le droit d’en prélever sur les Juifs. Les textes talmudiques très abondants, montrent que R. Judah le prince possédait de larges domaines terriens, des gardes du corps d’origine gothique et de nombreux navires 34. Enfin, R. Judah le prince respectait les riches ainsi qu’un passage talmudique l’atteste explicitement 35. D’autres textes disent exagérément que ce patriarche était même plus fortuné que l’empereur romain 36. L’archéologue israélien Z. Weiss a prétendu il y a une dizaine d’années avoir localisé la propriété de R. Judah le prince dans la cité galiléenne de Sepphoris, où le patriarche séjourna pendant les dix-sept dernières années de sa vie, suivant la tradition talmudique 37. S’il s’agit véritablement de sa demeure, il est clair que la richesse de ses mosaïques correspond magnifiquement à la description donnée de R. Judah le prince par les sources talmudiques. Il est à noter que ce maître, ainsi que ses descendants, tentèrent de réduire au silence l’opposition des riches qui n’appartenaient pas à la société rabbinique, ainsi que celle de Sages nécessiteux, en affectant les uns à certains postes publics et en assistant financièrement les autres 38. De nombreuses exégèses rabbiniques affirment du reste que Moïse était extrêmement riche, cela bien que le texte biblique n’en sache apparemment rien 39. Or, il s’avère que les auteurs de ces commentaires rabbiniques furent précisément tous originaires de la cité galiléenne de Sepphoris contemporains de R. Judah le Prince 40, comme s’il fallait légitimer par des antécédents bibliques une réalité contemporaine de la richesse du patriarche, assimilé peut-être à Moïse ! Comme l’a bien montré L. I. Levine : « Ce n’est pas un hasard si les Sages les plus connus, nommés à des postes à responsabilité dans la seconde moitié du iiie siècle, étaient fortunés 41. » Ainsi, R. Yohanan dit à R. Hanina bar Sissi, que ce dernier n’avait aucune chance de recevoir une quelconque nomination car il manquait de serviteurs 42. R. Abbahou, très riche notable de Césarée [iii-ive siècle], fut nommé à répétition tandis que son contemporain R. Shimon bar Abba, à court d’argent et
164 PA R D È S N ° 5 4
Emmanuel Friedheim
au seuil de la famine, eut beaucoup de difficulté à obtenir un poste 43. Il est donc juste de prétendre que les rabbins considéraient la richesse comme globalement positive.
Selon des textes midrashiques le riche a des qualités personnelles utili-sées à bon escient. Sur un passage du livre des Juges rappelant « les hommes vertueux », le midrash dit : « Ce sont les riches qui ont des moyens 44. » Le riche nourrit ses enfants de viande, de poisson et de bon vin. Il leur assure ainsi la sécurité financière, garantissant l’enseignement de la Torah 45. Mais les Sages étaient aussi conscients du fait que l’alliance entre richesse et pouvoir pouvait parfois conduire à la corruption et au déclin de la société. Il nous semble qu’il faille ici combiner cette reconstitution avec un élément de taille, à savoir la crise économique qui frappa la population juive de Palestine romaine dans la seconde moitié du iiie siècle.
SAGESSE ET RICHESSE
On sait que l’empire romain fut alors affecté par une crise sécuritaire, économique, sans précédent dans l’histoire de Rome. En outre, la popu-lation juive palestinienne ne fut de loin pas épargnée par cette crise 46. La précarité économique troublait alors la quiétude de l’esprit, condition indispensable à l’étude et à l’élaboration complexe des textes halakhiques. À cette époque, et sans doute en raison d’un besoin pressant de liquidités, la vénalité de postes publics devint alors monnaie courante, en dépit du fait que les acquéreurs de l’aristocratie urbaine n’avaient aucune connaissance en Torah. On rapportera à cet effet une critique édifiante figurant dans le Talmud de Jérusalem 47 :
R. Mana maudit ceux qui achètent le pouvoir. R. Imi / Ami leur appliqua le verset : « Vous ne ferez point pour vous des dieux en argent et en or » (Exode XX, 20). R. Yachia dit : Et le talit (châle, c.-à-d. : le symbole du pouvoir) qu’il porte ne vaut pas plus que la selle d’un âne. R. Shein dit : Celui qui achète le pouvoir, on ne se lève pas devant lui, on ne l’appelle point maître, et le châle dont il est vêtu est semblable à la selle d’un âne. R. Zeira et l’un des maîtres étaient assis pour étudier la Torah devant la maison d’étude, au moment ou l’un d’eux passait devant eux. Le collègue de R. Zeira lui dit : Faisons comme si l’on étudiait et de la sorte, nous ne nous lèverons pas devant lui. Jacob de Naboraya expliqua (litt. traduisit) : « Malheur à celui qui dit à un morceau de bois : Éveille toi ! à la pierre inerte : Lève toi, Sont-ce là des guides ? » (Habacuc II, 19) Sait-il où guider ? « Vois l’idole est plaquée d’or et d’argent »
PA R D È S N ° 5 4 165
Richesse et pauvreté dans le judaïsme intertestamentaire et talmudique
(ibid.), avec l’argent il ne sera pas nommé, « et aucun souffle n’est en elle » (ibid.), il n’est érudit en rien.
La richesse, certes, mais reversée équitablement au peuple, et ce avant tout, pour des Sages de la Torah. Car pour les Sages de la Mishna ou du Talmud, on ne le répétera jamais assez, qu’ils furent riches ou pauvres, nulle valeur ne pouvait rivaliser avec l’étude, dont l’importance fut si bien décrite par R. Yossi b. Kisma dans le traité Avot, 6, 10 : « Même si l’on me donnait tout l’argent et l’or, les pierres précieuses et les perles du monde entier [pour ne pas habiter dans un lieu de Torah], je ne résiderais que dans un emplacement de Torah. »
Pour conclure, la société juive à la fin de l’époque du second temple était divisée entre des groupes sociaux qui pour la plupart d’entre eux se sentaient exclus du temple et mis à l’écart de ses richesses. Celles-ci étaient essentiellement réservées à une minorité sacerdotale, qui fut alliée de surcroît au pouvoir romain local, oppresseur et cupide. Au regard de ce contexte historique, il est envisageable d’expliquer la fronde, menée par les différentes mouvances juives contre l’opulence à outrance et ses injustices sociales. Mais après 70, ces frictions de naguère, entre fortunés et démunis, finirent par s’estomper progressivement, à l’heure où parmi les pharisiens/rabbiniques, on (re)constitua une société juive se fondant sur des personnalités aisées, qui amorcèrent un processus de répartition équitable des ressources.
N’y avait-il donc plus de nécessiteux parmi les Sages et la société juive aux iie et iiie siècles ? Loin de nous une telle idée ! Certains d’entre eux furent considérablement éprouvés par la misère et le dénuement, notamment R. Yeoshoua b. Hanania (ier-iie siècle), qui était un charbonnier besogneux 48, R. Éléazar Hamsa et R. Yohanan b. Godgada qui, malgré l’immensité de leur érudition, étaient tant faméliques que marmiteux 49. On retiendra aussi l’affirmation de R. Shimon bar Yohaï – à la suite du soulèvement de Bar Kokhba en 135 et de ses conséquences désastreuses, notamment sur le plan économique – selon qui : « quiconque profite de l’argent dans ce monde-ci consomme déjà sa part du monde futur » 50, ou encore ces Juifs sans-le-sou, qui du temps de R. Yehouda bar Ilaï (iie siècle) n’avaient qu’un vêtement pour six 51.
Cela dit, nombreux furent également ces maîtres infortunés assistés par les Sages aisés, notamment R. Judah le prince qui nourrit la classe rabbi-nique et le reste du peuple lors d’une année de sécheresse et de disette 52.
166 PA R D È S N ° 5 4
Emmanuel Friedheim
Ces rabbins assistés devaient manifestement considérer favorablement la richesse et sa répartition juste et équitable parmi les différentes strates de la société juive. Tant qu’il n’y eut pas de corruption entravant la loi et la morale sociale et que la place du statut de Sage de la Torah fut préservée au sein de la société, on ne trouva apparemment aucune dissonance entre sagesse et richesse. Ainsi pouvait-on d’une part placer en avant la richesse du patriarche comme R. Judah le prince, lequel se comportait à certains égards comme un membre à part entière de la noblesse romaine, et affirmer d’autre part que lorsque ce dernier décéda, la modestie quitta ce monde 53.
NOTES
1. S. Safrai, « The Service of God in the Second Temple », in : idem, In Times of Temple and Mishnah – Studies in Jewish History, I, Jérusalem 1994, p. 34. [Héb.] ; R. Yankelevitch, « The Temple of Onias : Law and Reality », in : I. Gafni, A. Oppenheimer & M. Stern (dir.), Jews and Judaism in the Second Temple, Mishna and Talmud Period – Studies in Honor of Shmuel Safrai, Jérusalem 1993, p. 109 [Héb.]. Cela dit, certains dysfonc-tionnements ayant trait au sanctuaire, particulièrement dans les dernières années de son existence, suscitèrent parfois la critique, cf. E. Friedheim, « Polythéisme et monothéisme ou la question des convergences cultuelles au sein du second temple de Jérusalem », Revue biblique, 119/3 (2012), p. 367, n. 3.
2. A. Shlasky, Private Finance and Banking among Palestinian Jewry during the Late Second Temple, Mishnah and Talmud Periods (30 BCE – 395 CE), Unpub. Ph. D. Thesis, Ramat-Gan 2010, p. 231-237. [Héb.]
3. Y. Yadin, The Temple Scroll, I, Jerusalem 1977, p. 141 [Héb.] ; II, col. XXIX, lignes 8-10, p. 91-92. [Héb.]
4. D. Flusser, The Spiritual History of the Dead Sea Sect, Jerusalem 1987 2, p. 56. [Héb.] ; M. Broshi, The Dead Sea Scrolls, Qumran and the Essenes, Jerusalem 2010, p. 106. [Héb.]
5. Pesher sur les Psaumes, XXXVII, 2, 10, et al.6. Le texte grec translitère le terme hébraïque de « Mamon », désignant l’argent, cf.
Matthieu, 6, 24. Ce phénomène est assez courant dans le Nouveau Testament, tant pour des termes araméens qu’hébraïques translitérés en grec, cf. F. Bernard-Marie, La langue de Jésus – L’araméen dans le Nouveau Testament, Paris 1999, p. 29-44.
7. Ce fameux passage figure aussi dans les autres évangiles synoptiques (Matthieu, 19, 24 ; Marc, 10, 25) authentifiant ainsi probablement son historicité, cf. Broshi (supra, n. 4).
8. Matthieu, 5, 3.9. Matthieu, 21, 12-13 ; Marc, 11, 15-17 ; Luc, 19, 45-46 ; Jean, 2, 14-16, 16 : « et il dit
aux vendeurs de pigeons : Ôtez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. »
10. Cf. notamment : P. Matteï, Le christianisme antique de Jésus à Constantin, Paris 2008, p. 69, et al.
11. Cf. Tosefta Menahot, 13, 21 (éd. Zuckermandel, p. 533).12. Mishna Abot, 6, 4.
PA R D È S N ° 5 4 167
Richesse et pauvreté dans le judaïsme intertestamentaire et talmudique
13. Sifri sur Deutéronome, 281, 17 (éd. Finkelstein, p. 298) ; TB Guittin, 56a. Et al.14. Mishna Yevamot, 6, 4 ; TJ Yevamot, 6, 4 (7a) ; TB Yoma, 18a ; TB Yevamot, 61a. Et al.15. TB Baba Bathra, 21a.16. Lamentations Rabba, 1, 46-47 (éd. Vilna) [Myriam fille de Naqdimon et Myriam fille
de Baïtous] ; TB Guittin, 56a.17. Flavius Josèphe, Guerre des Juifs, II, 17, 6 : « Puis ils [= les sicaires] portèrent le feu
dans les archives publiques, pressés d’anéantir les contrats d’emprunt et d’empêcher le recouvrement des créances, afin de grossir leurs rangs de la foule des débiteurs et de lancer contre les riches les pauvres sûrs de l’impunité. Les gardiens des bureaux des conservateurs s’étant sauvés, ils mirent donc le feu aux bâtiments. Une fois le nerf du corps social ainsi détruit, ils marchèrent contre leurs ennemis ; notables et grands prêtres se sauvèrent en partie dans les égouts… » (traduction : Th. Reinach & R. Harmand, révisée et annotée par S. Reinach, J. Weill, E. Leroux, Publications de la société des études juives, Paris 1900-1932).
18. Cf. par exemple : S. C. Mimouni, Le judaïsme ancien du vie siècle avant notre ère au iiie siècle de notre ère – des prêtres aux rabbins, Presses Universitaires de France, Paris 2012, p. 456 : « L’endettement encourage en effet, non seulement la concentration foncière, mais aussi la déchéance sociale des individus puisque le chômage peut conduire à l’esclavage. Tous les paysans pauvres n’en sont certes pas arrivés à cette déchéance, mais la haine des riches a atteint un degré inouï dans la Palestine d’avant 66… Cette haine sociale débouche sur une épuration rigoureuse des privilégiés que mettront en œuvre les zélotes en 68 et en 69, aidés en cela par les autres factions comme par exemple les sicaires descendants directement ou indirectement du groupe de Jean de Galilée ou de Gamala. »
19. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, XX, 9, 7 : « À ce moment le Temple était achevé. Le peuple voyait donc que les ouvriers, au nombre de plus de dix-huit mille, chômaient et avaient besoin de salaires, parce qu’ils se procuraient jusque-là de quoi vivre en travaillant au sanctuaire… »
20. Mekhilta de R. Ishmael Yithro – Massekhta de-Bahodesh, 1, (éd. Horovitz-Rabin, p. 203-204) ; Sifri sur Deutéronome, 305 (éd. Finkelstein, p. 325) ; Tosefta Ketoubot, 5, 9-10 (éd. Lieberman, p. 74) ; Abot de R. Nathan, 17 (Version A, éd. Schechter, p. 33a) ; TB Ketoubot, 66b-67a. Et al.
21. Exode, XX, 14 ; Deutéronome, V, 18.22. TJ Teroumot, 8, 4 (46b).23. Deutéronome, XXIII, 20-21.24. Shlasky, (Supra, n. 2), p. 70-170. [Héb.]25. TB Nédarim, 64b.26. TB Erouvine, 41b.27. TB Berakhot, 27b.28. Abot de R. Nathan, 40 (Version A, éd. Schechter, p. 64b) ; TB Berakhot, 57b.29. Mishna Sota, 9, 15.30. Sifri sur Deutéronome, 452 (éd. Finkelstein, p. 409) : « La plupart des prêtres sont
riches. »31. TB Pessahim, 49b.32. S. Lieberman, Tosefta Ki-fshutah – A Comprehensive Commentary on the Tosefta,
VIII, Order Nashim, Jerusalem 19922, p. 762. [Héb.]33. Tosefta Ketoubot, 5, 1 (éd. Lieberman, p. 71-72) ; TJ Shevi’it, 4, 2 (35b) ; TB Nédarim, 62a ;
Massekhet Kalla, 21 (éd. Higger, p. 157-158) ; Tosefta Haguiga, 3, 37 (éd. Lieberman,
Emmanuel Friedheim
p. 393) ; B. Z. Rosenfeld, Lod and its Sages in the Period of the Mishnah and the Talmud, Jerusalem 1997, p. 26ff. [Héb.]
34. TJ Mo’ed Qatan, 3, 1 (81c) ; TB Houlin, 7b ; TB Nédarim, 50b-51a ; TJ ‘Avoda Zara, 1, 10 (42a) ; Genèse Rabba, 20, 6 (éd. Theodor-Albeck, p. 190). Et al. ; L. I. Levine, The Rabbinic Class in Palestine during the Talmudic Period, Jerusalem 1985, p. 90ff. [Héb.] ; A. Oppenheimer, Galilee in the Mishnaic Period, Jerusalem 1991, p. 60-84. [Héb.] ; L. I. Levine, « Bet She’arim in its Patriarchal Context », in : L. Di Segni, Y. Hirshfeld, J. Patrich & R. Talgam (dir.), Man near a Roman Arch – Studies Presented to Prof. Y. Tsafrir, Jerusalem 2009, p. 115-129. [Héb.]
35. TB Erouvin, 86a.36. Oppenheimer (supra, n. 34).37. Z. Weiss, Cathedra Quarterly, 99 (2001), p. 7-26. [Héb.]38. Levine, (Supra, n. 34 – Ire publication), p. 119. [Héb.]39. M. Beer, The Sages of the Mishnah and the Talmud – Teachings, Activities and
Leadership, E. Friedheim, D. Sperber, R. Yankelevitch (dir.), Ramat-Gan 2011, p. 344-361. [Héb.]
40. Ibid., p. 357ff. [Héb.]41. Levine (Supra, n. 34 – Ire publication), p. 123. [Héb.]42. TJ Sanhédrin, 2, 6 (20c).43. Levine (Supra, n. 34 – Ire publication), p. 124. [Héb.]44. Mekhilta de R. Ishmael, Massekhta De-Amalek – Yithro, 2 (éd. Horovitz-Rabin, p. 198).45. Sifri sur Deutéronome, 37 (éd. Finkelstein, p. 71).46. E. Friedheim, « Haine et mépris ou le fondement historique de la rivalité entre judaïsme
palestinien et babylonien au iiie siècle de l’ère commune », JUDAICA – Beiträge zum Verstehen des Judentums, 69/1 (2013), p. 29-32.
47. Bikourim, 3, 3 (65d).48. TB Berakhot, 28a. Ce passage cite aussi les critiques virulentes de R. Yeoshoua à
l’encontre du patriarche présumé Rabban Gamaliel, l’accusant en substance d’être largement déconnecté de la réalité sociale et de la pauvreté qui habitent quotidiennement les Sages d’Israël, cf. ibid.
49. TB Horayot, 10a.50. Midrash sur les Psaumes, 92, 8 (éd. Buber, p. 407). À comparer avec : TJ Berakhot,
9, 1 (13d) ; Genèse Rabba, 35, 2 (éd. Theodor-Albeck, p. 329) ; Exode Rabba, 52, 3. Et al.
51. TB Sanhédrin, 20a. Et pour un habit pour deux, cf. TB Sota, 49a.52. TB Baba Bathra, 8a.53. Mishna Sota 9, 16.
Related Documents