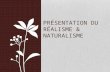Thémata. Revista de Filosofía, 41: 443-466 (2009). UNE EXPLICATION CAUSALE DE LA HIÉRARCHIE NATURELLE Propriétés et limites du naturalisme d’A. N. Whitehead Miguel Espinoza Jusqu’à aujourd’hui il n’y a pas de théorie nous permettant de comprendre la nature de la vie, mais je dois affirmer que l’étude du contrôle hiérarchique formera la base de telle théorie. Howard H. Pattee INTRODUCTION La présente réflexion, accompagnée par la philosophie de l’organisme d’Alfred North Whitehead, vise à décrire un espace naturaliste, métaphysique et réaliste dans lequel on peut plonger le problème de l’explication de la hiérarchie naturelle. En ce qui me concerne, je soulignerai qu’une telle explication doit être nécessairement causale, condition non requise par Whitehead, bien que, comme nous le verrons, la causalité est bien présente dans son exposé. Ce cadre naturaliste, métaphysique et réaliste peut être considéré également comme un antécédent et comme un prolongement spéculatif et rationnel de la recherche scientifique, laquelle est destinée à expliquer la formation de la hiérarchie naturelle avec ses propres moyens. Whitehead partage l’idée que la nature est composée d’entités et de strates émergentes — mathématiques, physiques, biologiques, psychiques, etc. J’ajoute que les descriptions

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Thémata. Revista de Filosofía, 41: 443-466 (2009).
UNE EXPLICATION CAUSALE
DE LA HIÉRARCHIE NATURELLE
Propriétés et limites du naturalisme d’A. N. Whitehead
Miguel Espinoza Jusqu’à aujourd’hui il n’y a pas de théorie nous permettant de comprendre la nature de la vie, mais je dois affirmer que l’étude du contrôle hiérarchique formera la base de telle théorie.
Howard H. Pattee
INTRODUCTION
La présente réflexion, accompagnée par la philosophie de l’organisme d’Alfred North
Whitehead, vise à décrire un espace naturaliste, métaphysique et réaliste dans lequel on peut
plonger le problème de l’explication de la hiérarchie naturelle. En ce qui me concerne, je
soulignerai qu’une telle explication doit être nécessairement causale, condition non requise
par Whitehead, bien que, comme nous le verrons, la causalité est bien présente dans son
exposé. Ce cadre naturaliste, métaphysique et réaliste peut être considéré également comme
un antécédent et comme un prolongement spéculatif et rationnel de la recherche scientifique,
laquelle est destinée à expliquer la formation de la hiérarchie naturelle avec ses propres
moyens.
Whitehead partage l’idée que la nature est composée d’entités et de strates émergentes —
mathématiques, physiques, biologiques, psychiques, etc. J’ajoute que les descriptions
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 2
scientifiques de l’ontologie et de la dynamique à chaque niveau sont généralement assez
satisfaisantes. D’autre part comment ne pas reconnaître qu’on est assez loin d’obtenir une
explication causale satisfaisante du processus qui fait émerger une strate des strates
préexistantes. La difficulté est essentiellement conceptuelle : le physicalisme et le
spiritualisme, des doctrines concurrentes de l’émergentisme dans la tentative d’explication de
la diversité naturelle, signifient une bifurcation, insoutenable, de la nature, une absence
d’explication unitaire qui ne sera pas comblée sans une révision des concepts de base du
physicisme et du spiritualisme. Ainsi, au moment de chercher avec Whitehead une explication
causale de la hiérarchie naturelle, on exposera sa conception de l’entité actuelle, sorte
d’atome ; la collaboration entre la cause efficiente et la cause finale, et le développement de la
notion de concrescence en tant que constitution réelle interne de toute entité. Et je ne
manquerai pas de faire remarquer, quand cela sera nécessaire, les différences entre la
philosophie whiteheadienne et le naturalisme intégral tel qu’il est conçu dans cet essai.
Mon objectif est, par conséquent, double : primo, exposer l’une des façons de concevoir
la hiérarchie naturelle en faisant une brève description des classes d’entités ou de systèmes
qui existent et des différentes strates naturelles ; secundo, proposer quelques observations
concernant l’explication de la hiérarchie. En tant que pièce d’une réflexion guidée par la
tentative d’esquisser un naturalisme intégral ou compréhensif, il s’agit, comme d’habitude
dans cet essai, d’éviter à la fois les excès réductionnistes du physicisme et l’idée vitaliste
selon laquelle il y a seulement des discontinuités infranchissables entre, d’une part,
l’inorganique, et, d’autre part, les phénomènes biologiques et psychiques.
Considérez ces quatre thèses: (I) La nature est composée d’entités émergentes ; (II) Il
existe une hiérarchie d’entités et de strates ; (III) Rien, ni les entités, ni les strates, ni les
propriétés, ni les relations ni les comportements des êtres ne résultent du hasard mais ils sont
tous, sans exception, causalement déterminés. Et attendu que la relation causale présuppose la
continuité spatiotemporelle entre l’ensemble des entités et des processus appelés « cause » et
les phénomènes appelés « effet », il s’ensuit que (IV) La formation d’entités et de strates
comporte non seulement des discontinuités mais, également et nécessairement, des continuités
spatiotemporelles.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 3
§ 1. — ÉMERGENCE ET ÉMERGENTISME
Pour mieux comprendre la signification des thèses énoncées ainsi que la notion de
hiérarchie, j’examine quelques concepts-clés. « Émergence » ne jouit pas d’une signification
unanimement acceptée. Pour ma part je l’emploie, en un sens faible, pour reconnaître d’une
part qu’il y a des nouveautés ontologiques qui conforment l’échelle naturelle (nous y
reviendrons), et, d’autre part — ce qui explique le caractère faible de cet émergentisme — pour
affirmer que les nouveautés ontologiques doivent s’expliquer par le déterminisme causal des
quatre causes de la tradition aristotélicienne. L’émergentisme est donc un anti-
réductionnisme : ce n’est pas le cas que toutes les nouveautés et que toutes les influences
causales s’expliquent seulement par l’inférieur, par l’action exclusive des éléments et des
causes physicochimiques.
Le terme « émergence » fut utilisé durant la deuxième moitié du 19ème siècle et les
premières décennies du 20ème siècle notamment par des auteurs tels que George-Henry
Lewes, Samuel Alexander et C. Lloyd Morgan. Selon Alexander,
l’émergence d’une nouvelle qualité à un certain niveau d’existence signifie qu’à ce niveau vient à l’être une certaine constellation ou collocation de mouvements appartenant à ce niveau et possédant la qualité qui lui est propre ; et cette collocation possède une nouvelle qualité distinctive d’un complexe supérieur. Cette qualité et la constellation à laquelle elle appartient sont à la fois nouvelles et exprimables sans reste en des termes propres au niveau duquel elles émergent ; c’est ainsi que l’esprit est une nouvelle qualité distincte de la vie, avec ses méthodes propres de comportement… non pas purement vital, mais aussi vital.1
Les auteurs que l’on pourrait classer d’émergentistes sont nombreux et des différences
les séparent, mais l’essentiel se trouve dans ces lignes d’Alexander. Le mot d’Alexander peut
être analysé comme suit : (I) On postule que dans la nature il y a plusieurs niveaux ou
plusieurs strates d’existence. C’est ce que je nomme ici « la hiérarchie naturelle ». Cela veut
dire que tout ce qui existe, d’un point de vue ontologique, ne s’équivaut pas. Le problème
principal de cette affirmation est de trouver des critères convaincants pour séparer les
différents niveaux ou strates du monde. L’absence de critères qui fassent l’unanimité explique
que tous les émergentistes ne distinguent pas exactement les mêmes strates. (II) On postule
qu’à un certain niveau il y a apparition de quelque chose de nouveau, soit d’une nouvelle
entité, d’une nouvelle propriété, d’une nouvelle relation ou d’un nouveau comportement.
Dans la nouveauté il y a des propriétés absentes dans les parties appartenant aux strates
1 Samuel Alexander, Time, Space and Deity, I, éd. Dover, New York, 1966, p. 45.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 4
précédentes qui la constituent. (III) L’idée suivante introduit un problème difficile : « Cette
qualité et la constellation à laquelle elle appartient sont à la fois nouvelles et exprimables sans
reste en des termes propres au niveau duquel elles émergent. » Il s’agit du rapport entre
l’épistémologie et l’ontologie. Si les termes de la description de la nouveauté sont ceux du
niveau qui la voit naître, où est donc la discontinuité, la nouveauté ontologique ? (IV) La
nouveauté est une certaine constellation, c’est-à-dire un nouvel ensemble de positions et de
mouvements, bref un nouveau mécanisme que l’on pourrait concevoir comme plus ou moins
matérialiste.
Aujourd'hui l'opinion unanime est d'attribuer la naissance de l'idée d'émergence à John
Stuart Mill, à sa distinction entre les lois hétéropathiques et les lois homopathiques. Dans son
Système de logique déductive et inductive il écrit:
Le principe de la proportionnalité des effets aux causes ne peut pas être appliqué aux cas dans lesquels l'augmentation de la cause altère la qualité de l'effet, c'est-à-dire dans lesquels la quantité surajoutée à la cause ne se compose pas avec elle, mais les deux ensemble produisent un phénomène entièrement nouveau... Ainsi, ce prétendu axiome de la proportionnalité des effets à leurs causes fait défaut juste au point où fait défaut aussi le principe de la Composition des Causes, c'est-à-dire, là où le concours des causes est tel qu'il détermine un changement dans les propriétés du corps et le soumet à de nouvelles lois plus ou moins différentes de celles auxquelles il était soumis auparavant.2
Je trace l'origine de l'idée d’émergence où de nouveauté à Aristote. Voici un passage entre
autres:
Mais la génération et la corruption absolues et complètes ne sont pas définies, comme certains philosophes le soutiennent, par l'union et la séparation, tandis que le changement dans le continu serait l'altération. Bien au contraire, c'est là où toute l'erreur réside. Il y a, en effet, génération et corruption absolues, non pas du fait de l'union et de la séparation, mais quand il y a changement total de telle chose à telle autre chose.3
Quand les composants agissent ensemble dans le nouvel être (pensez aux éléments
physicochimiques d’une cellule), cet être manifeste en acte de nouvelles propriétés et de
nouveaux comportements qui existaient en puissance dans les éléments. Et les composantes
qui existaient en acte avant le changement substantiel ne disparaissent pas pour autant mais
continuent à exister potentiellement dans la nouvelle entité, raison pour laquelle on peut les
retrouver par analyse. La façon philosophique de parler de puissance et d’acte est implicite
dans une science qui se donne comme objectif de savoir précisément et concrètement
2 John Stuart Mill, Système de logique déductive et inductive, (1843), Livre III, Ch. VI, § 3 « Les effets sont-ils proportionnés à leurs causes ? », éd. française Librairie Philosophique de Ladrange, Paris, 1866. 3 Aristote, De Generatione et Corruptione, I, Ch. 2 : 317a 17-24, éd. française Vrin, Paris, 2005 (les italiques sont miennes).
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 5
comment les qualités des éléments se transforment en qualités des composés. Et si on peut
retrouver les éléments par analyse du tout, cela implique que, sans perdre leur identité
d’origine, ils ne sont pas immuables, comme les atomes ont été conçus à un moment donné,
car ils sont adaptables et sensibles à leur nouvelle configuration ; les éléments s’accommodent
aux nouvelles lois et se laissent contrôler par le tout. Par exemple, chez les personnes, puisque
nous pensons avec des neurones composés d’électrons, ceux-ci suivent non seulement les lois
de la physique mais ils obéissent à un composé de lois physiques, biologiques et
psychologiques ; toutefois, si l’organisme est analysé, on retrouve en acte les propriétés et les
lois purement physiques. On se demande donc, au point de vue des idées, ce qu'il y a de
nouveau dans l'émergence des modernes — mais en général, en philosophie, il est difficile de
trouver des idées dont les origines ne remontent pas à l'Antiquité Classique.
§ 2. — LE DÉTERMINISME CAUSAL PRODUCTEUR DE PROPRIÉTÉS ÉMERGENTES
Voici d’emblée deux problèmes difficiles : 1° attendu qu’on reconnaisse, comme je le
fais, l’existence de propriétés ontologiquement émergentes, est-il ontologiquement cohérent
de postuler qu’elles soient produites par un déterminisme causal universel ? 2° Étant donné
que toute nouveauté doit être exprimée avec des combinaisons de concepts préexistants,
même s’il y avait des innovations ontologiques, comment pourrions-nous les exprimer, et, par
conséquent, comment pourrions-nous qu’elles existent ? La réponse que j’essaie de rendre
plausible est qu’ontologiquement il faut distinguer la nouveauté absolue de la nouveauté
relative. La prémisse du déterminisme causal universel exclut toute nouveauté absolue, la
création ex nihilo. Seule la nouveauté relative est possible. Et cette nouveauté relative est
exprimable avec de nouvelles combinaisons d’idées de concepts préexistants, ainsi que grâce
à la formation de noveaux concepts, résultat de nouvelles intuitions et de nouvelles
perceptions, car je ne partage pas le pessimisme selon lequel la science et la philosophie
seraient incapables de multiplier et d’améliorer leurs concepts.
On dira que cette façon de concevoir l’émergence est inusitée, qu’elle enlève une partie
essentielle au concept original d’émergence. Si c’est le cas, il faut assumer cette diminution et
c’est pourquoi je qualifie volontiers mon idée d’« émergentisme faible ». Le terme
« émergence » est pourtant conservé car, étant donné deux niveaux contigus de la hiérarchie
naturelle, il existe, en effet, au niveau supérieur, de nouvelles propriétés, de nouvelles lois et
de nouveaux comportements comme conséquence des nouvelles relations entre les éléments
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 6
du niveau inférieur. Et ces nouvelles relations sont constitutives d’une nouvelle dynamique
entre les éléments anciens, nouvelle dynamique qui est, à son tour, la composante explicative
essentielle de l’innovation. Les êtres ultimes de la physique, particules et champs, sont
ontologiquement si loin de propriétés émergentes telles que la pensée consciente, qu’on se
demande quelles propriétés extraordinaires on devra ensuite attribuer aux relations
constitutives de la nouvelle dynamique pour qu’une entité ou une nouvelle fonction, telle que
la conscience ou le moi conscient, puisse apparaître.
L’émergentisme décrit-il vraiment une situation ontologique, ou bien est-il un
commentaire purement épistémologique ? Du fait que le réductionnisme n’explique ni la vie
ni la conscience avec des catégories physicochimiques, l’émergence est, au moins
aujourd’hui, une réalité épistémologique. Maintenant la question de savoir si l’émergence est
aussi une caractéristique du réel est un problème plus compliqué et ouvert où se mélangent
des questions de fait, des questions de concepts et des questions d’appréciation. D’après la
métaphysique d’Aristote, le changement total d’une chose en une autre signifie un
changement de forme, et d’après la métaphysique whiteheadienne, le changement total d’une
chose en une autre signifie que les composants se sont organisés en une nouvelle
concrescence, ont donné lieu à une nouvelle synthèse, et la nouveauté révèle des propriétés
émergentes.
Étant donné que la hiérarchie naturelle montre des discontinuités et des continuités, ce
que je viens de dire suggère trois façons de concevoir l’émergentisme : 1° L’émergentisme
sans déterminisme causal universel. Il expliquerait les discontinuités entre les strates sans
rendre compte des continuités. 2° L’émergentisme avec déterminisme causal physicochimique
(déterminisme des causes efficaces). Il expliquerait les continuités sans rendre compte des
discontinuités. 3° L’émergentisme avec le déterminisme causal des quatre causes
aristotéliciennes. Il rendrait compte des continuités et des discontinuités. Dans cet essai je
soutiens cette troisième sorte d’émergentisme.
Ainsi, la reconnaissance des quatre causes aristotéliciennes est, de mon point de vue,
essentielle à la notion de déterminisme causal et à la conception de l’émergence. L’action de
la forme et de la finalité est manifeste surtout dans les phénomènes de la matière vivante :
elles guident l’action de la matière et des forces agissantes. Ainsi, si l’émergentisme (faible)
est une alternative au réductionnisme physicaliste, c’est essentiellement parce que l’ontologie
du premier inclut une conception de la causalité plus riche que ce dernier.
La base rationnelle du déterminisme causal est ce grand principe, déjà rencontré dans
notre essai, énoncé depuis l’Antiquité Classique, entre autres, par Lucrèce : rien ne sort de
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 7
rien ni ne va vers le néant. L’accent est placé sur les notions de cause et de causalité. La cause
est quelque chose de spécifique et de réel qui participe à la production d’une chose ou d’un
phénomène. La causalité est un principe concernant le mode de production des choses. Le
déterminisme est l’idée selon laquelle l’avenir et le passé de quelque chose sont,
respectivement et en principe, prévisibles et rétrodictibles, une fois en possession des lois, de
préférence causales, qui ordonnent les phénomènes.
Si l’idée magique selon laquelle une chose peut exercer une influence instantanée à
distance était vraie, alors l’espace et le temps seraient annulés car l’influence n’aurait pas
besoin d’occuper de proche en proche l’espace et le temps entre la cause et l’effet. L’idée de
trou ou de vide absolu dans l’espace, dans le temps ou dans la matière répugne à
l’entendement, et ce rejet signifie l’origine de la pensée scientifique, philosophique et
rationnelle. La pensée rationnelle a commencé avec la reconnaissance d’un monde unique,
d’un seul espace, d’un seul temps et d’une seule matière.
Si les vides absolus y sont exclus, il s’ensuit que l’espace, le temps, la matière et
l’influence causale sont au moins quantitativement continus. Par contre, selon les
changements que l’on considère, il est juste d’affirmer que la matière, l’espace, le temps et
l’influence causale peuvent être qualitativement discontinus. Ainsi, étant donné deux strates
contiguës de la hiérarchie des systèmes, ce que la strate supérieure conserve de la strate
inférieure exprime une continuité causale quantitative et qualitative, tandis que les propriétés,
les lois et les comportements émergents expriment, d’une part, une continuité quantitative,
mais, d’autre part, une discontinuité qualitative. Par exemple, chez les animaux, on constate
d’une part l’existence d’une strate chimique en continuité quantitative avec la strate physique
due aux composantes physiques des processus chimiques et, d’autre part, une discontinuité
qualitative due aux propriétés typiquement chimiques de cette strate relativement supérieure ;
on constate l’existence d’une strate biologique physicochimiquement composée et, par
conséquent, une continuité quantitative ; mais il y a aussi une discontinuité qualitative sans
laquelle il n’y aurait pas de distinction entre le vivant et le non vivant, et ainsi successivement
jusqu’à l’apparition des sociétés composées d’individus conscients de leur moi.
Le petit oiseau qui utilise son bec comme marteau fait appel à son substrat physique,
mais ensuite quand il réunit des petites branches pour construire son nid, la strate physique est
guidée par celle, biologique, de son instinct. Entre les strates, nous l’avons affirmé, il y a une
différence qualitative, une hiérarchie. Avec la notion de hiérarchie nous voulons attirer
l’attention sur le fait que dans les objets complexes il y a une organisation guidée par un
principe directeur : des causes multiples physiques et chimiques sont guidées, ordonnées,
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 8
interprétées et évaluées en vue de former des systèmes vivants tels que l’estomac, la vision ou
l’animal tout entier. On s’accorde à dire qu’on mesure la supériorité d’un système par la
variété de la nature des parties qui le composent et qui collaborent à la production d’une fin
unique, c’est-à-dire qu’un système est d’autant plus riche que son unité dans la multiplicité
l’est, ainsi l’œil humain est supérieur à l’œil de la grenouille.
Chaque niveau possède ses propres règles qui contrôlent le comportement des
composants. La hiérarchie assure la cohérence et l’harmonie de l’ensemble : l’influence du
niveau supérieur limite l’action des éléments du niveau inférieur en les intégrant au plan
d’ensemble. On comprend qu’ici le processus le plus intéressant et le plus difficile à expliquer
soit la dynamique qui se développe entre les différents niveaux : de quelle façon le niveau
inférieur conditionne le niveau supérieur et, à son tour, de quelle façon le niveau supérieur
limite les degrés de liberté du comportement des composantes du niveau inférieur pour les
incorporer à la forme globale. C’est en pensant aux composantes de chaque niveau et aux
propriétés dont elles doivent être dotées, ainsi qu’au problème du rapport dynamique entre les
strates des systèmes, que j’ai choisi les idées whiteheadiennes examinées dans cet essai.
Depuis la naissance de la science moderne on pense que la composition et la dynamique
de chaque strate de la hiérarchie est descriptible et explicable par la science correspondante.
L’échelle comtienne des sciences donne une idée assez précise de ce que l’on veut dire. Le
complément de cette hypothèse présuppose que la dynamique à la frontière entre les strates,
facteur clé dans la description et dans l’explication de l’organisation des êtres vivants et
conscients, serait descriptible et explicable par les catégories de la théorie de l’évolution telles
que les variations aléatoires et la sélection naturelle. Bien que dans cette théorie les causes
formelles et finales soient absentes, les variations aléatoires ne sont pas dépourvues de causes
efficaces physicochimiques : l’aléatoire signifie qu’il n’y a pas de relation directe entre ce
dont un organisme aurait besoin pour survivre et ce qu’il obtient (Lamarck, on s’en souvient,
avait proposé le contraire). La théorie de l’évolution est, bien évidemment, indispensable : le
problème difficile pour les spécialistes est d’évaluer la portée explicative, exhaustive ou non,
de ses mécanismes. D’après mon idée de l’explication, expliquer signifie monter dans
l’échelle de la nécessité, exposer la nécessité dans le déterminisme causal producteur d’un
phénomène.4 Il s’ensuit qu’une explication n’est pas tout à fait satisfaisante dans la mesure où
il y a des zones abandonnées au hasard, au jeu de petites causes efficientes non dirigées par
une nécessité. C’est pourquoi, au moment de comprendre l’adaptation, il serait sage de
4 Cf. e.g. M. Espinoza, Théorie du déterminisme causal, op.cit., pp. 213 et s.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 9
compléter les mécanismes darwinistes par l’introduction des causes formelles et finales
naturellement conçues, par la considération de quelques mécanismes mathématiques tels que
la recherche de solutions optimales aux problèmes posés par le besoin d’adaptation. En
définitive c’est par sa valeur pour la révision des aspects conceptuels et causaux de
l’explication de la hiérarchie naturelle, ainsi que par sa valeur pour la conception des
composantes des entités, que l’étude de Whitehead a été choisie à ce point de notre enquête.
§ 3. — L’ENTITÉ ACTUELLE
Une des préoccupations principales de Whitehead, que tout naturaliste intégral et vrai
partage, consiste à élaborer un système d’idées capable d’accueillir les différents aspects et
valeurs des choses, ainsi que l’expérience humaine, riche et variée, tâche inusitée dans une
époque dominée par la perspective étroite des sciences naturelles : j’ai à l’esprit la nature et la
portée de l’ontologie, de la sémantique et de la méthodologie de ces dernières. Dans ce
contexte, on ne peut qu’apprécier chez Whitehead l’intuition aigue de la profondeur et de la
complexité de la nature.
D’après le postulat principal de l’émergentisme qui aspire à rendre compte de la
hiérarchie naturelle, primo, tout ce qui existe est fait des mêmes entités ultimes, secundo, des
nouvelles relations entre les éléments constituent une nouvelle dynamique qui signifie la
naissance d’une nouvelle entité dotée de nouvelles propriétés et de nouveaux comportements
régis par de nouvelles lois. On doit donc se former une idée de la nature des entités ultimes
ainsi que des relations causales entre les entités et entre les différents niveaux. Une brève
digression sur les formalismes nous fera mieux comprendre le programme de Whitehead
pertinent pour notre discussion. Premièrement, les abstractions ou concepts fondamentaux tels
que la substance, l’espace, le temps et la causalité sont du plus haut intérêt : sans eux, ni nous,
ni les animaux supérieurs — qui partagent avec nous ces catégories — ne serions capables de
satisfaire les besoins vitaux d’alimentation, de reproduction, d’évitement des prédateurs,
d’apprentissage. Ensuite nous essayons de comprendre le monde et notre expérience grâce à
la multiplication de concepts de plus en plus abstraits. Les concepts les plus abstraits ont un
intérêt vital moindre, ils nous conditionnent moins que les catégories fondamentales de la
connaissance que nous partageons avec les animaux. Et les formalismes abstraits du langage
usuel dotés de sémantique ont été prolongés par les symbolismes syntactiques des
mathématiques encore plus abstraits que les concepts du langage usuel.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 10
Or tous les concepts sont nécessairement des abstractions et les quelques aspects séparés
des choses contrastent avec le grand nombre d’aspects différents des choses concrètes. Ce
serait donc une erreur que de confondre l’abstrait et le concret, il faut éviter « l’erreur du
concret mal placé » qui consiste à penser qu’il y a quelque chose de concret là où l’homme a
formé une abstraction.5 Le fait de prendre conscience de cette erreur est si important que l’une
des définitions de la philosophie, d’après Whitehead, est la critique des abstractions. La
philosophie doit compléter et harmoniser les abstractions en les réglant d’après nos intuitions
les plus concrètes, ce qui aboutit à des schémas de pensée plus complets.6 Il est impossible de
ne pas être d’accord avec Whitehead sur ce point : dans la réalité rien n’est simple, chaque
chose est ce qu’elle est et tout simplification résulte de notre représentation.
Si les cosmologies sont incapables de rendre justice à la richesse de notre expérience, si
elles sont incapables de décrire et d’expliquer convenablement les différents systèmes
naturels, si elles aboutissent à une dualité substantielle telle que la distinction entre le
physique et le mental, ou à l’idée que tout est exclusivement physique ou exclusivement
mental, c’est parce qu’on a confondu l’abstrait et le concret, la partie et le tout. C’est pourquoi
Whitehead postule qu’il faut repenser les catégories, les concepts fondamentaux de la
connaissance. Sa table des catégories n’est pas simple (je me limite ici à les mentionner) : il y
en a trois pour l’ultime, huit pour l’existence, vingt-sept catégories pour l’explication ainsi
que neuf obligations catégorielles.
En ce qui concerne la hiérarchie naturelle, un mode de classification des doctrines
consiste à faire attention à l’unité ou à la multiplicité du matériel constitutif des êtres. D’après
les doctrines pluralistes, la hiérarchie naturelle manifeste l’existence, par exemple, d’une
énergie physique, d’une énergie ou force vitale et d’une énergie spirituelle, toutes différentes
et compréhensibles par trois métaphysiques différentes. Pour les doctrines monistes, au
contraire, l’étoffe ultime de tout ce qui existe est d’un seul genre et le processus de formation
des entités suit une seule rationalité susceptible d’être saisie par une seule métaphysique. En
ce sens, la philosophie whiteheadienne de l’organisme est une sorte de monisme.
S’il y a des composants ultimes de l’univers alors ils doivent être d’un seul ordre en vue
de satisfaire l’une des exigences élémentaires de la raison. L’histoire de la pensée montre que
la raison, en tout ordre de choses, cherche, en effet, l’unité. La raison est ainsi faite —
Meyerson, on s’en souvient, l’avait décrite avec éloquence — qu’expliquer signifie montrer
l’unité et l’identité derrière le multiple et le divers. Whitehead érige cette leçon de l’histoire de
5 Alfred North Whitehead, Science and the Modern World, op. cit., p. 51. 6 Ibid., p. 87.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 11
la pensée en principe: « le présupposé selon lequel il existe un seul genre d’entités actuelles
constitue un idéal de théorie cosmologique auquel la philosophie de l’organisme s’efforce de
se conformer ».7
Au point de vue de l’étoffe ultime, nous avons vu que la philosophie de l’organisme est
un monisme. Mais si l’on considère que cette doctrine admet une multiplicité d’entités et
d’expériences, alors, de ce point de vue, rien n’empêche de la classer comme un pluralisme.
Cela étant reconnu, dans l’optique de cet essai seul son monisme est pertinent : il y a des
composants ultimes et ils sont tous d’un même genre.
La multiplicité des entités actuelles signifie que l’univers de l’organicisme n’est pas un
monisme extrême comme celui de l’Être parménidéen. Considérez que grâce au principe
whiteheadien de relativité, chaque élément et chaque ensemble d’éléments de l’univers
participe, d’une façon ou d’une autre, de la constitution de toute entité,8 et ce postulat, en
reconnaissant l’existence d’une multiplicité d’entités qui s’emboîtent les unes dans les autres
dans un univers en évolution, empêche que l’univers soit une seule entité existant en bloc
toujours identique à elle-même. La multiplicité d’entités forme ainsi un monde solidaire parce
que toute entité, sans exception, aussi improbable ou insignifiante qu’elle puisse paraître à
première vue, d’une façon ou d’une autre et dans la mesure de ses possibilités, a une influence
sur le reste de l’univers : ceci est stipulé par « le principe de pertinence intensive »9 (Dans
Théorie du déterminisme causal j’ai proposé une thèse en partie semblable et en partie plus
précise : tout dans l’univers a une signification, ce qui veut dire que tout dans l’univers
participe à des relations causales. C’est pourquoi considérer que quelque chose est insignifiant
veut dire que la recherche de causalité n’a pas été menée assez loin).
Les deux types fondamentaux de catégories de l’existence sont, d’une part, les
« événements » ou « entités actuelles » et, d’autre part, les « objets éternels ».10 Les objets
éternels sont des formes qui spécifient le caractère des entités actuelles. La concrescence
d’une entité actuelle, son devenir, consiste en l’acquisition de formes définies grâce à des
décisions dont l’objectif est précisément l’assimilation ou le rejet d’un objet éternel. Ceci
épuise ce que nous devons connaître sur les objets éternels dans notre essai, et la critique
mentionnée à continuation mise à part, il ne sera plus question de ces objets. Il est à remarquer
que selon Whitehead, les objets éternels ont été tous donnés en une seule fois. Il ne peut y
avoir de nouveaux objets éternels. Mais cette affirmation est arbitraire et elle est incompatible
7 A. N. Whitehead, Process and Reality, op. cit., p. 130. 8 Ibid., p. 65. 9 Ibid., p. 172. 10 Ibid., p. 30.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 12
avec l’idée whiteheadienne d’un univers en évolution permanente. Si l’univers évolue, il est
raisonnable de penser que les objets éternels émergent, comme les entités actuelles. La
nécessité de cette hypothèse devient encore plus évidente quand on sait que dans la
philosophie whiteheadienne la nature est présidée par le principe ontologique : « tout se situe
positivement en acte quelque part, et en puissance, partout ».11 Ma recherche d’un naturalisme
intégral et cohérent n’a donc pas de place pour des entités éternelles non émergentes et non-
évolutives, ni pour aucune entité dont l’existence dépend d’elles.
« Événement » est le terme employé par Whitehead dans La Science et le monde
moderne, et son équivalent dans Procès et réalité est, comme on sait, « entité actuelle »,
«occasions actuelles», « réalités finales » ou encore « rēs vera ». On ne peut aller derrière les
entités actuelles pour trouver quelque chose de plus réel qu’elles ».12 «… Une théorie de la
science qui écarte le matérialisme doit répondre à la question concernant la nature de ces
entités primaires. Il ne peut y avoir qu’une réponse sur cette base. Nous devons commencer
avec l’événement comme unité ultime du phénomène naturel ».13 Le fait d’avoir nommé
« événements » les constituants ultimes signifie que ce ne sont pas des entités éternelles
comme les atomes des anciens ou comme les monades leibniziennes. Au contraire, en dernier
ressort ce sont des entités microscopiques extrêmement éphémères. En dernier ressort car
Whitehead, d’une façon ambiguë, appelle aussi événements ou entités actuelles les
conglomérats de telles entités. Voici un point particulièrement important pour la philosophie
de l’organisme : les entités actuelles sont des relations plutôt que des substances, ou bien, si
l’on veut (car ce qui est ultime, quelle que soit sa nature, est une substance) les entités
actuelles sont des relations transformées en substances. Chaque entité actuelle est en rapport
avec toutes les autres entités actuelles grâce aux « préhensions », notion décrivant à la fois
l’aspect subjectif de la perception ainsi que le fait que la perception participe à la constitution
de l’objet. Bien entendu, dans la philosophie de l’organisme, toutes les préhensions ne sont
pas conscientes ou cognitives.14
Encore une autre spécificité de cette conception est qu’il n’y a pas lieu de distinguer les
relations externes des relations internes. Traditionnellement, quand un système est considéré
comme une substance, il est conçu comme une unité pourvue un bord net qui le sépare de
l’environnement. De cette façon les composants internes du système développent entre eux
des relations internes tandis que le système, à travers son bord ou frontière, entretient avec
11 Ibid., p. 54. 12 Ibid., p. 23. 13 Science and the Modern World, op. cit., p. 103. 14 Ibid., p. 69.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 13
d’autres systèmes des relations externes. Or dans la philosophie de l’organisme quand on
affirme que tout est, en fin de compte, événement, on implique l’absence de relations
externes : elles sont, toutes, internes, constitutives de son être. C’est une façon de stipuler le
principe de relativité whiteheadien : chaque événement (ou entité actuelle) est présent dans
tous les autres événements de l’univers avec des degrés différents de pertinence. L’unité de
tout ce qu’il y a est l’unité d’un réseau de relations. Il existe en conséquence une sorte de
sympathie universelle semblable à la conception stoïcienne où tout est présent dans tout ou est
sensible à tout, d’une façon positive, négative ou même indifférente (« sympathie » : mot
heureux car il implique ou suggère que tout est vivant ou, si l’on préfère, que tout est
organisme). L’entité actuelle organise, et, tout comme la monade leibnizienne, est une unité
dans la multiplicité. Par exemple, il n’y a pas d’ego substantiel ou objet qui ne soit un réseau
de relations, un ensemble de perspectives ou de modes de perceptions d’autres entités.
Considérez tout ce qui contribue à notre formation.
Ceux qui ne connaissent pas Whitehead et qui essayent à tout prix d’éviter
l’anthropomorphisme trouveront surprenant que l’on appelle « perception » y compris la
relation entre des objets inanimés. Or ce point est capital pour comprendre sa philosophie
naturelle : il y a d’une part une continuité entre l’inanimé et le vivant et, d’autre part, il
s’exprime comme s’il était légitime d’expliquer l’inférieur par le supérieur comme le font
typiquement les anti-réductionnistes et comme, entre autres, Aristote l’avait fait autrefois. On
prend comme modèle et point de départ le plus complexe et supérieur que nous connaissons,
i.e. l’homme, et on essaye ensuite de trouver ses propriétés à un degré moindre ou en
puissance dans les systèmes inférieurs. Cette procédure est légitime aux yeux de tout
émergentiste car si les strates naturelles supérieures présupposent les strates inférieures et en
sont issues, les propriétés des entités supérieures doivent exister en puissance dans les
systèmes qui leur donnent naissance. Par exemple, la pensée humaine, consciente,
symbolique, doit forcément plonger ses racines dans les niveaux sous-jacents ; elle doit être
présente, d’une façon rudimentaire, chez les animaux supérieurs, et cette pensée animale doit
exister en puissance chez des animaux encore moins évolués.
Toute entité actuelle est une série de perceptions ou de préhensions, bien que, comme
chez Leibniz (nous l’avons rappelé) toutes les perceptions ne soient pas conscientes. Tout
organisme (au sens whiteheadien) est constitué d’entités actuelles. Les biologistes du 19ème
siècle ont découvert des organismes extrêmement petits à une échelle où l’on ne soupçonnait
pas leur existence. Prolongeons cette tendance à la limite, semble suggérer l’auteur, et l’on
découvrira que toutes les entités sont des organismes. Ainsi un organisme est tout ensemble
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 14
d’entités actuelles et non seulement l’être vivant tel que celui que nous connaissons à notre
échelle. Un cristal est, lui aussi, un organisme. Avec ce terme « organisme » on souligne que
les composants des systèmes ne sont pas mutuellement indifférents mais qu’au contraire ils
ont tous une valeur les uns pour les autres. « La science prend un aspect nouveau, ni purement
physique ni purement biologique. Elle devient l’étude des organismes. La biologie est l’étude
des grands organismes, alors que la physique est l’étude des petits organismes. »15 Étant
donné que les organismes incluent, en tant que composants, d’autres organismes, on se
demande si l’analyse est prolongeable à l’infini. Whitehead répond, comme les premiers
atomistes, qu’il lui semble très improbable qu’il y ait dans la nature une régression infinie.
§ 4. — LA PRÉHENSION POSITIVE OU SENTIR
Faut-il croire que tout est fait d’atomes matériels et que seule leur efficacité, additionnée
avec les interactions physiques aléatoires, produit les différentes strates de la hiérarchie
naturelle ? Cette hypothèse ne semble pas satisfaisante car on se demande comment des
particules pauvres en propriétés ou même vides, par simple accumulation, comme les briques
d’un mur, produiraient les diverses classes d’entités vivantes et conscientes.
D’autres versions du naturalisme telles que celles d’Aristote, D’Arcy Thompson ou
René Thom, mettent à une place d’honneur, la cause formelle et la cause finale, ou plutôt la
forme-fin considérées comme constituant deux aspects d’un seul et même fait. Ainsi la
croissance des organismes serait due à l’action de la matière et aux interactions physiques,
alors que la variété de forme de tous les êtres, inorganiques et vivants, serait le résultat des
causes formelles et finales qui guident et organisent l’action de ce qui est purement matériel.
La variété de la hiérarchie naturelle serait, en somme, un problème de physique — la
croissance — et de téléologie géométrique — la forme.
Ce n’est pas tout. Encore une autre tentative d’explication causale de l’émergence est
celle d’une conception plus complexe à la fois du genre d’atomes qui seraient les composants
ultimes de l’univers et des relations qui les unissent. C’est la situation où se trouve
Whitehead. Bien qu’il préfère s’associer à Platon, il est clair que son émergentisme a des
racines aristotéliciennes et que, de plus, sa conception de la matière, de la forme et de la
finalité — bref, son ontologie — est comparable, avec bénéfice intellectuelle, aux conceptions
15 Ibid., p. 103.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 15
de D’Arcy Thompson et de René Thom au moins dans la mesure où ces penseurs ont
réinterprété scientifiquement la cause formelle et parfois, aussi, la cause finale.
Nous avons vu que d’après le mathématicien et philosophe britannique les entités
actuelles sont des unités d’expérience douées d’un pôle physique et d’un pôle mental. Elles ne
sont pas des corpuscules vides et leurs relations sont principalement celles inscrites dans les
causes efficientes et dans les causes finales. Étant donné la diversité des classes d’entités qui
composent la hiérarchie naturelle, si l’on veut avoir une chance de l’expliquer causalement il
est indispensable d’élaborer l’ontologie sur une base complexe telle que celle qui vient d’être
esquissée. D’autre part, pour éviter l’explication tautologique il ne faudrait pas non plus que
la base soit aussi riche que ce que l’on veut expliquer. La philosophie de l’organisme essaie
d’éviter les deux écueils, celui du réductionnisme et celui de l’explication tautologique. Pour
permettre de mieux comprendre ce qui vient d’être exposé depuis le début de cette section
j’explique et je commente les concepts whiteheadiens de cause efficiente et de cause finale,
résumés dans la notion de préhension.
On a pris l’habitude de dire, non sans raison, que d’après l’image scientifique moderne,
le monde est comme une gigantesque partie de billard, composé de corps qui s’attirent, se
choquent et se repoussent suivant certaines forces simples. Dans ce monde la cause est une
force, et ce qui est propre aux corps en tant que sources ou récepteurs de l’action causale est
leur situation ponctuelle dans l’espace et dans le temps. Telle est, d’un mot, l’idée qui se
dégage de la mécanique rationnelle newtonienne. Par contre Whitehead, en tant qu’héritier de
l’électromagnétique, conscient des changements introduits dans la vision du monde par la
physique relativiste et sensible à la variable biologique, ne se satisfait pas de cette conception
primitive de la causalité. Tout comme Platon et Aristote, sa façon de penser la relation causale
n’est point mécanique mais organique, conséquence de penser le monde comme un être
vivant. Le modèle mécaniste de la partie de billard est remplacé par celui, organiciste, de
l’évolution d’un œuf.
L’entité actuelle est une série de préhensions, i.e. de relations avec l’ensemble des
entités qui composent l’univers en évolution. On trouve une idée similaire dans la
Monadologie leibnizienne. Leibniz distingue la perception inconsciente qu’il appelle
« perception », de la perception consciente ou « aperception ». Whitehead garde cette
distinction mais il choisit des nouveaux termes afin d’éviter la suggestion leibnizienne selon
laquelle la perception est une représentation. Ainsi chez Whitehead les préhensions peuvent
être inconscientes ou conscientes et ne sont pas des représentations. En fait la plupart des
perceptions ne sont pas conscientes. Une préhension est positive s’il y a acceptation d’une
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 16
entité, d’une donnée ; négative, dans le cas contraire. La préhension positive est un sentir
(feeling) et signifie une opération générale fondamentale, à savoir, le passage de la donnée
objective à son assimilation subjective. Cette relation, indispensable pour comprendre la
formation des entités, est causale : « Un sentir physique simple actualise une cause. L’entité
actuelle qui est la donnée initiale est la « cause », le sentir physique simple est l’« effet » et le
sujet qui éprouve le sentir physique simple est l’entité actuelle « conditionnée » par l’effet.
Cette entité actuelle « conditionnée » est également désignée comme « effet ». Toute action
causale complexe peut être réduite à un ensemble de tels composants primaires. Les sentirs
physiques simples sont donc aussi nommés sentir « de causalité ».16
La relation causale entre la tulipe et la lumière est évidente : le végétal se tourne vers
elle, il exploite l’énergie solaire ; la photosynthèse n’aurait pas lieu sans lumière. Le loup
perçoit la Lune et cette relation causale n’est pas moins évidente. Ces relations sont
particulières : la tulipe et l’animal ne perçoivent pas la lumière de la même manière : chaque
entité subjectivise ou intériorise les données selon sa propre constitution, et à son tour, la
constitution se modifie en fonction des données subjectivisées. La relation causale, en
permettant à l’entité qui agit comme donnée ou cause de s’incorporer à l’entité réceptrice,
rend possible en même temps la permanence ou durée de l’entité composante. Dans les deux
cas la relation implique durée et mort. Ainsi une entité morte — au sens où elle a actualisé ses
potentialités, atteint ses objectifs et ses limites —, en entrant dans la composition d’une entité
en formation, i.e. en vivant en elle, prolonge son être. Ce faisant, il y a une adaptation
mutuelle : tandis que l’entité qui reçoit la donnée ou cause se conforme aux propriétés de la
nouvelle composante, la nouvelle donnée se soumet à l’organisation de l’entité intégrée, à ses
lois et aux caractéristiques de son comportement. Cette conception permet à Whitehead de
reprendre l’observation ancienne d’après laquelle l’inorganique devient organique et matière à
pensée : de la terre naît l’herbe qui alimente les animaux qui sentent et raisonnent, les
végétaux et les animaux alimentent l’homme. Clairement l’inorganique suit, dans cette
ascension, les lois de la vie, de la sensibilité et de la pensée :
La doctrine que je soutiens affirme que le concept global de matérialisme s’applique seulement à des entités très abstraites, produits du discernement logique. Les entités durables concrètes sont les organismes, de sorte que le plan de l’ensemble influence les caractères mêmes des divers organismes subordonnés le constituant. Dans le cas de l’animal, les états mentaux s’intègrent au plan de l’organisme total et modifient donc les plans des organismes subordonnés successifs jusqu’au organismes ultimes les plus petits tels que l’électron. Ainsi un électron à l’intérieur d’un corps vivant diffère d’un électron extérieur, en raison du plan du corps. L’électron court en
16 Process and Reality, op. cit., pp. 276-277.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 17
aveugle soit dans le corps soit en dehors de celui-ci, mais il court à l’intérieur du corps en accord avec sa nature dans le corps, c’est-à-dire en accord avec le plan général du corps, plan incluant l’état mental. Mais le principe de modification est parfaitement général à travers la nature, et ne représente aucune propriété particulière des corps vivants.17
§ 5. — LA FORMATION CAUSALE DES ENTITÉS : LA CAUSE EFFICIENTE
La plupart de nos contemporains semble convaincue par le rejet humien de la causalité
efficiente. D’après le philosophe écossais toute chose, pour être une cause, doit agir, être
efficace. Il s’ensuit que si l’on arrive à réfuter la cause efficiente, aucune autre cause ne reste
debout. C’est ce que Hume a cru montrer en faisant remarquer que tout ce que l’on peut
constater est la conjonction constante de la cause et de l’effet, leur contiguïté dans l’espace et
dans le temps. Par contre, l’un des traits essentiels réclamés pour la relation causale est absent
de la perception sensible, à savoir, la connexion nécessaire, la transmission nécessaire d’une
matière, d’une énergie ou d’une information de la cause à l’effet. Le scepticisme suit : le
raisonnement causal n’élargit pas la connaissance sensorielle. La raison de ce bref rappel de
Hume est qu’il présente un point de départ approprié pour comprendre les notions
whiteheadiennes sur la causalité.18
Whitehead répond correctement au défi de Hume : prouver, en faisant appel à la
sensation, que quelque chose transite nécessairement de la cause à l’effet. Whitehead nomme
« référence symbolique » la nature mixte de la perception caractéristique de l’homme. L’un
des modes est l’efficience causale, l’autre, la présentation immédiate. Hume et Kant font
partie des nombreux analystes de la perception qui, en se concentrant sur la présentation
immédiate, tendent à oublier la participation de l’efficience causale. Je perçois autour de moi,
ici et maintenant, des solides saillants : une longue série de livres ouverts, des stylos,
l’ordinateur ; j’entends des sons. L’immédiateté de présentation est l’appréhension des choses
présentes dans l’espace et dans le temps. Mais il ne faut nullement oublier que ce mode est
possible parce que je perçois avec mon corps, avec mes appareils sensoriels qui ont une
histoire, et que les objets perçus, eux aussi, résultent d’une histoire : « Les causes ne sont pas
le moins du monde ‘inconnues’, et parmi elles on trouve l’efficience des yeux. »19 Mon corps
17 Science and the Modern World, op. cit., p. 79. 18 Voir en particulier la critique de la causalité selon Hume dans A.N. Whitehead, Symbolism, Its Meaning and Effet, University of Virginia, 1927 ainsi que dans Process and Reality, Part II, VIII Symbolic Reference. 19 Process and Reality, op. cit., pp. 198-199.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 18
et les objets, convenablement présents ici et maintenant, émergent de la permanence d’un
passé massif souvent vaguement perçu.
Imaginons un acte réflexe, le clignement que nous faisons et que nous sentons dans une
chambre obscure au moment de l’éclairer soudainement. La séquence de ce qui est perçu dans
le mode de la présentation immédiate est composé ainsi : rayons de lumière, la sensation de
fermer les yeux, instant d’obscurité. L’explication physiologique de la succession se formule
avec les termes de la causalité efficiente et non avec ceux de la présentation immédiate :
enregistrement du trajet d’un train d’excitations le long des nerfs jusqu’au centre nerveux, et
message de contraction revenant vers les paupières. Et de toute façon, le sujet sent que les
expériences de l’œil par rapport à l’éclair sont la cause du clignement. Ce que le sujet sent,
c’est — contrairement à l’avis de Hume — l’impossibilité de ne pas cligner. Le rejet de
l’argument whiteheadien présupposerait injustement, encore une fois, la primauté artificielle
de la présentation immédiate sur la causalité efficiente. L’obstacle humien écarté, évaluons la
participation de la cause efficiente dans la composition des entités.
La formation d’une nouvelle entité est le fruit de la « concrescence ». C’est une sorte de
centralisation, de processus où des éléments croissent ensemble harmonieusement. C’est une
multiplicité devenue unité. La catégorie whiteheadienne de l’ultime se dédouble en créativité,
pluralité et unité. La nouvelle entité est une multiplicité unifiée, et il a créativité dans le sens
où la nouvelle entité se détache de la multiplicité unifiée la laissant dans son arrière-plan.
Pensez, par exemple, à la croissance des pétales d’une fleur. La concrescence comporte une
phase initiale et une phase supplémentaire. La cause efficiente est une activité essentielle de la
première phase de la formation d’une entité. Nous l’avons vu : l’entité qui atteint ses objectifs
meurt et peut devenir une donnée composante d’une nouvelle entité en cours de formation à
l’intérieur de laquelle elle devient immortelle. Dans sa formation, l’entité impose à ses
données une conformation à ses fins.20 Whitehead est à placer parmi ceux qui essayent de
corriger l’importance exclusive accordée à la cause efficiente par les penseurs et scientifiques
modernes qui ont réagi avec exagération face à l’hypertrophie médiévale dans l’emploi des
explications finalistes : « L’une des tâches d’une saine métaphysique consiste à présenter des
causes finales et efficientes dans leur véritable relation mutuelle. »21
D’après la doctrine aristotélicienne des quatre causes, la vision whiteheadienne de la
causalité, en n’accordant pas une valeur exclusive à la cause efficiente, est sur les bons rails
en ce qui concerne la recherche d’intelligibilité. Ce qui ne surprend pas car la stratégie de
20 Process and Reality, op. cit., p. 99 21 Ibid., p. 101.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 19
Whitehead qui consiste à réhabiliter la coopération entre la cause efficiente et la cause finale
s’inscrit dans son rejet de la vision physiciste qui, typiquement, nie toute valeur à la
téléologie. Cela étant dit, attendu que dans la philosophie de l’organisme la cause efficiente
garantit la continuité du passé au présent et au futur, au point de vue aristotélicien il faut
associer cette conception à la cause matérielle plutôt qu’à la cause efficiente. Rappelons que
pour Aristote la matière est, précisément, le substrat permanent qui assure la continuité de
l’existence quand les autres aspects, tels que la forme ou la finalité, changent.
Comme nouvelle expression du complémentarisme et du continuisme whitehediens
considérez ceci : aussi bien les causes efficientes que les causes finales sont présentes dans les
entités d’ordres différents de la scala naturæ, mais le poids relatif de chaque classe de cause
n’est pas la même selon la strate à laquelle appartient l’entité. Ainsi comme il n’y a pas de
frontière stricte entre l’inerte et le vivant, ainsi il n’y pas non plus de frontière stricte entre les
domaines présidés par la cause finale et ceux pour lesquels la cause finale est sans grande
pertinence.
L’emploi par Whitehead de termes tels que « créativité », « décision » et « liberté » dans
la formation des entités laisse penser que dans la nature il y a de la place pour
l’indétermination causale. Ces mots désorientent car dans sa formation, l’entité accepte ou
rejette telle ou telle autre entité en fonction de ses propriétés. C’et pourquoi je pense qu’au
moins la notion de liberté ici ne convient pas. D’après Whitehead, les entités sont
intérieurement déterminées et extérieurement libres. On comprend leur détermination
intérieure étant donné les caractéristiques des nombreuses entités assimilées. Mais, contre
Whitehead, j’aimerais faire remarquer que l’on ne comprend pas comment les entités peuvent
être extérieurement libres. À mon sens, comme je viens de le suggérer, la décision de
préhender positivement ou négativement une entité est déterminée par ce que l’entité est déjà
au moment de la décision.
En examinant la causalité, une brève discussion de la notion whiteheadienne de la liberté
s’impose. Il se trouve que cette conception n’est pas dépourvue de contradiction.
Premièrement, Whitehead reconnaît, d’une part, comme Spinoza, que toute entité actuelle est,
dans sa concrescence, causa sui, cause de soi-même, et, plus généralement, que toute liberté
dans l’univers est la manifestation du fait qu’un être est cause de soi-même.22 « La liberté
absolue n’existe pas comme fait ; une entité actuelle ne possède que la liberté propre à la
phase primaire que lui assigne comme un « donné » sa position de relativité vis-à-vis de son
22 Ibid., p. 106.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 20
univers actuel. La liberté, l’être donné, la potentialité sont des notions qui se présupposent et
se limitent mutuellement. »23 Tout cela est, à mon sens, parfaitement raisonnable. Mais,
deuxièmement — voici donc la contradiction —, dans ce même livre Process and Reality on
lit : « La liberté ultime des choses, par delà tous les déterminismes, c’est Galilée qui l’a
chuchotée — E pu si mouve ! —, liberté pour les inquisiteurs de penser de travers, pour Galilée
de penser droit, et pour le monde de se mouvoir indépendamment de Galilée et de ses
inquisiteurs. »24 Or d’après le principe ontologique de Whitehead, tout ce qui existe se trouve
dans une ou dans plusieurs entités actuelles qui nécessairement le déterminent canalisant ainsi
son activité. On ne voit donc pas comment quelque chose de l’univers pourrait arriver « par
delà les déterminismes ».
Indépendamment de l’interprétation plus ou moins favorable à la liberté que l’on fasse
de celle-ci selon la cosmologie organiciste, c’est un fait que l’on ne comprend pas
rationnellement comment dans la nature il pourrait y avoir quelque chose ou une zone qui
présente un vide de déterminisme causal. Premièrement, s’il y avait une région où le
déterminisme causal faisait défaut, elle serait ineffable, au-delà des capacités de tous nos
systèmes de symboles. Les systèmes de symboles identifient et classent les objets dans
l’espace et dans le temps ; ils décrivent la naissance, le développement et la transformation
des objets. Rien de tout cela n’est descriptible ni compréhensible sans la causalité car rien ne
sort de rien. Toute activité, y compris la permanence d’un objet assurée par la cause
matérielle, est causale. Ainsi même le nom propre, en tant que symbole identifiant,
présuppose la causalité. Il s’ensuit que la causalité est à la fois un principe des choses et une
présupposition symbolique. Deuxième raison contre l’hypothèse d’une liberté au-delà de tout
déterminisme causal : quiconque chercherait une preuve expérimentale de l’existence d’un
vide de détermination causale présupposerait l’impossible, à savoir, la connaissance
exhaustive de l’univers. Seule une telle exhaustivité assurerait qu’il y a des endroits sans
causes. Et cela serait paradoxal car toute expérience scientifique réalisable, dont la valeur est
toujours locale, est destinée, précisément, à rendre manifeste une relation causale :
l’expérience scientifique consiste à modifier les éléments variables qui entrent en compte dans
la constitution d’une chose ou d’un processus et à observer les conséquences.
23 Ibid., p. 155. 24 Ibid., p. 61.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 21
§ 6. — LA FORMATION CAUSALE DES ENTITÉS : LA CAUSE FINALE
Au 19ème siècle les vitalistes soutenaient que les objets inertes sont le domaine de la
cause efficiente et qu’à ce niveau la valeur explicative de la cause finale est nulle, tandis que
le comportement des êtres vivants serait incompréhensible et n’aurait pas de sens sans une
force vitale sui generis et sans finalité. Cette vision n’est pas celle de Whitehead car il affirme
le continuisme selon lequel la différence entre les êtres est de degré. Ils sont tous constitués
d’expériences, de sentirs, et tous manifestent une collaboration entre la cause efficiente et la
cause finale. Par contre les vitalistes réservent le domaine des forces vitales au monde animé
tout en abandonnant la strate des entités inertes au mécanisme atomiste et physiciste. Bien que
le vitalisme ne soit pas réductionniste, il contribue tout de même à maintenir la bifurcation
indésirable entre le physique et le mental parce que, d’après cette doctrine, la nature serait
scindée entre l’inanimé et le vivant. Le vitalisme est un compromis insatisfaisant car « le
fossé entre la matière vivante et la matière inerte est trop vague et problématique pour
supporter le poids d’une telle hypothèse arbitraire, impliquant quelque part un dualisme
essentiel. »25 Je partage volontiers ce continuisme, expression de la volonté de concevoir une
nature unique, ordonnée par une seule rationalité saisissable par une seule philosophie
naturelle.
La cause efficiente, nous l’avons vu, constitue la phase initiale de la concrescence, stade
pendant lequel la nouvelle entité assimile les propriétés et les contraintes des éléments qui
entrent dans sa composition. Toute entité, de la plus complexe et la plus sophistiquée à la plus
simple et la plus humble, expérimente un sentir causal qui va de l’absence de conscience
jusqu’à la pleine conscience. Bien que la cause finale corresponde aux phases supplémentaires
de la concrescence, c’est-à-dire celles de la production de nouveauté guidées par une finalité,
cela ne signifie nullement que la finalité soit absente chez les organismes inférieurs. Les
végétaux manifestent, eux aussi, à leur façon, un comportement orienté vers
l’autoconservation. La relation entre la cause efficiente et la cause finale est donc la relation
entre la phase initiale et la phase supplémentaire de la concrescence.
Le mode d’action de la cause finale est la façon dont le plan d’ensemble de l’organisme
conditionne le comportement des entités qui le composent (attendu que la notion de plan est
associée à la forme, ce serait plus juste de parler ici de forme-fin). D’après Whitehead,
rappelons-nous, les électrons suivent exclusivement les lois de la physique quand ils sont en
25 La Science et le Monde Moderne, op. cit., p. 79.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 22
dehors d’un corps vivant, mais à l’intérieur de celui-ci ils sont également conditionnés par la
strate biologique supérieure. Celle-ci intègre les électrons et les soumet à des nouvelles
contraintes. Sans ce conditionnement il devient impossible de comprendre le comportement
unifié de l’être vivant.
Sujet, satisfaction, super-jet et objet sont des notions indispensables à la formation d’une
entité actuelle permettant de comprendre le rôle de la cause finale. Pendant la formation d’une
entité, une multiplicité de données (d’entités) s’unifie dans un sentir intégré et complexe : ce
sentir est la satisfaction de l’entité actuelle et signifie que l’entité est complète, achevée. Cet
accomplissement est la cause finale, la raison d’être du processus à l’origine des préhensions.
Le sujet n’est pas une substance qui trouverait les entités qui le forment et qui réagirait ensuite
à leur présence comme on réagit à des choses externes. Le sujet est une entité en formation,
processus qui consiste à réunir une multiplicité de données en une unité. L’entité actuelle, en
tant que sujet, préside à sa propre immédiateté de devenir. En tant que super-jet elle est une
créature atomique qui exerce sa fonction d’immortalité objective. Une fois que l’entité est
complète, achevée, elle devient un objet, un être mort susceptible d’entrer dans la formation
d’autres entités, destin qui lui permet de perdurer. Toute finalité des entités est transitive : une
fois la fin atteinte, elle devient un moyen de constitution d’une nouvel être. La finalité est
présente, elle exerce son influence à toutes les étapes de la concrescence, depuis les premiers
sentirs jusqu’à ce que le sujet atteigne le stade d’objet pour une nouvelle concrescence.
§ 7. — LA STRATE DE L’EXTENSION PURE
Pour comprendre la hiérarchie naturelle whiteheadienne il faut décrire sa notion de
société. Pour toute la tradition atomiste — la philosophie de l’organisme en fait partie — tandis
que les composants ultimes sont des entités microscopiques, les entités macroscopiques sont
des composés, des groupes, ou, en langue whiteheadienne, des sociétés. Whitehead semble
avoir introduit le terme « société » pour souligner l’ordre qui existe entre les composants
d’une entité.26 Une société est plus qu’une classe d’entités à laquelle on applique un nom. Il
existe une condition plus stricte : le nom de la classe doit s’appliquer à chaque membre en
raison d’une dérivation génétique à partir d’autres membres de la même société. Il y a une
forme partagée par chaque entité composante de la société, et cette participation à la forme se
26 Process and Reality, op.cit., pp. 39-40.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 23
réalise par les préhensions des autres membres de la société. La dérivation génétique et la
participation à la forme expliquent que les membres d’une société se ressemblent entre eux.
L’une des intuitions principales de la cosmologie whiteheadienne est que rien n’existe
par soi-même, il n’y a pas d’être indépendant. Il s’agit d’une idée proche de l’ancienne
sympathie cosmique de Posidonios d’Apamée et qui traverse l’histoire de la pensée jusqu’à
une déclaration récente de Richard Feynman : « Il n’y a pas d’objet unique abandonné à son
propre sort dans l’univers. » Et l’éminent physicien continue sa réflexion dans le plus pur
esprit whiteheadien (ce qui étonne quand on sait qu’il s’est moqué de la métaphysique du
philosophe) : « Tout objet est un mélange de beaucoup de choses et, par conséquent, nous ne
pouvons le traiter que comme une série d’approximations et d’idéalisations […] ; y compris
les choses simples et idéalisées ne fonctionnent que parce qu’elles font partie de l’univers. »
Nous parlons des objets concrets, naturellement complexes, d’une façon abstraite, et
rappelons-nous que l’une des erreurs les plus courantes en science et en philosophie est de
confondre le concret et l’abstrait.
Maintenant que nous avons une idée de la complexité des entités qui peuplent le monde
et de la façon dont elles se forment, révisons, par ordre de généralité, les strates de la scala
naturæ selon Whitehead. La strate la plus profonde et la plus étendue est le continuum
extensif qui sous-tend le passé, le présent et le futur du monde.
Un continuum extensif est un complexe d’entités unies par les diverses relations conjointes entre tout et parties, par chevauchements définissant des parties communes, par contact et du fait d’autres relations dérivées de ces relations primaires. La notion d’un « continuum » contient à la fois la propriété de la divisibilité indéfinie et la propriété de l’étendue libre d’entraves… Ce continuum extensif exprime la solidarité de tous les points de vue possibles à travers l’ensemble du procès du monde. Ce n’est pas un fait antérieur au monde ; c’est la première détermination de l’ordre — c’est-à-dire de la potentialité réelle — surgissant du caractère général du monde… Ce continuum n’inclut ni formes, ni dimensions ni mesurabilité.27
La plupart des émergentistes distinguent seulement l‘inerte, le vivant et le conscient, c’est
pourquoi la description du continuum extensif et la fonction que Whitehead lui reconnaît est
l’un des traits les plus originaux de sa conception de la hiérarchie naturelle : le fond du réel
serait de nature topologique.
L’extension pure est la strate la plus compréhensive, celle qui assure l’unité finale aussi
bien de l’univers que nous observons pendant notre époque cosmique que de l’univers
d’autres époques susceptibles d’exister. Par exemple, à notre époque cosmique il existe une
27 Ibid., p. 82. Voir aussi Ibid., Part IV «The Theory of Extension ».
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 24
matière dotée de certaines propriétés électromagnétiques, mais on peut imaginer une époque
où il puisse exister une sorte d’antimatière avec des caractéristiques électromagnétiques
différentes. L’extension pure est abstraite : comparons-là à une topologie, au contenu d’une
théorie préalable à l’introduction de propriétés métriques, contenu qui exclut la possibilité de
la mesure. Dans l’extension pure la seule propriété discernable ou postulable est sa continuité,
sa connexion extensive. Probablement le mieux qu’on puisse faire est de la concevoir comme
l’origine de l’ordre de notre époque cosmique. Un autre point à retenir est que le continuum
extensif ne précède pas les autres strates chronologiquement, ne précède pas, évidemment,
l’existence des entités ultimes. Ce continuum, nous venons de le lire : « est un complexe
d’entités unies par les diverses relations conjointes entre tout et parties, par chevauchements
définissant des parties communes, par contact et du fait d’autres relations dérivées de ces relations
primaires. »
L’histoire de la pensée n’est pas exempte de cette façon de concevoir la base la plus
large de l’univers. L’idée selon laquelle finalement tout est constitué par un milieu continu
très abstrait fait penser immédiatement à la materia prima aristotélicienne, omniprésente,
inconnaissable selon Aristote parce qu’elle n’a pas de forme : c’est parce que les choses ont
une forme qu’elles sont connaissables. L’extension pure rappelle aussi, d’une certaine façon,
l’étendue cartésienne et l’espacetemps einsteinien, équivalentes au monde extérieur à l’esprit,
mais cette fois le monde-extension et le monde-espacetemps sont intelligibles car l’étendue et
l’espacetemps sont l’objet de la science de l’espace, la géométrie.
§ 8. — LA STRATE GÉOMÉTRIQUE
L’ordre de l’extension pure, duquel nous avons un aperçu précaire, est hérité par la
strate plus spécifique de la société géométrique. Depuis Descartes, l’arrière-plan de la
mécanique est la géométrie, mécanique qui est à toutes les époques le squelette métaphysique
de la science naturelle en général. Au 17ème siècle, comme on le sait, la seule géométrie
connue était la géométrie euclidienne et c’était donc elle l’arrière-plan mathématique de la
mécanique. Pendant les deux siècles qui ont suivi, les mathématiciens ont examiné des
problèmes dont la solution n’exige pas la mesure : c’est le début de la topologie. Si nous
allons du plus général au plus spécifique, alors à l’intérieur de la société géométrique on voit
naître au moins deux degrés émergents : la topologie et la géométrie eucilidienne. Rappelons
que chaque société peut contenir plusieurs sociétés simultanément. Tout comme en
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 25
construisant une maison on peut construire plusieurs chambres avec leurs ambiances
respectives, ainsi de l’extension pure émergent des géométries de différentes dimensions.28
À l’exception du continuum extensif il n’y a pas de société, de quelque statut que ce
soit, qui puisse s’abstraire des propriétés de la société géométrique qui la compose.
Remarquez donc que la continuité des entités actuelles et de la causalité trouve son fondement
dans la continuité de la société géométrique, héritée du continuum extensif. Il ne faut pas
imaginer que dans la philosophie du procès, précisément parce qu’on accorde beaucoup
d’importance à la progression de l’univers, à son caractère événementiel, temporel, les
caractéristiques géométriques des entités soient reléguées au second plan. Au contraire, on
trouve chez Whitehead plusieurs illustrations de la valeur du caractère géométrique des
événements.29
§ 9. — LA STRATE ÉLECTROMAGNÉTIQUE
« Notre présente époque cosmique est constituée d’une société « électromagnétique »,
plus particulière au sein de la société géométrique, et dans laquelle des caractères
déterminants encore plus particularisés ont cours. »30 En harmonie avec l’esprit de la science
pendant les premières décennies du 19ème siècle, l’idée est que le fond physique de l’univers
est d’essence électromagnétique. À ce niveau d’émergence il y a de nouvelles entités telles
que les électrons, les protons, les trains réguliers d’ondes, les atomes et les molécules. Ces
entités participent à de nouvelles relations émergentes avec les strates sous-jacentes et avec
leur environnement. À ce niveau d’émergence il y a quelques déterminations qui rendent
possible la mesure et l’expression quantitative des objets, de leurs propriétés et de leurs
comportements, des déterminations qui sont donc indispensables à la formation des lois
fonctionnelles quantitatives telles que nous les connaissons depuis le 17ème siècle.31
J’aimerais ajouter que ce niveau d’émergence est l’ancrage matériel de la géométrie
euclidienne.
Etant donné que, d’après Whitehead, il y a continuité entre l’inerte et le vivant, il est
impossible de tracer une frontière stricte au domaine d’application de la physique
mathématique. Il n’a pas considéré nécessaire l’inclusion d’une strate spécifiquement
28 Ibid., p. 116. 29 Voir, p. ex., The Concept of Nature, 1920, éd. Cambridge U. P., 1964, p. 187. 30 Process and Reality, op. cit., p. 116. 31 Ibid., p. 117.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 26
chimique entre le physique et le vivant, mais il a été sensible à d’autres aspects et disciplines
« de pont » entre le physique, le vivant et le psychique :
La « physiologie physique » s’occupe de l’appareil subordonné inorganique, et la « physiologie psychologique » cherche à s’occuper des nexus [sociétés] « intégralement vivants », aussi bien en faisant abstraction de l’appareil inorganique qu’en tenant compte des réponses de ces nexus à l’appareil inorganique, et de leurs réponses réciproques.32
§ 10. — LA STRATE VIVANTE
D’après Whitehead, nous ne connaissons pas d’être vivant sans son appareil inorganique
subordonné. Les nouveautés ne surgissent pas du néant mais ce sont de nouvelles synthèses
d’éléments préexistants. La génération du nouveau, cela a été rappelé, est le passage de la
multiplicité à l’unité. Un peu plus haut, au début de l’explication de la strate de l’extension
pure, j’ai décrit la notion de société. Maintenant, pour mieux comprendre l’émergence des
entités vivantes, il faut faire un détour par la société structurée, notion dont l’éclaircissement
aidera aussi à mieux comprendre la formation des entités déjà vues. Les êtres et les objets sont
des sociétés de sociétés. Une société est dite « structurée » quand le réseau qui la constitue
contient des sociétés hiérarchiquement structurées : il y a des sociétés principales tandis que
d’autres sont subordonnées. Une société structurée (par exemple, un cristal, un rocher, une
planète, une étoile) est plus ou moins complexe par rapport à la multiplicité de ses sous-
sociétés ainsi que par rapport au caractère plus ou moins compliqué de la configuration de sa
structure. Une société structurée est stable ou instable par rapport aux changements existants
dans la société la plus englobante de son environnement. La stabilité d’une société peut
dépendre ou non de certaines caractéristiques précises de la société qui la loge. Une société
structurée soumise à une telle dépendance est « spécialisée », tandis que la société « non
spécialisée » est celle qui jouit de cette indépendance. Il saute aux yeux qu’au point de vue de
la société subordonnée, la non spécialisation est une propriété souhaitable : elle lui permet
l’adoption de nouvelles fonctions afin de s’adapter au nouvel environnement, ce qui signifie
un gain de survie. C’est pourquoi « le problème consiste donc pour la Nature à produire des
sociétés à la fois « structurées » à haut niveau de « complexité », et « non spécialisées ». De la
sorte, l’intensité se combine à la survie. »33
32 Ibid., p. 122. 33 Ibid., p. 120.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 27
C’est dans la solution de ce problème qu’on trouve la différence — mais non la
démarcation stricte — entre l’inerte et le vivant. Whitehead envisage deux solutions et toutes
les deux valorisent le « pôle mental ». Contrairement à la métaphysique dualiste cartésienne
selon laquelle une substance est, ou bien physique, ou bien mentale, l’idée de Whitehead est
que toute entité actuelle possède un pôle physique et un pôle mental. Le pôle physique est la
partie ou aspect d’une entité constitutif de la phase initiale de sa concrescence et consiste en la
réception passive des composants qui viennent de l’extérieur de l’entité. Par contre le pôle
mental est la partie supérieure de la concrescence : le pôle mental permet à l’entité de
répondre au donné. Cet aspect est le côté subjectif de l’entité et signifie une certaine initiative
dans la détermination de sa propre constitution. Toutes les entités sont douées d’un pôle
mental, mais elles ne sont pas toutes conscientes. La présence de la conscience est un fait
exceptionnel : « La philosophie de l’organisme tient que la conscience n’apparaît qu’à un
stade tardif et dérivé d’intégrations complexes. »34
Il y a deux solutions au problème de produire des sociétés structurées non spécialisées
et, par conséquent, capables d’une longue survie. La première consiste, pour la société, dans
la mise à jour d’un degré élevé d’objectivation moyenne qui élimine les différences de détails
de la pluralité des membres de la société. On y observe une préférence pour l’uniformité. Ce
développement de la mentalité est caractéristique des corps dits « matériels », des entités qui
sont un degré inférieur de société structurée. L’autre façon de résoudre le problème de
produire des sociétés structurées non spécialisées produit les entités vivantes. Cette façon
s’obtient par une initiative dans les préhensions conceptuelles, c’est-à-dire, dans l’appétition.
L’appétition signifie une inquiétude concernant la réalisation de ce qui n’est pas mais peut
advenir. L’appétition principale est le désir de préservation ou de survie. Ce qui caractérise
cette deuxième voie est le vif intérêt que porte l’entité à la réception des nouveaux éléments
de l’environnement. On y voit le rôle actif de la subjectivité qui consiste à donner naissance à
une nouveauté qui soit à la hauteur de la nouveauté de l’environnement. Dans les sociétés
structurées les plus sophistiquées l’initiative consiste à penser les diverses expériences, tandis
que chez les organismes moins sophistiqués l’initiative est une adaptation sans pensée :
Conformément à cette théorie de la « vie », la signification première de la « vie » consiste à engendrer la nouveauté conceptuelle — l’innovation d’appétition… on n’appelle « vivante » une société qu’en un sens dérivé. Une « société vivante » est celle qui contient des « occasions vivantes ». Ainsi, le plus ou moins de « vie » d’une société est fonction de l’importance
34 Ibid., p. 187.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 28
respective en elle des occasions vivantes. Aussi, une occasion peut avoir plus ou moins de vie en fonction de l’importance relative des facteurs de nouveauté dans sa satisfaction finale.35
Tandis que les sociétés dites « matérielles » n’ont pas besoin de la protection d’une
société vivante pour exister, cette dernière, par contre (pensez à la cellule), a besoin des
électrons, des atomes, etc. La vie, moins indépendante et moins robuste que les choses dites
« matérielles », est une propriété d’un ensemble d’entités : le passage d’un ordre physique
plus ou moins strict à une certaine originalité dans la réaction face aux caractéristiques de
l’environnement.
Tout être essaie d’intensifier son expérience, ce qui présuppose, apparemment, que son
comportement n’est pas rigoureusement déterminé par son passé, par les causes matérielles et
efficientes. Il s’ensuit que la vie serait inexplicable sans la participation de la cause finale.
D’après Whitehead, la participation de cette cause se situe dans un espace vide, dans les
interstices de chaque cellule, dans les interstices du cerveau. La cause finale n’agit pas dans
les espaces occupés par les entités corpusculaires. Whitehead ne le dit pas, mais cette dernière
observation suggère que la vie serait comme une sorte de fluide qui court dans le corps de
certaines entités. Dans son action, qui est une aventure originale, la structure vivante se
déstabilise mais récupère ensuite la stabilité, se répare notamment en s’alimentant. Mais voici
une observation critique concernant la clarté de ce que Whitehead veut dire : que faut-il
entendre ici précisément par « interstice » ou « espace vide » ? L’idée de vide absolu répugne
à la raison. Parlons donc de vide relatif, comme quand on dit « le réservoir est vide d’eau »
(mais il contient de l’air). Qu’y a-t-il donc d’absent et de présent dans ces interstices ? Et de
quelle façon le fluide qui se déplace à travers eux pourrait-il être le responsable de
l’originalité, de la créativité de la vie et de la liberté ? On ne comprend pas comment ces
interstices ou espaces relativement vides, s’ils existent, échappent au déterminisme causal
universel.
Retenons ces deux points : (I) La vie est associée à la nouveauté, aux efforts d’une entité
en vue de s’adapter aux nouveautés présentées par un environnement en évolution. Dans la
mesure où une entité est vivante, dans cette mesure le passé de la structure, l’influence de la
cause efficiente, a une importance inférieure à celle de la sensibilité au présent subjectivement
déterminée en fonction d’une cause finale. D’autre part, le non vivant est à associer au
répétitif, à l’uniforme, à l’élimination de la diversité des détails de l’environnement. (II) Il n’y
a pas de frontière stricte entre le vivant et le non vivant : le vivant ne jouit pas
35 Ibid., pp. 121-122.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 29
d’indépendance en relation au « matériel » ; il présuppose, précisément, un passé massif et
chargé d’entités plus ou moins vivantes ou plus ou moins inertes.
§ 11. — LA STRATE CONSCIENTE
Whitehead est d’avis que le dualisme métaphysique du corps et de l’esprit initié à
l’époque moderne par Descartes est une erreur dont la correction est l’un des objectifs de la
cosmologie organiciste. Imaginer que chaque personne est composée d’un corps et d’un esprit
c’est faire sien un sophisme responsable de maintes confusions, à savoir, « l’erreur du concret
mal placé ». Ce sophisme consiste à confondre abstrait et concret.36 Corps et esprit sont des
notions abstraites, il faut essayer de voir les processus sous-jacents qu’elles recouvrent.
Considérer que corps et esprit sont deux êtres différents génère des problèmes mal posés
comme celui de la relation causale entre eux, celui de savoir comment le corps matériel
étendu et l’esprit sans extension peuvent interagir. De plus, si, selon Descartes, une substance
n’a besoin de rien d’autre pour exister, qu’est-ce qui empêche que tout soit purement physique
ou purement mental ? Spinoza, ayant compris les absurdités du dualisme, élabora une
métaphysique moniste : il y a une seule substance. Et si le corps et l’esprit interagissent, alors
ils partagent le même espace et le même temps, c’est-à-dire, le même monde : c’est le
raisonnement à la base du monisme de William James.
Rappelons que tout a un pôle physique et un pôle mental. La mentalité des animaux
supérieurs et de l’homme signifie un degré élevé de l’action du pôle mental. Un animal, un
homme, est une pluralité d’entités, de centres de vie. Ainsi, ce qu’on doit expliquer, c’est
l’unité dans la multiplicité, la façon dont l’organisme contrôle et unifie. Grâce à ce contrôle,
nous avons conscience d’une expérience subjective unifiée et d’un comportement objectif
unifié. « La conscience concerne la forme subjective d’un sentir… La conscience est ce qui
émerge dans quelques processus de synthèse d’opérations physiques et mentales… dans
l’analyse de tout sentir conscient, on doit trouver des sentirs physiques à titre de composants,
et inversement, partout où il y a conscience, se trouve un composant du fonctionnement
conceptuel. Car l’élément abstrait au sein du fait concret est précisément ce qui suscite notre
conscience.37
36 Science and the Modern World, op. cit., pp. 51, 55. 37 Process and Reality, op. cit., pp. 282-283.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 30
Descartes, Locke, Hume, Kant et bien d’autres se sont trompés en pensant que
l’expérience présuppose la conscience. Au contraire, la conscience émerge de l’expérience, du
caractère centralisé et du contrôle exercé sur les très nombreux centres de vie. La philosophie
de l’organisme place la conscience dans une position ontologique subordonnée. La conscience
est un événement rare, « la couronne de l’expérience », non pas sa base nécessaire. D’un point
de vue émergentiste il importe de signaler que la conscience illumine, de façon directe,
seulement la constitution ou l’état de la strate de l’organisme qui lui donne naissance. Le
domaine éclairé par la conscience est très réduit, sans commune mesure, avec les zones de
l’expérience qui restent dans l’obscurité. La conscience n’accède aux phases antérieures
qu’indirectement, et ce dans la mesure où elles participent à la constitution des phases plus
élevées, proches de son émergence. « Qui dit conscience dit élément de remémoration. La
conscience rappelle des phases antérieures en les faisant sortir des recoins obscurs de
l’inconscient. »38
Ceci donne un aperçu de la profondeur métaphysique de la nature et permet de
comprendre le lien manifeste entre la philosophie de l’organisme et quelques thèses centrales
du réalisme métaphysique et du naturalisme émergentiste. Reconnaissons, contre l’idéalisme
sous-jacent à la philosophie moderne, que l’ordre épistémologique dans lequel les choses
apparaissent à la conscience avec clarté et distinction n’est pas l’ordre de la priorité
ontologique. « La philosophie de l’organisme est l’inversion de la philosophie kantienne…
Pour Kant, le monde émerge du sujet ; pour la philosophie de l’organisme, le sujet émerge du
monde. »39
Chez un organisme suffisamment complexe, le passage des relations (préhensions ou
sentirs) à la conscience est constitué par une opération de sélection entre les données
susceptibles de continuer la formation de l’entité. Ainsi quelques données, si elles sont
pertinentes à la réalisation des fins de l’entité, sont reçues, tandis que les autres sont laissées
de côté. La conscience est la forme subjective qui se construit en contrastant l’affirmation et
la négation. La conscience est un aspect de certaines perceptions, de certains jugements et de
certaines déterminations. La perception consciente est la forme de jugement la plus primitive.
La conscience atteint sa maturité dans la négation (quand je dis, par exemple, « mon cartable
n’est pas noir »). La conscience nécessite le contraste entre ce qui est et ce qui n’est pas ;
entre ce qui est et ce qui pourrait ou devrait être ; entre le fait avéré et l’hypothétique. « La
perception négative est le triomphe de la conscience, et atteint son point culminant dans la
38 Ibid., p. 283. 39 Ibid., p. 106.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 31
libre imagination, là où les nouveautés conceptuelles quadrillent un univers où elles ne sont
pas données en présence. »40 Finalement, on trouve dans la philosophie de l’organisme une
réponse à la question sur la valeur de la conscience : lutter contre la subjectivité de
l’organisme. La conscience rend possible la représentation intérieure du monde et la réflexion
sur cette représentation. L’homme peut ainsi se transcender et devenir une perspective sur le
réel en soi.
Ces idées sur la conscience forcent l’adhésion et sont assez originales. Par contre il est
impossible d’être d’accord avec Whitehead quand il affirme que l’activité mentale n’est pas
spatiale : « bien que le mental ne soit pas spatial, il est toujours une réaction à une expérience
physique, spatiale, et assimilation de cette expérience. »41 Ou bien il faudrait peut-être
introduire des distinctions concernant les modes sous lesquels les choses peuvent être
qualifiées ou non de spatiales. Par exemple, peut-on imaginer une façon absolue et une façon
relative de ne pas être spatial ? Quoi qu’il en soit, si nous prenons « espace » dans son sens
usuel, on ne comprend pas comment quelque chose de non spatial peut réagir à quelque chose
de spatial sans partager le même espace ; on ne comprend pas comment la conscience non
spatiale peut assimiler quelque chose de physique qui, lui, est spatial. Tout ce qui existe est
spatial et l’idée selon laquelle la vie mentale serait une exception est irrationnelle.
Mais alors, dira-t-on, quel espace occupe la conscience ? quelle est son extension ?
combien mesure-t-elle ? On sait que la nature de la conscience est la majeure source
d’énigmes — le problème ne semble pas être scientifique, décidable. J’ai eu, en effet,
l’occasion d’affirmer que nous n’avons pas les concepts appropriés pour expliquer la
conscience. Cela dit, je ne vois pas comment on pourrait rationnellement nier que la
conscience émerge, d’une façon ou d’une autre, de la complexité des fonctionnements du
cerveau, bien que nous ne sachions pas comment cela arrive. Il est donc raisonnable de penser
que la conscience est spatiale au moins dans le sens où le cerveau et son activité le sont.
CONCLUSION
La cosmologie whiteheadienne comporte des éléments importants en vue de
l’explication causale de la hiérarchie naturelle. En voici les idées principales attribuables à la
philosophie de l’organisme. Parfois j’interprète. Je ne veux pas dire que Whitehead les ait
40 Ibid., p. 187. 41 Ibid., p. 128.
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 32
énoncées telles quelles : (I) La nature est susceptible de recevoir une explication unitaire. Cela
implique la croyance à un universalisme (contre le relativisme et le scepticisme). (II) La
nature est ordonnée et l’ordre est partiellement saisi parce que nous en faisons partie — c’est
un réalisme partiel ou perspectivisme. (III) Ce qui existe est soit une entité actuelle soit un
composé d’entités actuelles qui sont des entités ultimes toutes d’un même genre — atomisme
moniste. (IV) L’univers est solidaire — je spécifierai : causalement solidaire — car toute entité
a une valeur pour toute autre entité, d’une façon ou d’une autre, dans une mesure plus ou
moins grande. (V) Le processus de formation des entités est une collaboration entre causes
efficientes et causes finales. (VI) La sensibilité des entités leur confère une plasticité qui leur
permet d’être régies par des lois d’ordres différents. (VII) Dans la nature il y a continuité car
rien ne sort de rien, et discontinuité : par exemple, toute entité ne se comporte pas comme une
cellule ou comme un être conscient.
En plus de ces idées qu’il serait sensé de retenir, il y a des points de désaccord. Ils sont
la conséquence de ma recherche d’une explication causale intégralement naturaliste de la
hiérachie des êtres et des strates. Il est possible que Whitehead se soit fixé, lui aussi, ce même
objectif. Si c’était le cas, alors nos conceptions de ce qu’est un naturalisme intégral diffèrent.
En voici trois points importants de la philosophie de l’organisme qui signifient, d’après mon
point de vue, un recul du naturalisme : (I) Pour Whitehead le monde est incomplet et a donc
besoin d’un complément, Dieu. Or cette entité multiforme n’est pas naturelle au moins dans le
sens où une de ses faces est illimitée, infinie, libre, complète et éternelle. Il est à remarquer,
primo, que ces concepts sont négatifs, dépourvus de contenu intelligible, raison pour laquelle
ils devraient, si possible, être remplacés par d’autres notions à contenu positif et davantage à
notre portée. Secundo, tout aussi incompréhensible est l’affirmation whiteheadienne selon
laquelle le monde serait ontologiquement incomplet. Il n’est pas exclu que ce philosophe ne
confonde ici notre connaissance du monde avec le monde. Je dirais qu’ontologiquement rien
ne manque à la nature, qu’elle est ce que Spinoza dit de la vérité, sa propre norme.42 Par
contre, il y a beaucoup de vides dans notre représentation du monde. (II) D’une façon
analogue à ce qu’il dit sur la divinité, il semble à Whitehead que les atomes, i.e. les entités
actuelles, ne suffisent pas à rendre compte de la formation des êtres et il postule, en
conséquence, les objets éternels. Je maintiens que les objets éternels ne sont pas naturels parce
42 « De même que la lumière fait paraître elle-même et les ténèbres, de même la vérité est sa propre norme et celle du faux ».
Une explication causale de la hiérarchie naturelle 33
qu’ils n’évoluent pas : d’après la philosophie de l’organisme il ne peut y avoir émergence de
nouveaux objets éternels, ce qui est contradictoire au sein d’une doctrine influencée par
Bergson, si sensible à la créativité et au temps. (III) Il arrive que les idées de Whitehead sur
l’indétermination et sur la liberté, que ce soit dans la nature en général ou chez l’homme, ne
soient pas claires dans le sens où on ne sait pas quel est leur degré d’indétermination et par
rapport à quelles contraintes. En tout cas la philosophie de l’organisme n’est pas un
déterminisme causal universel. Quoi qu’il en soit, tout vide absolu de déterminisme causal ne
peut être naturel : il est, par les définitions mêmes de la description, de la connaissance et de
la preuve, ineffable, inconnaissable et indémontrable.
* * *
Related Documents