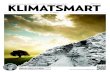Monsieur Jean-Pierre Dupuy Monsieur François Gérin Société industrielle et durabilité des biens de consommation In: Revue économique. Volume 26, n°3, 1975. pp. 410-446. Citer ce document / Cite this document : Dupuy Jean-Pierre, Gérin François. Société industrielle et durabilité des biens de consommation. In: Revue économique. Volume 26, n°3, 1975. pp. 410-446. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1975_num_26_3_408212

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Monsieur Jean-Pierre DupuyMonsieur François Gérin
Société industrielle et durabilité des biens de consommationIn: Revue économique. Volume 26, n°3, 1975. pp. 410-446.
Citer ce document / Cite this document :
Dupuy Jean-Pierre, Gérin François. Société industrielle et durabilité des biens de consommation. In: Revue économique.Volume 26, n°3, 1975. pp. 410-446.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/reco_0035-2764_1975_num_26_3_408212
AbstractIndustrial society and the durability of consumer goods
The reduction in the durability of consumer goods appears to be both a necessary condition for thereproduction of our economic system and a major source of the notorious malaise in industrial societies: amidst its unfortunate consequences fall inflation, pollution and disfigurement of the naturalenvironment through massive production of waste, impairment of the symbolic qualify of oursurroundings, etc. It is shown that this phenomenon is nor the reflection of an alleged general taste forchange ― which would be a miracle since, it coincides with the "necessities" of economic development― neither the price paid by the consumer to satisfy the manufacturer's appetite for profit ; but the by-product of a culture, just like scarcity, inequality, constant frustration, the breakdown of man's traditionalcommunion with his environment.The concept of psychological obsolescence is central in the analysis which is developed here. It givesrise to paradoxical or perverse mechanisms in the realm of consumption as well as production, whichare an affront to common sense.The paper comprises a main text of general import, interspersed with illustrations relating to two specificcases : the motor car and drugs.
RésuméLa réduction de la longévité des biens de consommation apparaît tout à la fois comme une conditionnécessaire à la reproduction de notre système économique et comme une source majeure du fameuxmalaise des sociétés industrielles : parmi ses conséquences néfastes, il faut classer l'inflation, lapollution et l'enlaidissement du milieu naturel par production massive de déchets, les rythmes fratricidespesant en particulier sur la sécurité de l'emploi, la dégradation de la qualité symbolique du cadre de vie,etc.On montre que ce phénomène n'est ni la traduction d'un prétendu goût général pour le changement,goût miraculeux puisqu'il irait dans le même sens que les « nécessités » du développementéconomique ; ni le prix payé par les consom-mateurs pour que l'appétit de profit des producteurs puissetrouver de quoi se satisfaire ; mais le sous-produit d'une culture, au même titre que la rareté, lesinégalités, les frustrations sans cesse renouvelées. Le concept d'obsolescence psychologique estcentral à l'analyse proposée. Sur lui se greffent des mécanismes dans le domaine de la consommationcomme dans celui de la production qui défient les évidences du sens commun.L'article comprend un texte principal de portée générale, dans lequel on a intercalé des illustrations quiconcernent deux cas précis : l'automobile et le médicament.
ûti
SOCIETE INDUSTRIELLE
ET DURABILITE
DES BIENS DE CONSOMMATION
L'article ci-dessous comprend un texte principal de portée générale, dans lequel on a intercalé des illustrations qui concernent deux cas précis : l'automobile et le médicament. A eux seuls, ces deux cas couvrent un large pan de la réalité. On a en effet affaire à un bien durable et à un bien fongible ; à un symbole de la société de consommation, de ses excès et de ses futilités, et à un de ses produits apparement les plus estimables ; à un bien choisi directement par le consommateur et à un bien prescrit par un professionnel.
Les développements sur le médicament sont inspirés d'un livre qui est paru aux éditions du Seuil en octobre 1974 (J.~P. Dupuy et S. Karsenty, L'invasion pharmaceutique). Ceux qui concernent l'automobile sont tirés d'une étude menée par F. Gerin au sein du CEREBE (Centre de Recherche sur le Bien-Etre).
INTRODUCTION
La réduction de la longévité des biens de consommation est sans doute l'un des phénomènes les plus éclairants qui soient pour ouvrir le procès des sociétés industrielles. C'est une caractéristique qui semble intimement associée au niveau de développement de ces sociétés. C'est un des facteurs les plus efficaces de ce que l'on appelle la détérioration de la qualité de la vie.
Quand nous parlons de diminution de la durabilité des biens de consommation, cette expression recouvre deux réalités distinctes, bien que, semble-t-il, très étroitement liées. Il y a d'une part le fait que la durée de vie des biens de consommation dits « durables » (c'est-à-dire des biens qui ne sont pas détruits par le premier usage) tend à se raccourcir. Il y a d'autre part que la présence sur le
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 411
marché de chaque modèle ou type de bien, qu'il s'agisse d'un bien durable ou d'un bien fongible, tend également à diminuer1.
Une étude suédoise portant sur des produits de grande consommation (alimentation, produits capillaires, d'hygiène, d'entretien) a montré que sur 1 000 articles existant sur le marché en 1950, 470 seulement survivaient en 1955 et qu'il n'en restait que 300 en I9602. Ce renouvellement incessant des biens et services mis à la disposition des consommateurs est d'observation courante dans tous les pays uns ueveiuppes. n luuuh; luuà les secieuib uc m vie ceuinjum^uc et sociale, s'étend à tous les types de biens, les plus quotidiens et les plus banals comme les plus « sérieux » et les plus sophistiqués. Il ne doit donc pas être assimilé purement et simplement au phénomène « gadget ».
Il déborde d'ailleurs le domaine de la simple consommation, s'étend aux biens d'équipement industriel et même aux idées, à l'art, à la production culturelle et intellectuelle.
La pharmacopée française comprend 3 500 produits, sous 1 1 000 présentations différentes. Le renouvellement de cette pharmacopée se fait en quatorze ans environ, 250 produits en moyenne étant mis chaque année sur le marché et en chassant un nombre sensiblement équivalent. 70% des médicaments aujourd'hui commercialisés ont moins de quinze ans, et presque la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie est réalisée avec des produits de moins de cinq ans.
Tout le monde semble d'accord pour reconnaître qu'il s'agit là d'une manifestation de la vitalité de l'industrie pharmaceutique. Il faut sans doute beaucoup de lucidité ou d'innocence pour s'écrier comme le professeur Jean-Marie Pelt : « Si par hasard... vous aviez l'intention d'acheter dans une librairie parisienne le prix Goncourt de 1962, vous ne le trouveriez pas, car le prix Goncourt de 1962 a disparu. Ce qui conduit à se poser la question suivante : est-ce que ce prix Goncourt était un navet ? Et alors le jury Goncourt a eu tort de donner le prix à ce livre. Ou est-ce que, au contraire, c'était un bon livre ? Et alors le libraire et l'éditeur ont tort de ne pas l'avoir dans leur magasin. Il en est un peu du médicament comme de ce livre. Les médicaments naissent et meurent à une cadence toujours plus rapide et pour ma part, moi qui suit un apôtre du médicament, je suis toujours stupéfait lorsque les industriels croient trouver un argument publicitaire puissant en disant
1. Ces notions mériteraient d'être affinées dans le cadre de monographies portant sur des cas spécifiques. Ainsi, il faudrait distinguer, à propos des biens durables faisant l'objet d'un marché d'occasion, la durée de vie pour le premier acheteur et la durée de vie globale, du premier achat à la mise au rebut. Pour ce qui est de la longévité d'un modèle sur le marché, il faudrait préciser le degré de changement au-delà duquel on considère que l'on n'a plus affaire au même modèle.
2. Cité par R. Leduc, Comment lancée un produit nouveau, Dunod.
412 REVUE ECONOMIQUE
que les 9/ 10e des médicaments utilisés aujourd'hui n'existaient pas il y a dix ans. Si l'on appliquait ce raisonnement aux aliments, nous serions tous conduits à manger des racines et à abandonner les oranges, bananes, pommes et raisins alors que ces aliments sont fort efficaces... » 3.
Les objets changent de nature. Les produits agricoles qu'autrefois on trouvait dans leur état naturel et en vrac dans les magasins (beurre en motte, lait au litre, café au poids, etc.) ont été remplacés par des produits industriels dans lesquels la part du conditionnement, de l'emballage, de la marque, de la présentation devient prépondérante. Certains experts estiment que dans quelques années, le prix des produits alimentaires sera composé de 5 % de matière première et de 95 % de conditionnement, de frais de transport et de frais généraux. Ce changement de nature permet le renouvellement du produit. Ainsi l'anchois à l'huile remplace l'anchois au sel et est lui-même remplacé par l'anchois roulé. Dans d'autres cas, c'est non pas une sophistication mais une simplification du produit qui favorise le changement. Les objets « à jeter » font irruption dans notre vie quotidienne — stylos à bille, briquets, conditionnement en plastique des bouteilles d'eau minérale, nappes, serviettes, mouchoirs en papier, vaisselle en carton, filtres des cafetières, etc. - — mais aussi à l'hôpital.
De façon générale, face aux innovations incessantes, les biens dits « durables » le sont de moins en moins. Des statistiques allemandes montrent que les meubles ordinaires de fabrication moderne sont renouvelés par une famille tous les dix ans. Les montres qu'autrefois on gardait toute une vie sont détrônées par les montres à bon marché, changées selon l'usage et faites pour durer quelques mois. Le costume masculin qui durait jadis une dizaine d'années est de nos jours changé tous les deux ans. La longévité des constructions habitables reste encore élevée en France, mais commence à être mise en question. Pour certains architectes, encouragés parfois par les pouvoirs publics, la vérité de demain est dans la maison construite pour quinze ans, dont on change comme de voiture. Structures mobiles, variables, démontables, souplesse des infrastructures d'une façon générale, voilà ce qu'on nous promet et qui sans doute nous attend.
Ainsi dans le cas de l'automobile en France, autant que les statistiques de l'INSEE permettent de l'appréhender, la longévité globale est passée
3. Déclaration au Premier Congrès du Club européen de la santé, les 20, 21 et 22 janvier 1972.
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 413
de quatorze ans 4 en 1 962 à dix ans et huit mois actuellement ; selon les tendances imaginées avant la crise récente par les constructeurs, cette évolution devrait se stabiliser pour atteindre dix ans et deux mois vers 1980. Pour ce qui est de la durée de possession du véhicule par son premier acheteur, M. Villeneuve constate à l'aide de deux méthodes de calcul convergentes 5 qu'elle est stable à moyen terme autour d'une valeur moyenne de cinq ans pour les voitures acquises une année donnée (1967). Il en va de même pour les véhicules achetés d'occasion.
Parallèlement, sans que le sens de la causalité, si causalité il J résistants. Ils s'usent plus rapidement. Ils ne sont plus conçus pour durer. En France, des associations de consommateurs se plaignent que bougies de moteurs, pneus, lames de rasoir, réfrigérateurs, vêtements, bas, chaussures, etc., soient de qualité de plus en plus médiocre et aient une durée de vie technique de plus en plus courte. Mais de façon concomitante, on note qu'un certain « bon usage » des produits par les consommateurs se perd. Leur choix et leur achat se font dans des conditions d'information le plus souvent médiocres. Leur entretien est réduit au minimum, ce qui accélère leur usure.
D'un point de vue purement descriptif, deux éléments principaux concourent à une usure prématurée des automobiles.
Le premier se situe chez les constructeurs : il s'agit pour eux de maintenir l'aspect extérieur des véhicules tout en faisant des économies de matière ou de valeur ajoutée. Ceci permet de réduire les coûts de fabrication, préoccupation constante d'une industrie dont le marché populaire est hypersensible aux prix de vente 6. Ainsi réduit-on l'épaisseur des tôles au strict minimum compatible avec un emboutissage sans criques et des essais de contraintes vibratoires corrects sur l'équivalent de quelques dizaines de milliers de kilomètres. Ainsi remplace-t-on un bourrelet caoutchouté de pare-chocs par une bande de matière plastique sans épaisseur, donc sans utilité pratique, mais en rappelant l'aspect. La nécessité de calculer au plus juste amène à quantifier la qualité. Ce souci, qui était autrefois absent (on fabriquait avant tout des organes robustes et peu sophistiqués), pose des problèmes difficiles d'homogénéité des longévités des différentes parties du véhicule, compte tenu d'utilisations très diverses. Aussi, n'est-il pas étonnant, malgré une fiabilité générale accrue, de trouver des usures prématurées importantes : moteur, caisse, aménagements intérieurs en matériaux plastiques par exemple.
Le deuxième élément est causé par les utilisateurs, sans qu'ils en soient totalement responsables : l'état général d'ignorance dans lequel
4. Ce chiffre assez élevé est en partie expliqué par la présence encore importante de véhicules d'avant-guerre, dont la guerre avait suspendu l'utilisation.
5. Enquête transports 1967, les Collections de l'INSEE, M 15/1972, pp. 68 à 70. 6. MM. Nicolon et Chanaron, « L'innovation dans la construction des matér
iels de transport terrestre », IREP/IPEPS, tome I, p. 68.
414 REVUE ECONOMIQUE
les maintient un enseignement où la connaissance de la technique reste faible et peut-être aussi une certaine désaffection vis-à-vis de leur automobile les conduisent à négliger son entretien courant (vérification des niveaux par exemple) et à conduire d'une façon heurtée, surtout dans les villes. De plus, la confusion fréquente, autrefois possible, entre vitesse de croisière et vitesse de pointe a pu accélérer considérablement l'usure des moteurs lors de la conduite sur autoroute. La complexité grandissante des opérations d'entretien, qui nécessitent de plus en plus un outillage spécialisé coûteux, achève enfin de les détourner de l'entretien.
La réduction de la longévité des biens est un phénomène profond des sociétés industrielles. Plus ces sociétés sont développées, plus ce phénomène est marqué. On ne doit pas s'en étonner. Lorsqu'on est proche de la saturation du marché d'un bien de consommation durable, le gros de la production sert à satisfaire la demande de renouvellement. Son volume est ainsi inversement proportionnel à la durée de vie du produit. Une des raisons pour lesquelles ce que craignaient un certain nombre d'économistes, comme Adam Smith ou Ricardo, à savoir la disparition des occasions d'investir et l'apparition de l'état stationnaire, ne s'est pas produit, est donc justement la diminution de la durabilité des biens 7.
Dans le cas de l'automobile en France, on est passé durant les années « soixante » d'une structure où l'essentiel des immatriculations allait à l'accroissement du parc, à une structure où près des deux tiers vont à son . renouvellement. Les chiffres ci-dessous, fondés sur des estimations de la Chambre syndicale des constructeurs automobiles, le prouvent bien :
Année Immatriculations/ Accroissement/ Renouvellement/ parc % parc % parc %
1961 12,0 9,0 3,0 1965 11,8 7,7 4,1 1969 11,5 5,5 6,0 1973 12,0 4,8 72
N.B. — Seules des estimations sont possibles, le fichier des cartes grises étant inapte à prendre en compte les mises au rebut, car les possesseurs se défaisant d'un véhicule ne rendent pas tous sa carte grise à la Préfecture du département considéré.
Le rôle de la longévité des véhicules est donc de plus en plus déterminant dans le volume de production du secteur automobile ; rappelons
7. Chamberlin écrit dans « Product as an Economie Variable », Quaterly Journal of Economies, feb. 1953 : « The subject of durability is evidently (or should be) closely linked to keynesian economics, since aggregate demand may fall off and unemployment result if products last too long ».
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 415
que dans le cas d'un parc sans expansion, au bout de quelques renouvellements, le pourcentage de renouvellement est l'inverse de la longévité moyenne, exprimée en années. Dans la réalité exposée ci-dessus, le problème est beaucoup plus compliqué. On démontre s que l'inverse de la moyenne harmonique des longévités est égal à la somme du taux de renouvellement et de la moitié du taux d'accroissement. Si donc par exemple la longévité doublait (pour passer à vingt ans), la production pourrait presque diminuer de moitié, si l'accroissement continuait de régresser comme jusqu'à maintenant — ce qui est plausible, compte tenu de la saturation progressive que nous avons notée ci-dessus.
Uans notre système économique, i innovation, qui est bien ie contraire de la durabilité, est donc un moteur de l'expansion et une condition du maintien du plein emploi. D'où l'intérêt que les gestion- naines de l'économie lui portent : témoin, la campagne nationale qui a été organisée en France en 1971 pour en chanter les louanges et mettre de l'huile dans les rouages, alors que les mécanismes qui l'engendrent paraissaient grippés. Mais il y a plus. De condition, de simple moyen, l'innovation est passée, dans notre système de valeurs, au rang de finalité. Le neuf est devenu synonyme de meilleur, l'innovation de progrès. Le dynamisme d'un homme, d'une entreprise, d'un pays se mesure à la jeunesse des produits qu'il possède ou qu'il produit. Celui qui oserait mettre cela en question serait traité de dangereux passéiste.
Et pourtant ! La liste des maux, des nuisances, des inégalités que l'on peut imputer au compte de la réduction de la longévité des biens et de l'innovation, sous les formes que nous connaissons, est impressionnante.
On peut commencer par l'inflation, fléau majeur de notre société. Comme certains des exemples déjà cités l'ont suggéré, les innovations qui provoquent le remplacement d'anciens produits par des nouveaux, sont loin de toutes apporter des progrès décisifs dans la satisfaction des besoins auxquels sont censés répondre ces produits. C'est évident pour les articles d'usage courant, que des sophistications plus ou moins arbitraires permettent de renouveler sans cesse : enrichissement de l'acier des lames de rasoir, additifs divers mis dans les huiles de voitures, passage du bois au plastique pour la télévision, décoration fleurie de poubelles, incorporation d'un réchauffeur pour le beurre dans les réfrigérateurs, modification de la forme des rasoirs électriques, etc., etc. Mais cette « gadgétisation » du changement affecte aussi les produits « sérieux », comme les médicaments et les automobiles.
8. Enquête Transports 1967, les Collections de l'INSEE, M 15/1972, p. 80.
416 REVUE ECONOMIQUE
Tous les « nouveaux » médicaments mis sur le marché n'apportent pas des progrès équivalents, puisqu'on recouvre sous ce vocable aussi bien la découverte scientifique originale qui enrichit la thérapeutique d'une nouvelle classe de molécules actives que le médicament déjà existant dont on aura modifié le dosage, la forme pharmaceutique, le modèle de conditionnement, les indications, ... ou tout simplement le nom. Or, il semble bien que la très grande majorité des quelque 250 produits nouveaux qui sont chaque année mis sur le marché et qui se substituent à des produits moins coûteux, se situent sur les plus bas barreaux de l'échelle que l'on peut dresser en guise d'indicateur d'innovation. Que l'on en juge d'après des chiffres américains, la situation française ayant toutes raisons d'être très voisine. Aux Etats-Unis, de 1948 à 1966, 7 563 présentations ont été lancées sur le marché (soit en moyenne 420 par an), qui se répartissent en 1785 nouvelles formes galéniques de produits déjà lancés et 5 778 nouveaux produits. Ceux-ci se décomposent eux- mêmes en 676 nouvelles substances thérapeutiques, 3 757 associations de substances déjà connues et 1 345 produits lancés par un nouveau fabricant et identiques à un produit déjà lancé. Encore faut-il ajouter que sur ces 676 nouvelles substances, plus de la moitié d'entre elles n'étaient que de nouveaux sels ou dérivés d'une molécule déjà connue. En définitive, moins de 5 % des nouveaux médicaments lancés aux Etats-Unis sur cette période de dix-huit ans constituaient véritablement des innovations majeures.
Dans le cas de l'automobile, en ce qui concerne la technique du véhicule, on vit pratiquement sur un acquis assez ancien ; seuls quelques
Innovation Invention et prototypes
Premières applications industrielles
Extension progressive ou adoption généralisée
Traction avant
Frein à disque
Transmission automatique
Verre feuilleté
Suspension
pneumatique Plastique
J.-A. Grégoire, 1925
Ferdinand Porsche sur char Tigre, 1942.
Jaguar type « Le Mans », 1952
Revignot et Pleishel, 1930 environ
E. Bénédictus, 1909
J.-A. Grégoire, 1950
Chimie organique, années « quarante »
« Traction avant » Citroën 1934
Citroën DS 1955
Aux U.S.A. dès 1945
U.S.A., pays nordiques,
années « soixante », sur réglementation
« Traction 15 six H » Citroën 1953
Citroën DS (Pavillon), 1955
Renault, Morris, Peugeot, Simca, années « soixante » ; Volkswagen, Audi, années « soixante-dix » Renault, Peugeot, Simca, etc., années « soixante »
En Europe, 7 % des véhicules en sont actuellement équipés Europe ? Option ou installation sur modèles de luxe
Citroën, puis Rolls-Royce et Morris, années « soixante » Renault 5, Citroën SM, Matra, années « soixante- dix »
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 417
progrès améliorent-ils la fiabilité lors de son utilisation, ou la productivité de sa fabrication.
Ainsi les premiers moteurs à arbres à came en tête datent-ils de 1914, lorsqu'ils furent montés sur des motos Peugeot, conçus par l'ingénieur Henry en 1913 et Antonesco en 1922.
Le tableau ci-dessus permet de voir les délais s'écoulant en Europe entre invention d'une technique de portée universelle, premières applications industrielles, extension progressive, ou adoption généralisée. Il permet de se rendre compte que le « risque » industriel se situe au deuxième niveau et que l'industrie, à l'heure actuelle, préfère rester au troisième, sans chercher et développer trop d innovations coûteuses et risquées. Le seul avantage que prennent les « pionniers » est celui de l'expérience.
Ainsi, l'industrie automobile se contente-t-elle plus facilement de gadgets technologiquement mis au point depuis longtemps (lève-vitres, antennes, lave-glaces électriques par exemple).
Or, même lorsqu'elles sont d'un intérêt médiocre, sinon nul, les innovations coûtent cher, pour le producteur comme pour le consommateur. Pour le producteur, parce qu'il faut entretenir des équipes de recherche et développement, et de marketing ; établir et maintenir le prestige et la réputation de la marque, multiplier les expériences de produits nouveaux dont certaines seulement aboutiront à un succès. Mais surtout parce que tous ces frais devront être amortis sur des séries souvent courtes et de durée incertaine : toute innovation est par nature promise à être supplantée par une innovation ultérieure. Le prix payé par le consommateur se ressentira de tous ces éléments, le producteur n'ayant pas d'intérêt à la modération s'il veut faire face rapidement à toute menace concurrencielle. Mais si l'on a affaire à un bien durable, dont la durée de vie est sensible à l'apparition de nouveaux modèles, ce gonflement du prix n'est qu'un élément du surcroît de dépense à la charge du consommateur : lui aussi devant amortir le prix d'achat sur une durée plus courte, la satisfaction d'un besoin donné lui coûtera finalement très cher.
On connaît les énormités auxquelles tout cela conduit dans le domaine industriel. Le prix unitaire du Boeing 747 qui atteint déjà 60 millions de dollars risque d'être insuffisant pour amortir ses chaînes de production dans la mesure où Concorde le rendrait obsolète. Les recherches menées par IBM pour aboutir aux ordinateurs de la troisième génération ont coûté 5 milliards de dollars. Or, on sait que dans l'informatique, l'innovation va très vite, si vite que les ordinateurs ne peuvent même plus être vendus mais loués. On aboutit à des taux de croissance de plus de 100% par an,
Revue Economique - N° 3, 1975 27
418 REVUE ECONOMIQUE
qui ne peuvent être soutenus que par l'autofinancement, donc par les prix 9. Le domaine des objets quotidiens n'échappe pas à cette règle. Des articles simples tels que savons, piles électriques, lames de rasoir ont vu leur coût de fabrication diminuer jusqu'à quelques centimes l'unité ; les prix ne suivent pas. C'est que les firmes vendent moins ces produits à l'état simple que des marques, des images, des conditionnements, des gammes, tous éléments qui nécessitent le travail de personnels nombreux et qualifiés, et qui permettent justement le changement, comme on l'a vu. L'exemple des lessives est typique et bien connu. On imagine très bien que ce produit pourrait être vendu en vrac, sans marque et sans publicité (dont l'efficacité paraît d'ailleurs douteuse sur le volume global des ventes).
Dans le domaine de l'automobile, une équipe d'universitaires américains 10 d'origines variées (MIT, University of Chicago, Harvard University) a calculé en 1962 les coûts des divers changements survenus sur les automobiles américaines depuis 1949 ; ils arrivent ainsi à plus de 11 milliards de dollars annuels pour l'économie américaine entre 1956 et 1960, dont près de la moitié sont imputables aux augmentations de taille et de puissance des véhicules, et aux consommations supplémentaires de carburant qu'elles entraînent. Qui a payé le prix de ces changements ? C'est essentiellement le consommateur, au taux moyen de 700 dollars à l'achat et de 40 dollars annuels pour l'essence.
On peut estimer qu'en Europe, où l'ampleur des changements de carrosserie et de moteur a été nettement moindre qu'aux USA, l'addition par véhicule est sans doute moindre. Le surcoût entraîné par les changements a d'ailleurs été masqué par la diminution, due à des gains de productivité, des prix (en monnaie constante) de l'automobile et du carburant qui a été observée jusqu'en 1968 1:1 (et qui a cessé depuis, principalement à cause des réglementations en matière de sécurité et de pollution atmosphérique). Cette diminution est encore plus nette si on la rapporte au revenu par habitant12.
Il reste que cette évolution aurait pu être encore plus marquée sans un certain nombre de changements portant sur des paramètres d'utilité technique douteuse : ligne, puissance superflue, etc. La question se pose de savoir pourquoi les constructeurs ont « choisi » de se battre plus sur le terrain des changements que sur celui des prix.
Le taux de croissance de la consommation de médicaments en France était un des plus élevés du secteur de la santé, de l'ordre de 16 à 17% par an en francs courants, de 1950 à 1970. Il peut être considéré
9. D'après Alain Chénicourt, L'inflation ou l anti-croissance, L'usine nouvelle, Robert Laffont.
10. F.M. Fischer, Z. Griliches, C. Kaysen, «The Costs of Automobile Model Changes since 1949 », The Journal of; Political Economy, oct. 1962.
11. MM. Nicolon et Chanaron, op. cit., tome I, p. 61. 12. Op. cit., p. 70.
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 419
comme la somme du taux de croissance du nombre d'entrées (consultations, visites) dans le système médical: 6 à 7% par an; du taux de croissance du nombre de produits par ordonnance, qui est faiblement positif ; et du taux de croissance du prix moyen des médicaments prescrits et achetés à chaque époque : ce dernier taux est très élevé, il est de l'ordre de 10 % par an, donc plus de la moitié du taux de croissance des dépenses pharmaceutiques. Il résulte lui-même de deux phénomènes : le rythme rapide de renouvellement de la pharmacopée et le fait que chaque médicament nouveau est nettement plus cher, car plus coûteux, que celui auquel il se substitue.
T . . » .1- . - - i. . -.--__..__.. .. •_._..-./.-.. j. 1 - 1 . . . - . 1 ■ f<r ."» AAAt-\-lA^.C*AAAt-AAl-iD N^ JllVLi V CULliV // AA CiLf kfUA LUllt AC> LVALAO OUUVCliL ^l fc-lCr L^C~O progrès techniques très minimes, comme on l'a vu, on peut affirmer que la progression de la puissance pharmacodynamique moyenne des médicaments est inférieure à celle des moyens utilisés pour les concevoir, les produire et les commercialiser.
Corollaire : les dépenses de médicaments correspondant aux prescriptions effectives des médecins sont bien supérieures à tout instant aux dépenses correspondant aux médicaments les moins coûteux qui permettraient d'obtenir des effets pharmacodynamiques utiles équivalents. Ce surcroît de dépenses peut être évalué par les dépenses de mise au point, d'essais et contrôles divers, de promotion commerciale des fausses nouveautés, auxquelles il faut ajouter les gains de productivité sur la fabrication qu'on ne réalise pas, du fait de la faible durée de vie des produits. Il est sans doute considérable.
Notons entre parenthèses que ce surcroît de dépenses n'est donc pas à imputer, comme un certain nombre d'analyses simplistes portant sur la « surconsommation » de médicaments l'affirment, à une catégorie particulière de médicaments que seraient les « faux » médicaments, à activité pharmacodynamique quasi nulle. Tout médicament incorpore dans son coût une partie de ce surcroît de dépenses.
Résumons-nous : des innovations coûteuses par elles-mêmes et n'apportant bien souvent que des progrès médiocres, en termes utilitaires. Cela veut dire qu'un volume physique donné de consommation, c'est-à-dire un « niveau de vie », en termes physiques, donné, nous revient de plus en plus cher : l'inflation n'a pas d'autre définition.
Un moyen très éclairant de mettre en rapport le coût des innovations qu'a connues l'automobile et les améliorations de performances en termes de gain de temps et de mobilité qui, tous comptes faits, en ont résulté est de calculer ce qu'on peut appeler la « vitesse généralisée » de l'automobile, pour divers modèles rangés par ordre de performances croissantes.
Le principe du calcul est simple. On estime toutes les dépenses annuelles liées à la possession et à l'usage d'une automobile : amortissement des frais d'acquisition du permis de conduire ; amortissement des frais d'achat de la voiture ; frais fixes payables annuellement : vignette, assurance, garage ; dépenses courantes d'utilisation : carburant, huile, pneus, graissages-vidanges, révisions périodiques, réparations normales ou dues à des accidents, frais de stationnement et péages, amendes, achats
420 REVUE ECONOMIQUE
d'accessoires divers. Ces dépenses sont converties en temps, en les divisant par le revenu horaire : ce temps est donc le temps qu'il faut passer à travailler pour obtenir les ressources nécessaires à l'acquisition et à l'utilisation de sa voiture. On l'additionne au temps passé effectivement à se déplacer. Ce dernier est estimé à partir du kilométrage annuel moyen, de la répartition de celui-ci en types de déplacements — trajet domicile-travail, déplacements professionnels, vacances, déplacements privés, loisirs — du croisement de cette répartition avec une répartition selon des types de vitesse — vitesse sur route, vitesse urbaine aux heures de pointe et aux heures creuses selon le type d'agglomération — et enfin d'une estimation de ces vitesses. On ajoute enfin pour mémoire les autres temps liés à l'utilisation de la voiture : temps passé personnellement à l'entretien, temps perdu dans les bouchons, temps passé à l'achat d'essence et d'accessoires divers, temps passé à l'hôpital, temps perdu dans des incidents, etc. Le temps global ainsi obtenu, mis en rapport avec le kilométrage annuel, permet d'obtenir la vitesse généralisée cherchée.
Le tableau ci-dessous donne les résultats pour des situations-types, caractérisées par une catégorie socio-professionnelle (CSP), un modèle de voiture et une commune de résidence. On y a également fait apparaître les performances de la bicyclette, calculées selon le même principe.
Les données sont relatives à l'année 1967, donc bien avant les récentes hausses du carburant, et en l'absence de toute limitation de vitesse.
On constate qu'à modèle donné, plus on monte dans la hiérarchie sociale, et plus la vitesse généralisée est forte. Deux raisons à cela : l'augmentation du kilométrage annuel, qui diminue l'importance par kilomètre des charges fixes, et surtout l'élévation du revenu qui diminue le temps de travail nécessaire pour obtenir des ressources données. Par ailleurs, quelle que soit la catégorie sociale, le modèle de voiture le
Vitesses généralisées en km/h
C.S.P.
Modèle dette
14 13
13
12
Citroën 2 CV
14 12
10
8
Simca 1301
14 10
8
6
Citroën DS 21
12 8
6
4
Cadre supérieur P . Employé V . Ouvrier spécialisé V Salarié agricole R .
P: Paris; V: ville moyenne; R: commune rurale (commune de résidence).
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 421
plus rapide en termes de vitesse généralisée est toujours celui de bas de gamme, lequel est lui-même systématiquement distancé par la bicyclette (sauf pour les catégories les plus favorisées, pour lesquelles il y a équivalence). Ces résultats se passent de commentaire.
Un des éléments du malaise que suscitent actuellement les problèmes de la santé dans les pays industrialisés est le sentiment d'un divorce entre le rythme d'accroissement des moyens consacrés à ce secteur et les progrès obtenus en matière d'allongement de l'espérance de vie, de réduction des taux de mortalité et de morbidité.
l[Vii-n r-r>ti> I^c Ar>r\r>tnsn>c Ar> acxr^^ry r\n Va T711 à r->ror-inc Aoa in/>rliraTm>nf 1 croissent à un rythme plus rapide que celui de la plupart des autres consommations. De l'autre, on ne peut observer qu'un très net ralentissement des gains en espérance de vie. Si, en effet, l'espérance de vie à la naissance, en France, n'était que de 39 ans en 1825, passait à 47 ans en 1900 pour atteindre 71 ans en 1966, il faut noter que pour les pays les plus avancés d'un point de vue sanitaire, et alors que dans la première moitié du siècle on avait gagné en moyenne quatre ans d'espérance de vie toutes les dix années de calendrier, de 1950 à 1960 le gain tombe à un ou deux ans dans les pays en tête de file, et depuis 1960 le progrès est encore moindre. La situation française est typique à cet égard. En quarante années, de 1932 à nos jours, l'espérance de vie est passée de 55 à 68 ans pour les hommes et de 60 à 75,5 ans pour les femmes. Jusqu'en 1960, pour chacun des deux sexes, l'espérance de vie augmente de façon régulière, d'environ six mois par an. A partir de 1960 on observe une tendance au plafonnement, plus marquée pour les hommes que pour les femmes. Pour ces dernières, l'allongement de l'espérance de vie n'est plus que d'un mois par an, alors que l'espérance de vie masculine oscille autour de 68 ans depuis 1965.
Par ailleurs, un grand nombre d'études, tant d'épidémiologues que d'économistes, concluent que les variations dans le temps ou dans l'espace de la mortalité sont, au niveau moyen où se situent les diverses variables dans les pays développés, beaucoup plus influencées par des variables de mode de vie et d'environnement que par les consommations médicales proprement dites, dont l'effet différentiel paraît modeste 13.
Bien qu'on dispose de peu de données sur la morbidité, il semble que cette conclusion doive être étendue à tout indicateur global de santé, incluant mortalité et morbidité. Pour le grand biologiste René Dubos, on peut largement douter que nos contemporains adultes aient une plus grande espérance de vie en bonne santé que nos ancêtres 14.
L'inflation, et tout son cortège de conséquences néfastes, est donc sans aucun doute liée au phénomène de réduction de la longévité des biens tel que nous l'observons. On peut en dire autant d'autres traits de la société industrielle qui la font accuser, à juste
13. J.-P. Dupuy, « La décision en matière de santé », Analyse et Prévision, nov. 1973.
14. René Dubos, L'homme et l'adaptation au milieu, Payot, Paris, 1973.
422 REVUE ECONOMIQUE
titre, de dégrader la « qualité de la vie » : pollution et enlaidissement du milieu naturel par production massive de déchets ; rythmes fratricides pesant en particulier sur la sécurité de l'emploi ; disparition d'une certaine qualité du travail avec le déclin d'un artisanat de réparation qualifié, entretenant des rapports étroits avec sa clientèle, et son remplacement par des emplois peu qualifiés et/ou peu enrichissants, liés à la conception, à la production et à la promotion commerciale d'objets fragiles ou éphémères, etc., etc.
Il y a plus grave encore. Les modifications continuelles de l'environnement matériel dans lequel vivent les hommes sont responsables d'un appauvrissement dont la mesure du PNB ne tient pas compte mais qui n'en est pas moins tragiquement préjudiciable à leur bien- être. Nous voulons parler de la perte du sens de cet environnement pour la majorité d'entre eux. Pour que le cadre matériel dans lequel il vit « dise » quelque chose à quelqu'un, il est nécessaire : soit qu'il ait participé à sa création, soit qu'il ait eu le temps d'assimiler son langage et partage le poids de souvenirs qui s'y rattachent. Dans une société où le changement est à la fois continuel et programmé et monopolisé par le système industriel, aucune de ces deux conditions n'est satisfaite pour la majorité de la population. Il en résulte une dégradation d'une certaine qualité symbolique du cadre de vie qu'il faudrait ranger au premier rang des pollutions de notre époque15.
DES ANALYSES MAGIQUES
Nous voici donc au cœur du problème. La réduction de la longévité des biens apparaît tout à la fois comme une condition nécessaire de la continuation de notre système économique et comme une source majeure du fameux malaise des sociétés industrielles. Une analyse des raisons du phénomène s'impose donc. Nous commencerons par en présenter deux, fréquemment défendues, et qui nous semblent présenter un point commun, au-delà de leur évidente opposition : celui de faire jouer à un acteur social particulier un rôle prédominant, en lui prêtant un pouvoir quasi magique.
La souveraineté du consommateur
Pour l'économiste libéral, le marché constitue Yultima ratio. Si un consommateur se sépare d'un produit ancien et le remplace par
15. Sur cette question fondamentale, cf. P. cTIribarne, La politique du bonheur, Le Seuil ; Ivan Illich, La convivialité, Le Seuil ; B. DE Jouvenel, Arcadie, SEDEIS.
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 423
un nouveau, c'est que le changement vaut au moins pour lui, par définition, le coût que l'opération entraîne. Au nom de quoi en jugerait-on autrement ? Lui fera-t-on remarquer que telle innovation est adoptée alors que de fait elle n'apporte qu'un progrès quasi nul d'un point de vue utilitaire ? Il répondra que ce qu'on achète alors, c'est la nouveauté en elle-même. Le nouveau modèle de telle marque automobile peut différer du précédent uniquement par la forme des ailes arrière : cela suffit à marquer la nouveauté, et à satisfaire le besoin, le goût de nouveauté que ressent ïe consommateur. C est dans cette logique que les auteurs de l'article américain, déjà cité, qui chiffrent à quelque 1 1 milliards de dollars par an le coût des changements de modèles d'automobiles aux Etats-Unis, considèrent que rien ne permet d'affirmer a priori que ce coût n'a pas été accepté en connaissance de cause par les consommateurs américains, alors même qu'il résulte en grande partie de changements mineurs. Et cette logique est irréfutable dès lors que l'on considère cette propension à la nouveauté pour elle-même comme une caractéristique psychologique donnée des consommateurs.
Quant à faire remarquer, comme nous l'avons fait, que la rapidité du changement est la cause d'une perte de qualité « poétique » des objets et du cadre matériel, on vous répondra que vous vous référez à des valeurs d'une autre époque, ou d'une catégorie sociale restreinte, valeurs non partagées par la majorité de nos contemporains, leur comportement le prouve.
Cette école de pensée a produit un autre raisonnement, non moins intéressant à démonter. Avant de le faire, rappelons le schéma classique de la rationalité du renouvellement des équipements dans l'industrie. On y explique le renouvellement des équipements par deux raisons différentes : l'usure des matériels, c'est-à-dire la diminution de leurs performances à mesure que le temps passe (ou, ce qui revient au même en théorie, l'accroissement des coûts d'entretien à performances constantes) ; I obsolescence, liée à l'apparition de nouveaux matériels dont les performances sont plus élevées à coût donné, ou dont le coût est plus faible à performances données, qui diminue la valeur d'usage des anciens matériels. Compte tenu de ces deux phénomènes, on montre que vis-à-vis d'un critère de minimisation des coûts ou de maximisation du profit, il devient intéressant, à partir d'une certaine époque, de mettre au rebut l'ancien équipement pour le remplacer par un nouveau, alors même que techniquement l'ancien matériel pourrait encore faire usage. C'est ainsi qu'il peut être parfaitement « rationnel », pour une compagnie
424 REVUE ECONOMIQUE
aérienne, de se débarrasser d'avions mis en service peu d'années auparavant et en parfait état de marche, pour profiter du progrès technique.
Si l'on transpose ces notions dans le domaine de la consommation 16, on peut, toujours dans la logique libérale du marché, fournir au phénomène de réduction de la durée de vie des biens durables, l'explication suivante, telle que S.B. Linder, par exemple, la présente dans son ouvrage, The Harried Leisure Class. Il part de la constatation que notre société, selon le mot de Bertrand Rüssel, est celle où l'on apprend à faire deux fois plus d'épingles en un temps donné plutôt que de faire une quantité donnée d'épingles en deux fois moins de temps. En d'autres termes, les gains de productivité sont convertis en ressources matérielles au lieu de l'être en ressources temporelles. C'est le fondement même de la croissance économique, considérée comme un phénomène inévitable et souhaitable. Donc, la durée du travail restant sensiblement la même, de plus en plus de biens se disputent un temps de non-travail inchangé. La consommation de ces biens prenant du temps, le temps devient un bien rare par rapport aux choses. L'économiste traduit cela en disant que la « valeur du temps » (scus-entendu : exprimée en unités de biens matériels) s'accroît.
Or, pour entretenir notre patrimoine, nous disposons a priori de trois moyens de procéder : entretenir nous-mêmes nos biens en y consacrant notre propre temps, faire appel aux services d'entreprises spécialisées (c'est-à-dire se payer le temps des autres) et enfin... ne pas entretenir et remplacer nos biens à un rythme rapide. La valeur du temps augmentant, et la productivité dans les services d'entretien augmentant moins vite que dans la production des biens, c'est cette dernière solution qui l'emporte. En d'autres termes le coût relatif des biens par rapport aux coûts d'entretien diminue : c'est un cas particulier du phénomène d' obsolescence. Vêtements sales et fripés, automobiles jamais lavées ni révisées, maisons mal entretenues sont le lot quotidien d'une société pressée. Tout cela conduit au résultat paradoxal qu'une société où les gens accordent tant d'im-
16. Ce qui ne va pas sans une sérieuse difficulté théorique. Les définitions données postulent en effet l'existence d'une mesure des performances. Dans le cas d'un équipement industriel, ce sera par exemple la contribution au profit de l'entreprise. Dans le cas d'un bien de consommation, il pourra être difficile de trouver une telle mesure, les motivations d'achat pouvant être diverses et confuses. Nous reviendrons sur ce point ci-dessous. Notons que la même difficulté vaut en fait également pour l'industrie, le choix des équipements pouvant obéir à des considérations «extra-économiques» (exemple: ordinateurs).
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 425
portance à leur niveau global de consommation est aussi celle où ils se désintéressent le plus de chaque consommation en particulier. C'est ainsi que Linder explique l'attrait pour la nouveauté et un phénomène que l'on peut nommer : usure psychologique (diminution rapide de l'agrément apporté par un objet à mesure que le temps passe).
Cette théorie de l'accroissement de la valeur du temps permet d'expliquer de la même façon bien d'autres caractéristiques absurdes
i i 11 ■*,■ rr i , _ î. V •„• J' UU JJcUclLUJAcueù vj. une ou^iclc aiiainn. \_tê lciujjo, ex j. Cl'IylUC ^ Uliv. qualité de vie médiocre : diminution du temps consacré aux activités demandant pour être accomplies relativement plus de temps que de ressources, comme le sommeil, le farniente, les activités de méditation, de réflexion personnelle, de pratique des arts, d'enrichissement de l'esprit ; réduction du temps consacré à s'occuper des autres et remplacement par l'utilisation de ressources matérielles (vieillards ne trouvant plus place dans les familles, parqués dans des hospices où le temps d'attention à autrui est mieux « rentabilisé », etc.
On ne peut pas nier qu'on dispose avec cette théorie d'une explication séduisante d'un ensemble de phénomènes, dont celui de la réduction de la longévité des biens, qui caractérisent tous une société où l'encombrement et la rareté du temps s'accroissent dangereusement. Mais cette explication n'est performante que parce qu'elle ne remet pas en cause le fait d'observation que les progrès de productivité sont convertis en biens et non pas en temps. Elle passe complètement sous silence la question de savoir pourquoi il en est ainsi, alors que c'est de cela que découlent toutes les caractéristiques de l'affectation du temps qui rendent la qualité de nos vies si mauvaise. Pourquoi continuons-nous à « croître », alors que les avantages directs tirés de l'augmentation du niveau de vie semblent plus que détruits par les inconvénients résultant de l'accroissement de la rareté du temps ? Pourquoi continuons-nous à travailler autant pour produire à grands frais un changement incessant de notre environnement matériel dont l'observation paraît nettement montrer qu'il apporte plus de mal que de bien ?
A ces questions, il semble que l'explication libérale ne puisse apporter de réponse satisfaisante.
La souveraineté du producteur
Un autre courant de pensée consiste à raisonner comme dans un roman policier. Il y a crime, donc nécessairement un coupable.
426 REVUE ECONOMIQUE
Pour chercher le coupable, cherchons à qui le crime semble profiter le plus. Nous avons trouvé : le producteur.
Ainsi, H. Brochier (dans Les effets de la planification française au niveau des structures économiques et sociales) écrit : « A partir du moment où l'appareil de production est capable de satisfaire, rapidement et à peu de frais, les besoins élémentaires de la quasi- totalité des individus, la consommation perd son autonomie et se trouve déterminée par la logique de la production, c'est-à-dire dans une société capitaliste, celle du profit. La plupart des besoins socialement exprimables que ressentent les consommateurs sont aujourd'hui la création des producteurs, et ont été conçus, mis au point, propagés dans l'intérêt quasi exclusif de ceux-ci. »
Plus loin, l'auteur utilise l'expression : « planification privée de l'obsolescence ».
Effectivement, comme on l'a vu, dans le cas d'un bien durable dont le marché est proche de la saturation, plus la durée de vie du bien est courte, plus son ou ses producteurs en vendent. Dans le cas d'un bien fongible, ce raisonnement ne tient plus, mais l'observation montre que presque toujours le renouvellement d'un modèle sert de prétexte à une augmentation du prix. L'anchois roulé coûte cinq fois le prix de l'anchois au sel. Le préparer soi-même économiserait à la ménagère quelque 30 F par heure ! Le changement de conditionnement des eaux minérales, qui s'est accompagné d'un accroissement de la capacité de 90 à 150 cl, a conduit à peu près à un doublement des prix. L'huile de voiture normale coûtait 1 F le litre : l'huile spéciale en bidon de deux litres atteint maintenant quelque 15 F. Le prix des pneus a augmenté de 60 % en dix ans au fil des perfectionnements successifs, etc., etc. 17.
Il peut même arriver qu'une réglementation administrative inadaptée favorise, voire encourage le renouvellement avec hausse des prix. Ainsi, en France jusqu'en 1968, le prix des médicaments était soumis au régime suivant : blocage des prix pour les produits anciens, régime du « cadre de prix » pour les nouveaux produits. Ce dernier consistait à appliquer au prix de revient industriel une marge brute forfaitaire et dégressive destinée à couvrir les frais généraux administratifs et commerciaux, les frais de publicité, les frais financiers et la marge bénéficiaire de l'entreprise, indépendamment donc de la valeur réelle des dépenses engagées.
Un tel système pouvait être tourné aisément. Pour compenser le blocage des prix de ses produits, il suffisait au fabricant de lancer des produits nouveaux dont il avait intérêt à gonfler artificiellement le prix de revient. On utilisait systématiquement les matières premières les plus
17. Exemples cités par Alain Chénicourt, op. cit.
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 427
chères, en s'approvisionnant par exemple à l'étranger chez un fournisseur échappant au contrôle des pouvoirs publics français : la marge brute s'en trouvait ainsi augmentée en valeur absolue.
Pour arriver à leurs fins, les producteurs auraient le choix entre diverses méthodes. L'usure provoquée, qui consiste à mettre sur le marché des produits de moindre résistance, et donc de moindre durée de vie technique : c'est ainsi que le marché européen des réfrigérateurs s'est trouvé bouleversé, ces dernières années, par l'irruption ae moaêîes peu cuulcua ^i cuju^uo puai durer peu. L'cbccïccccnce provoquée, qui consiste à dévaloriser par divers procédés les anciens modèles pour en faciliter la substitution par de nouveaux. Un moyen brutal est tout simplement de les retirer du marché. Ainsi, il n'est plus possible de trouver en pharmacie les anciennes aspirines toutes simples, remplacées par les aspirines effervescentes, tamponnées, microfinées, enrobées, etc., etc. Un moyen plus subtil est de créer des modes. La recette : modifier de façon purement apparente et marginale le modèle précédent — allonger une jupe, transformer un phare rond en phare carré, changer le format de l'hebdomadaire — et, grâce à une publicité et une promotion commerciale savamment agencées, faire passer les vessies pour des lanternes tout en les vendant très cher.
Ces explications paraissent bien rapides. Non pas que les faits rapportés soient niables. Mais l'interprétation qui en est donnée est plutôt courte.
Tout d'abord, si ces pratiques présentent des avantages manifestes pour les producteurs, elles ne sont pas sans coût. Nous l'avons vu, toute innovation, même mineure, revient cher à la firme. De plus, la certitude du succès est loin d'être grande. Bien souvent (des chiffres de plus de 30% ont pu être avancés), le lancement du produit nouveau conduit à un échec, soit immédiat (l'image de nouveauté ne prend pas) soit différé (le nouveau produit est rapidement supplanté par une innovation concurrente). En fait, on a l'impression que la politique d'innovation à outrance est moins une politique favorable à l'ensemble des firmes qu'une contrainte à laquelle chaque firme doit se soumettre compte tenu du comportement des autres. Tout producteur sait d'expérience que s'il n'innove pas, ses produits seront chassés du marché par les produits nouveaux de ses concurrents.
Par ailleurs, ne peut-on penser que « l'usure provoquée » résulte tout simplement du fait que, les producteurs se rendant compte que leurs produits ne dureront guère pour des raisons non techniques,
428 REVUE ECONOMIQUE
il est plus avantageux de fabriquer des articles peu coûteux et peu chers, dont la durée de vie technique est adaptée à la durée de vie réelle ? Ne peut-on arguer que si les firmes cessent de produire et de mettre sur le marché d'anciens articles, c'est tout simplement parce qu'une demande insuffisante n'en assure plus la rentabilité ?
Enfin, invoquer la toute-puissance de la publicité et des techniques commerciales dans la transformation du consommateur en pantin manipulable à merci, c'est vraiment croire à un mythe que de nombreuses études ont grandement mis à mal. Cela ne veut d'ailleurs pas dire que ces techniques n'ont pas de fonction pour la firme, comme nous le verrons ci-dessous.
Notons pour terminer que la réduction de la longévité des biens n'est pas manifestement l'apanage du seul capitalisme. Il s'agit là d'une propriété des sociétés industrielles en général, qu'elles soient soumises à la loi du marché ou à celle des bureaucrates.
DE LA SOCIETE DU TOUJOURS PLUS A L'OBSOLESCENCE PSYCHOLOGIQUE DES BIENS
Face à une première interprétation des phénomènes qui voit dans ceux-ci la simple réalisation de ce que souhaitent les individus, et reste donc impuissante à expliquer leurs conséquences mauvaises ; face à une seconde analyse qui recherche des coupables et les trouve en la personne de certains acteurs sociaux, en l'occurence les producteurs, nous voudrions proposer une explication radicalement différente.
Ce qui est à mettre en cause ici, c'est un système. Et non pas un système que certains manipuleraient en fonction de leurs seuls intérêts et aux dépens d'autrui, mais un système dont tout le monde se fait complice et victime (ce qui ne veut pas dire que certains ne sont pas plus victimes que d'autres). Ce système, ce sont les règles du jeu de ce que l'on peut appeler la socio-culture occidentale, celle qui a inventé le mode industriel de production.
Comment caractériser en peu de mots l'essentiel de ces « règles du jeu»? De tout temps et dans toute société, les rapports de l'homme avec son environnement et avec les autres hommes ont été régis par un ensemble de représentations, d'attitudes, de comportements communs, leur donnant un sens et constituant ce que les anthropologues appellent une culture. Par définition, une culture est ce que les économistes nommeraient un concernement collectif : le fait pour quelqu'un d'en jouir ne prive évidemment personne
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 429
d'autre d'en jouir de la même manière. La société industrielle peut être caractérisée comme celle qui a rompu avec cet état de choses. Dans cette société, chacun cherche la solution à ses problèmes relationnels et d'insécurité dans l'accès à des produits (biens ou services) délivrés et fabriqués selon le mode industriel. L'éveil au monde et aux choses se fait moins par la participation à la vie quotidienne que par la consommation du service éducation. Les relations inter- personnelles s'établissent moins par le temps que l'on accorde à la riar>/~>1/> An- l'aliff» mil» r-, a r> 1 ' r>r-\-< ci-f-i rr r> A' ̂ ki ofc ^«".fonir T ' of-i ry r^i e oo X --— - -- — -^ — y- - _ O" J ~" " "" O ' ~ ~ devant la fuite du temps, devant le vieillissement, devant la mort n'est plus incorporée à une culture qui lui donne un sens, elle est combattue par la consommation de services médicaux. Le besoin de dépasser dans l'imaginaire les limites du quotidien est comme de tout temps à l'origine de pratiques magiques, mais ces pratiques passent par l'accès individuel à des objets techniques, qu'il s'agisse de la consommation de vitesse ou de médicaments.
Dès lors que les dimensions fondamentales du bien-être de l'homme — ou plutôt de son être-bien — au-delà de la simple satisfaction des besoins physiologiques élémentaires, comme la qualité de ses relations interpersonnelles, son sentiment de sécurité, le sens qu'il donne à son environnement et à sa vie, dépendent de l'accès à, et de la consommation de biens et services produits industriellement, ce qui était solution culturelle collective, donc illimitée en quantité, est devenu chose rare — qu'il s'agisse d'une marchandise dans un système de marché, ou de 1'« output » d'une institution planifiée dans un système centralisé. Ce que l'un a, c'est autant de pris sur ce que les autres ont. Chacun cherche donc à en avoir plus. Mais, et c'est là le vice fondamental du système, chercher à lutter contre cette rareté par plus d'abondance ne mène à rien, sinon peut-être qu'à encore plus de rareté et encore plus d'inégalités.
La raison en réside dans la logique du « toujours plus », qui repose sur le principe que l'on ne saurait jamais avoir assez d'une bonne chose. Ce qui compte, c'est moins ce que l'on a en soi, que ce que l'on a par rapport à ce qu'il serait mieux d'avoir. Or, ce qu'il serait mieux d'avoir est en particulier donné par ce que les autres, ou du moins certains autres (les groupes sociaux que l'on prend comme modèles de référence) ont. On comprend dès lors pourquoi plus d'abondance, en augmentant ce qu'il est mieux d'avoir, crée autant de rareté qu'elle n'en supprime.
C'est ainsi que l'on peut définir, pour le problème qui nous occupe, la notion d' obsolescence psychologique. Soit un type de bien,
430 REVUE ECONOMIQUE
dont on étudie le renouvellement. Compte tenu de ses caractéristiques physiques, la consommation de ce bien produit certaines performances techniques ou physiques : réduction de la morbidité dans le cas d'un médicament, gain de temps dans le cas d'une automobile, etc. Mais la consommation de ce bien a également d'autres fonctions : elle est un « input » des performances obtenues sur les dimensions non physiques du bien-être que nous avons évoquées. En tant que telle, ce ne sont pas les caractéristiques absolues qui comptent, mais les caractéristiques relatives par rapport à une norme de référence. Si un nouveau bien surgit, dont les performances techniques sont, ou paraissent, meilleures, la norme augmente, et les performances psycho-sociales de l'ancien bien sont diminuées. C'est ce phénomène de dévalorisation que nous nommons obsolescence psychologique.
En plus de ses effets techniques, le médicament remplit, dans la relation médecin-malade, un certain nombre de fonctions non techniques, mais néanmoins essentielles.
Tout malade, quelle que soit sa morbidité, qu'il s'agisse d'un accidenté de la route ou d'un hypertendu, d'un cancéreux ou d'un névrosé, pose à son médecin un problème technique, il lui demande de le soulager et de le guérir, mais il lui présente également une angoisse, une demande d'aide. Aussi les moyens techniques que le médecin déploie pour répondre à la demande exprimée de son patient ont une double fonction : celle de résoudre le problème technique posé par le malade, d'une part, mais aussi, d'autre part, celle de répondre de façon détournée à sa demande d'aide, en ayant rôle de signe d'une prise en charge.
Parmi ces moyens techniques, la prescription pharmaceutique a une place privilégiée, dans la mesure où elle ne nécessite de la part du médecin, psychologiquement et en temps, qu'un investissement relativement minime. Un des rôles essentiels du médicament dans la relation médecin-malade est donc de constituer un signe de l'attention que le médecin porte à son malade.
Mais pour que le malade se sente véritablement et globalement pris en charge par son médecin, les témoignages de compréhension ne suffisent pas : il faut aussi qu'il se sente pris en charge techniquement, il faut qu'il ait confiance dans la capacité d'intervention de son médecin. Or, il semble que dans bien des cas, cette dernière soit problématique, et en tout cas ressentie comme telle par le médecin. Que cela tienne à l'irruption sur le marché des soins d'un certain type de patients à la maladie « inorganisée », aux symptômes imprécis et changeants, ou que cela tienne aux modifications de la pratique médicale induites par l'apparition de thérapeutiques médicamenteuses dont les effets sont décrits en termes de symptômes et signes cliniques observables aisément, et qui ne nécessitent plus du médecin le passage par un diagnostic étiologique, c'est un point que nous ne trancherons pas ici. Quoi qu'il en soit, c'est une fois de plus le médicament qui vient arranger les choses, la prescrip-
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 431
tion pharmaceutique ayant ici le rôle de signifier la capacité d'intervention du médecin. Je vous prescris ceci, donc je sais ce que vous avez, semble dire le médecin en rédigeant l'ordonnance, évitant par là même de recourir à des analyses ou de prendre la décision d'orienter le malade vers un confrère spécialiste ou vers l'hôpital, ce qui serait perçu a contrario comme un signe d'incompétence.
Pour qu'un médicament permette d'obtenir de bonnes performances sur les dimensions non techniques de la satisfaction du médecin et du malade, il est donc nécessaire qu'il signifie l'efficacité technique. Les caractéristiques signifiantes du produit à cet égard seront, outre son
faisant passer pour un médicament dangereux ; parfois un prix élevé ; le plus souvent tout simplement... la jeunesse, c'est-à-dire la nouveauté, symbole de progrès et d'espoir.
Mais le médicament agissant en tant que signe, les performances obtenues dépendent moins de la valeur absolue de ce signe que de sa place au sein d'une gamme hiérarchisée de signes. C'est moins l'efficacité qu'il faut signifier que la plus grande efficacité. Prenons un exemple simple. Tous les généralistes et les rhumatologues reconnaissent l'efficacité de l'aspirine. Mais prescrire aujourd'hui un produit aussi ancien, aussi connu, aussi banal et alors que tant de nouveaux produits se sont succédés sur le marché depuis son apparition, serait perçu par le malade comme un manque d'attention du médecin à son égard, voire comme une volonté de non-prise en charge (à moins que le médecin ait une telle notoriété que cette notoriété, à elle seule, sécurise le malade et que le médecin n'ait nul besoin de s'affirmer davantage : ce type de médecin pourra prescrire de l'aspirine). Pour le médecin, ce ne serait certes pas le meilleur moyen d'affirmer sa compétence et sa puissance d'intervention. Ce qui est signifiant, c'est donc l'écart entre ce que le médecin pourrait faire et ce qu'il fait. Si le médecin et le malade n'étaient pas concernés par ces dimensions non techniques, on ne comprendrait pas de telles choses : l'aspirine serait jugée raisonnablement efficace, et elle serait prescrite. Si l'on réintroduit au contraire les effets non techniques du médicament dans l'analyse, on comprend que les performances qu'un médicament donné permet d'obtenir sur les fins non techniques poursuivies par le médecin et le malade diminuent quand un nouveau médicament plus efficace, ou perçu comme tel, surgit sur le marché. Si c'est la nouveauté du produit qui à elle seule signifie l'efficacité, il suffira qu'un produit nouveau apparaisse pour que cette destruction d'une partie des capacités des médicaments plus anciens se produise. C'est ce phénomène que nous nommons « obsolescence psychologique » des médicaments.
Pour ce qui concerne l'automobile, une littérature abondante a tellement vulgarisé tout ce qu'elle représente dans notre société qu'il n'est nul besoin d'insister ici sur ce point. Indiquons seulement que dans une société où les riches et les puissants, et ceux qui veulent le paraître, se distinguent par le fait qu'ils parcourent les plus longues distances et roulent sur la file de gauche, il n'est pas étonnant que l'automobile soit, en dehors de ses fonctions utilitaires, un signe de la place qu'on occupe dans la hiérarchie sociale et un instrument de maîtrise magique du monde.
-132 REVUE ECONOMIQUE
Ces fonctions de signe de l'automobile donnent naissance, de la même manière que pour le médicament, au phénomène d'obsolescence psychologique. <.< Ainsi, aux âges héroïques de l'automobile, quand presque tous allaient à pied ou en voiture à cheval, que les quelques automobilistes roulaient à 30 km/h, rouler à 60 était susceptible de fournir une forte impression de maîtrise du monde ; quand il est banal d'être automobiliste, et que la moindre 2 CV fait du 100, celui qui roule à 60 se sentira au contraire impuissant, et retrouver une forte impression de maîtrise du monde exige de dépasser les 150 km/h » 1S.
On peut de la même façon revenir sur la notion, déjà évoquée, d'usure psychologique. L'usure psychologique sera définie comme la diminution dans le temps, sans lien direct avec l'apparition de nouveaux biens, des performances qu'un bien donné permet d'obtenir sur les dimensions non physiques du bien-être. Outre celle que Linder mettait en évidence, on peut trouver à ce phénomène deux composantes, compte tenu des « règles du jeu » de la société industrielle. L'usure psychologique est tout d'abord fille de l'obsolescence psychologique. C'est en effet l'apprentissage de l'obsolescence des anciens produits qui forge, chez tous les acteurs sociaux, la représentation d'un progrès technique indéfini. Imagine-t-on qu'un même praticien puisse prescrire le même médicament pendant six ans sans entrer en contradiction manifeste avec la représentation collective d'une science thérapeutique en progrès constant ? Une deuxième composante résulte d'un phénomène psychologique qui se produit chaque fois que l'on croit trouver dans la consommation une réponse à un problème d'une autre nature : l'objet convoité une fois possédé se révélera bien souvent soudain dépourvu d'attraits. Ainsi, le malade insatisfait de ne pas avoir été véritablement entendu tranfèrera-t-il cette insatisfaction sur le médicament prescrit, jugé inefficace ou au contraire trop efficace et par là dangereux.
Nous allons maintenant mettre en évidence les mécanismes qui se greffent sur les fonctions sociales de la consommation et sur le phénomène d'obsolescence psychologique des biens. Nous souhaitons montrer par là comment des acteurs sociaux ayant tous intériorisé les règles du jeu que nous avons schématisées, peuvent en arriver à des comportements dont la résultante est la situation absurde que nous connaissons.
18. P. d'Iribarne, « La consommation et le bien-être, approche psycbo-socio- économique », Revue d'économie politique, 1972.
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 433
L'OBSOLESCENCE PSYCHOLOGIQUE ET LES MECANISMES DE LA CONSOMMATION
L'obsolescence psychologique est à la source de mécanismes paradoxaux ou pervers, propres à choquer les évidences du sens commun.
Il y a tout d'abord la possibilité d'existence de comportements que l'on peut qualifier de « réqressifs » : c'est le cas où, dans une gamme de qualités d'un bien classées par performances techniques croissantes, un individu donné choisit une qualité de plus en plus médiocre à mesure que la gamme s'étend vers le haut à la suite d'innovations.
Etudiant le comportement d'automobilistes désirant fortement un modèle au-dessus de leurs moyens, une recherche de la SEMA a constaté qu'« au lieu de se " rabattre " sur un modèle d'un prix un peu moindre, ils se " rabattent " sur le modèle le moins cher, refusant de s'y identifier, et pensant par là même que les autres ne les jugeront pas sur ce modèle dont le style est à leur sens trop éloigné de leur propre personnalité ».
Le révélateur dans le temps de ce type de comportement est l'apparition de nouveaux modèles qui modifient l'univers du choix, tout comme, semble-t-il, les événements consécutifs à la récente crise pétrolière ; ainsi a-t-on pu noter que les modèles de milieu de gamme ont été plus « boudés » par la clientèle que les modèles de haut de gamme : 20 % contre 17,5 % de baisse des ventes, respectivement, sur les quatre premiers mois de 1974 en France.
De même, on a pu noter chez certains médecins « une tendance à rester fidèles aux premiers médicaments essayés dans un type de traitement, tout en étant intéressés par le dernier sorti. De là se manifestent un vide et un oubli pour les produits entre-deux, en tout cas pour eux une résistance à vaincre beaucoup plus solide » 19.
Ce détachement pour les produits « entre-deux » et, si l'on ne peut « suivre le progrès », ce report sur des qualités médiocres ou anciennes s'observe dans de nombreux autres domaines. On a pu le constater, semble-t-il, dans les bibliothèques municipales, où les livres les plus demandés sont soit des classiques, soit les derniers succès à la mode. Quant au prix Goncourt 1962, comme le notait ci-dessus le professeur Pelt, il est tombé dans l'oubli.
Comment expliquer ce type de comportement ? Soit trois qualités d'un même bien numérotées par ordre de performances techniques croissantes 1, 2 et 3. Admettons que, alors que la qualité 3 n'existe
19. Guy Serraf, « Le médecin, le malade et le médicament », La Nef, n° 37, avril-août 1969.
Revue Economique - 2V° 3, 1975 28
434 REVUE ECONOMIQUE
pas encore, un individu donné choisisse la qualité 2 plutôt que la qualité 1. C'est que la différence d'utilité sociale (faisant intervenir les fonctions du bien sur les dimensions non physiques de son bien-être aussi bien que sur les dimensions physiques) qu'il retire de la consommation de 2 par rapport à celle de 1 « vaut » pour lui la différence de coût entre 2 et 1. Mais 3 est mis sur le marché : 1 et 2 subissent simultanément l'obsolescence psychologique, la différence d'utilité sociale entre 2 et 1 est diminuée et il se peut qu'elle ne vaille plus la différence de coût. Le choix de l'individu se portera donc soit sur trois, si 3 est trop coûteux, sur 1.
Le raisonnement précédent fait intervenir un coût d'adoption d'une innovation. Dans le cas de l'automobile, c'est évidemment le prix payé par le consommateur. Mais dans le cas du médicament prescrit par le médecin ? Ce dernier ne le paie évidemment pas. A défaut de coût monétaire, il ne fait cependant pas de doute que le médecin doive surmonter certains obstacles d'ordre psychologique pour adopter une nouvelle thérapeutique. Une raison en est que le médecin a besoin d'être convaincu de la rationalité de ses actions. Pour qu'il décide de remplacer dans ses prescriptions un ancien produit par un nouveau, il faut qu'il se persuade de la plus grande efficacité de ce dernier. Cela pourra être d'autant plus difficile que le rythme de renouvellement des produits dans la catégorie thérapeutique considérée sera fort. On peut donc dire qu'il existe un coût psychologique d'adoption d'une innovation, d'autant plus fort que le médicament est récent.
Ce type de comportement régressif permet d'expliquer le succès de « bons vieux produits », dont la longue présence sur le marché semble constituer une exception paradoxale aux modifications incessantes de notre environnement matériel. Ce succès est assuré par ceux qui ressentent très fortement le coût, monétaire et/ou psychologique, des innovations. Mais leur comportement, on le comprend maintenant, loin d'être « déviant », s'explique fondamentalement par les mêmes mécanismes que le comportement plus classique de ceux qui « suivent le progrès »
Un deuxième mécanisme a trait à l'interdépendance entre producteur et consommateur que crée le phénomène d'obsolescence psychologique. Il va être possible de montrer que, contrairement aux « évidences » du raisonnement libéral, le consommateur peut être amené à payer plus cher pour le changement que ce changement ne vaut pour lui, mais sans pour autant que l'on soit obligé de supposer qu'il a perdu toute faculté de choix.
Soit un bien pouvant exister en deux qualités, notées 1 et 2 par ordre de performances techniques croissantes. Appelons U (1,1) l'utilité sociale pour un individu donné de la qualité 1, 1 étant seule
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 435
sur le marché (utilité sociale faisant intervenir, encore une fois, les dimensions physiques et non physiques du bien-être). La qualité 2 est mise sur le marché. De deux choses l'une, ou l'individu a intérêt à continuer à consommer 1, ou il passe à 2. Dans le premier cas, il est clair que son bien-être va diminuer puisque pour un prix identique il ne retirera de la qualité 1 qu'une utilité sociale U (1,2) inférieure à U (1,1) du fait de l'obsolescence psychologique de 1. Il faut montrer que même s'il a intérêt à consommer 2, son bien- ecre peut finalement öaisser.
2 étant mis sur le marché, l'individu consonhnera 2 si la différence d'utilité sociale entre les qualités 2 et 1, soit U (2,2) — U (1,2) vaut au moins pour lui la différence de prix notée P. Mais entre l'état initial où l'individu consommait 1 en l'absence de 2, et l'état final où il consomme 2, l'utilité sociale n'a. augmenté que de U (2,2) — U (1,1), quantité inférieure à U (2,2) — U (1,2) du fait de l'obsolescence psychologique de 1. Il se peut donc très bien que l'individu y perde finalement, c'est-à-dire que U (2,2) — U (1,1) soit inférieur à P, alors même que 2 étant mis sur le marché, l'individu a intérêt à consommer 2 plutôt que 1. La figure ci-après indique les positions respectives, sur un même axe, des trois grandeurs U (1,1), U (1,2) et U (2,2) et illustre cette possibilité logique 2°.
Obsolescence psychologique f de la qualité 1
1.2) U(2,2)
Différence de prix P
L'intérêt de ce résultat est de mettre en relief le piège qui est tendu au consommateur du fait de l'obsolescence psychologique. On
20. La « démonstration » donnée, comme celle qui concernait le phénomène régressif, peut être formulée de façon beaucoup plus rigoureuse, mais en utilisant un appareil mathématique d'un tout autre niveau. Le lecteur intéressé pourra se reporter à J.-P. Dupuy, « Innovation et obsolescence psychologique. Essai de formalisation dans le cadre d'une économie de marché », Cahiers du Séminaire d'Economêtrie, n° 15, 1973.
436 REVUE ECONOMIQUE
serait en effet tenté de dire, un peu rapidement, qu'il est en quelque sorte «forcé» de consommer le nouveau bien, puisqu'en fin de compte l'opération lui coûte plus qu'elle ne lui rapporte. Mais ce nouveau bien mis sur le marché, il vaut encore mieux pour lui le consommer que consommer l'ancien. Or, ce faisant, il assure la rentabilité commerciale du nouveau bien, et c'est donc lui-même qui scelle ainsi les barreaux de sa propre prison. C'est ce type d'interdépendance complexe entre producteur et consommateur qui nous paraît rendre le mieux compte de la réalité, plutôt qu'une causalité à sens unique, du type : le producteur fait ce qu'il veut du consommateur.
On mesure là combien est spécieux le raisonnement du libéral : « Vous dites que les gens sont malheureux à toujours courir après le dernier modèle automobile, le dernier type de poste TV, etc. ? Mais s'ils l'étaient vraiment, il leur suffirait de continuer à consommer comme autrefois, ils sont bien libres de le faire ! »
Le problème est que consommer comme autrefois aujourd'hui n'apporte plus du tout les mêmes satisfactions que consommer comme autrefois... autrefois.
On comprend également l'erreur logique qui est commise par ceux qui balaient toute mise en question de la contribution de ce que l'on appelle le « progrès matériel » au bien-être des gens d'un : « Personne ne souhaite sérieusement revenir dix ans en arrière. » II n'y a en effet nulle incompatibilité entre la constatation que des individus ayant « bénéficié » d'un progrès se sentent malheureux à l'idée d'être amenés à ne plus pouvoir en « bénéficier » (sous-entendu : les autres continuant, eux, à en bénéficier) et la possibilité que leur bien-être ait diminué du fait de ce progrès.
On comprend surtout par quels cercles vicieux complexes (et non par quelles manipulations) ce que l'observation directe révèle peut se produire : les consommateurs sont amenés à payer plus cher un bien-être décroissant. Bien sûr, tous ne sont pas logés à la même enseigne, mais tous sont finalement frustrés dans leurs aspirations et leurs désirs. Il y a ceux dont les ressources sont insuffisantes pour « suivre le progrès », et qui doivent se contenter de vieux biens rendus obsolètes. Il y a les « locomotives » du mouvement de diffusion des innovations, qui doivent toujours payer plus cher la volonté de rester en tête, et qui y perdent tous comptes faits. Il y a tous les intermédiaires, stratifiés selon la jeunesse et les performances techniques des biens qu'ils consomment. Il est donc intimement inscrit dans la logique du système que tant de ressources soient consacrées
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 437
à la conception et à la mise au point de nouveautés, et si peu à l'extension à tous de biens ou de techniques déjà mis au point. Le renouvellement rapide de notre environnement matériel et l'inégalité sont deux produits intimement liés de ce que nous appelions plus haut les « règles du jeu » de la société industrielle.
Ces résultats sont considérablement aggravés si l'on tient compte des répercussions indirectes et néfastes du changement accéléré, au premier rang desquelles nous classions la perte de qualité symbo-
tenu, il faut inclure dans P, qui est le coût de l'innovation, ces répercussions. On voit ainsi pourquoi il n'est nul besoin de supposer, comme le fait le libéral au mépris de toute évidence, que nos contemporains ne seraient plus sensibles à des valeurs de ce type, pour expliquer que leurs comportements en fassent apparemment si peu de cas. Le bilan est tel que nous aurions sans nul doute tous, collectivement, intérêt à nous arrêter, en tout cas à freiner ces rythmes fratricides. Mais les mécanismes sont tels qu'il est impossible à chacun, individuellement, d'agir autrement qu'il le fait. On a affaire à une situation absurde collectivement, bien que somme de comportements individuellement cohérents compte tenu des règles du jeu du système.
L'OBSOLESCENCE PSYCHOLOGIQUE ET LES MECANISMES DE LA PRODUCTION
Les raisonnements précédents s'inscrivaient dans le cadre d'une hypothèse optimiste : on y a admis que les caractéristiques des biens qui comptent pour l'obtention de bonnes performances sur les dimensions non physiques du bien-être, et qui font l'objet des surenchères que l'on a étudiées, sont par ailleurs des caractéristiques efficaces en termes techniques ou physiques.
Or, comme nous l'avons indiqué en commençant, l'observateur ne peut manquer d'être frappé par la « gadgétisation » du changement qui touche tous les domaines, y compris des domaines « sérieux » comme celui du médicament. C'est en étudiant la stratégie des producteurs face au phénomène d'obsolescence psychologique que nous allons en comprendre les raisons.
Les manuels de théorie économique ne connaissent en général qu'un mode de concurrence entre firmes : la concurrence par les prix. Paradoxalement, les cas où celle-ci s'exerce semblent de plus
438 REVUE ECONOMIQUE
en plus rares. La forme de concurrence la plus répandue est la concurrence par l'innovation. Pas étonnant, répondront certains : la concurrence par les prix tue le profit. Le modèle dit « de concur- rence parfaite » montre en effet que les prix tendent à se rapprocher alors des prix de revient. Une fois de plus, ce type d'argument paraît un peu court. Il est plus conforme à la réalité de dire que la politique d'innovation est moins choisie parce qu'elle est globalement favorable aux producteurs que parce que chaque producteur n'a pas intérêt à agir autrement compte tenu du comportement des autres.
Raisonnons en effet sur le cas schématique de deux producteurs en compétition dans la production d'un bien durable. Supposons que le premier essaie de conquérir la plus grande part du marché par une politique de faible dépense pour le consommateur, ce qui implique un bas prix et un produit conçu techniquement pour durer longtemps. Le deuxième producteur a alors intérêt à jouer la carte de l'innovation. Celle-ci provoquant l'obsolescence psychologique du bien produit par la première firme, ce bien sera moins désirable, sa durée de vie et donc la dépense pour son possesseur s'en ressentiront, deux raisons qui en éloigneront les consommateurs. Du fait de l'obsolescence psychologique, les producteurs n'ont pas en fait la maîtrise des paramètres qui leur permettraient de pratiquer une politique de faible dépense pour le consommateur. Face aux innovations destructrices de son concurrent, la première firme ne pourra contre-attaquer qu'en innovant à son tour, ce qui l'amènera à abandonner sa politique de bas prix, l'innovation coûtant cher et devant être soutenue par l'autofinancement. Chacun dès lors obligera l'autre à innover. En termes de théorie des jeux, la seule position d'équilibre stable est celle où chaque producteur adopte une stratégie d'innovation.
On peut même aller plus loin. Pour chaque producteur, il existe un rythme optimal d'innovations qu'il n'a pas intérêt à dépasser. Innover fréquemment a en effet des avantages : en favorisant un renouvellement rapide du marché, augmenter les ventes — mais aussi des inconvénients : l'innovation coûte cher, la dépense à la charge des consommateurs s'en ressent et peut les amener à freiner leur consommation, enfin des innovations trop fréquentes peuvent perdre toute crédibilité. Mais les innovations des uns entraînant l'obsolescence psychologique des produits des autres, aucun n'a la maîtrise de variables comme la durée de vie de ses propres produits, et personne ne peut s'en tenir à ces rythmes optimaux. Il faut innover
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 439
plus vite pour prévenir le pouvoir destructeur des innovations des autres 21. Ceci est une nouvelle raison de douter que l'explication des phénomènes en termes de « souveraineté des producteurs » soit très éclairante.
De fait, la concurrence par l'innovation avec obsolescence psychologique est particulièrement meurtrière. S'imagine-t-on ce que serait un championnat de boxe ou d'échecs si la simple apparition du challenger faisait perdre ses capacités au champion en titre ? La situation est _.._... ? _ _r 1 _r._ -/._■/. .. 1_ _; i__ : <.~ T~ „x^^^^.^A
d'innover fréquemment interdit pratiquement à la plupart des firmes d'entreprendre une véritable recherche fondamentale et appliquée : cette recherche, outre son coût, demande beaucoup de temps, trop de temps.
C'est ainsi que les laboratoires pharmaceutiques font le plus souvent une recherche ultra empirique qui consiste à synthétiser le plus grand nombre possible de molécules et à les tester systématiquement, pour apprécier leur activité, selon un processus très long, très complexe et très coûteux. Comme l'exprime si bien le professeur J.M. Pelt22, «faute de fil conducteur, chimistes et pharmacologues poursuivent le testage systématique de milliers de molécules, à la manière d'un serrurier qui consacrerait tous ses efforts à fabriquer des milliers de clefs de plus en plus perfectionnées, pour ouvrir une serrure qu'il ne connaîtrait pas. Or, plus le mécanisme est compliqué, plus faibles sont ses chances de tomber par tâtonnement sur la bonne clef ! On peut alors se demander si finalement il n'y aurait pas intérêt à démonter la serrure pour fabriquer ensuite la clef correspondante ! » Et effectivement, cette recherche symptoma- tique, hasardeuse, coûteuse et non coordonnée que pratiquent les laboratoires est à l'opposé de ce que serait une véritable recherche fondamentale, qui partirait de la connaissance de la « lésion biochimique » à l'origine de la maladie pour remonter à la thérapeutique.
Reste la politique dite de « développement », qui consiste à jouer de toutes les ressources de l'imagination, sinon scientifique et technique, du moins commerciale pour « faire du nouveau » avec de l'ancien. C'est donc sur des caractéristiques des produits souvent bien mineures que se jouera le jeu de la surenchère et de la différenciation que nous avons analysé au niveau de la consommation.
Un moyen de rendre crédible l'intérêt de ces modifications mineures et simultanément de tenter de protéger ses positions commerciales réside dans la politique de différenciation des produits.
21. En termes de théorie des jeux, on a affaire, du fait de l'obsolescence psychologique, à l'équilibre d'un jeu non coopératif à somme non constante qui n'est pas optimal.
22. Jean-Marie Pelt, Les médicaments, Le Seuil.
440 REVUE ECONOMIQUE
Lorsqu'une firme lance un nouveau produit, son problème essentiel est, dans le jargon du marketing, de le « positionner ». Il s'agit de lui créer une image précise et différenciée de telle sorte qu'il n'entre pas en concurrence directe avec un produit ancien. Il faut éviter que les consommateurs considèrent le nouveau produit comme un challenger d'un produit qu'ils connaissent déjà, et qui peut d'ailleurs appartenir aussi bien au producteur en question qu'à l'un de ses concurrents. En bref, il s'agit de présenter le produit non comme un nouveau moyen de satisfaire un besoin pour lequel il existait déjà des produits, mais comme la solution à un besoin spécifique pour lequel il n'existait rien jusqu'à présent. Il s'agit donc de multiplier et cloisonner les marchés de telle sorte que chaque produit soit en situation de monopole sur un marché : l'obsolescence psychologique devrait s'en trouver supprimée.
Chaque producteur a effectivement intérêt à pratiquer une telle politique mais si tous la pratiquent, globalement rien n'est changé. Le « pouvoir de résolution » du marché (cette expression ayant le sens qu'elle a en optique) est en effet limité, et il n'est pas possible de multiplier à l'infini les « créneaux » commerciaux. Arithmétique- ment parlant, chaque nouveau produit finit par en chasser toujours un autre. Chaque producteur peut simplement espérer que les produits chassés ne lui appartiennent pas. Finalement, l'obsolescence psychologique n'en est en rien supprimée.
C'est évidemment le rôle de la publicité et des techniques de marketing que de façonner ces images de produits, c'est-à-dire de calquer sur leur diversité une grille des fonctions techniques spécifiques qu'ils sont censés satisfaire. Les différenciations réelles étant souvent minimes, les différenciations commerciales pourront être inventées de toutes pièces, en fonction de l'imagination fertile des hommes de marketing, ce qui présente un inconvénient majeur : une gestion placée sous le signe de l'incertitude. Incertitude quant à l'image d'un produit qui se forgera finalement dans le marché, et qui peut être très éloignée de l'image de départ ; incertitude quant au risque éventuel de se concurrencer soi-même ; incertitude sur l'origine du succès ou de l'échec d'un produit, et donc sur la stabilité d'une position.
Comment un laboratoire pharmaceutique positionne-t-il ses produits par rapport à ceux de la concurrence et ceux qu'il a lui-même lancés auparavant ? On peut penser qu'il va tirer parti des différences d'identité et de propriétés thérapeutiques de ces divers produits. Certes, le type
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 441
de recherche que pratique l'industrie pharmaceutique conduit, on l'a vu, à ce que prolifèrent des spécialités très semblables les unes aux autres, mais ces différences existent néanmoins. On pourrait donc admettre, au moins dans les meilleurs des cas, que des diagnostics légèrement distincts conduisent à préconiser tantôt tel produit, tantôt tel autre. Mais, les laboratoires se heurtent alors à l'obstacle d'une certaine incapacité des médecins généralistes à pratiquer des diagnostics différentiels, leur savoir médical étant envahi par un pseudo-savoir pharmaceutique.
Dans ces conditions, la création d'une image différenciée pour un nouveau produit ne peut se faire que sur la base d'une différenciation
catégorisations cliniques du médecin. On jouera sur des oppositions du type : angoissés du matin-angoissés du soir. Ces images seront conçues, diffusées, suivies grâce à tout un jeu de moyens commerciaux puissants : utilisation de « noms de fantaisie », renseignements fournis par des panels, contacts directs avec les médecins grâce aux visiteurs médicaux, diverses formes de publicité : postale, presse médicale, congrès, etc. Tous ces moyens coûtent cher (on conçoit qu'il est d'autant plus coûteux de différencier commercialement les produits que leur différenciation réelle est faible, la notoriété d'une innovation majeure étant rapidement assurée par quelques déclarations de grands patrons, voire par la pression de l'opinion publique). Globalement, l'industrie leur consacre 15% de son chiffre d'affaires, contre 8 % pour la recherche.
Malgré cela le hasard et l'incertitude restent importants. L'image peut se former sur la base de faits très contingents. Ainsi, aux Etats-Unis et en Italie, le Librium est prescrit pour les grands anxieux et le Valium pour les petits anxieux. En France, c'est l'inverse. La raison en est qu'aux Etats-Unis et en Italie, le Librium existe sous forme de piqûre, alors qu'en France c'est le Valium qui est dans ce cas. Les situations où un laboratoire se concurrence lui-même sont fréquentes. Par exemple, le Nobrium s'est développé en grande partie au détriment du Librium, la consonnance voisine des noms donnant aux médecins l'impression qu'il s'agissait en gros de la même chose. « Tous les produits finissent par se grignoter, se superposer, ils prennent un marché qui n'est pas le leur », nous disait, désabusé, un directeur commercial de laboratoire.
C'est pour tenter de réduire ces incertitudes angoissantes que les constructeurs les plus audacieux, dans la lignée du marketing-mix, se livrent à des « segmentations » du marché automobile suivant des variables explicatives socio-démographiques lourdes telles que l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le revenu, la taille du ménage, le niveau d'instruction, etc., et des variables de situation décrivant le passé de la vie d'automobiliste des échantillons décrits.
Ainsi peuvent-ils relier de façon purement empirique, par la constatation de corrélations, ces échantillons segmentés et tel ou tel type de modèle existant et, par là, tenter d'estimer quel nouveau segment pourrait toucher tel nouveau modèle différencié des précédents par certaines caractéristiques. Son ampleur donne la valeur du maximum de pénétration possible pour le nouveau modèle dans l'ensemble du marché, et donc le maximum de production qu'il pourrait requérir. Il reste alors à savoir
442 REVUE ECONOMIQUE
quelle part du marché dans ce segment il pourrait prendre, et s'il ne risque pas de perturber ses voisins de « gamme » ; des raisonnements tout aussi empiriques conduisent à des estimations qu'on espère justes.
Lorsque l'ensemble de ces éléments semble favorable, on prend le risque de lancer le nouveau modèle (le risque financier et industriel sera d'autant plus réduit que celui-ci sera constitué de plus d'organes déjà produits en quantité importante : moteurs, châssis, roues, éléments mécaniques divers, etc.), et l'on vérifie a posteriori la justesse des prévisions. Dans l'état actuel de faiblesse théorique des explications avancées, nous estimons que la constatation d'un succès ne fournit pas d'arguments décisifs pour penser que les prochaines prévisions seront également judicieuses. L'incertitude demeure donc, malgré une certaine faculté d'adaptation organique de cette industrie à son milieu.
CONCLUSIONS
La réduction de la longévité des biens de consommation apparaît maintenant pour ce qu'elle est : non pas la traduction d'un prétendu goût général pour le changement, goût miraculeux puisqu'il irait dans le même sens que les « nécessités » du développement économique ; non pas le prix payé par les consommateurs pour que l'appétit de profit des producteurs puisse trouver de quoi se satisfaire ; mais le sous-produit d'une culture, au même titre que la rareté, les inégalités, les frustrations sans cesse renouvelées, la rupture de la communion qui s'est traditionnellement toujours établie entre l'homme et son environnement.
Quelles sont les origines de cette culture ? Il n'est pas possible de traiter ici cette question, qui imposerait une étude historique de l'évolution des représentations que l'homme s'est fait de la mort, du temps, de sa place dans le monde. Il est simplement évident que ce n'est pas le capitalisme qui a inventé cette culture, mais bien cette culture qui a inventé le capitalisme — à condition d'ajouter que le capitalisme dont il est ici question est celui qui s'étend de Washington à Moscou, en épargnant, pour un temps encore, la Chine.
Comment des règles du jeu aussi néfastes peuvent-elles se maintenir ? On a vu par quels mécanismes les producteurs sont amenés à se bloquer mutuellement dans une stratégie d'innovation à outrance, et par là dans une politique plus centrée sur le développement que sur la véritable recherche. Les plus lucides dénoncent cet état de choses et réclament aux producteurs des innovations vraies et techniquement valables. Les autres continuent de s'extasier devant la transformation d'un phare rond en phare carré, ou placent
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 443
tous leurs espoirs dans le nouveau médicament qui n'a de nouveau que le nom. Mais tous, les uns comme les autres, prisonniers de la logique du système, ont en commun ceci : ils ne s'imaginent pas que les problèmes de mobilité et de communication peuvent se régler autrement qu'en termes de moyens de transports toujours plus performants ; ils ne pensent pas que leur santé dépend d'autre chose que des progrès de la médecine ou de la recherche pharmaceutique. Conditionnés qu'ils sont à tout attendre de l'innovation industrielle, LxZ Cil C^l^licnt leur ZCZC.'Z*^'^ »■«»"-«•■»»'o ô nhannor \t> rr\r\T\c\o nui \(>C entoure. Et c'est ainsi que le système peut continuer à fonctionner, chacun s'en faisant le complice et la victime.
Que faire pour sortir de cette situation bloquée ? Faut-il interdire le changement, organiser une société figée ? Faut-il remplacer le vertige des rythmes fratricides par l'ennui de l'uniformité et du toujours pareil ? Le problème, bien entendu, n'est pas du tout là. Avec les règles du jeu actuelles, nous demander de nous passer de l'innovation industrielle, c'est comme demander à un drogué de se passer de sa drogue. Ce sont ces règles du jeu qu'il faut changer, ce qui ne veut pas dire souhaiter ou aménager une société immobile, mais simplement refuser un certain mode de changement, programmé et à sens unique. Comme dit Illich, il s'agit de « libérer l'avenir, de l'ouvrir à la surprise des actions personnelles. L'innovation industrielle est programmée, futile, réactionnaire. Le renouvellement des outils conviviaux aura la spontanéité et la fraîcheur des êtres qui les manieront... L'innovation du savoir comme celle du pouvoir peut fleurir là seulement où elle est protégée de l'usure industrielle » 23.
Comment donc changer ces règles du jeu dont tout découle ? Faut-il se contenter d'attendre une « révolution culturelle » en faisant confiance aux surprises de l'histoire ?
Il y a sans doute possibilité de faciliter les prises de conscience nécessaires. Diffuser largement des chiffres comme ceux de la vitesse généralisée de l'automobile, plus généralement mettre en œuvre une entreprise de démolition systématique des certitudes quant aux effets réels du prétendu progrès, devrait aller dans le bon sens.
Un blocage dont il a été peu question jusqu'ici devrait être attaqué de front et en priorité : celui qui s'attache à la valorisation sociale d'un certain type de travail dit « productif », au détriment d'autres formes d'activités créatrices. Il y a quelque ironie à constater qu'avec nos valorisations sociales, telles qu'elles se reflètent par
23. Ivan Illich, La convivialité, Le Seuil.
444 REVUE ECONOMIQUE
exemple dans la comptabilité nationale, mais pas seulement là, l'activité du « designer » ou du « concepteur » qui relance les ventes de tel modèle automobile en dessinant une nouvelle forme d'aile arrière est classée comme productive alors que celle d'un Socrate (qui, contrairement aux sophistes de profession, ne vendait pas ses leçons de sagesse) ne le serait pas. Si l'on veut sortir des cercles vicieux de l'innovation industrielle, il convient de préparer un renversement de ces valeurs. La garantie, non de l'emploi, mais du revenu en cas de « chômage », l'extension de formes de « travail » à temps partiel (les guillemets signifiant que ces mots sont utilisés dans leur acception actuelle qui révèle notre système de valeurs) sont des voies possibles.
Les analyses qui ont été développées dans cette note suggèrent par ailleurs qu'il peut être à la fois souhaitable et possible, avec les règles du jeu actuelles, de freiner le rythme des innovations et d'allonger la durée de vie des biens durables. L'économiste libéral a en partie raison, avons-nous vu, lorsqu'il affirme que les innovations ne font que satisfaire un besoin de changement, ne font que compenser l'usure psychologique des biens. Son tort est de ne voir dans ce phénomène qu'une caractéristique psychologique, justement, des consommateurs, en en occultant les fondements culturels, ce qui l'amène à ne pas distinguer le phénomène d' obsolescence psychologique, et les cercles vicieux qu'il entraîne. Car l'obsolescence psychologique, comme l'usure, oblige à innover pour se protéger contre elle, mais innover c'est aussi la provoquer. De telle sorte que plus les producteurs font d'efforts pour étancher la soif d'innovations de leur marché, plus ils l'attisent. On aboutit ainsi à une situation d'équilibre où chaque acteur social agit selon ses intérêts compte tenu du comportement des autres, mais que tous auraient intérêt à abandonner, producteurs compris, au profit d'une autre situation. Dès innovations moins fréquentes seraient suffisantes pour satisfaire le désir de changement ; elles permettraient aux producteurs de pratiquer une gestion moins périlleuse et moins soumise aux aléas des modifications d'image commerciale de leurs produits.
Il s'agit donc de mettre des bâtons dans les roues de la machine folle afin de la rendre un peu plus sage. On peut penser que des mesures allant dans ce sens favoriseraient du même coup l'apprentissage de règles du jeu plus satisfaisantes.
Les solutions techniques ne manquent pas, comme le montre l'exemple de l'automobile.
DURABILITE DES BIENS DE CONSOMMATION 445
Une étude fort sérieuse sur le plan technique, développée par Porsche, vise la construction d'un véhicule de longue durée de vie (le double de la durée moyenne actuelle, soit 20 ans environ), qui diminuerait le gaspillage de ressources minérales et d'énergie nécessaires à sa construction ; des organes spécialement étudiés pour une longévité accrue et une récupération aisée le constitueraient et son coût ne serait que de 30 % supérieur au coût d'un véhicule de performances utilitaires équivalentes. La société tout entière gagnerait donc à la généralisation de son utilisation : l'usager, du fait de sa dépréciation moins rapide compensant largement le «surcoût» à l'achat, les industriels, qui pourraient mieux amortir . il .. . , i __ i
favorable l'utilisation d'un cycle plus économique de fabrication-utilisation- récupération. La seule ombre au tableau pourrait être que le progrès technique pur, essentiellement en matière de sécurité, s'en trouve figé ; nous pensons que cet argument n'est pas pleinement convaincant : les constructeurs, moins soucieux d'innovations de perfectionnement pourraient faire aboutir plus vite des recherches de fond dans ce domaine et une conception astucieuse des véhicules, accompagnée par une réglementation intelligente permettrait d'intégrer leurs résultats aux véhicules déjà existants tout comme aux nouveaux, dans un appareil de production modifié au minimum ; par ailleurs, une maturité plus grande des utilisateurs leur ferait comprendre que la solution des problèmes de sécurité ne réside pas seulement dans la technique, mais aussi dans leur comportement (alors que jusqu'à ces derniers mois, toute amélioration de la sécurité primaire allait essentiellement à l'augmentation des performances à risque constant et non à la diminution de celui-ci à performances constantes).
Cependant, la mise au point d'une telle technique ne suffirait pas ; elle ne devrait être que le moyen d'une certaine politique cohérente de gestion des matières premières, d'amélioration de la sécurité et d'utilisation de l'automobile dans le cadre d'une politique globale des transports et de l'urbanisme. La simple mise en vente d'un tel véhicule sur le marché actuel de l'automobile ne constituerait probablement . qu'un fait marginal (par exemple 2e motorisation) venant grossir le lot des avortons institutionnels.
Ainsi l'existence d'une solution technique ne suffit pas. Il est nécessaire de passer par des mesures institutionnelles.
Dans le cas de l'industrie pharmaceutique, le problème est d'imposer de l'extérieur un frein au rythme de renouvellement des produits dans chaque catégorie thérapeutique. Que se passera-t-il alors en effet ? Chaque laboratoire se sentira beaucoup moins menacé par les possibilités d'innovation de ses concurrents. Du coup, il n'éprouvera plus lui-même la nécessité vitale d'<< innover » coûte que coûte et dans des délais brefs. Les arbitrages entre pseudo-recherche de développement et recherche fondamentale pourront donc être radicalement modifiés en faveur de cette dernière. Les innovations se feront plus rares, mais il s'agira de véritables innovations. Disparaîtra donc également la nécessité de différencier ses produits de leurs succédanés par les moyens publicitaires et commerciaux que l'on sait. Les pressions de toutes sortes sur les médecins
446 REVUE ECONOMIQUE
s'atténueront. Ceux-ci, n'ayant plus besoin d'apprendre à se reconnaître dans un univers grouillant et étranger de noms de produits, retrouveront une disponibilité de mémoire inespérée. Ils pourront la consacrer à un savoir médical authentique, et rétablir ainsi un équilibre aujourd'hui perdu. Finalement, on sera gagnant sur tous les tableaux : la recherche pharmaceutique, bien évidemment, les gestionnaires des laboratoires (plus de gestion dans l'incertitude des réactions d'un marché versatile), mais aussi leurs propriétaires (à moins qu'ils puissent nier que des produits de grande qualité ne rapporteraient pas en moyenne plus d'argent que des produits médiocres), la balance commerciale (pour la même raison), les chercheurs, les médecins... sans oublier la santé publique, tout le monde y trouvera son compte.
Une solution paraît très possible : la nationalisation de toute l'activité de commercialisation des produits pharmaceutiques qui est aujourd'hui le fait de l'industrie. Il s'agit de créer un Office national d'information médicale, géré par des représentants de l'Administration, de la Sécurité sociale, des médecins et de la profession pharmaceutique, dont les missions seraient de trier, sélectionner les nouveaux produits, en se montrant sévère dans l'appréciation du degré d'innovation, et de rassembler et diffuser le maximum d'informations à leur sujet.
Comme mesure d'accompagnement, il faudrait envisager la supression des noms de fantaisie des produits. Le médecin ne pourrait plus prescrire que des dénominations communes. Plusieurs laboratoires pouvant continuer à fabriquer le même produit (la nationalisation de l'industrie dans son ensemble n'étant pas envisagée dans cette hypothèse), ce serait au pharmacien d'officine de choisir, en tenant compte du sérieux des laboratoires, des techniques de fabrication qu'ils utilisent, de la qualité et du coût des produits.
De telles mesures ont déjà été proposées dans le passé, et elles furent toujours repoussées par la profession. Le lecteur peut se demander pourquoi, puisqu'elles sont censées améliorer la situation de l'ensemble des intéressés. C'est que ces mesures étaient toujours présentées à la suite d'analyses de la situation présente extrêmement culpabilisantes pour les laboratoires, comme moyen de mettre fin à des abus. Elles étaient dans ces conditions naturellement conçues et perçues comme une brimade et comme le début de la mainmise de l'Etat sur les affaires de la profession.
Ceci montre bien que toute intervention de cette nature ne peut être efficace que si elle découle d'un dialogue entre tous les partenaires sociaux. Mais ce dialogue doit lui-même reposer sur une analyse lucide de la situation actuelle, et non pas sur ce qui semble en tenir lieu trop souvent, c'est-à-dire un ensemble d'idées toutes faites et de raisonnements bâclés. C'est sans aucun doute cela le plus difficile.
Jean-Pierre DUPUY François GERIN (CEREBE) (CEREBE)
Related Documents