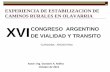Ouvrage coordonné par Françoise LESTAGE et María-Eugenia OLAVARRIA ADOPTIONS, DONS ET ABANDONS AU MEXIQUE ET EN COLOMBIE Des parents vulnérables Auteures : Amandine Delord, Séverine Durin, Félicie Drouilleau, Claire Laurant, Françoise Lestage, Gail Mummert, Maria-Eugenia Olavarria

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Ouvrage coordonné par Françoise LESTAGE et María-Eugenia OLAVARRIA
ADOPTIONS, DONS ET ABANDONS AU MEXIQUE ET EN COLOMBIE
Des parents vulnérables
Auteures : Amandine Delord, Séverine Durin, Félicie Drouilleau, Claire Laurant, Françoise Lestage, Gail Mummert,
Maria-Eugenia Olavarria
© L’HARMATTAN, 2014 5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.harmattan.fr [email protected]
[email protected] ISBN : 978-2-343-05147-5
EAN : 9782343051475
61
CHAPITRE II
SAUVER DES VIES.
MIGRATION FEMININE, GROSSESSE NON DESIREE ET PHILANTHROPIE ANTI-AVORTEMENT
AU MEXIQUE
Séverine Durin La dépénalisation de l’avortement est au Mexique un sujet
qui divise. Son approbation par l’Assemblée du District fédéral en avril 2007 a suscité une vague de réformes à la constitution de divers États qui protègent la vie dès la conception ou fécondation3. Même si la Constitution mexicaine prévoit depuis 1931 la non-pénalisation de l’avortement en cas de viol, depuis la seconde moitié des années 1970, le débat sur l’élargissement de sa dépénalisation a donné lieu à une polémique et des affrontements de positions. D’un côté, les féministes luttent pour le droit des femmes à disposer de leurs corps tandis que leurs opposants insistent sur la protection de la vie en gestation dès la conception ; ce qui a donné lieu à la création d’organisations au sein de la société civile, par exemple le Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto (Front National pour la Maternité Volontaire et et la Dépénalisation de l’Avortement), Católicas por el derecho a decidir (Catholiques pour le Droit de décider ) dont la position diffère de celle des membres de Vida y Familia A.C., (Vie et Famille, Association Civile) qui s’opposent à cette dépénalisation.
5. À partir de décembre 2008 et jusque janvier 2010, les États ayant réformé leur constitution sont : Basse Californie, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz et Yucatán. Voir www.gire.org.mx
62
Au-delà de ces confrontations sur l’avortement, au quotidien les femmes enceintes se heurtent à des dilemmes entre leurs désirs et leur capacité à devenir mère, pour des questions tant émotionnelles qu’économiques. Ces questionnements se font plus lancinants quand elles ne peuvent compter sur le soutien de leur compagnon, de leur famille, ou bien se voient sous la menace de perdre leur emploi à cause de leur grossesse. Au Mexique, malgré la promulgation de lois relatives aux droits des mères travailleuses, les femmes enceintes qui travaillent sont vulnérables et risquent le licenciement. Dans certains secteurs, tel le service domestique à demeure – qui se différencie du service domestique payé à la journée ou à l’heure – être enceinte suppose de façon presque systématique la fin de la relation employeur-employée (Durin, 2009).
Dans le contexte de l’augmentation de la migration des femmes indiennes vers la ville de Monterrey, lesquelles s’emploient principalement dans le service domestique à demeure, et de l’absence de droits qui protègent les employées domestiques lorsqu’elles sont enceintes, nous analyserons le fonctionnement du tissu associatif et institutionnel qui vient en aide aux femmes enceintes en détresse, veille pour les droits de l’enfance et considère l’adoption comme une alternative viable face à l’avortement et à l’abandon de nouveaux-nés. La plupart des associations, créées au long des quinze dernières années, justifient leur action en tant que mission, d’apostolat, pour sauver les bébés de l’abandon ou de l’avortement. Il faut souligner que ces femmes ne cèdent pas toutes leurs bébés en adoption, et la proportion d’adoptions peut varier considérablement d’une institution à l’autre. C’est dans ce contexte qu’au cours des quinze dernières années ont été créés à Monterrey des foyers pour femmes enceintes en détresse, au sein desquels il souvent possible de donner les nouveau-nés en adoption.
La ville de Monterrey est la troisième plus grande ville du Mexique et la capitale du Nord-est du pays. Elle forme une métropole avec huit autres municipalités. Historiquement, une élite d’entrepreneurs a été cruciale à son développement (Cerruti, 2000), et il y prédomine une pensée conservatrice qui
63
valorise le travail, l’effort, l’épargne et la famille, que certains qualifient d’idéologie libérale porfiriste (Zuñiga et Contreras, 1998). Or, si la croissance économique et démographique de la ville a reçu l’impulsion d’un important développement industriel, durant ces dernières années l’aire métropolitaine de Monterrey a subi de grandes transformations. On assiste à la croissance de l’économie des services (Garza, 2009) et à la conclusion de la première étape de métropolisation. D’une part, Monterrey a commencé à perdre de sa population en termes absolus, au bénéfice des autres communes (Durin et Moreno, 2008), et d’autre part la fragmentation urbaine est évidente.
Méthodologie
Cette étude est fondée sur le travail de terrain que j’ai effectué, à partir de 2008, dans un foyer pour femmes enceintes en détresse, sis à Monterrey4. C’est là que, dans le cadre d’un projet de recherche à ma charge sur l’insertion dans le monde du travail des femmes indiennes à Monterrey, qu’Alejandra León Saucedo a réalisé de mai à septembre 2008 un atelier que j’ai continué à animer jusqu’en mars 2010. Les portes de Casa Mi Ángel nous ont été ouvertes sans difficulté lorsque nous avons expliqué notre intérêt relatif à la situation des femmes enceintes, dans le cadre de notre recherche sur les migrantes indiennes, recherche dont une copie des résultats fut donnée à l’organisation, une fois conclue (CIESAS-CDI, 2008). C’est ainsi que j’ai pu continuer à animer, chaque lundi, l’atelier de projet de sortie du foyer, destiné à susciter la réflexion sur la préparation à la sortie de l’institution, comment trouver un logement, un emploi, qui s’occupera du bébé, la planification des éventuelles gestations futures, entre autres. Par ailleurs, sur demande de la responsable, j’ai présenté partiellement les
4 Dès 2004, mes recherches se sont centrées sur les Indiens à Monterrey, en insistant sur la situation des femmes, d’où une ample connaissance de la migration des femmes indiennes (Durin, 2008, 2009). Lors de travaux précédents, j’ai souligné la vulnérabilité des mères célibataires ainsi que le soutien apporté par les foyers, tels que Casa mi Ángel, A.C. et VIFAC (Durin, 2009).
64
résultats de la recherche aux membres du conseil d’administration, et préparé un rapport synthétique pour la réunion annuelle des donateurs.
L’association de bienfaisance privée (ABP) Casa Mi Ángel est dirigée par une douzaine de chefs d’entreprise, tous de genre masculin, qui forment un conseil d’administration dirigé par le fondateur de l’association. Ces messieurs se réunissent régulièrement dans un club pour traiter de sujets relatifs à leur activité professionnelle et, occasionnellement, pour informer leurs collègues des actions menées au foyer. Quant aux réunions du conseil (aussi appelé patronato), elles sont mensuelles et ne comptent parmi leurs membres qu’une seule femme, la coordinatrice du foyer. Celle-ci coordonne l’équipe de travail et est chargée, en outre, de la collecte de fonds. Les donateurs sont principalement des entreprises, nationales et multinationales, ainsi que des organismes gouvernementaux, comme le Desarrollo Integral de la Familia (Développement Intégral de la Famille), lesquels financent des projets spécifiques, par exemple le programme de prévention de la grossesse à l’adolescence, appelé ConSentir.
Quoique je n’aie jamais manifesté mon opinion au personnel ni aux futures mères quant à l’avortement, j’ai soutenu ma position en faveur de l’information des mères sur les méthodes contraceptives existantes. Sur ce point, la coordinatrice m’a communiqué que les membres du patronato ne jugeaient pas utile de les informer sur les moyens contraceptifs, cependant elle me laissa libre de réaliser cette activité, et n’en informa pas le patronato. Pour les Mexicains, dont la plupart sont catholiques et dévots de la Vierge de Guadalupe, la maternité est l’attribut le plus important de l’identité féminine (Lamas et al., 1994) ; Ana María Fernández soutient que, dans les pays à prédominance catholique, la « Femme » est assimilée à la « Mère », ce qui empêche de voir la diversité des rôles assumés par les femmes (1993). Ceci ne signifie aucunement que l’avortement ne soit pas pratiqué au Mexique5, mais plutôt que
5 Sur les chiffres relatifs à l’avortement au Mexique et les difficultés pour estimer son importance numérique, voir
65
les représentations dominantes quant à la maternité influent dans les débats sur la dépénalisation de l’avortement. S’il est vrai que la position contre l’avortement et « en faveur de la vie » repose en bonne partie sur celle assumée officiellement par l’Église catholique, il y a aussi des mères protestantes qui partagent cette vision, et des femmes catholiques qui militent pour sa dépénalisation, comme Católicas por el derecho a decidir (Catholiques pour le droit à décider).
Finalement, j’ai complété le travail de terrain à Casa Mi Ángel par des visites à d’autres foyers et crèches et des entretiens avec des personnes qui s’occupent de femmes enceintes et d’adoptions.
1. La vulnérabilité des employées domestiques au moment de la grossesse
Depuis une vingtaine d’années, on assiste à une participation
croissante de jeunes indiennes en provenance de la Huasteca (aire de culture qui se répartit principalement entre les états de San Luis Potosí, Veracruz et Hidalgo) comme employées domestiques à demeure, dans l’économie des services de l’aire métropolitaine de Monterrey.
Dans de précédentes études, j’ai souligné l’importance du cycle de vie dans la migration féminine et les trajectoires professionnelles des femmes, notamment que ces jeunes femmes travaillent comme employées domestiques à demeure tant qu’elles sont célibataires (Durin, 2009). Une fois mères, unies ou non par le mariage, certaines restent vivre en ville, d’autres retournent à leurs villages (Díaz, 2009) ; les plus vulnérables sont les mères célibataires (Durin, 2009).
Les anecdotes de muchachas – comme on désigne communément les bonnes – qui mettent fin à leur emploi pour cause de grossesse sont courantes. Normalement, être enceinte signifie la conclusion de la relation employée-patronne, car il est rare que cette dernière accepte que la domestique élève son
http://www.gire.org.mx/contenido.php?informacion=3, consulté le 25 février 2010
66
enfant dans sa maison. Quant aux employées de maison, elles savent, sans qu’on le leur dise, qu’elles ne seront plus les bienvenues une fois enceintes et sont conscientes que leur travail à plein temps ne durera que tant qu’elles resteront sans enfant. En soi, ce qui caractérise cet emploi est l’absence de médiation de la part de l’État et le caractère interpersonnel de la relation de travail. Le fait est que le Droit du Travail n’organise pas les relations de travail.
Du fait que les employées domestiques à demeure sont en majorité des migrantes, elles sont particulièrement vulnérables lorsqu’elles tombent enceintes. La grossesse est rarement la conséquence d’une décision prise en couple, mais de relations sexuelles où n’a été employée aucune méthode contraceptive, par ignorance ou par gêne de parler de sexualité en couple. En outre, lorsque la future maman est abandonnée par le père de l’enfant, le fait d’être migrante et éloignée de sa famille la prive de son soutien, notamment pour faire pression sur la famille de son compagnon afin que celui-ci assume ses responsabilités paternelles.
Dans les villages de la Huasteca, les histoires de mères célibataires abondent et l’on dit que « Monterrey engrosse ». Lorsque les mères sont célibataires, ce sont souvent les grands-parents qui se chargent d’élever leurs petits-enfants au village, pendant que leur fille travaille à Monterrey. J’ai appris qu’à l’occasion de la quatrième grossesse de leur fille (dont l’une avait impliqué de donner en adoption le nouveau-né), les grands-parents enregistrèrent leur dernier petit-fils comme leur fils à l’état-civil et se chargèrent de l’élever. Telle fut la solution trouvée pour résoudre les problèmes qu’entraîne une paternité non assumée, conjuguée au manque de prestations sociales en faveur des travailleuses domestiques. Or l’avortement et l’abandon de nouveau-né font l’objet d'un châtiment moral de la part de la société et constituent des délits aux yeux de la Loi.
Soulignons par ailleurs que cette situation d’abandon dans la grossesse n’affecte pas uniquement les jeunes Indiennes qui travaillent comme employées de maison : de jeunes primipares citadines ainsi que des mères de famille sont tout aussi
67
vulnérables. Les migrantes sont toutefois plus spécialement vulnérables du fait de l’absence de législation du travail en leur faveur en cas de grossesse, et de l’éloignement de leur famille. 2. La justification idéologique des actions institutionnelles
Les médias, en particulier la presse, signalent régulièrement
des cas de nouveau-nés abandonnés ; d’habitude, dans ces cas, ils rapportent les actions entreprises en faveur des femmes enceintes par le gouvernement et la société civile. L’analyse de ces articles de presse constitue une opportunité de dévoiler l’idéologie qui nourrit de telles actions.
En 2003, le journal le plus lu par les classes moyennes et supérieures de Monterrey, El Norte, lança une campagne en faveur du programme, qui débuta en 1997, Madres gestantes (Femmes enceintes) ; un programme du DIF de l’État du Nuevo León, une institution dirigée à ses différents niveaux par les épouses respectives du président, du gouverneur et des maires. Le titre de l’article était « 242 Bébés sauvés d’être jetés » (El Norte, 10 mars 2003). Il annonçait qu’il s’agissait d’« éviter que d’autres bébés soient jetés en raison de grossesses non désirées ». Le profil des responsables était connoté : « la plupart des femmes qui abandonnent leurs enfants ne sont pas de l’État » et « San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca et Querétaro sont les États qui concentrent le plus de gens qui viennent chercher du travail comme domestiques ou maçons au Nuevo Léon ». Sans jamais mentionner le mot Indiens, leur profil était signalé, par l’état d’origine des mères, leur activité économique ainsi que par les sites où le programme se déployait puisque « depuis novembre 2001 on a étendu le programme à la Alameda où se concentrent les couples venus d’ailleurs ». Comme l’a montré Díaz (2009) ce parc du centre-ville est un lieu de rencontres privilégié entre les migrants indiens à Monterrey. La directrice de Service de Protection des mineurs et de la famille ajoute que depuis le début du programme Madres gestantes, dans la section adoptions, « on s’est occupé de 242 femmes dont trois seulement sont du Nuevo
68
León ». Parmi ces femmes, quatre-vingt, c'est-à-dire un tiers d’entre elles, ont donné leur bébé en adoption.
De plus il ressort clairement de cet article que, si abandonner un bébé est un délit, le donner à adopter est infamant, puisque la représentante du DIF signale : « Après qu’une femme accepte de mener son bébé à terme pour le donner en adoption, nous lui faisons voir que c’est son enfant, elle reçoit une aide psychologique et à la fin, elle finit par garder son bébé, ce qui est le principal objectif du DIF ». Tout est dit : que la mère ait son bébé et l’élève elle-même, c’est ce qui est correct.
Dans ce même reportage, il était question de trois cas d’abandon de nouveau-nés le mois précédent, l’un dans une poubelle de la gare routière, le second dans un terrain vague et le dernier, trouvé dans une maison où travaillait une domestique. De ces femmes, « de Tamazunchale et Xilitla, villages de San Luis Potosí » il était écrit que « vu leur culture et leur façon de vivre […] elles pouvaient se faire tuer pour cette faute » (celle d’avoir un enfant sans reconnaissance de paternité). Or, le même jour, un autre article fut publié « Les pleurs de son bébé changent sa décision » sur le cas d’une jeune femme originaire de Monterrey qui avait décidé de donner en adoption son troisième enfant, faute de soutien de son compagnon et faute de revenus. Le journaliste raconte que la maman s’est ressaisie au moment de voir son bébé « qui me ressemble tellement ! De la voir si petite et sans défense, ben… ça te fait changer d’opinion ». La conclusion : « Elle a pris la bonne décision ». Par-delà le langage qui souligne le geste civilisé de la jeune femme face aux délits commis par les employées de maison « pas d’ici, des paysannes », il n’y a aucun doute que l’adoption non plus n’est pas acceptable. On continue à la considérer comme une renonciation à ce qui est correct : une femme qui a mis au monde doit élever son enfant.
Tout au long du mois de mars 2003 furent publiés divers articles à ce sujet dans le même journal et, pour conférer plus de légitimité au programme du DIF, un cas fut signalé : « Le cas d’une domestique sonne l’alarme » (El Norte, 13 mars 2003) une semaine après la présentation du programme Madres Gestantes du DIF. À l’annonce d’un infanticide sur un
69
nouveau-né, le président de Casa Mi Ángel remit en question la moralité de ces jeunes : « Il y a une situation très critique avec les employées de maison : beaucoup de ces filles sortent le samedi midi et reviennent travailler le lundi matin, mais où passent-elles les nuits de samedi et dimanche ? ». Le journaliste ajouta que « c’est dans la pénombre de l’Alameda… qu’une nombreuse jeunesse conçoit des enfants non désirés » et mentionna les coordonnées téléphoniques de trois associations qui offrent secours aux femmes enceintes en détresse, en plus du DIF.
La campagne médiatique généra l’augmentation des appels téléphoniques de dénonciation et se conclut avec l’article intitulé « Ne jette pas une vie, demande le DIF » (El Norte, 28 mars 2003). Le DIF y annonce qu’il se chargera également de la prévention des grossesses non désirées parmi les adolescentes citadines avec la projection d’une vidéo dans les collèges, afin de « faire prendre conscience à la population de ne pas laisser tomber les mineur(e)s, de prévenir les grossesses non désirées ou, à défaut, de promouvoir l’adoption, de prévenir l’avortement et la maltraitance prénatale ». L’institution reconnaissait ainsi que la situation de vulnérabilité face à une grossesse non désirée n’était pas l’exclusivité des migrantes et affectait également la jeunesse urbaine.
Au fil des ans, des cas d’abandons de nouveau-nés continuèrent à être rapportés avec une certaine régularité, la presse poursuivant sa campagne pour les prévenir. Les employées de maison y sont souvent présumées coupables; ainsi, en juillet 2006 fut rapporté le cas d’une nouveau-née abandonnée, qui fut secourue à temps. Dans « Bébé abandonnée sort de l’hôpital » (El Norte, 21 juillet 2006) on conclut que « la personne ayant abandonné le bébé serait une femme venue à la ville pour travailler comme employée de maison ». Dans El Norte, les représentations à propos des Indiens, spécialement celles relatives au service domestique, tendent à les stigmatiser comme « ignorantes, manipulables, infantiles et obscènes » (Moreno, 2008). Dans l’article de presse, le poids de la représentation a occulté la réalité : trois jours après sa publication, il s’avéra que la jeune mère était une citadine. Elle
70
avait abandonné la nouveau-née à l’issue d’une dispute avec sa mère (El Norte, 22juillet 2006). Deux ans plus tard, un nouvel article rapportait un cas similaire et signalait que « la principale hypothèse est qu’il pourrait s’agir d’une employée domestique n’ayant pas beaucoup fréquenté l’école » (Vidéos de recherche de la mère de bébé abandonné, El Norte, 10 septembre 2008).
Les employées domestiques à demeure ne sont pas les seules à affronter la maternité dans la solitude et la détresse. En mai 2009 on rapporta un cas dans l’un des quartiers les plus huppés de l’aire métropolitaine de Monterrey. « Un nouveau-né est jeté aux ordures » ; El Norte (23 mai 2009) annonce que celui-ci a été trouvé par une jeune riveraine et emmené à la police municipale. Quelques jours après, les grands-parents du bébé sont allés le chercher après « s’être présentés à l’hôpital pédiatrique pour réclamer le bébé et se soumettre à un test comparatif d’ADN » (Entregan a abuelos al bebé abandonado”, El Norte, 26 mai 2009). Le suspense se termina le 26 mai lorsque la jeune femme qui était supposée avoir trouvé l’enfant reconnut être sa mère (“Descubren farsa a mamá de bebé”, El Norte, 28 mai 2009). On est frappé par le fait que celle-ci avait caché sa grossesse durant des mois et avait « inventé ce conte pour se protéger d’un affrontement avec ses parents ». La sexualité est tabou, l’avortement un délit pénalisé et l’adoption a beau être promue par le programme du DIF, cela ne l’empêche pas d’être considérée comme une déviance. Selon les représentations dominantes sur l’identité féminine au Mexique, on s’attend à ce que les femmes se consacrent à leurs enfants (Lamas, 1994), avec ou sans le soutien des pères.
3. Les femmes de Casa Mi Ángel
Dans ce contexte, protéger les femmes délaissées pendant
leur grossesse constitue la meilleure manière de « protéger la vie », comme le souligne le titre d’un article sur Casa Mi Ángel (“Su misión: proteger la vida” El Norte, 9 novembre 2008). Dans ce foyer on reçoit des femmes enceintes dans la détresse, quelles que soient leur origine nationale, ethnique ou religieuse.
71
Pendant le travail de terrain effectué, les bénéficiaires étaient des jeunes femmes d’origine urbaine, originaires de plusieurs Etats, de jeunes paysannes et indiennes de la région huastèque et des migrantes centraméricaines : sur un total de 34 femmes que j’ai connues, 15 provenaient de zones rurales et indiennes, 17 de villes et 2 venaient d’Amérique centrale (Salvador et Honduras).
Selon la responsable, psychologue de formation, les migrantes indiennes connaissent un important changement dans leur style de vie lorsqu’elles sont embauchées en ville et, quand elles se réunissent à l’Alameda lors de leur jour de repos, elles s’initient à la consommation d’alcool et à la sexualité. La multiplication des hôtels de passe et des bars aux alentours est un témoin de ce phénomène. Quant aux émigrantes internationales, il s’agit de centraméricaines qui se rendent vers les États-Unis. Leur voyage dure habituellement des semaines, des mois même, elles traversent les états du Chiapas, Puebla, Veracruz, arrivent à Monterrey et, pendant le trajet, certaines sont violées ou se livrent à des rapports sexuels non protégés. La psychologue commente : « Dans une zone du Golfe du Mexique, vers la Mer des Caraïbes, on a retrouvé des cadavres de bébés » ; c’est ce qui a donné lieu à la création, il y a deux ans, d’une maison jumelle de Casa Mi Ángel à Cancún. Elle souligne aussi que les jeunes filles qui sont hébergées ne sont pas toutes migrantes ou pauvres, « il y a aussi des filles de la haute », y compris des étudiantes de prestigieuses universités privées. Elle signale que la grossesse non désirée n’est pas l’apanage d’une classe sociale, et ajoutant qu’« ici, on ne juge pas, nous recherchons toutes le soutien d’un compagnon dans la vie » (Entretien du 16 juillet 2009).
Elle considère que l’on pourrait ajouter un quatrième groupe, moins nombreux, de femmes d’origine étrangère qui sont enrôlées dans les circuits de prostitution: elle se souvient de quatre femmes originaires de Hongrie, d’Espagne, du Canada et d’Argentine, amenées au Mexique après qu’on leur eut promis de « faire du cinéma », lesquelles ont été enrôlées de force comme danseuses dans des cabarets.
72
Parmi les citadines, les jeunes femmes sont habituellement en conflit avec leurs parents à propos de leur compagnon et de leur grossesse, et se retrouvent en détresse quand ce dernier les abandonne ou maltraite. Carina, par exemple, est arrivée d’une autre ville avec son compagnon, qu’elle avait épousé contre l’avis de son père qui professait une autre religion. Jusque-là, Carina avait travaillé dans la boutique de sa défunte mère ; elle a perdu son emploi quand le couple est venu à Monterrey. Ils y ont trouvé hébergement à l’association de bienfaisance privée Caritas durant un mois tandis que le mari obtenait un emploi, pour ensuite louer une chambre. Lorsqu’il se retrouva chômeur, il eut un jour un accès de violence dans la rue et la gifla ; c’est alors qu’un chauffeur de taxi s’arrêta pour la défendre et la ramena à Caritas. Comme elle était enceinte, elle fut transférée à Casa Mi Ángel. Elle y resta quelques semaines, jusqu’à ce que son mari entre en contact avec elle, lui annonçant qu’il avait retrouvé du travail et lui demandant de reprendre la vie commune, ce qu’elle accepta après y avoir réfléchi plusieurs jours. Comme Carina, d’autres jeunes citadines en conflit avec leur famille et délaissées arrivent au foyer, de même que des mères de famille enceintes souffrant de violences infligées par leur compagnon. Parmi ces femmes, c’est rarement le motif économique qui prévaut, mais plutôt la violence subie et la rupture des liens familiaux qui les rendent vulnérables.
La situation des employées de maison émigrées de la région Huastèque est différente. Les motifs de leur arrivée au foyer répondent à une combinaison de facteurs : le manque de soutien de leur compagnon, la réprobation des parents envers la grossesse et la perte de l’emploi.
J’ai aussi connu des mères de famille indiennes, anciennes domestiques, qui arrivent de leur communauté pour demander l’aide de Casa Mi Ángel et donner un enfant en adoption. Irene, tout au long de sa jeunesse, a alterné les périodes de travail en ville avec celles où elle élevait ses filles au village. Elle a commencé à travailler en 2000, encore adolescente, dans une maison de Monterrey où elle était chargée des tâches de nettoyage ainsi que du soin des enfants. Lorsqu’elle tomba enceinte, faute de l’aide de son compagnon, elle retourna
73
accoucher dans son village où elle resta élever sa fille, jusqu’à ce que celle-ci ait deux ans. Elle la laissa alors aux soins de ses parents pour revenir travailler à plein temps à Monterrey. Enceinte de nouveau, elle retourna au village et travailla comme domestique dans le bourg. Enceinte une troisième fois d’un homme qui ne comptait pas assumer ses responsabilités, elle s’en alla à Monterrey pour y donner son nouveau bébé en adoption par l’intermédiaire de Casa Mi Ángel, où quelques années avant elle avait emmené une amie enceinte. Un mois avant le terme, Irene se demandait encore si elle devait donner l’enfant en adoption ou le garder car « il lui serait très difficile d’en élever un de plus » ; l’unique option à sa portée pour subvenir à ses besoins était de retrouver un emploi comme employée domestique à demeure, où les enfants sont rarement les bienvenus.
Tel est le cas de Berenice qui a perdu son emploi comme domestique pour cause de grossesse. C’est l’une des rares que je connaisse dont le compagnon ait reconnu sa paternité6, cependant, comme il habitait dans l’État de San Luis Potosí, la perte d’emploi de Berenice était inéluctable et signifiait une grande précarité économique. C’est pourquoi elle se rendit au foyer. Autre particularité notable : c’est sa patronne qui l’a conduite à Casa Mi Ángel à ses huit mois de grossesse, alléguant qu’elle y serait plus en sécurité.
La vulnérabilité des Indiennes et des émigrantes centraméricaines est similaire, bien que celle de ces dernières
6 Je suis consciente du fait que cet article apporte peu d’information
sur les progéniteurs, à cause des conditions de réalisation du travail de terrain : au foyer se trouvaient des femmes enceintes qui avaient été abandonnées ou battues, à une exception près (Berenice). Les hommes de leurs vies n’étaient pas le centre d’attention dans l’atelier, focalisé sur la mise au point de stratégies pour trouver un emploi et un logement au terme de leur séjour, et le partage d’informations relatives à l’utilisation des contraceptifs, l’allaitement et l’alimentation durant la grossesse. Je n’ai jamais réalisé de sessions sur les rapports de couple aussi parce que je n’avais pas la formation professionnelle pour mener à bien des dynamiques qui impliquent de se remémorer des expériences très douloureuses.
74
soit aggravée du fait de ne pas être citoyennes mexicaines. Lina est du Honduras, où elle a laissé ses onze enfants à la charge des aînés auxquels elle envoyait des virements tandis qu’elle vivait à Tapachula, au Chiapas, avec son compagnon. Elle s’y occupait de vieillards dans une maison de retraite, puis elle a travaillé dans une boulangerie jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte, et c’est alors que le couple décida de partir vers les États-Unis. Près de la frontière, un chauffeur de poids lourds leur proposa de les en rapprocher ; sous ce prétexte il s’empara de Lina après s’être débarrassé du conjoint. Malgré son apparente grossesse, il la viola, puis l’abandonna presque nue et terrorisée dans un terrain vague. Une femme l’y recueillit et, après un passage par l’hôpital et les bureaux de l’immigration à Monterrey, elle se retrouva à Casa Mi Ángel. Elle donna naissance à des jumeaux et espérait rentrer au Honduras une fois réglée sa situation migratoire.
Toutes les femmes que j’ai connues à Casa Mi Ángel étaient vulnérables en raison de leur condition ethnique, de classe et de genre, et ont été l’objet de diverses violences et de ruptures affectives et professionnelles qui rendent difficile l’accueil du nouveau-né.
4. Un réseau d’associations et d’institutions de soutien à la femme enceinte et de promotion de l’adoption
Remarquons que parfois ce sont les patronnes qui conduisent
les femmes enceintes aux maisons d’assistance qu’elles connaissent. Quelques-unes acceptent de recevoir chez elles un nouveau-né, à condition que la famille de l’employée de maison ne continue pas à grandir, selon une volontaire de FILIOS, « tu sais comment on est avec les bonnes : si elles tombent enceintes, elles se font jeter »… Cependant, certaines patronnes ne veulent pas que pèse sur leur conscience la responsabilité d’un avortement ou d’un abandon ; tel a été le cas de Berenice, que nous venons de relater. Lorsqu’elle annonça sa grossesse à sa patronne, celle-ci s’est attristée et m’a dit : « Non… si jeunette !… Mais c’est bien que tu ais décidé de ne pas avorter, tu as du mérite d’avoir décidé de le garder ». Elle a même
75
ajouté : « ôter la vie à un être qui grandit à l’intérieur de toi, dont le cœur commence à battre, c’est un péché car c’est déjà un être humain » (Entretien du 13 octobre 2009). Survient alors une convergence d’intérêts entre les employeurs, désireux de mettre un terme à la relation de travail sans porter préjudice à la vie de l’enfant, et les organismes qui secourent les célibataires enceintes.
Face à l’augmentation de la migration féminine pour travailler comme domestiques, la précarité des travailleuses et le phénomène concomitant de détresse des femmes enceintes, des secteurs de la société civile et de l’État ont réagi afin d’éviter que des mères ne recourent dans leur désespoir à l’avortement, à l’abandon ou à l’infanticide. C’est dans ce contexte que s’est constitué un réseau d’associations civiles qui se chargent, les unes du soin des femmes enceintes en détresse, les autres, de canaliser les bébés à adopter, sous la vigilance des lois et instances étatiques relatives à l’adoption. Trois foyers accueillent les femmes : VIFAC et Casa Mi Ángel sont les plus anciennes, respectivement de 15 et 12 ans d’existence à Monterrey, et le foyer de Casa Cuna Conchita ouvert depuis 2009. Celui-ci et VIFAC disposent aussi d’une pépinière, tandis que FILIOS accueille des enfants en attente d’être adoptés, de leur naissance jusqu’à sept ans ; n’étant pas foyer pour futures mamans, cet organisme envoie celles qui en ont besoin à Casa Mi Ángel et assure la couverture de leurs frais médicaux jusqu’à l’adoption.
Avant la création de ce réseau, il n’existait aucun recours pour les femmes enceintes, seulement des pépinières qui accueillaient des bébés en attente d’adoption. La responsable du foyer de Casa Cuna Conchita explique qu’« avant, il y avait un déficit du côté de l’attention aux femmes ». Le foyer est récent et date de 2009, alors que la pépinière a été fondée il y a soixante-dix ans, et fonctionnait alors comme une crèche pour les enfants des femmes qui travaillaient et aussi comme centre d’adoption. « Il y a eu jusqu’à mille enfants », commente-t-elle. Au fur et à mesure des changements sociaux, la structure d’accueil s’est transformée et médicalisée : ouverture d’une école d’infirmières, d’une maternité et, dans les années 1970,
76
création d’une section de chirurgie et de rayons X. Cette clinique renommée fait maintenant partie d’un groupe médical qui compte deux autres centres hospitaliers à Monterrey et un à San Antonio (Texas).
En ce qui concerne le gouvernement de l’état du Nuevo León, le DIF est responsable d’une structure d’accueil pour les enfants maltraités et orphelins, appelé Capullos. Il est responsable du programme Madres gestantes (Mères enceintes) qui offre aux futures mamans un contrôle médical prénatal, soutien psychologique et, au cas où elles nécessitent un foyer, les défère à Casa mi Ángel. La responsable du programme commente que « beaucoup donnent en adoption parce qu’elles ne peuvent assumer cette responsabilité » et, une fois leur décision prise, après l’accouchement, on les dirige vers le département légal pour qu’elles manifestent officiellement leur consentement. Le bébé reste au Centro Capullos jusqu’à ce qu’une famille l’adopte. L’institution qui enregistre la signature de la cession de la garde pour la mère est la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia ( Procureur pour la défense des enfants et de la famille), un service du DIF. Toutes les associations et institutions ont l’obligation d’y amener les mères désireuses de donner leur enfant en adoption, afin d’y enregistrer leur consentement ; elles ont un mois pour se désister, délai durant lequel le bébé reste aux soins de l’un des hospices enregistrés, qui en reçoivent la garde transitoirement. Conchita et VIFAC les ont en garde uniquement ce premier mois, alors que FILIOS peut les accueillir jusqu’à leurs sept ans ; après quoi ils sont pris en charge par des institutions dont le siège se trouve à Mexico.
Ces acteurs font partie du Conseil des Adoptions de l’État du Nuevo León (Consejo estatal de Adopciones), instance dirigée par le gouverneur et la directrice du DIF de l’État du Nuevo Léon, la direction du centre Capullos et le procureur de la Défense du Mineur et de la Famille ou leurs suppléants respectifs. Assistent également à ce conseil, qui se réunit mensuellement, un représentant du Conseil de Développement social, des Secrétariats du Gouvernement, de l’Éducation publique, de la Santé, de la Commission des Droits de
77
l’Homme, de VIFAC, FILIOS, Casa Cuna Conchita, Casa Paterna la Gran Familia (foyer pour enfants, actuellement en passe de se transformer en école) ainsi que d’une association de parents adoptifs. La fonction de ce conseil est de veiller au bien suprême des mineurs et de donner l’autorisation entérinant le processus d’adoption. En 2008 au Nuevo Léon, 92 adoptions internes ont été réalisées, c’est-à-dire par des grands-parents ou l’époux de la mère lorsque la conception s’est faite hors mariage, et 58 adoptions externes. Il faut remarquer que, le Mexique étant une fédération, le cadre législatif varie d’un État à l’autre.
En matière d’adoption, les quinze dernières années ont été le théâtre de changements, avec la création de foyers pour femmes enceintes en détresse et, au cas où ils fonctionnent aussi comme pépinières, pour leurs bébés. Ceux-ci ont en moyenne une capacité d’accueil de 15 personnes. VIFAC apparaît dans l’état de Mexico il y a plus de 20 ans, dans le contexte du débat de la dépénalisation de l’avortement. Ses fondatrices étaient membres de l’élite locale et ont commencé leur action au moyen de réunions de sensibilisation sur la sexualité responsable, puis ont ouvert des foyers et se sont chargées d’adoptions. Le premier foyer fut celui de Monterrey, il y en a actuellement 18 dans tout le pays. Selon leur brochure, l’association Vida y Familia, A.C. (Vie et Famille Association Civile), s’appelle ainsi parce que : « Vie : droit par excellence et notre souci central, puisque de nombreuses femmes dans le désespoir attentent contre elle et celle de leur bébé. Famille : institution sociale où doit grandir tout enfant, que sa famille soit biologique ou adoptive » (Tríptico informativo 2005/2006 de VIFAC).
Casa mi Ángel a aussi donné le jour à un réseau de foyers dans tout le pays. Comme VIFAC, c’est à Monterrey qu’elle a ouvert son premier foyer ; durant des années, elle y avait hébergé les proches de malades soignés à l’Hôpital régional de l’IMSS, jusqu’à ce que le fondateur, en visite à un lieu de culte à la Vierge Marie à Atlanta (Georgia, USA), reçoive un message divin l’invitant à ouvrir un foyer pour femmes enceintes. Il joignit donc ses efforts à ceux d’amis entrepreneurs et offrit sa maison natale pour y héberger ces femmes. Il voit
78
cette action comme un apostolat, une mission, qu’il a rempli en tant que catholique au nom de sa foi, car c’est « le Patron (Dieu) qui l’a voulu ».
Il faut rappeler que VIFAC, Casa Mi Ángel, ainsi que FILIOS sont des associations civiles administrées par des membres de la classe dominante, qui vivent de dons privés (entreprises, personnes), soupers de gala, loteries de Noël, et qui reçoivent parfois un subside du gouvernement de l’État.
VIFAC est un internat clos, les femmes y assistent à des cours, reçoivent une orientation spirituelle, collaborent aux tâches ménagères ; elles ne sont pas autorisées à sortir et ne peuvent recevoir de visites que deux heures, le dimanche. À Casa Mi Ángel, les activités quotidiennes sont identiques, mais comportent un horaire de sortie, tandis que les femmes de Casa Cuna Conchita y viennent en majorité pour effectuer leurs contrôles médicaux ; peu d’entre elles logent au foyer. En général, les femmes hébergées sont originaires d’autres états, « La plupart viennent du Chiapas, de San Luis Potosi, Hidalgo, Oaxaca et d’autres états du sud » ; ainsi, des 24 adoptions réalisées de juillet 2008 à juin 2009, un cinquième seulement étaient du Nuevo León. Les futures mères s’y réfugient parce que « elles ont été victimes de viol, ou ont trompé leur mari alors qu’elles sont de la haute société, ou parce qu’elles ont déjà trois enfants au rancho et n’en veulent pas d’autre ». Quand elles viennent, elles sont décidées à donner le bébé en adoption.
C’est le cas des femmes qui se réfugient à VIFAC ou à Casa Cuna Conchita, où elles savent qu’elles pourront laisser leur enfant en adoption. Dans le cas de VIFAC, les chiffres officiels pour 2005/2006 sont de plus de 40 % de bébés cédés en adoption au Nuevo León, ce qui correspond à la moyenne nationale de 42 % sur une période de 22 ans (Rapport annuel VIFAC pour 01/10/2005 - 01/10/2006). À Casa Mi Ángel le taux est moindre : de 1999 à l’été 2009, il n’atteint que 24 %. Selon la psychologue du foyer « celles qui donnent en adoption ont d’autres projets : gagner de l’argent, se marier, etc… un autre projet de vie ». Tout au long de leur grossesse les femmes réfléchissent et la plupart finissent par décider de garder l’enfant.
79
Chez FILIOS, c’est le cas de neuf sur dix, selon la personne chargée d’emmener les futures mamans à la consultation prénatale. Elle se rappelle d’une mère originaire de San Luis Potosí qui avait eu une première fille par césarienne. Lors d’une seconde grossesse, alors que sa situation économique était difficile, elle opta pour l’adoption. Durant sa grossesse, elle est restée à Casa Mi Ángel avec sa petite fille : le lendemain de l’accouchement, le couple s’est repenti et a décidé de garder le bébé. En revanche, il y a aussi des femmes qui décident de céder leur enfant des mois après la naissance, comme « cette femme du Veracruz qui, ne pouvant prendre soin de son bébé, l’avait laissé à une amie au village, mais six mois après elle s’en est repentie, l’amie lui demandait tout le temps de l’argent, elle préféra alors l’adoption. Elle m’a appelée et nous sommes allées faire les démarches » (Entretien mené le 16 juillet 2009).
Conclusion : philanthropie anti-avortement et vulnérabilité des travailleuses
La création des foyers pour femmes enceintes en détresse
débute dans les années quatre-vingt-dix dans un contexte polarisé autour de la dépénalisation de l’avortement7. Rappelons qu’en 1983 le président Miguel de la Madrid essaya de modifier le code pénal pour réformer les dispositions relatives à l’avortement et à l’adultère, initiative rejetée face à la forte réaction de l’Église catholique et de groupes conservateurs. VIFAC se créa en 1985 ; en 1989, tandis que des cliniques pratiquant l’avortement étaient fermées, la procuration de justice du District Fédéral (D.F.) et le ministère de la Santé établissaient les bases pour que les femmes victimes de viol puissent avorter légalement. En 1990 les causes justifiant l’avortement ont été étendues et la réaction ne s’est pas fait attendre : Église catholique et parti de droite (PAN) ont fait opposition et la réforme a été gelée. La lutte continue, entre
7 (http://www.gire.org.mx/contenido.php?información=42, consulté le 25 février 2010)
80
partisans et opposants à la dépénalisation de l’avortement, et elle s’est intensifiée durant toute la décennie.
Ainsi donc, le premier débat national a eu lieu il y a plus de trente ans, au moment où VIFAC s’est fondé et, à sa suite, son réseau de foyers ; une vague de réformes conservatrices dans plusieurs états a suivi la dépénalisation de 2007 du District fédéral. Cependant, la création de foyers pour femmes enceintes à Monterrey coïncide avec l’augmentation spectaculaire de la migration féminine d’origine indienne au Nuevo León à partir des années quatre-vingt-dix. Entre 1990 et 2005, le nombre des locuteurs en langue indigène dans l’entité s’est multiplié par six et huit femmes indiennes sur dix intègrent le marché du travail comme employées de maison (Durin, 2008, 2009). Éloignées de leur foyer, sans protection légale au travail, elles sont particulièrement fragiles en cas de grossesse. Elles passent alors d’une situation de travailleuses hébergées à celle de sans-logis ; les foyers, qui reçoivent également des femmes maltraitées par leur conjoint ou leur famille, leur offrent un hébergement, et le cas échéant, la possibilité de donner le nouveau-né en adoption.
L’idéologie qui sous-tend les actions en faveur de ces femmes pourrait être qualifiée de philanthropie anti-avortement, étant donné que ce qui importe aux âmes bienfaisantes c’est que les bébés engendrés voient le jour. Dans les présentations que réalise Casa Mi Ángel, l’association met en avant le fait que le Mexique est en-tête pour les avortements, et qu’en 2007 et 2008 ont été réalisés 15 000 avortements dans sa capitale (D.F.), dont un quart d’adolescentes. Par ailleurs, Casa Mi Angel souligne que « des bébés sont jetés aux ordures » et que beaucoup sont abandonnés. Le discours associatif s’appuie sur les articles de presse référant 315 cas en 16 mois, et conclut qu’il faut agir. De la même manière similaire, VIFAC stipule que sa mission est de « protéger la vie humaine en prenant soin de la femme enceinte en détresse et de son futur enfant ; il s’agit d’une alternative à l’avortement et à l’abandon de mineurs »8. Foyer et adoption sont la réponse juste.
8http//www.vifac.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=34 , consulté le 25 février 2010.
81
Lors de l’entretien mené avec la responsable du foyer de VIFAC dans l’aire métropolitaine de Monterrey, elle me confia qu’on lui faisait des reproches : « Elles font les folles et vous les soutenez quand même ! », ce à quoi elle répondait (à ces détracteurs) : « Ce n’est pas elles que nous soutenons, mais leurs bébés, à qui nous sauvons la vie ». Dans le cas des femmes qui ont décidé d’élever leur enfant, que deviendront-elles et qu’en sera-t-il de leurs enfants ? J’ai posé la question aux membres du comité d’administration de Casa Mi Ángel quand je leur ai présenté une partie des résultats de mon étude sur les Indiennes à Monterrey. Il a alors été question d’établir un accord avec le DIF pour qu’il offre aux mères célibataires l’accès à ses crèches. Cependant le Président du Conseil d’Administration a mis fin à la discussion en disant : « Ceci est un autre apostolat ».
Avec pour toile de fond une terrible inégalité, on assiste à la circulation de bébés, mis au monde par des employées de maison, avec l’assistance d’acteurs qui militent contre la dépénalisation de l’avortement et se chargent de leur trouver des parents adoptifs, des âmes bienfaisantes qui appartiennent à la classe sociale qui engagent du personnel de domestique à demeure. Non seulement les corps de ces femmes sans droits servent à nettoyer les foyers de familles aisées, mais aussi à procréer des bébés que d’autres élèveront et qui sont les enfants de l’inégalité.
Au fond, personne ne s’indigne des raisons qui sous-tendent la vulnérabilité de ces femmes en matière de droit du travail, ou sur le fait qu’il n’existe aucun programme d’attention aux mères célibataires.
Related Documents