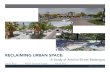RETROUVER SON FOYER : PROPRIÉTÉ ET DÉPOSSESSION DANS LES RÉCITS DE VISITE DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON Danna Piroyansky Belin | Revue d'histoire moderne et contemporaine 2014/1 - n° 61-1 pages 97 à 122 ISSN 0048-8003 Article disponible en ligne à l'adresse: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2014-1-page-97.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour citer cet article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Piroyansky Danna, « Retrouver son foyer : propriété et dépossession dans les récits de visite des exilés palestiniens à leur ancienne maison », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2014/1 n° 61-1, p. 97-122. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour Belin. © Belin. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. 1 / 1 Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © Belin Document téléchargé depuis www.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © Belin

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RETROUVER SON FOYER : PROPRIÉTÉ ET DÉPOSSESSION DANSLES RÉCITS DE VISITE DES EXILÉS PALESTINIENS À LEURANCIENNE MAISON Danna Piroyansky Belin | Revue d'histoire moderne et contemporaine 2014/1 - n° 61-1pages 97 à 122
ISSN 0048-8003
Article disponible en ligne à l'adresse:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2014-1-page-97.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piroyansky Danna, « Retrouver son foyer : propriété et dépossession dans les récits de visite des exilés palestiniens à
leur ancienne maison »,
Revue d'histoire moderne et contemporaine, 2014/1 n° 61-1, p. 97-122.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour Belin.
© Belin. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
Expropriation et politiques de populati on au XXe siècle
Retrouver son foyer : propriété et dépossession dans les récits de visite
des exilés palestiniens à leur ancienne maison
Danna PIROYANSKY
L’ampleur et la valeur des biens que les Palestiniens abandonnèrent en 1948 et que l’État israélien s’est appropriés a fait (et fait toujours) l’objet de débats politiques et historiques importants1. Cet article porte sur les biens qui ont une valeur fi nancière et émotionnelle, en particulier les biens immobiliers. D’après Nicholas Blomley, la propriété recouvre deux types de valeur : d’un côté, elle possède une valeur au sens matériel et pécuniaire, et d’un autre côté, il s’agit d’une construction discursive et symbolique. Blomley suggère d’incorporer l’analyse des récits à l’étude de la propriété et de son rôle en tant que pratique culturelle, afi n de mieux comprendre ces deux aspects2. C’est l’approche adoptée ici. Il s’agit d’analyser le discours tenu par les Palestiniens sur les biens et la propriété, tel qu’il s’exprime au travers d’un prisme parti-culier : les récits de visite de retour dans leurs maisons qu’ont écrits certains citadins palestiniens.
Comme d’autres rituels palestiniens publics ou privés (par exemple la compilation de livres de villages à des fi ns commémoratives), la pratique consistant à retourner voir son lieu d’origine ou sa maison familiale est un acte qui combine la commémoration, la construction identitaire, la transmission de l’histoire entre générations et l’affi rmation politique3. Jusqu’à présent, les visites de retour palestiniennes n’ont été que rarement examinées (quand elles l’ont été,
1. Michael R. FISCHBACH, Records of Dispossession : Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli Confl ict, New York, Columbia University Press, 2003, p. XXII, annexe 1.
2. Nicholas BLOMLEY, « Landscapes of property », Law and Society Review, 32-3, 1998, p. 567-612.3. Laleh KHALILI, « Grass-roots commemorations : Remembering the land in the camps of Leba-
non », Journal of Palestine Studies, 34-1, automne 2004, p. 6-22 ; Rochelle DAVIS, « Mapping the past, re-creating the homeland: memories of village places in pre-1948 Palestine », in Ahmad H. SA’DI, Lila ABU-LUGHOD (ed.), Nakba : Palestine, 1948, and the Claims of Memory, New York, Columbia University Press, 2007, p. 53-75.
REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE61-1, janvier-mars 2014
9012_rhmc61-1_007_208.indd 979012_rhmc61-1_007_208.indd 97 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
98 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
ce fut par des anthropologues et des sociologues)4. Dans la mesure où ces rares travaux se fondent en général sur des entretiens et des témoignages, les récits autobiographiques de visites de retour restent une source très peu exploitée5.
Cet article se fonde sur un corpus de divers récits de retour, dix textes en tout, dont quatre écrits par des femmes. La plupart de ces récits sont extraits d’autobiographies et de mémoires portant sur la vie entière de leurs auteurs. Le récit de la vie d’Hala Sakakini a été imprimé à Amman en 1990 ; publiée à l’origine en arabe sous le titre « Les battements de cœur de la mémoire » par la maison d’édition Dar Kan’an, l’œuvre de Bashir el-Hairi a été traduite en hébreu six ans plus tard ; les mémoires autopubliés de John N. Tleel ont paru en Israël en 2000, alors que ceux de Serene Husseini Shahid ont été édités la même année à Beyrouth ; Free Press a publié le Retour d’exil de Fawaz Turki en 1994 ; enfi n, la première édition du livre autobiographique de Ghada Karmi a paru en 2002 (et une seconde édition en 2008) chez Verso, maison d’édition britannique de gauche. Certains des documents rassemblés dans ce corpus ont d’abord été commencés non comme des mémoires autobiographiques complets mais comme de courts essais personnels publiés dans des magazines et des journaux. On trouve parmi ceux-ci le récit de George Bisharat paru en mai 2003 dans le San Francisco Chronicle ; un essai écrit par Rema Hammami et Salim Tamari en 1998 pour le Journal of Palestine Studies ; la courte des-cription qu’Edward Said donne d’une visite de retour récente et publiée dans le numéro de décembre 1992 d’Harper’s Magazine ; et la description que fait Noman Kanafani de son expérience personnelle de « Homecoming » dans un essai paru sous ce même titre en 1995 dans Middle East Report6.
4. Danny RUBINSTEIN, The People of Nowhere : The Palestinian Vision of Home, New York, Times Books, 1991, chapitre 7 ; Efrat BEN-ZE’EV, « The politics of state and smell », in Marianne Elizabeth LIEN, Brigitte NERLICH (ed.), The Politics of Food, Oxford, Berg, 2004, p. 141-160 (en particulier p. 143-146) ; Helena LINDHOLM SCHULZ, The Palestinian Diaspora : Formation of Identities and Politics of Homeland, Londres et New York, Routledge, 2003, p. 215-218 ; Juliane HAMMER, « A crisis of memory : homeland and exile in contemporary palestinian memoirs », in Ken SEIGNEURIE (ed.), Crisis and Memory : Representation of Space in Modern Levantine Narrative, Wiesbaden, Reichert, 2003, p. 177-198 (en particulier p. 196) ; Efrat BEN-ZE’EV, Issam ABURAIYA, « “Middle ground” politics and the re-palestinization of places in Israel », International Journal of Middle East Studies, 36-4, novembre 2004, p. 639-655 ; Salim TAMARI, Rema HAMMAMI, « Virtual returns to Jaffa », Journal of Palestine Studies, 27-4, été 1998, p. 65-79.
5. Les visites de retour palestiniennes (fi ctives ou réelles) ont aussi été représentées dans d’autres médias. La nouvelle de Ghassan KANAFANI écrite à la fi n des années 1960, Retour à Haïfa, est un canon de la littérature : Retour à Haïfa et autres nouvelles, Arles, Sindbad, 1997 (traduit de l’arabe par Jocelyne et Abdellatif Laâbi). Les visites de retour ont aussi été portées à l’écran : le documentaire de la BBC pour la télévision My Homeland, Your Homeland (1993) qui montre le retour de l’historien palestinien Hisham Sharabi dans sa ville de Jaffa en est un exemple. Le documentaire du réalisateur palestinien Sahera Dirbas Stranger in My Home : Jerusalem (2007) qui présente les histoires de huit familles de réfugiés palestiniens internes retournant visiter leur maison à Jérusalem en est un autre exemple.
6. (NDLR : On a repris ici les translittérations anglaises utilisées par l’auteure dans la version originale du texte). Hala SAKAKINI, Jerusalem and I : A Personal Record, Amman, Economic Press, 1990 ; Bahir AL-KHAYRI, Khafaqat dhakirah, Damas, Dar Kan’an, 1991 ; Bashir EL-HAIRI, Letters to A Lemon Tree, Jérusalem, The Alternative Information Center, 1997 [en hébreu, trad. D. Brafman] ; John N. TLEEL, I Am Jerusalem, Jérusalem, chez l’auteur, 2000 ; Serene HUSSEINI SHAHID, Jerusalem Memories, Tel Aviv, Andalus, 2006 [en hébreu, trad. Mali Baruch] ; Fawaz TURKI, Exile’s Return : The Making of A Palestinian American, New York, Free Press, 1994 ; Ghada KARMI, In Search of Fatima : A Palestinian Story, New York,
9012_rhmc61-1_007_208.indd 989012_rhmc61-1_007_208.indd 98 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 99
Analysant la relation complexe entre écriture autobiographique et historio-graphie, Jeremy D. Popkin a mis en lumière les diffi cultés que rencontrent les historiens lorsqu’ils tentent d’utiliser les documents autobiographiques comme des sources. « Les autobiographies et les mémoires peuvent être considérés comme des sources douteuses pour la recherche historique », écrit-il, « mais ce sont néanmoins des sources, et souvent des sources irremplaçables »7. En effet, les récits autobiographiques mélangent souvent expériences collectives et individuelles et contribuent à combler le fossé entre, d’une part, le moment et le lieu où ils ont été écrits et, d’autre part, l’expérience personnelle telle que l’auteur se la remémore8.
Les récits autobiographiques palestiniens, dont le genre prit forme après 1967, se sont multipliés au cours des années 1990. Leur prolifération durant cette période était attribuée à la crise déclenchée par le processus de paix d’Oslo, en particulier chez les réfugiés qui s’inquiétaient de la possibilité d’avoir à renoncer à leur « droit au retour » en échange de l’obtention d’un État. Selon Juliane Hammer, ces mémoires représentent « une réaction à une crise perçue de la mémoire, une angoisse quant au risque d’oubli de la terre d’origine »9. Pour cette raison, un des thèmes récurrents des récits autobio-graphiques des Palestiniens (et des exilés en général) est l’espace physique (national et local, collectif et privé) et, en même temps, l’espace imaginé de la patrie palestinienne et l’espace de la diaspora au sein de laquelle ces auteurs évoluent. L’acte d’écriture, en lui-même, s’est transformé en acte de « réappropriation de la terre d’origine »10. Notre thèse soutient que cet espace n’est pas complet en soi car il est aussi porteur de sens, en rapport avec la question des biens et de la propriété, de façon à la fois matérielle et symbolique.
La plupart des auteurs de mémoires palestiniens sont des hommes et des femmes qui ont grandi au sein de familles le plus souvent chrétiennes et appartenant aux classes moyennes ou supérieures. Leurs parents et les membres de leur famille étaient souvent impliqués dans la politique locale ou nationale ou dans des entreprises commerciales d’ampleur. Si certains d’entre eux étaient des enfants ou de jeunes adultes en 1948, d’autres sont des réfugiés palestiniens de seconde génération.
Verso, 2002 ; George E. BISHARAT, « Rite of return to a palestinian home », San Francisco Chronicle, 18 mai 2003 ; S. TAMARI, R. HAMMAMI, « Virtual returns… », art. cit. ; Edward SAID, « Palestine, then and now : an exile’s journey through Israel and the occupied territories », Harper’s Magazine, décembre 1992, p. 47-55 ; Noman KANAFANI, « Homecoming », Middle East Report, 194/195, mai-juin/juillet-août 1995, p. 40-42.
7. Jeremy D. POPKIN, History, Historians, and Autobiography, Chicago, The University of Chicago Press, 2005, p. 23.
8. Jerome BRUNER, « Self-making and world-making », in J. BROCKMEIER, D. CARBAUGH (ed.), Narrative and Identity : Studies in Autobiography, Self and Culture, Amsterdam, J. Benjamins Publication Company, 2001, p. 25-37 (en particulier p. 29-30) ; Sidonie SMITH, Julia WATSON, Reading Autobiogra-phy : A Guide for Interpreting Life Narratives, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2001, p. 14.
9. J. HAMMER, « A crisis of memory… », art. cit., p. 177.10. Susanne ENDERWITZ, « “Home” in palestinian autobiographies », in Crisis and Memory, op.
cit., p. 223-242 (en particulier p. 223-224) ; J. HAMMER, « A crisis of memory… », art. cit., p. 180-181.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 999012_rhmc61-1_007_208.indd 99 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
100 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
Une caractéristique signifi cative de ce corpus est qu’une grande partie a été écrite ou traduite en anglais, dans le but de toucher un public plus large qui n’est pas forcément familier avec la question palestinienne. Dans ces textes en anglais, la mémoire palestinienne a été séparée du discours interne arabe (et formulé en arabe). Ainsi, l’acte de « traduction » devient un acte de protestation politique, une incarnation individuelle du récit palestinien des-tinée au lecteur occidental. En même temps, mettre des mots sur les visites de retour et les émotions qu’elles évoquent, en particulier en anglais, c’est traduire le désir humain élémentaire de retour au jardin d’Éden avant la chute. En ce sens, ce à quoi nous nous référons lorsque nous parlons des vagues de « visites de retour » de Palestiniens, peut être considéré comme appartenant à un phénomène plus global qui rassemble mémoire, identité et voyage, et lie entre elles pratiques culturelles, personnelles et collectives. Cette tendance, qui a été appelée tourisme de la nostalgie, de l’héritage, de la généalogie ou de la diaspora, inclut des expériences qui recouvrent des frontières chrono-logiques et géographiques très larges, dont les visites de noirs américains au Ghana dans les années 1990, les voyages de juifs en Pologne après la Seconde Guerre mondiale, le « homecoming » d’un clan écossais réuni en 2009, ou bien encore les visites d’anciens combattants allemands dans les années 1950 dans les pays dans lesquels ils s’étaient battus pendant la guerre11.
Écrire en anglais, en particulier pour les Palestiniens qui revenaient visiter leur ancienne maison après 1967, implique aussi un sens de l’identité, de son statut social, de sa classe et son niveau d’éducation ; certains des auteurs dont il est question ici sont fi ers de leur niveau de maîtrise de l’anglais (et d’autres langues étrangères). À l’inverse, écrire en anglais, en particulier pour les visiteurs des années 1990, souligne les défi s qu’implique un état de diaspora intergénérationnel, avec les conséquences nationales et culturelles ressenties par les réfugiés de seconde et de troisième génération, dont l’utilisation de l’anglais plutôt que de l’arabe comme lingua franca est une manifestation.
Un second trait majeur de ces œuvres autobiographiques est que la vie qu’elles décrivent se déroule généralement dans un cadre urbain (il est intéres-sant de constater que nombre de ces auteurs viennent de Jérusalem), et donne une image détaillée des centres urbains palestiniens. Ceci est particulièrement important étant donné que l’on a peu écrit sur les visites de retour en ville, par
11. Pour plusieurs études de cas cf., par exemple, Edward M. BRUNER, « Tourism in Ghana : the representation of slavery and the return of the Black diaspora », American Anthropologist, 98-2, 1996, p. 290-304 ; Andrew DEMSHUK, « Wehmut und Trauer – The Jewish travelers in polish Silesia and the foreigness of Heimat », in Simon-Dubnow-Institut. Jahrbuch/Yearbook, VI, 2007 (dossier « Early modern culture and Haskala – Reconsidering the borderlines of modern Jewish history », D. B. RUDERMAN, S. FEINER, ed.), p. 311-338 ; Moira BIRTWISTLE, « Genealogy tourism : the Scottish market oppor-tunities », in Marina NOVELLI (ed.), Niche Tourism : Contemporary Issues, Trends, and Cases, Oxford, Butterworth-Heinemann, 2005, p. 59-72 ; Alon CONFINO, « Travelling as a culture of remembrance : traces of national socialism in West Germany, 1945-1960 », History & Memory, 12-2, 2000, p. 92-121. Cf. aussi Marianna HIRSCH, Nancy K. MILLER (ed.), Rites of Return : Diaspora Poetics and the Politics of Memory, New York, Columbia University Press, 2011.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1009012_rhmc61-1_007_208.indd 100 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 101
contraste avec les retours en milieu rural, et sur les classes moyennes et urbaines, en comparaison de la vie rurale dans la Palestine d’avant 1948 en général12.
Les deux vagues de retour racontées dans les textes autobiographiques pales-tiniens se sont déroulées à la suite de la guerre de 1967 et dans les années 1990. La guerre de 1967 fut un tournant dans l’histoire des Palestiniens comme des Juifs. La politique de « ponts ouverts » adoptée par Israël juste après cette guerre, qui permettait la circulation des personnes et des biens entre la Jordanie et les territoires récemment occupés, fut une décision d’importance. L’ouverture des ponts traversant le Jourdain et l’annexion de Jérusalem-Est à Israël permirent à des dizaines de milliers de Palestiniens de Cisjordanie et des pays arabes voisins, qui avaient été coupés de leurs villes et leurs villages d’origine pendant dix-neuf ans, de retourner voir les maisons qu’ils avaient abandonnées ou dont ils avaient été expulsés en 1948. La seconde vague de visites de retour de Palestiniens a des limites chronologiques plus fl oues : le processus de paix d’Oslo et la peur d’une renonciation de l’OLP au droit au retour en échange d’un État déclenchèrent cette vague de visites des Palestiniens exilés de la première et de la deuxième génération13. Les contextes historiques dans lesquels ces visites de retour s’effectuèrent, puis furent racontées, ont ainsi d’importantes implications en termes de conception des biens, de la propriété, de la dépossession et de la possibilité d’une restitution.
Le but de cet article est d’analyser le discours palestinien sur les biens et la propriété en se concentrant sur trois thèmes : les pratiques rhétoriques et symbo-liques exprimant la propriété palestinienne vis-à-vis des propriétaires juifs actuels ; la rencontre entre « voisins diachroniques » et l’enchaînement de la dépossession dans le contexte juif-arabe plus général ; la maison palestinienne-devenue-israé-lienne comme palimpseste.
« CETTE MAISON ÉTAIT LA NÔTRE » : LES VISITES DE RETOUR COMME MOYEN DE REVENDICATION DE LA PROPRIÉTÉ PALESTINIENNE
Au cours d’une période de douze ans (1948-1960) et par le biais d’un processus qui était avant tout législatif mais aussi administratif et judiciaire, Israël expropria
12. Pour une approche générale des centres urbains palestiniens, voir Manar HASAN, « The des-truction of the city and the war on the collective memory : the victorious and the defeated », Theory and Criticism, 27, 2005, p. 197-207 [en hébreu]. Pour des études de cas spécifi ques, cf., par exemple, May SEIKALY, Haifa : Transformation of an Arab Society 1918-1939, Londres, I. B. Tauris, 2002 ; Salim TAMARI, « Bourgeois nostalgia and the abandoned city », Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 23/1-2, 2003, p. 173-180 ; Itamar RADAI, « The collapse of palestinian-arab middle class in 1948 : The case of Qatamon », Middle Eastern Studies, 43-6, 2007, p. 961-982 ; Salim TAMARI (ed.), Jerusalem 1948 : The Arab Neighbourhoods and Their Fate in the War, Jérusalem, Institute of Jerusalem Studies, 1999 ; Daniel MONTERESCU, Dan RABINOWITZ (ed.), Mixed Towns, Trapped Communities : Historical Narra-tives, Spatial Dynamics, Gender Relations and Cultural Encounters in Palestinian-Israeli Towns, Burlington, Ashgate, 2007, p. 135-155.
13. L. KHALILI, « Grass-roots commemorations… », art. cit., p. 6 ; E. BEN-ZE’EV, I. ABURAIYA, « “Middle ground” politics… », art. cit., p. 640.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1019012_rhmc61-1_007_208.indd 101 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
102 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
les Palestiniens de leurs biens meubles et immeubles et en prit le contrôle14. L’ordonnance de juin 1948 sur les propriétés et les zones abandonnées régit les biens palestiniens dans les zones récemment occupées (« abandonnées »). En décembre, une loi plus complète régula l’expropriation des biens arabes par le biais d’un « Gardien des biens » de l’absent. Suivant cette loi, le gardien provisoire d’une propriété abandonnée obtenait un statut légal mieux défi ni, qui se focalisait moins sur la propriété abandonnée et insistait davantage sur le statut d’« absent » de son propriétaire. Ce vocabulaire fi nit par faire référence à tous les Palestiniens déplacés pendant la guerre, qu’ils soient revenus ou non par la suite. L’expro-priation ainsi légalisée n’était pas permanente, et cependant, comme l’observent Geremy Forman et Sandy Kedar, « la propriété des absents était dès lors traitée par l’administration comme une propriété d’État »15. La mise en place de la loi sur l’acquisition de terres (validation des actes et compensations) de mars 1953 permit aux gardiens de biens d’absents et de non-absents de vendre ces biens à l’Autorité de développement. Cette loi s’appliquait à l’immobilier et offrait des compensations pour les terres dont les Palestiniens avaient été expropriés16. Elle a été largement appliquée au cours de la seule année pendant laquelle elle fut en vigueur. En dépit des vigoureuses protestations des citoyens palestiniens qui n’étaient pas absents, le ministère des Finances nationalisa quelque 120 000 hectares qui tombaient sous le coup de cette loi17.
Les maisons que les Palestiniens et les Palestiniennes retournèrent visiter en 1967 et dans les années 1990 n’appartenaient donc légalement plus à leur propriétaire d’origine. Pendant des années, rares furent les réfugiés palestiniens qui tentèrent, en tant que personnes privées, d’obtenir une restitution, en enga-geant des poursuites par le biais du système judiciaire israélien et en utilisant divers arguments pour prouver qu’ils avaient été injustement expropriés de leurs biens. Parmi ceux-ci, beaucoup essayèrent de prouver qu’ils n’étaient en fait pas « absents » suivant la défi nition légale israélienne18. À la suite du processus de paix d’Oslo en particulier, il y eut un intérêt grandissant pour la recherche de moyens potentiels de revendiquer les biens palestiniens. L’espoir d’une solution d’ensemble auquel on crut au milieu des années 1990 encouragea de nombreux Palestiniens à envisager, de façon peut-être plus réaliste que jamais auparavant, la possibilité de récupérer leurs anciennes maisons. Une des voies empruntées à cette époque (et à un moindre degré depuis) fut d’engager un avocat spécialisé dans
14. Le paragraphe suivant se fonde sur Geremy FORMAN, Sandy KEDAR, « From Arab land to Israel lands : the legal dispossession of the Palestinians displaced by Israel in the wake of 1948 », Envi-ronment and Planning D : Society and Space, 22, 2004, p. 809-830 ; cf. aussi M. FISCHBACH, Records of Dispossession…, op. cit., chapitre 1 ; Menachem HOFNUNG, Israel – Security Needs Vs. The Rule of Law, Jérusalem, Nevo, 1991 [en hébreu], p. 159-170.
15. G. FORMAN, S. KEDAR, « From arab land… », art. cit., p. 815.16. Ibid., p. 819-822.17. Yifat HOLZMAN-GAZIT, Land Expropriation in Israël : Law, Culture and Society, Aldershot,
Ashgate, 2007, p. 112.18. Entretien avec l’avocat Elias Daoud Khoury, 30 juillet 2012.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1029012_rhmc61-1_007_208.indd 102 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 103
le droit de propriété, dans l’espoir que des preuves de propriété suffi raient pour déposer une plainte19. Dans d’autres cas, des ONG palestiniennes commencèrent à rassembler des données sur les propriétés palestiniennes à Jérusalem-Ouest20. Adoptant une approche plus politique, des géographes du Département des cartes et enquêtes de la Maison d’Orient (le quartier général offi cieux de l’OLP à Jérusalem de 1983 à 2001) avaient aussi tenté dès 1995 de compiler une base de données des propriétés palestiniennes à Jérusalem-Ouest. Cette entreprise est encore en cours : la page web du Département encourage les Palestiniens qui ont des revendications de propriété en suspens [à Jérusalem-Ouest] et possédant des documents fi scaux prouvant leur droit de propriété, à les faire suivre au bureau du Département où ils seront archivés en vue d’un usage futur21.
Cependant, très peu de réclamations ont abouti. Si les membres de la famille Daoud sont parvenus à récupérer certains de leurs biens à Jérusalem-Ouest après avoir réussi à prouver qu’on ne pouvait pas les considérer comme absents (puisqu’en 1948 ils habitaient en Amérique du Sud), l’échec des tentatives de la famille Sansur ou le cas complexe et toujours en cours de Constantine Salame sont des exemples plus représentatifs22. À l’évidence, une solution politique globale est aujourd’hui encore bien éloignée.
Alors que de nombreux Palestiniens préfèrent la solution d’une restitution, le discours international eut plutôt tendance à soutenir l’idée d’une indemnisation23. La justice israélienne, quant à elle, a clairement montré sa préférence pour la solution consistant à accorder des compensations individuelles : la loi d’acquisi-tion de 1953 offrait des compensations fi nancières pour les terres expropriées sur la base de la valeur de ces terres au 1er janvier 1950, avec un intérêt annuel de 3 %24. Cependant, pour de nombreux Palestiniens dépossédés, accepter cette compensation semblait signifi er la reconnaissance fi nale de la nationalisation de leurs biens par Israël. De plus, la compensation offerte par la loi ne correspondait pas, selon eux, à la valeur réelle de leurs biens25.
19. L’avocat Elias Daoud Khoury nous a indiqué que, vers le milieu des années 1990, environ 200 propriétaires palestiniens l’avaient approché dans l’espoir de pouvoir revendiquer leurs biens et qu’il avait accepté de déposer un recours pour seulement quelques-uns d’entre eux. Entretien du 30 juillet 2012.
20. Comme le fi t la Palestinian Society for the Protection of Human Rights and the Environment, en 1996, ou l’Institute for Jerusalem Studies affi lié à l’Institute for Palestine Studies, en 1999. M. FISCHBACH, Records of Dispossession, op. cit., p. 337.
21. www.orienthouse.org/dept/maps_dept.html (consulté le 31 juillet 2012).22. Danny RUBINSTEIN, « Yesh mechir leyerushalayim meuchedet », Haaretz, 2 juillet 1999 ; Dalia
KARPEL, « Shel mi havila hazot », Haaretz, 10 janvier 2003.23. La résolution 194 (III) de l’Assemblée générale des Nations unies de décembre 1948 appelait
au rapatriement des réfugiés et à une compensation pour les biens appropriés. Michael R. FISCHBACH, The Peace Process and Palestinian Refugee Claims : Addressing Claims for Property Compensation and Res-titution, Washington (DC), United States Institute of Peace Press, 2006, p. 16.
24. G. FORMAN, S. KEDAR, « From arab land… », art. cit., p. 819-822. En juillet 1973, une autre loi portant sur le problème des compensations pour les propriétés d’absents détenues par l’État fut votée par le Parlement israélien [loi de 1973 sur les biens (Compensation) des absents]. Elle permit à ceux qui résidaient en Israël en 1973 ou après de demander des compensations pour les biens détenus par un gardien de biens d’absent ou par l’Autorité de développement.
25. Ibidem, p. 819, 821 ; Y. HOLZMAN-GAZIT, Land Expropriation…, op. cit., p. 112.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1039012_rhmc61-1_007_208.indd 103 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
104 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
Dans leurs écrits, les visiteurs de retour en 1967 ne font pas référence à quelque tentative que ce soit pour reprendre formellement possession de leurs biens. Quant à ceux qui les suivirent dans les années 1990, ils décrivent quel-quefois des tentatives pour récupérer des biens perdus ou tout au moins pour obtenir la reconnaissance, de la part des Israéliens, de leur acte d’appropriation. George Bisharat, un professeur de droit d’origine palestino-américaine vivant à San Francisco, et dont la famille possédait la spectaculaire Villa Harun ar-Rashid dans le quartier Talbiya de Jérusalem-Ouest, la visita deux fois, en 1977 et en 2000. En 2003, à l’occasion du 55e anniversaire de la Nakba, il décrivit ces deux visites dans le San Francisco Chronicle. Dans ce texte, Bisharat raconte l’histoire de la maison, son rôle crucial dans la guerre de 1948, sa seconde vie en tant que résidence de Golda Meir et fi nalement sa fonction actuelle de maison d’un Juif américain. Dans les derniers paragraphes de ce récit à la fois historique et personnel, Bisharat explique comment il conserve dans sa maison californienne :
« [un] épais dossier qui regroupe les archives que ma famille a constituées dans le but de récupérer la Villa Harun ar-Rashid. Bien entendu, nous n’avons pas eu gain de cause, et nous n’avons pas non plus obtenu de reconnaissance de l’injustice dont nous, comme d’innombrables autres, avons souffert. Nos maisons et nos biens sont passés il y a bien longtemps dans la possession d’agences d’État ou quasi-gouvernementales qui, aujourd’hui encore, refusent de louer ou de vendre des terres aux non-juifs »26.
Il semble que George Bisharat a perdu l’espoir de récupérer la Villa Harun ar-Rashid et s’est résigné à, tout au moins, conserver ses souvenirs :
« Récemment, j’ai découvert ma fi lle en train de contempler des photos de mon père étant garçon dans sa maison de Jérusalem. Je sais maintenant qu’elle et mon fi ls sont les héritiers de la vérité sur la Villa Harun ar-Rashid »27.
Edward Said, quant à lui, montra plus de fermeté lors de la visite de sa maison de famille à Talbiya en 199228. Dans un entretien avec un journaliste juif-israé-lien publié en août 2000, lorsqu’on lui demanda s’il estimait avoir un droit au retour et, spécifi quement, si lui, en tant qu’individu, avait le droit de retourner à Talbiya, Said décrivit comment, lors de sa visite de 1992, il avait pris avec lui le titre de propriété de sa maison de famille, qui portait le nom de son oncle. Cet oncle voulait que Said recherche ce qui pouvait être fait pour revendiquer la propriété de la maison. Quatre ans plus tard, selon Said, son oncle vint en personne et rejoignit une organisation pour la protection des droits de propriété des Palestiniens. « […] Si vous me posez la question à titre personnel », fi nit par répondre Said au journaliste, « je répondrai que je vais me joindre à mon cousin,
26. G. BISHARAT, « Rite of return… », art. cit.27. Ibidem. Souligné par l’auteur.28. Dans son article « “My beautiful old house” and other fabrications » (Commentary, septembre
1999, p. 23-31), Justus Reid WERNER a mis en doute l’affi rmation de Said selon laquelle il aurait vécu les douze premières années de sa vie dans cette maison ; il avance que la résidence régulière de la famille de Said se trouvait au Caire et qu’il ne rendit visite à la famille de son oncle à Talbiya que de façon occasionnelle.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1049012_rhmc61-1_007_208.indd 104 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 105
dont le nom du père apparaît sur le titre et qui est en train d’essayer d’obtenir une reconnaissance du fait que la maison lui a été prise. Qu’il s’agit de sa maison »29.
Plus fréquemment, les visites de retour, comme les autres types de voyage à but mnémonique qui sont courants dans d’autres pays et dans d’autres cadres nationaux, constituaient un remède symbolique plutôt que légal. Que ce soit de façon consciente et délibérée ou sans y penser, par le biais du langage et d’actes apparemment banals, les visiteurs pouvaient, tout au moins au niveau des repré-sentations, déclarer leur propriété sur la maison qu’ils venaient visiter.
Une façon de procéder consistait pour ces visiteurs à faire face aux résidents et propriétaires actuels (le plus souvent juifs) de leur ancienne maison. Certains visiteurs de retour se présentèrent simplement comme les propriétaires. Ainsi Serene Husseini Shahid, lors de sa visite du quartier Musrara de Jérusalem en 1972. Il s’était écoulé 36 ans depuis que Shahid Husseini et sa famille étaient par-tis pour Beyrouth, en raison des activités politiques de son père, Jamal Husseini (fondateur du Parti arabe de Palestine). Dans la voiture qui conduisait Serene, ses trois sœurs et leur mère, de Jéricho à Jérusalem, l’atmosphère était donc lourde. À l’époque, la mère de Shahid Husseini, épouse de Jamal Husseini, fi lle de l’ancien maire de Jérusalem Faidi al-Alami et sœur du militant nationaliste Musa al-Alami, avait 80 ans. Marchant à l’aide d’une canne, elle fut la seule à oser sortir de la voiture pour frapper à la porte de son ancienne maison. Une femme juive d’âge moyen ouvrit la porte et la mère de Shahid Husseini pria poliment mais fermement : « Je vous demande la permission d’entrer et de visiter ma maison ». Lorsque l’occupante actuelle lui répondit que cela ne pouvait pas être sa maison puisqu’ils (c’est-à-dire probablement elle et son mari) l’avaient achetée, la vieille dame palestinienne répliqua fermement qu’elle ne l’avait jamais vendue30. Il s’agissait là d’une affi rmation claire de propriété de la part d’une femme âgée et qui, issue d’un milieu distingué, avait vécu plusieurs épisodes de migration forcée en raison des engagements politiques de sa famille. D’une certaine façon, son autoreprésentation en tant que propriétaire de la maison est ce qu’Efrat Ben Ze’ev défi nit comme « un acte mineur d’opposition politique »31.
D’autres visiteurs de retour revendiquèrent la propriété de leur maison de façon plus subtile et moins confl ictuelle. Nombreux sont ceux qui préférèrent utiliser le passé plutôt que le présent pour se référer à leur statut de propriétaire et ils utilisaient même parfois les deux temps dans la même phrase. Comme beau-coup d’habitants palestiniens de Ramla, Bashir el-Hairi (le petit-neveu de Sheikh Mustafa Khairi, le mukhtar de Ramla avant la guerre) s’enfuit pour Ramallah avec sa famille en 1948. Il avait alors six ans. Plus tard cette même année, la famille s’installa à Gaza et retourna ensuite à Ramallah en 1957. En 1967, Bashir el-Hairi
29. Ari SHAVIT, « Zchut hashiva sheli », Haaretz, 18 août 2000 (traduit de l’hébreu par l’auteure).30. S. HUSSEINI SHAHID, Jerusalem Memories…, op. cit., p. 148.31. B. EL-HAIRI, Letters…, op. cit., p. 39. Cf. par exemple S. HUSSEINI SHAHID, Jerusalem Memories,
op. cit., p. 148 ; Encounters of Memory, Jérusalem, The Alternative Information Center, 2000 [en hébreu], p. 133 ; Maariv, 27 juin 1967, p. 17 ; E. BEN ZE’EV, « The politics of taste and smell… », art. cit., p. 144.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1059012_rhmc61-1_007_208.indd 105 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
106 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
était un avocat de 25 ans qui venait de fi nir ses études à l’Université du Caire, où il s’était engagé politiquement avec le Mouvement nationaliste arabe puis le Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP)32. Dans ses mémoires, il décrit la visite qu’il effectua en 1967 dans sa maison de famille de Ramla et sa première rencontre avec Rachel, la fi lle des occupants juifs de la maison, avec qui il allait entretenir une amitié forte pendant des années. Lors de cette première rencontre, alors que l’un et l’autre se tenaient de part et d’autre du seuil de la maison, el-Hairi se présenta (en anglais) et dit à cette jeune femme qu’il était :
« [L]e fi ls du propriétaire de cette maison. Cette maison était la nôtre avant la guerre, la guerre de 1948, et nous sommes venus aujourd’hui de Ramallah pour la voir. Nous per-mettez-vous de la voir ? Nous pensons que vous n’y verrez pas d’objection »33.
En utilisant cette tournure, el-Hairi parvint à exprimer à la fois une reven-dication de propriété dans le passé (« Cette maison était la nôtre ») et une recon-naissance de son occupation juive actuelle (« Nous permettez-vous de la voir ? »)34.
Parfois cependant, même ce type de déclaration mélangeant références à la propriété passée et présente paraissait trop cru et trop risqué à certains Palesti-niens de retour. Le ton conciliant de l’écrivain et militant politique Fawaz Turki dans son récit évoque une attitude plus apaisée vis-à-vis de son statut personnel d’exilé permanent. Dès la préface, il affi rme que « [m]on livre est l’histoire d’un Palestinien exilé qui éprouve des diffi cultés vis-à-vis de sa condition puis, fi na-lement, fi nit par l’accepter »35. Turki, dont la famille a vécu dans les camps de réfugiés de Beyrouth pendant plusieurs années après 1948, déménagea ensuite aux États-Unis où il s’installa comme journaliste et écrivain. Décrivant son retour en Cisjordanie après des années de diaspora, il raconte la visite de sa maison d’enfance de Haïfa, à la veille de la première Guerre du Golfe en 1990. Contrairement à la mère de Serene Husseini Shahid ou même à Bashir el-Hairi, Turki choisit ses mots avec une extrême précaution lorsqu’il approcha l’homme juif qui lui ouvrit la porte. Sa requête, faire le tour de la maison, s’appuyait sur le fait qu’il était « né ici ». Cette déclaration ne faisait pas immédiatement de lui un Palestinien et, en effet, lorsque le vieil homme paru très étonné que, malgré le fait qu’il était
32. Sandy TOLAN, The Lemon Tree : An Arab, a Jew, and the Heart of the Middle East, New York, Bloomsbury, 2006, p. 9, 58, 103, 123, 125, 140. En septembre 1967, el-Hairi fut arrêté et interrogé pour sa prétendue implication dans un attentat à l’explosif à Jérusalem qui se produisit plus tôt cette année-là. En 1972, il fut reconnut coupable et condamné à quinze ans de prison. Quatre ans après sa libération, en 1988, el-Hairi fut expulsé vers le Liban, et, au cours des années qui suivirent, exilé à Tunis. Il retourna fi nalement à Ramallah et en Cisjordanie en 1996 : ibidem, p. 170, 185, 199, 211, 238, 250.
33. B. EL-HAIRI, Letters…, op. cit., p. 39 (traduction de l’auteure, comme pour toutes les autres citations de ce livre ci-après). Cf. aussi dans d’autres récits : H. SAKAKINI, Jerusalem and I…, op. cit., p. XV ; S. HUSSEINI SHAHID, Jerusalem Memories, op. cit., p. 148 ; Encounters of Memory, op. cit., p. 133 ; Maariv, art. cit., p. 17.
34. On trouve un autre exemple de ce discours de propriété alliant passé et présent dans une autre rencontre entre propriétaires originels et actuels d’une maison à Ramla dans laquelle la palestinienne anonyme (qui vivait à Ramallah) annonça à la femme et à l’homme qui lui ouvrirent la porte que : « J’habitais par le passé dans cette maison. Et cette maison est à moi ». Staughton LYND, Sam BAHOUR, Alice LYND (ed.), Homeland : Oral Histories of Palestine and Palestinians, New York, Olive Branch Press, 1994, p. 65.
35. F. TURKI, Exile’s Return…, op. cit., p. IV.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1069012_rhmc61-1_007_208.indd 106 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 107
né dans cette maison, le jeune homme devant lui ne parlait pas du tout hébreu, Turki expliqua à contrecœur qu’il était un Palestinien vivant aux États-Unis36.
La propriété palestinienne pouvait encore être proclamée et revendiquée d’autres manières, au cours de ces visites. Les actes démontrant la familiarité du visiteur-propriétaire avec la maison constituaient une autre façon indirecte et pas toujours délibérée, quoique symboliquement forte, de revendiquer sa propriété. Abu Faras, un avocat de trente ans qui était du voyage lorsque Bashir el-Hairi alla visiter sa maison de famille à Ramla en 1967, découvrit que la grande demeure avait été transformée en école. Après avoir expliqué (en arabe) au gardien de l’école que « nous étions les propriétaires de cette maison avant 1948 », et ayant demandé la permission de la visiter, une jeune enseignante qui parlait anglais accéda à sa requête. Après l’heure de fermeture de l’école, Abu Faras et ses deux compagnons visitèrent les bâtiments. Par le biais de deux actes apparemment banals, Abu Faras exprima sa propriété symbolique du bâtiment : tout d’abord, alors qu’il descendait des escaliers, il avertit ses amis de faire attention à ne pas trébucher sur certaines marches dont il se rappelait qu’elles étaient dangereuses ; ensuite, au moment de quitter les lieux, « il verrouilla bien [le portail], comme s’il fermait le portail de sa propre maison ». Témoin bienveillant de cet épisode, el-Hairi décrit ainsi ces actes de revendication subtils : « Et pourquoi ne devrait-il pas [verrouiller le portail derrière lui] ? N’est-il pas le propriétaire de la maison ? »37.
Une pratique plus commune consistait à faire le tour de la maison en inspec-tant attentivement ses moindres recoins. Né au sein de la diaspora palestinienne, Noman Kanafani a décrit comment, en 1995, il retrouva pour la première fois la maison de sa famille, qui avait été abandonnée un après-midi de 1948, et qu’il n’avait lui-même jamais habitée. Kanafani retrouva des parents éloignés et de nouveaux amis qui l’emmenèrent visiter cette maison d’Acre où il n’avait jamais résidé. Dans son récit, l’intime familiarité supposée et la sensualité intense se transforment en un acte d’amour presque érotique avec la bâtisse :
« Je fi s le tour des six pièces qui donnent directement sur le hall central. Je demandai à ce qu’on me laisse seul. Je touchai les dalles fraîches et colorées, touchai les pierres taillées, les poignées et les panneaux des portes, et ouvris les fenêtres et vis ce que ma mère et mon frère avaient vu depuis cet endroit dans le passé. Je touchais, voyais et sentais les lieux pour la première fois, et cependant, ils m’étaient si familiers qu’ils évoquèrent des souvenirs et me fi rent verser des larmes »38.
Cette intimité imaginée était construite à partir des souvenirs nostalgiques d’un exilé de seconde génération, qui n’étaient pas ceux de Kanafani lui-même mais plutôt ceux de ses parents.
36. F. TURKI, Exile’s Return…, op. cit., p. 6 ; cf. aussi le témoignage du Révérend Jarveys, dans Encounters of Memory, op. cit., p. 125.
37. B. EL-HAIRI, Letters…, op. cit., p. 35. Cette pratique est exprimée, par exemple, dans la transcription du témoignage oral du Révérend Jarveys, qui décrivit comment, lors d’une visite de son ancienne maison à Lydda, son père décida de repeindre les rebords de fenêtre en piteux état de cette maison qu’il avait possédée dans le passé : Encounters of Memory, op. cit., p. 125.
38. N. KANAFANI, « Homecoming », art. cit., p. 40-42.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1079012_rhmc61-1_007_208.indd 107 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
108 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
Enfi n, un autre moyen pour les Palestiniens de proclamer et de revendiquer leur propriété consistait à identifi er les bâtiments à distance et à exprimer de la fi erté à leur égard. John N. Tleel fut déplacé avec sa famille à l’intérieur de Jéru-salem (d’une maison à l’extérieur des murs de la Vieille Ville vers l’intérieur de la Vieille Ville). Au cours des années qui suivirent, il retourna à plusieurs reprises visiter sa maison de famille. Dans ses mémoires datant de 2000, I am Jerusalem, Tleel décrit comment, en 1967,
« nous avons marché sur des ruines et nos rêves de revoir à nouveau nos maisons devinrent soudainement possibles, mais qu’avons-nous vu ? Nous avons vu nos maisons détruites par la guerre. Nous avons vu nos maisons capturées par des étrangers. Ce qui était autrefois blanc, propre et neuf était à présent morne, assombri et décrépi. Ce qui nous avait appartenu semblait ne plus être à nous »39.
À la différence des auteurs mentionnés jusqu’ici, Tleel s’est toujours retenu d’entrer dans le bâtiment que son grand-père Daoud avait conçu avec son frère cadet en 1896, un édifi ce impressionnant de 27 pièces dans lequel sa famille élargie au complet avait habité :
« Pour des raisons émotionnelles, j’évite encore de m’approcher de la maison, mais je suis fi er de la montrer d’assez près à mes amis et mes connaissances lorsque je passe en voiture avec eux par la rue Musrara »40.
En attirant l’attention de ses amis sur sa maison de famille, Tleel agit en fi er propriétaire des lieux ; le fait qu’il ne souhaite pas y entrer devient un acte de défi et un refus d’admettre une dépossession, et donc de reconnaître la nouvelle propriété juive-israélienne.
D’une certaine façon, ces pratiques en apparence banales et ordinaires, qu’il s’agisse de pratiques physiques ou rhétoriques, représentent ce que Michel de Certeau concevait comme faisant partie d’« un mode individuel de réappro-priation » de l’espace urbain, puisqu’il considérait des actes mineurs tels que la marche, l’observation, le fait de donner des noms ou de se remémorer, comme « des procédures – multiformes, résistantes, rusées et têtues – qui échappent à la discipline sans être pour autant hors du champ où elle s’exerce […] »41. En d’autres termes, en se référant aux propriétaires d’origine de la maison, en faisant le tour des bâtiments ou en les montrant de loin, les visiteurs palestiniens parvenaient à se réapproprier leur maison, tout au moins de façon temporaire et symbolique, indépendamment des propriétaires actuels, le plus souvent des Juifs israéliens.
Le discours intime et personnel sur la propriété de ces biens était différent de celui qui s’élaborait lors des rencontres avec les occupants actuels. Ce discours-là, plus marqué par l’appréhension, révélait la peur de voir les revendications de propriété échouer, la frustration d’expériences passées similaires ou encore une réticence à rouvrir de vieilles blessures. L’éducatrice Hala Sakakini, fi lle de l’intellectuel palestinien Khalil Sakakini, visita la maison de Qatamon dans
39. J. TLEEL, I Am Jerusalem, op. cit., p. 201.40. Ibidem, p. 205.41. Michel DE CERTEAU, L’invention du quotidien. Arts de faire, Paris, UGE 10/18, 1980, p. 179.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1089012_rhmc61-1_007_208.indd 108 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 109
laquelle elle avait grandi42. Alors qu’à la fi n de 1948 des combats faisaient rage dans ce quartier de Jérusalem, la famille Sakakini partit pour Le Caire, où elle resta pendant plusieurs années avant de déménager pour Ramallah en 195343. Faisant le récit de sa vie dans ses mémoires, en 1990, Sakakini raconte les années pendant lesquelles elle grandit dans ce quartier prospère ainsi que la visite trau-matisante de sa maison de famille lors d’un retour en 1967. Face aux femmes qui travaillaient dans la maison transformée en école maternelle, Sakakini proclama clairement son droit de propriété : « C’est notre maison. Nous habitions là avant 1948 ». Cependant, en elle-même (et à l’adresse de ses lecteurs), Sakakini recon-naissait que « [c]e n’était plus chez moi »44.
De façon similaire, Ghada Karmi, une militante et chercheuse palestinienne née à Jérusalem en 1939, décrit avec éloquence le sentiment intime de défaite ultime inhérent à toute visite de retour pour les Palestiniens. Dans son autobiographie de 2002, In Search of Fatima : A Palestinian Story, elle raconte comment elle a grandi à Qatamon, élevée par les soins d’une servante appelée Fatima. Les souvenirs du traumatisme du départ de 1948, qui signifi ait qu’il fallait laisser derrière Fatima et Rex, le chien adoré de la famille, hantèrent Karmi lorsqu’elle s’installa à Londres avec sa famille. Le retour dans sa maison d’enfance, en 1988, fut un moment de désabusement, dénué de tout romantisme : « Mais, bien entendu, elle [c’est-à-dire la maison] n’était plus la nôtre et ne l’avait plus été depuis cinquante ans. Notre maison était morte, comme Fatima, comme le pauvre Rex, comme nous »45. Edward Said décrivit la même sensation d’irrévocabilité et de défaite, dans un court récit de la visite de sa maison de famille à Talbiya en 1992 :
« Plus qu’aucune autre chose, peut-être, ce fut la maison dans laquelle je ne suis pas entré, dans laquelle je ne pouvais pas entrer, qui symbolisa l’étrange fi n de l’histoire. Elle semblait me regarder de haut, de derrière ses persiennes fermées. La Palestine telle que je l’avais connue n’était plus et je me retrouvai à penser à la dernière fois que je vis mon père, quelques jours avant sa mort à Beyrouth »46.
Dans ces exemples, le discours intime évoque cette prise de conscience diffi cile et cependant réaliste, touchant à la fois à la sphère privée et à la sphère nationale, que ce qui avait existé n’était plus là. Ces récits sont ainsi rendus bouleversants par les notions de mort et de perte dont ils sont imprégnés. Loin d’être des retours triomphants avec de grandes déclarations et, au fi nal, la reconnaissance des droits de propriété palestiniens, de nombreux retours avaient plutôt tendance à briser tout espoir de voir le propriétaire et sa maison réunis47.
42. Pour en savoir plus sur l’histoire de la maison de Sakakini à Qatamon, voir Danna PIROYANSKY, « From island to archipelago : the Sakakini house in Qatamon and its shifting ownership throughout the twentieth century », Middle Eastern Studies, 48-6, 2012, p. 855-877.
43. « Such Am I, Oh World ! » : Diaries of Khalil al-Sakakini, Gideon SHILO (trad.), Jérusalem, Keter, 1990 [en hébreu], p. 236-237, à la date du 1er janvier 1949.
44. H. SAKAKINI, Jerusalem and I…, op. cit., p. XV.45. G. KARMI, In Search of Fatima…, op. cit., p. 450.46. E. SAID, « Palestine, then and now… », art. cit., partie III.47. D. RUBINSTEIN, The People of Nowhere…, op. cit., p. 62.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1099012_rhmc61-1_007_208.indd 109 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
110 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
« MAIS CET HOMME VEUT QUE JE SORTE DE SA MAISON » :RENCONTRES ENTRE VOISINS DIACHRONIQUES ET CYCLE DE LA DÉPOSSESSION
Le processus légal qui permit l’appropriation de biens à l’origine palestiniens transforma la propriété de personnes dites « absentes » en propriété d’État, à la fois de facto et de jure. Les boutiques, les usines, les maisons et les autres pro-priétés immobilières urbaines furent d’abord transférées au Gardien israélien des propriétés des absents pendant la guerre, et furent ensuite gérées, juste après celle-ci, par l’agence gouvernementale Amidar48. Au fur et à mesure que le nombre d’appartements gérés par Amidar augmenta au cours des années49, leur gestion devint de plus en plus diffi cile, en particulier d’un point de vue fi nancier. Amidar commença alors à vendre nombre de ses appartements, le plus souvent à leurs locataires50. Ce faisant, les biens palestiniens nationalisés devinrent des propriétés privées, appartenant essentiellement à des Juifs51.
Les rencontres entre les propriétaires originels et ceux qui leur avaient succédé ont mis en évidence le fait que ces maisons dans lesquelles ils étaient « voisins diachroniques », une expression utilisée par Yfaat Weiss pour rendre compte des relations uniques qui se forment entre personnes ayant vécu dans la même maison à différentes époques52, constituent une illustration symbo-lique du confl it. Ces rencontres sont souvent l’apogée dramatique du récit des visites de retour, au cours duquel la contestation de la propriété (symbolique comme légale) touche à son expression la plus distincte : le second occupant, qui veut éviter que son mode de vie ne soit troublé, se trouve à l’intérieur de la maison ; à l’extérieur, le premier occupant souhaite revendiquer sa propriété, ne serait-ce que de façon temporaire et sur un registre émotionnel. Les récits de ces rencontres révèlent aussi un cycle de la dépossession, suivant lequel les maisons prises aux Palestiniens sont données à des occupants juifs qui ont perdu leur propre maison dans leur pays d’origine.
Les propriétaires juifs actuels réagirent souvent aux visites de retour en rejetant le visiteur palestinien et en refusant de le ou la laisser entrer, une réponse qui créait une nouvelle expérience de dépossession et d’expulsion pour ces visiteurs. La résidente anonyme de Ramla, qui vint de Ramallah au début des années 1990 avec un jeune ami de ses enfants, se vit non seulement refuser
48. Traduction en hébreu de « ma nation demeure ».49. En 1949, Amidar gérait environ 10 000 appartements. En 1962, le nombre de biens que l’insti-
tution contrôlait était passé à 200 000, puis à 300 000 dans les années 1980. Ytzhak KATZ, Privatization, Tel Aviv, Pecker, 1997 [en hébreu], 191.
50. Ibidem, p. 190-194.51. Il convient de noter ici qu’il est clair que ces transactions n’étaient pas uniquement motivées
par des raisons fi nancières, mais avaient aussi une dimension politique, puisque nombre des biens mis en vente, qui étaient enregistrés comme propriétés de l’Autorité de développement depuis 1953, étaient des biens à l’origine palestiniens qui étaient alors transférés de façon permanente entre les mains de personnes privées.
52. Yfaat WEISS, A Confi scated Memory : Wadi Salib and Haifa’s Lost Heritage, New York, Columbia University Press, 2011, chapitre 1.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1109012_rhmc61-1_007_208.indd 110 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 111
l’entrée de la maison, mais on la menaça également d’aller prévenir la police. Son jeune compagnon de voyage décrivit cette visite comme un traumatisme pour tous ceux qui étaient impliqués :
« Elle les supplia ! Elle pleura. Je n’oublierai jamais cela. Et ils ont refusé. Alors elle a abandonné. Nous sommes remontés dans le bus et nous sommes rentrés à la maison »53.
Le refus de laisser entrer le visiteur peut aussi être considéré comme une façon de surmonter une certaine gêne morale. C’est peut-être la raison pour laquelle le nouveau propriétaire de la maison de George Bisharat refusa de lui laisser en faire le tour : le magistrat à la retraite qui avait siégé à la Cour suprême israélienne était sans nul doute familier avec les diffi cultés légales et éthiques liées à son droit de propriété54. Lors de la visite de sa maison d’enfance à Haïfa au début des années 1990, Fawaz Turki se vit aussi refuser l’entrée, quoique de façon moins brutale. Turki rend compte du dialogue emprunt de maladresse et de gêne avec le second occupant, un homme âgé venu d’Europe de l’Est. Au cours de la conversation, Turki essaya d’expliquer son statut unique de Palestinien-américain visitant sa maison d’enfance, sans déclarer ouvertement sa nationalité. Par la suite, le vif étonnement du second occupant força Turki à être plus direct :
« “Je veux dire, je suis Palestinien. Je ne suis pas Israélien”. Cet ajout redondant ne fi t qu’accroître l’agitation des expressions faciales qu’il faisait avec ses sourcils ridés et la moue de sa lèvre inférieure. Il me regarda alors comme si je l’avais gifl é. Ses mains commencèrent à trembler de façon plus évidente.
Sur la défensive, je balbutie alors : “Je veux dire, enfi n, vous savez, je suis en fait américain”. Mais l’homme veut alors que je sorte de sa maison. Sa maison. Ma maison. Notre maison.
Je suis parti sans que l’un de nous deux ne dise un mot de plus »55.
Alors que la visite de retour de Turki se termina sans trouble majeur, d’autres échanges de ce type ont été plus animés, parfois même cruels. L’anthropologue Rema Hammami, une Palestinienne de seconde génération née en Arabie Saoudite, vint à Jaffa au printemps 1989 accompagnée de sa tante maternelle. Celle-ci avait quitté Jaffa en 1948 à l’âge de onze ans, et avait passé son adolescence à Beyrouth, avant de retourner vivre à Jérusalem. Dans un essai publié en 1998, Hammami décrit le rude accueil qu’elle reçut dans sa maison de famille, qui était devenue un centre pour enfants défi cients mentaux. On lui permit de faire le tour des locaux et lorsqu’elle rencontra
53. S. LYND, S. BAHOUR, A. LYND (ed.), Homeland, op. cit., p. 65. Un autre exemple est celui d’un Palestinien du nom d’Omar qui revint voir son ancienne maison à Jérusalem en 1967. Le nouveau propriétaire juif de la maison, lui-même un immigrant venant d’un pays arabe (indéterminé), dit au reporter juif-israélien qui avait incité Omar à faire cette visite : « Je ne sais pas ce qu’il [Omar] veut. Et vous, vous ne le savez pas non plus. Personne dans ce pays ne fera la paix à mes dépens. […] Vous pensez que je n’ai pas laissé derrière moi une maison à l’étranger [?] Et bien si. Je l’ai laissée aux Arabes. Dites à cet homme de s’en aller. Dites-lui que cette maison m’a beaucoup coûté ! Cela m’a beaucoup coûté […] ». Uri OREN, « Omar returns », Yediot Ahronot, 9 juillet 1967, p. 11.
54. G. BISHARAT, « Rite of return », art. cit.55. F. TURKI, Exile’s Return, op. cit., p. 6.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1119012_rhmc61-1_007_208.indd 111 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
112 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
le directeur, il ne lui demanda pas le but sa visite mais, au lieu de cela, lui montra une frise en couleur sur le mur, qui représentait le retour du peuple juif sur la Terre d’Israël et loua l’établissement de l’État juif. Hammami eut l’impression qu’avec ces quelques mots, cet homme déniait non seulement le droit de propriété de sa famille, mais aussi l’existence passée, présente et future des Palestiniens dans ce pays qui était prédestiné pour son peuple56. D’autres occupants secondaires considéraient également la question du droit de propriété comme un « jeu à somme nulle », au terme duquel il ne pouvait y avoir qu’un seul propriétaire gagnant.
Cependant, il y avait aussi ceux qui, en dépit de la surprise causée par l’apparition soudaine des premiers occupants, se montraient plus accueillants. Telle fut l’expérience que raconte Serene Husseini Shahid : alors que le dia-logue entre sa mère et la propriétaire juive actuelle à Musrara sembla d’abord tendu, à la fi n de la visite elles se parlaient comme deux vieilles connaissances. Une des raisons de ce rapprochement était qu’elles partageaient un sentiment de solidarité et d’empathie qui venait des parcours assez similaires qu’elles avaient suivis. Il se trouva que la femme juive était une immigrante venue d’Irak. Lorsqu’elle comprit la nature de la visite, elle déplora l’enchaînement des événements qui les avaient menés là : « Maudits soient-ils [c’est-à-dire, probablement, les gouvernements irakien et israélien]. En Irak, nous avions notre propre maison. Nous n’aurions pas dû venir ici pour avoir à faire face à une situation pareille »57. De la même façon, lorsque Hala Sakakini et sa sœur visitèrent leur ancienne maison à Qatamon, la femme âgée qui dirigeait l’école maternelle dans le bâtiment fut « apparemment émue ». Lorsqu’elle entendit leur
56. S. TAMARI, R. HAMMAMI, « Virtual returns to Jaffa », art. cit., p. 69.57. S. HUSSEINI SHAHID, Jerusalem Memories, op. cit., p. 148-149. La saisie des biens juifs en Irak
s’effectua, comme en Israël, par des moyens légaux. En mars 1951, le parlement vota une résolution portant sur le gel des biens juifs. Cette loi prit effet après que le parlement eut voté une loi de déna-turalisation un an plus tôt (mars 1950) qui, en vigueur pendant un an, permit aux Juifs de renoncer à leur citoyenneté irakienne et de quitter le pays. Cette loi n’évoquait cependant pas la question des biens, et elle déclencha une réponse si massive chez les Juifs que le gouvernement irakien s’alarma et promulgua une seconde loi. Par la suite, en mars 1951, le gouvernement irakien vota une loi qui gela les biens des Juifs candidats à l’émigration. C’est de cette manière que les biens détenus par les Juifs furent nationalisés. De façon plus générale, les communautés juives dans tout le monde arabe souffrirent, en raison des circonstances globales et locales, en particulier entre la fi n des années 1940 et les années 1960. Sur ces événements en Irak, cf. Sylvia G. HAIM, « Aspects of Jewish life in Baghdad under the monarchy », Middle Eastern Studies, 12-2, 1976, p. 188-208 ; Moshe GAT, A Jewish Community in Cri-sis : The Exodus from Iraq, 1948-1951, Jérusalem, Zalman Shazar Center for Jewish History, 1989 [en hébreu], chapitres 4 et 7 ; Elie KEDOURIE, « The break between Muslims and Jews in Iraq », in Mark R. COHEN, Abraham L. UDOVITCH (ed.), Jews among Arabs : Contacts and Boundaries, Princeton, Darwin Press, 1989, p. 21-63 ; Yehouda SHENHAV, « The Jews of Iraq : zionist ideology, and the property of the Palestinian refugees of 1948 : an anomaly of national accounting », International Journal of Middle East Studies, 31-4, 1999, p. 605-630. Pour une vue plus générale de la propriété juive dans les pays arabes, cf. Michael R. FISCHBACH, Jewish Property Claims against Arab Countries, New York, Columbia University Press, 2008, chapitre 1 (en particulier p. 52) ; cf. aussi Itamar LEVINE, Locked Doors : The Seizure of Jewish Property in Arab Countries, Westport, Praeger, 2001, qui analyse en profondeur le sort de la propriété juive en Iraq, Égypte, Syrie et au Liban.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1129012_rhmc61-1_007_208.indd 112 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 113
histoire, elle répondit rapidement à ses visiteuses venues de Ramallah « qu’elle aussi avait perdu sa maison en Pologne »58.
D’autres rencontres entres « voisins diachroniques » produisirent des résultats complètement différents. En 1985, Dalia Eshkenazi, la jeune femme que Bashir el-Hairi avait rencontrée en 1967 (et qu’il appelle « Rachel » dans ses mémoires), décida de transformer la maison de Ramla en un lieu qui incarnerait les histoires des deux familles (et des deux nations). Une fois devenue la propriétaire légale de la maison, Eshkenazi se sentit l’obligation morale de la partager avec ses pro-priétaires originels. Son idée était de transformer la maison en école maternelle pour les enfants palestiniens de la ville. En 1991, ce rêve se matérialisa avec l’inauguration de la « Open House », qui à ce jour encore fonctionne comme un centre de dialogue entre Juifs et Palestiniens59. La maison matérialise maintenant la solution de la restitution, démontrant la possibilité de la coexistence dans une ville mélangée60. Mais il s’agit clairement d’une exception plutôt que de la règle61.
Les rencontres entre propriétaires passés et présents se passèrent de façons complètement différentes lorsque les occupants secondaires étaient aussi des Palestiniens. Noman Kanafani, par exemple, découvrit que sa maison de famille à Acre était occupée par une famille palestinienne avec deux petites fi lles. À cette occasion, l’empathie et la culpabilité s’entremêlent : d’un côté, la nouvelle propriétaire fait tout son possible pour obtenir l’approbation et l’aval du des-cendant des anciens propriétaires : elle fait visiter toute la maison à Kanafani, lui montre les efforts qui ont été faits pour conserver intact le plan d’origine de la maison et fait des compliments sur le bon goût de sa mère. D’un autre côté, le spectre de la dépossession se profi le derrières ces tentatives d’aplanir toutes les tensions potentielles : « Il y avait un accord tacite entre nous », écrit Kanafani, « un sentiment implicite profond que nous sommes tous des victimes et que nous devrions nous estimer heureux que la maison soit occupée pour l’essentiel par des
58. H. SAKAKINI, Jerusalem and I, op. cit., p. XV. En Europe, la confi scation de facto et de jure des biens juifs, lors de l’accession des nazis au pouvoir puis de leurs conquêtes, fut souvent un prélude à, ou une partie intégrante, du génocide. Suivant un long processus qui commença en Allemagne, se poursuivit en Autriche, dans les régions frontalières de la Tchécoslovaquie, et fi nalement dans toutes les zones sous infl uence directe ou indirecte de l’Allemagne, les biens dont les Juifs avaient été expropriés avaient été soit transférés au Reich, soit appropriés par les gouvernements locaux et la population non-juive. En Pologne, par exemple, cette expropriation progressive avait commencé dès novembre 1939, avec le gel de tous les avoirs bancaires des Juifs (et, rétrospectivement, fut le prélude à l’extermination de la communauté juive polonaise) : Constantin GOSCHLER, Philipp THER, « A history without boundaries : The robbery and restitution of Jewish property in Europe », in Martin DEAN, Constantin GOSCHLER, Philipp THER (ed.), Robbery and Restitution : The Confl ict over Jewish Property in Europe, New York, Berghahn Books, 2007, p. 3-17 (en particulier p. 4) ; Dieter POHL, « The robbery of Jewish property in Eastern Europe under German occupation, 1939-1942 », in Robbery and Restitution…, op. cit., p. 68-80 (en particulier p. 71-73) ; Itamar LEVINE, Walls Around : The Plunder of Warsaw Jewry during World War II and its Aftermath, Westport, Praeger, 2004, chapitre 1.
59. S. TOLAN, Lemon Tree…, op. cit., p. 222. Le site web de la maison se trouve à www.friendso-fopenhouse.co.il/ (consulté le 1er août 2012).
60. Ibidem, p. 190-191.61. Voir par exemple le cas de la maison Baramki à Jérusalem. Thomas ABOWD, « The Politics and
Poetics of Place : The Baramki House », Jerusalem Quarterly File, 21, 2004, p. 49-58.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1139012_rhmc61-1_007_208.indd 113 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
114 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
familles palestiniennes plutôt que par des familles juives »62. L’enchaînement de la dépossession s’opérait même au sein des différentes communautés palestiniennes.
D’une certaine façon, la rencontre entre les précédents propriétaires pales-tiniens et les propriétaires palestiniens actuels était, comme la rencontre entre propriétaires palestiniens et juifs, une reproduction en miniature des relations intra-palestiniennes en général. Ces relations ont constitué un problème délicat et ont évolué au cours des années63. Des différences socio-économiques, poli-tiques et culturelles existent entre les Palestiniens qui sont restés à l’intérieur des frontières d’Israël après 1948, les habitants des territoires occupés après 1967, et les réfugiés qui vivent à l’étranger, en Europe ou aux États-Unis. Ces différences séparent ces Palestiniens non seulement géographiquement mais aussi mentalement64. Les émotions et les confl its qui se fi rent jour au cours des visites de retour de 1967 et dans les années 1990 étaient par conséquent diffi -ciles à surmonter pour toutes les parties impliquées, et ce en dépit d’une identité nationale commune et de la mémoire collective d’avant 1948.
« NOTRE MAISON EST UNE TOMBE ! » :LA MAISON ISRAÉLO-PALESTINIENNE COMME PALIMPSESTE
Les maisons retrouvées au cours des visites de retour n’incarnaient plus leurs propriétaires d’origine. Cependant, elles ne correspondaient jamais complètement non plus à leurs occupants secondaires, forcés de construire sur les fondations posées par les premiers. Les maisons palestiniennes-devenues-juives-israéliennes sont ainsi des palimpsestes portant les « formes passées superposées les unes sur les autres » en un sens architectural et fonctionnel, mais aussi, et peut-être principalement, en un sens symbolique65. Dans ces maisons, les traces du passé palestinien étaient encore évidentes en dépit des éléments qui, ajoutés par la suite, marquaient la présence juive-israélienne. Cette juxtaposition rendait et exprimait les nouvelles relations de pouvoir dans l’ère post-Nakba.
Les éléments architecturaux palestiniens qui avaient échappé à la destruc-tion en raison de leurs techniques de construction avancées, de leur design moderne, ou par pure et simple chance, devinrent vite, dès les années 1950, des éléments très recherchés par de nombreux acheteurs juifs-israéliens. Dans le cadre du processus d’embourgeoisement de nombreux quartiers riches de Jaffa et de Jérusalem depuis les années 1970 (et plus particulièrement depuis les années 1990), la « maison arabe » est devenue un objet de plus en plus convoité.
62. N. KANAFANI, « Homecoming », art. cit., p. 42.63. S. TAMARI, « Bourgeois nostalgia… », art. cit., p. 174.64. Sari HANAFI, « The sociology of return : Palestinian social capital, transnational kinship and
the refugee repatriation process », in Eyal BENVENISTI, Chaim GANS, Sari HANAFI (ed.), Israel and the Palestinian Refugees, Berlin, Springer, 2007, p. 3-40 (en particulier p. 37-38).
65. David HARVEY, The Condition of Postmodernity : An Inquiry into the Origins of Cultural Change, Cambridge, Blackwell, 1995, p. 66.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1149012_rhmc61-1_007_208.indd 114 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 115
Il s’agit d’un cas exceptionnel où l’adjectif « arabe » en hébreu (aravi) a fi ni par représenter quelque chose ayant une valeur positive66. Bien que nombre de ces maisons aient été préservées pour conserver leur architecture d’origine, cette préservation n’a fait qu’éveiller l’antagonisme et les ressentiments chez les premiers propriétaires. L’anthropologue américano-palestinienne Lila Abu-Lughod, fi lle de l’érudit de premier plan Ibrahim Abu-Lughod qui s’était exilé de Jaffa en 1948, a consacré un essai aux années de jeunesse de son père, son retour et sa mort en Palestine. « Return to half-ruins » est une sorte d’eulogie intime qui offre un récit détaillé de ses funérailles mémorables à Jaffa en 2001. Abu-Lughod fait une référence rapide à l’embourgeoisement juif des quar-tiers arabes de la ville, non sans railler les « nombreux Israéliens [qui] vivent aujourd’hui dans les quartiers arabes de Jaffa, certains d’entre eux jouissant de maisons restaurées avec goût, agrémentées de carreaux et d’arches de style arabe […] »67. De ce point de vue, la préservation par les Juifs-Israéliens n’est que le prolongement de l’expropriation et de la nationalisation : en tant que reconnaissance prétendue ou même sincère de l’Autre palestinien, la préserva-tion permet de s’approprier non seulement la maison matérielle mais aussi les souvenirs originaux de ses propriétaires palestiniens. De plus, la progression de la transformation bourgeoise des quartiers de Jaffa et Jérusalem a aussi eu tendance à déloger physiquement les occupants pauvres des propriétés de l’Amidar (de diverses appartenances), les forçant à une relocalisation à l’intérieur de la ville. Ce processus a ajouté un maillon supplémentaire à l’enchaînement de la dépossession.
D’un point de vue architectural et fonctionnel, bien des réparations matérielles effectuées dans les maisons visitées étaient plutôt légères, et ne contrarièrent pas les propriétaires d’origine. Lorsque Bashir el-Hairi visita Ramla en 1967, par exemple, il lui sembla que peu de choses avaient changé dans sa maison de famille. Bien que la sonnette du portail de derrière ait été enlevée et que les meubles aient été remplacés, el-Hairi et ses amis conclurent que « ils [les nouveaux propriétaires] n’ont rien changé dans la maison »68. De façon similaire, dans la maison de la famille Husseini, les choses étaient pour l’essentiel les mêmes, et les seuls changements étaient dus à des nécessités fonctionnelles : les nouveaux propriétaires qui vivaient là bien plus nombreux que ne l’avaient prévu les propriétaires d’origine, furent obligés d’utiliser les rebords de fenêtre en pierre comme plans de cuisine improvisés69. De la même façon, la rambarde de métal ajoutée autour de la véranda de la maison de la
66. Amiram GONEN, Gad COHEN, « Diverse gentrifi cation of neighbourhoods in Jerusalem », City and Region, 19-20, 1989, p. 9-27 [en hébreu] (en particulier p. 18) ; N. LICHFIELD, Y. SHVEID, Shimur Moreshet Habinuy BeIsrael, Jérusalem, The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1986, p. 264.
67. Lila ABU-LUGHOD, « Return to half-ruins : memory, postmemory, and living history in Pales-tine », in Nakba, op. cit., p. 77-104 (en particulier p. 98).
68. B. EL-HAIRI, Letters…, op. cit., p. 38, 42.69. S. HUSSEINI SHAHID, Jerusalem Memories, op. cit., p. 149.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1159012_rhmc61-1_007_208.indd 115 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
116 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
famille Sakakini à Qatamon avait pour but d’empêcher d’y grimper les bambins de l’école maternelle maintenant installée dans la maison70.
Cependant, il y avait aussi des changements qui menaçaient de masquer l’identité palestinienne des maisons et qui, par conséquent, agacèrent les pro-priétaires d’origine. Lorsque Rema Hammami et sa tante tentèrent de retrouver leur maison de famille dans le quartier Jabaliyya de Jaffa, elles
« continuèrent à tourner en rond en suivant la même rue du quartier résidentiel, et ma tante montrait du doigt la maison de Said Hammami, la maison de pierre rose de la famille Kanafani au coin de la rue, et ainsi de suite. Confuse, elle refaisait alors son calcul : “Notre maison devrait se trouver ici”. Quand tout à coup, elle comprit : le bâtiment israélien de deux étages, marron, grotesque et affreux était en fait notre maison, maintenant masquée par une façade hideuse en béton de galets. Nous sommes sorties de la voiture et elle commença à pleurer, “Ils l’ont enterrée ! Notre maison est une tombe !” […] Ma tante était trop contrariée pour rentrer dans la maison et elle remonta dans la voiture »71.
La tante d’Hammami perçut les changements architecturaux effectués comme un enterrement prématuré du bâtiment, une tentative pour faire dispa-raître les traits distinctifs originaux de la maison. La maison avait aussi reçu un nom hébreu, Beit Nurit (Maison Bouton d’Or), et cependant la véranda à trois arches était encore là, tout comme le grand liwan (un hall central traditionnel). Les ajouts effectués et le changement de nom avaient pour but d’essayer de transformer la maison de la famille Hammami en une maison juive-israélienne, mais ses éléments palestiniens d’origine étaient diffi ciles à faire disparaître, même en les recouvrant d’une couche de béton de galets.
Il existait encore d’autres tentatives d’oblitérer le passé palestinien des maisons maintenant occupées par des Juifs, des tentatives motivées par des préoccupations nationales plutôt que fonctionnelles. Le récit de George Bisharat en fournit quelques exemples intéressants. Une anecdote rapporte que Golda Meir, qui avait habité dans l’appartement supérieur de la maison de Jérusalem, demanda que l’on fasse décaper à la sableuse le nom arabe du bâtiment sur le portail avant l’arrivée de Dag Hammerskjöld, secrétaire général des Nations unies72. Véridique ou non, l’anecdote fut d’une certaine façon reproduite par
70. H. SAKAKINI, Jerusalem and I…, op. cit.71. S. TAMARI, R. HAMMAMI, « Virtual returns to Jaffa », art. cit., p. 68. Souligné par l’auteur.72. G. BISHARAT, « Rite of return », art. cit. Cette anecdote apparaît aussi (sans référence) dans
un livre de David Kroyanker. Dans un autre livre paru plus tard, Kroyanker corrigea légèrement sa version, avançant que Golda Meir vivait là dans les années 1950 alors qu’elle était ministre du Travail, et que c’est vers cette époque que l’enseigne de l’entrée principale de la maison fut enlevée pour effacer les traits distinctifs arabes du bâtiment : David KROYANKER, Jerusalem Architecture – Periods and Styles : Arab Building Outside the Old City Walls, Jérusalem, The Jerusalem Institute for Israel Studies, 1975 [en hébreu], p. 268 ; ID., Jerusalem Neighbourhoods: Talbiyeh, Katamon and the Greek Colony, Jérusalem, The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2002 [en hébreu], p. 120-121. D’après l’autobiographie de Golda Meir, elle vécut dans cette maison de 1949 à 1956, et ce fut sa résidence : Golda MEIR, My Life : The Autobiography of Golda Meir, Londres, Weidenfeld and Nicholson, 1975, p. 224, 226. Hammerskjöld fut secrétaire général de 1953 à septembre 1961 et effectua une visite au Moyen-Orient en avril-mai 1956. Il semble donc que l’histoire de Meir donnant l’ordre d’ôter ce signe avant son arrivée, si elle est véridique, n’a pu se produire que vers le milieu de l’année 1956, avant qu’elle ait quitté sa résidence de Jérusalem.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1169012_rhmc61-1_007_208.indd 116 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 117
l’expérience personnelle que vécut Bisharat lors de son retour de 1977 pour visiter la maison : le couple de personnes âgées qui l’occupait fut réticent à le laisser pénétrer au-delà du hall d’entrée. Ils lui dirent qu’ils avaient trouvé le plafond et les murs tachés de suie, que « la maison avait subi de gros travaux et qu’ils avaient fait beaucoup pour l’arranger ». « De toute façon, tout a changé » prétendirent-ils, pour justifi er de leur refus de le laisser entrer plus avant. Bis-harat cependant, ne fut pas contrarié par les réparations en elles-mêmes, mais par ce qu’elles représentaient : « Cette histoire de rénovation représentait aussi une version urbaine et à plus petite échelle du mythe selon lequel les sionistes avaient trouvé une terre en friche et avait “fait fl eurir le désert” »73.
La tentative de reconstruction de la maison pour lui donner une nouvelle essence juive était cependant vouée à l’échec. Son passé palestinien était encore clairement évident, en dépit des gros travaux de rénovation et des tentatives d’oubli. De façon très symbolique, même le nom de la villa était encore visible près de l’entrée.
Pour conclure, certaines des altérations effectuées sur les maisons pales-tiniennes dont des Juifs s’étaient saisis étaient d’ordre technique et visaient simplement à adapter l’édifi ce à de nouvelles fonctions. D’autres changements n’étaient que superfi ciels d’un point de vue fonctionnel, mais en un sens plus profond, ils avaient pour but de masquer ou même oblitérer de façon symbolique le passé de la maison. D’un autre côté, la préservation constituait une tentative de conserver les traits distinctifs originaux, mais ce faisant, elle contribuait aussi à poursuivre le processus d’appropriation. Dans tous ces cas, le résultat fi nal était très similaire : la maison palestinienne-devenue-juive-israélienne était transformée en un palimpseste qui portait les traces des voisins diachroniques qui l’avaient occupée à différentes époques.
Alors que la plupart des auteurs cités ci-dessus étaient soit quelque peu contrariés, soit extrêmement hostiles lorsqu’ils découvrirent les changements effectués sur leur maison de famille, Fawaz Turki resta plutôt stoïque. S’étant vu refuser l’entrée de sa maison d’enfance à Haïfa, il ne savait que trop bien que la maison qu’il avait connue étant bambin n’était plus vraiment là. Selon lui, les maisons d’enfance étaient irrémédiablement changées par la guerre, et seules les choses « héritées de la nature, la vue de la Méditerranée en contrebas, le ciel sans nuage au-dessus, le vert luxuriant des arbres autour, survivaient sans changer »74.
CONCLUSIONS
Dans son livre sur la construction de l’identité palestinienne, Rashid Khalidi fait référence aux diverses identités enchevêtrées de la population arabe de la Palestine ottomane, « comprenant des fi délités transnationales, religieuses,
73. G. BISHARAT, « Rite of return », art. cit.74. F. TURKI, Exile’s Return…, op. cit., p. 4.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1179012_rhmc61-1_007_208.indd 117 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
118 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
locales, familiales et envers l’État-nation »75. À ces diverses façons de se per-cevoir, nous pourrions ajouter un sens de l’identité dérivé de la possession de biens. Margaret Jane Radin développe ce thème de la relation entre propriété et personnalité, et ce faisant distingue deux catégories de biens : « les biens qui sont liés à une personne, et les biens qui ne sont détenus que de façon purement instrumentale : respectivement, les biens personnels et les biens fongibles »76. D’après Radin, les « biens liés à la personne » et la force du lien entre individus et « choses » dérivent de et sont exprimés par plusieurs marqueurs, à commencer par l’idée généralement acceptée selon laquelle le caractère et l’individualité d’une personne s’expriment au travers des biens qu’elle possède77. Un autre marqueur est lié aux attentes futures de la personne par rapport à ses biens, et l’idée que la perception que cette personne a de sa propre individualité dépend de la réalisation de ses attentes dans les années à venir78. Cette idée semble être particulièrement valable dans le cas qui nous intéresse ici puisque les mots bayt et dar (les équivalents arabes de maison) font simultanément référence à la structure physique et à la famille qui l’habite. Ainsi, ces mots dénotent la permanence, la sécurité et une projection dans le futur79. Enfi n, la force du lien entre individu et biens, d’après Radin, est aussi déterminée par « le genre de douleur qui s’ensuivrait en cas de perte »80. Dans le cas palestinien, la théorie de la propriété constitutive de la personne permet d’expliquer la réticence à réclamer et recevoir une compensation de la part d’Israël, étant donné le lien intime entre les maisons et la construction de la personne.
Toutefois, la question de la propriété ne saurait être appréhendée comme appartenant exclusivement au domaine privé. La propriété est une construction sociale et politique fondée sur l’idée que la propriété n’est pas une « chose » mais un « droit ». De ce point de vue, et comme Crawford B. Macpherson l’exprime clairement, « tout système de propriété est un système organisant les droits de chaque personne en relation avec autrui »81. En effet, pour ces citadins pales-tiniens des classes moyennes à supérieures qui retournèrent visiter leurs mai-sons de famille, le discours sur les biens et la propriété ne fut pas une matière strictement personnelle. Le début du XXe siècle a vu l’ascension d’une classe moyenne palestinienne dont le style de vie était résolument différent de celui de la population rurale, ou même de celui des classes urbaines plus pauvres.
75. Rashid KHALIDI, Palestinian Identity : The Construction of Modern National Consciousness, New York, Columbia University Press, 1997, p. 20.
76. Margaret Jane RADIN, « Property and personhood », in Reinterpreting Property, Chicago, University of Chicago Press, 1993, p. 35-71 (en particulier p. 37).
77. Ibidem, p. 42.78. Ibidem, p. 43.79. Rosemary SAYIGH, « A house is not a home : permanent impermanence of habitat for Palestinian
expellees in Lebanon », Holy Land Studies, 4/1, 2005, p. 17-39 (en particulier p. 19).80. M. RADIN, op. cit., p. 37.81. Crawford B. MACPHERSON, Property : Mainstream and Critical Position, Toronto, University
of Toronto Press, 1978, p. 4.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1189012_rhmc61-1_007_208.indd 118 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 119
Les familles les plus aisées envoyaient leurs fi ls et leurs fi lles à l’école dans des établissements réputés et passaient leurs vacances à l’étranger ou dans des résidences d’été. Cette existence bourgeoise avait tendance à conjuguer traditions locales (comme par exemple fumer le narguilé) et styles occiden-taux. Ceci est particulièrement évident dans la conception architecturale des maisons urbaines palestiniennes avec leur combinaison d’éléments distinctifs du Moyen-Orient (comme le liwan) et de caractéristiques européennes (comme l’utilisation du toit en pente couvert de tuiles rouges ou de sols à l’italienne). En ce sens, il est particulièrement intéressant de noter l’interprétation locale de l’architecture moderniste (et plus particulièrement du style Bauhaus) que l’on pouvait trouver à Haïfa et Jaffa à l’époque mandataire82. Cette culture unique distingue la classe moyenne des autres groupes au sein de la société palestinienne83.
Avec l’écroulement des centres urbains palestiniens en 1948, cette bour-geoisie se dispersa. Comme nous l’avons vu, nombre de ces familles pouvaient se permettre de commencer une nouvelle vie à l’étranger. Cependant, la ville palestinienne qu’ils laissèrent derrière eux se marginalisa progressivement dans la mémoire collective. Manar Hasan a proposé plusieurs explications du semi-effacement de la ville de la mémoire collective palestinienne (et de la mémoire collective sioniste). Par-dessus tout, le déracinement et la dispersion de la population urbaine forcèrent la bourgeoisie palestinienne « à inventer le village, à orner ses souvenirs de différentes formes de traditions rurales et de les intégrer à l’histoire »84.
Ainsi, le retour aux maisons de famille dans les villes a dû réveiller des souvenirs urbains « oubliés », alors que la rencontre avec la maison véritable qui impliquait l’expression du discours sur la propriété et les biens ravivait la conscience de classe (dans son contexte palestinien d’avant 1948). Avec leur valeur économique et symbolique, leur architecture distincte et leurs souve-nirs privés, les maisons visitées fonctionnaient comme un rappel puissant du milieu socio-économique dont étaient issus ces Palestiniens exilés, déclenchant la reconstitution non seulement d’une identité personnelle mais aussi d’une conscience de classe.
Le discours palestinien sur la propriété et les biens met en lumière non seu-lement des identités personnelles et de classe mais aussi des identités nationales. L’idée de la maison de famille palestinienne est désormais connectée à celle de la maison nationale palestinienne, liant le personnel et le collectif sous un même toit. En effet, d’après Amahl Bishara, la maison palestinienne est devenue « une métaphore compliquée de la nation ». Selon elle, comme l’État-nation, il
82. Cf., par exemple, Shmuel YAVIN (ed.), Bauhaus in Jaffa : Modern Architecture in an Ancient City, Tel Aviv, The Bauhaus Center Tel Aviv, 2006.
83. I. RADAI, « The collapse… », art. cit. ; D. KROYANKER, Jerusalem Neighbourhoods…, op. cit. Cf. aussi, par exemple, les mémoires d’Edward Said, Serene Husseini Shahid, Hala Sakakini, et Ghada Karmi.
84. M. HASAN, « The destruction of the city… », art. cit., p. 203.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1199012_rhmc61-1_007_208.indd 119 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
120 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
est diffi cile d’imaginer partager sa maison avec un étranger85. Ce lien entre les dépossédés et leurs maisons, entre réfugiés et leur patrie, a fi ni par être symbolisé par la clef de la maison abandonnée. De nombreux réfugiés sont partis avec les clefs de leur maison en 1948, pensant que leur départ ne serait que temporaire, et ces clefs sont devenues un symbole collectif et national du Retour imaginé86, un symbole que l’on voit apparaître comme élément visuel sur les posters et dans les graffi tis87.
Ce droit sert toujours de toile de fond aux visites de retour dans les mai-sons palestiniennes. L’espoir d’une réunion permanente du propriétaire et de sa maison est donc aussi un souhait de récupérer la patrie perdue, la visite de retour évoquant le rêve d’un Retour futur. En effet, alors que la visite de Noman Kanafani dans sa maison de famille à Acre était sur le point de s’achever, son hôte palestinien (le nouveau propriétaire de la maison), trouva bon de lui crier ce qui peut être compris comme une question au sens double : « [Q]uand revenez-vous ? »88.
* * *
À la lumière des exemples présentés ici, les récits de visites de retour dans les maisons urbaines palestiniennes ne rentrent pas facilement dans les catégories de la nostalgie, du patrimoine, de la généalogie ou du tourisme de diaspora. En contraste avec la plupart de ces genres de voyage, les visites de retour palestiniennes (ou tout au moins leurs récits) possèdent plus que des connotations émotionnelles et comportent aussi des problèmes légaux, économiques et politiques. Opérant à la fois sur un registre individuel et sur un registre national, les visites de retour palestiniennes expriment donc la persistance des revendications de restitution. Elles prouvent que, même s’il se peut que les biens eux-mêmes ne soient jamais rendus, le discours sur leur propriété est voué à durer. C’est en particulier le cas dans le contexte urbain, où de nombreux biens immobiliers « abandonnés » subsistent et servent de rappel constant de la dépossession et de la perte.
Comme nous l’avons vu, le discours palestinien sur la propriété et les biens est riche et fl uctuant, en dépit de l’expérience commune de la Nakba. Au sein de ce discours, des pratiques rhétoriques et physiques sont mises en œuvre pour revendiquer la propriété symbolique, la rencontre entre « voisins diachroniques » révèle à la fois les tensions et la possibilité d’une coexistence entre anciens et nouveaux occupants, et la juxtaposition des passés et des présents est mise en
85. Amahl BISHARA, « House and homeland : examining sentiments about and claims to Jerusalem and its houses », Social Text, 21-2, 2003, p. 142-162 (en particulier p. 143-144).
86. G. BISHARAT, « Rite of return », art. cit. ; L. KHALILI, « Grass-Roots Commemorations… », art. cit., p. 13-14 ; S. LYND, S. BAHOUR, A. LYND (ed.), Homeland, op. cit., p. 65. Cf. aussi Riina ISOTALO, « Palestinian return : refl ections on unifying discourses, dispersing practices and residual narratives », in Israel and the Palestinian Refugees, op. cit., p. 159-188.
87. L. KHALILI, « Grassroot commemorations… », art. cit., p. 13-14.88. N. KANAFANI, « Homecoming », art. cit., p. 42.
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1209012_rhmc61-1_007_208.indd 120 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
VISITES DES EXILÉS PALESTINIENS À LEUR ANCIENNE MAISON 121
lumière par les traits distinctifs visibles de la maison palestinienne qui subsistent dans sa récente réincarnation juive-israélienne. De toutes ces façons, par le biais du discours sur la propriété, les visites de retour contribuent à façonner et à reformuler les identités politiques, socio-économiques et individuelles.
Le discours palestinien sur la propriété et les biens met aussi l’accent sur la complexité des relations entre Palestiniens, et en particulier des problèmes israélo-palestiniens sensibles, non seulement dans le passé mais aussi dans le futur. Les Palestiniens retourneront-ils un jour dans leurs maisons, non pas en tant qu’individus mais en tant que peuple ? Y a-t-il une maison qui soit assez grande pour servir de « maison nationale » pour les citoyens des deux nationalités ? Enfi n, quel rôle joueront les Palestiniens exilés des classes moyennes à supérieures dans ce retour imaginé ? De façon plus importante, le discours palestinien sur la propriété et sur les biens, tel que restitué ici, fait voir clairement que tant que la blessure israélo-palestinienne reste ouverte, le problème des maisons palestiniennes perdues et de leur propriété contestée est voué à demeurer une partie du problème originel mais aussi une partie de sa résolution future.
Danna PIROYANSKY
Tel-Aviv, Israë[email protected]
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1219012_rhmc61-1_007_208.indd 121 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
122 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE
Résumé / Abstract
Danna PIROYANSKYRetrouver son foyer : propriété et dépossession dans les récits de visitedes exilés palestiniens à leur ancienne maison
Cet article examine le discours palestinien sur les biens et la propriété dans le contexte israélo-palestinien. Il analyse ce discours au sens culturel, à travers les récits autobiographiques palestiniens de visites de retour dans les maisons urbaines. Cet article se concentre sur deux moments historiques (après 1967, et dans les années 1990) durant lesquels les visites de retour des Palestiniens dans leurs anciennes maisons, leurs anciens quartiers et villes se multiplièrent, et il s’articule autour de trois parties. La première s’intéresse aux pratiques rhétoriques et symboliques qui, mises en œuvre pour exprimer la propriété palestinienne vis-à-vis des propriétaires juifs-israéliens actuels, soulignent le rôle du Palestinien en tant que visiteur de retour dans l’acte de revendication. La deuxième partie examine la rencontre entre « voisins diachroniques » et le cycle de la dépossession qui, s’opérant dans le contexte israélo-palestinien au sens large, se concentre sur la relation entre habitants passés et présents. Enfi n, la troisième partie se concentre sur la maison elle-même et développe l’idée de la maison palestinienne-devenue-israélienne conçue comme un palimpseste qui révèle les couches successives de l’occupation et de la propriété pas-sées et présentes. Cette troisième section est suivie d’une discussion des répercussions générales de ce discours concernant les biens et la propriété sur la construction de l’identité palestinienne du point de vue de l’individu, de la communauté et de la nation, mettant en lumière le rôle de ce discours dans toute future résolution du confl it israélo-palestinien.
MOTS-CLÉS : Palestine, Israël, XXe siècle, retour, propriété, dépossession ■
Danna PIROYANSKYReclaiming home : property and ownership in narrativesof return visits to the palestinian urban house
This article examines the Palestinian discourse of property and ownership in its Israeli-Palestinian context. It deconstructs and reconstructs this discourse in the cultural sense by analysing Palestinian autobiographical narratives of return visits to urban homes. Set in two historical moments (post-1967 and the 1990s) in which Palestinian return visits to former homes, neighbourhoods and cities became widespread, this article is centred on three thematic sections. The fi rst deals with rhetorical and symbolic practices articulating Palestinian ownership vis-à-vis the present Israeli-Jewish owners, emphasising the role of the Palestinian returning visitor in the act of reclamation. The second section examines the encounter between “diachronic neighbours” and the chain of dispossession that has been in operation in the broader Jewish-Palestinian context, centring on the relationship between past and present occupants. Finally, the third section elaborates on the idea of the Palestinian-turned-Israeli home as palimpsest, exposing various layers of past and present occupation and ownership and placing the house itself in the focus. This section is followed by a discussion of the overall effect of this ownership and property discourse on Palestinian identity-making in its individual, communal and national senses, highlighting its signifi cance in any future resolution of the Israeli-Palestinian confl ict.
KEYWORDS: Palestine, Israel, 20th century, return, property, dispossession ■
9012_rhmc61-1_007_208.indd 1229012_rhmc61-1_007_208.indd 122 30/04/14 16:3330/04/14 16:33
Doc
umen
t tél
écha
rgé
depu
is w
ww
.cai
rn.in
fo -
-
- 84
.228
.15.
37 -
02/
09/2
014
17h2
5. ©
Bel
in D
ocument téléchargé depuis w
ww
.cairn.info - - - 84.228.15.37 - 02/09/2014 17h25. © B
elin
Related Documents