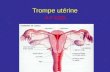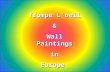BRÈVE PRÉSENTATION DE LA QUESTION Dans les recherches concernant l’acquisition du langage écrit est insé- rée l’analyse des ratures présentes dans les textes écrits par les élèves en salle de classe, cadre au sein duquel ces ratures apparaissent comme des indices d’opérations métalinguistiques. Les travaux de nombreux chercheurs français (Turco 1988 ; Penloup 1994 ; Boré & David 1996 entres autres) et, en particulier, les recherches menées par Claudine Fabre (1990, 2002), pionnières en ce qui concerne les études sur les brouillons des élèves, soutiennent que le retour de l’apprenti sur le texte qu’il écrit implique, d’une certaine manière, une capacité de réflexion à analyser des éléments linguistiques (syntaxiques, phonologiques, lexicaux, morphologiques, orthographiques, etc.). Selon ce que Fabre affirme, « lorsque le scripteur modifie, il se place de fait dans une position métalinguistique » (Fabre, 1990 : 14). Cette affirmation va dans le même sens théorique que celui soutenu par Rey-Debove (1982) : La rature est une activité métalinguistique, et non linguistique, parce qu’elle n’entre pas dans l’opposition « écrire/pas écrire » (opposition linguistique). La rature d’un mot travaille sur un énoncé déjà là […]. Le fait de barrer entre dans l’opposition métalinguistique « ajouter une séquence/retrancher une séquence », les deux opérations échappant à la spontanéité de l’encodage phrastique. Eduardo Calil Université Fédérale d’Alagoas (Brésil) [email protected] Cristina Felipeto Université de Sciences Médicales de l’Etat d’Alagoas (Brésil) [email protected] Quand la rature (se) trompe : une analyse de l’activité métalinguistique © Langage et société n° 117 – septembre 2006

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BRÈVE PRÉSENTATION DE LA QUESTION
Dans les recherches concernant l’acquisition du langage écrit est insé-rée l’analyse des ratures présentes dans les textes écrits par les élèvesen salle de classe, cadre au sein duquel ces ratures apparaissentcomme des indices d’opérations métalinguistiques. Les travaux denombreux chercheurs français (Turco 1988 ; Penloup 1994 ; Boré &David 1996 entres autres) et, en particulier, les recherches menées parClaudine Fabre (1990, 2002), pionnières en ce qui concerne les étudessur les brouillons des élèves, soutiennent que le retour de l’apprentisur le texte qu’il écrit implique, d’une certaine manière, une capacitéde réflexion à analyser des éléments linguistiques (syntaxiques,phonologiques, lexicaux, morphologiques, orthographiques, etc.).Selon ce que Fabre affirme, « lorsque le scripteur modifie, il se placede fait dans une position métalinguistique » (Fabre, 1990 : 14). Cetteaffirmation va dans le même sens théorique que celui soutenu parRey-Debove (1982) :
La rature est une activité métalinguistique, et non linguistique, parce qu’ellen’entre pas dans l’opposition « écrire/pas écrire » (opposition linguistique). Larature d’un mot travaille sur un énoncé déjà là […]. Le fait de barrer entre dansl’opposition métalinguistique « ajouter une séquence/retrancher une séquence »,les deux opérations échappant à la spontanéité de l’encodage phrastique.
Eduardo CalilUniversité Fédérale d’Alagoas (Brésil)[email protected]
Cristina FelipetoUniversité de Sciences Médicales de l’Etat d’Alagoas (Brésil)[email protected]
Quand la rature (se) trompe : une analyse de l’activité métalinguistique
© Langage et société n° 117 – septembre 2006
Selon Fabre (1986 : 59), « les variantes des brouillons marquaientune démarche d’interrogation et d’ajustement, travaillant sur la scription,la langue, le discours, et susceptibles d’être les traces de diverses acti-vités métalinguistiques et métadiscursives ». Cette démarche d’inter-rogation et d’ajustement indique qu’on suppose l’existence d’uneautonomie dans les activités métalinguistiques au sein de laquelle le« sujet qui rature » et l’« élément raturé » se trouvent dans des ins-tances distinctes et séparées, à savoir, d’une part, la langue, en tantque système régi par des règles et des normes qu’il convient de domi-ner, et d’autre part, le mode de fonctionnement de l’apprenant, reflé-tant et analysant les éléments qui composent le système.
Considérer la rature comme une activité « méta », désignant unecertaine distanciation entre l’apprenti et le texte qu’il écrit, nousconduit à nous interroger sur ce que cette position réflexive peutnous révéler de la relation entre le sujet et les marques qui apparais-sent durant l’acte d’écriture. C’est à partir de ce point que nous aime-rions lancer quelques réflexions sur la dimension des ratures ren-contrées dans les textes écrits par des écoliers, en nous focalisant enparticulier sur celles qui ne visent pas l’amélioration du texte, objec-tif premier de l’acte de raturer.
MÉTHODOLOGIE ET OPÉRATIONS MÉTALINGUISTIQUES
En général, les approches méthodologiques des études sur la raturedes textes scolaires sont centrées sur le produit d’un processus d’écri-ture, elles analysent de fait le texte (brouillon ou texte « remis aupropre1 ») dans sa forme achevée, en portant l’accent non seulementsur le caractère quantitatif des ratures que présentent les textes, maisaussi sur la description des types de ratures figurant dans lesbrouillons collectés.
Fabre, en se penchant sur les caractéristiques des altérations ren-contrées dans les énonciations écrites, se demande de quelle façon lesécoliers parviennent à rédiger un discours écrit devenant, au traversdes modifications successives du texte, un « ensemble langagier
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO64
1. Nous entendons par « remettre au propre » le fait de recopier un brouillonen éliminant toutes les erreurs et ratures qui s’y trouvent, usage particuliè-rement répandu dans les milieux scolaires brésiliens.
socialisable2 » (1987 : 15). Il analyse des textes écrits par des élèvesqui fréquentent l’école élémentaire3 en considérant que les modifi-cations rencontrées dans les textes signalent une attitude réflexivechez celui qui écrit à l’égard du texte qu’il écrit.
Pour accéder aux retours des élèves sur les textes et à leurs façonsde les raturer, Fabre propose une méthodologie bien précise. Dans lecadre d’une salle de classe, le chercheur prie les professeurs de CP,CE1, CE2, CM1 et CM2, de demander à leurs élèves de produire untexte. Le plus important, du point de vue méthodologique est quesoient respectées trois étapes du processus d’écriture :– 1re étape : le brouillon (le « premier jet »), écrit au crayon bleu ounoir ;– 2e étape : la relecture du brouillon en utilisant obligatoirement uncrayon rouge pour d’éventuelles modifications ;– 3e étape : la copie de ce texte au crayon vert.
Selon l’auteur, le procédé méthodologique ne peut pas générer depréoccupation relative aux aspects communicationnels, pragma-tiques ou encore aux conditions de production et aux genres textuelsliés aux textes que produisent les apprentis.
Le professeur, dans le respect les conditions de production ordi-naires d’un écrit scolaire, peut proposer en classe de langue françai-se une rédaction ou un dialogue, ou encore un texte descriptif etexplicatif, le recours à ce procédé méthodologique a pour but de faireapparaître les pratiques d’écriture répétitives. De la sorte, les élèvesécrivent pour le professeur, lequel remet le matériel au chercheur.
Justifiant son travail à partir d’une perspective linguistique, Fabredécrit les ratures produites sans établir quelque type de relation quece soit avec d’autres aspects qui peuvent prendre en considérationdes informations sur le niveau social et économique des élèves, surles pratiques de lecture et d’écriture de la communauté à laquelle ils
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 65
2. Fabre utilise la définition présentée par Culioli (1982 : 10) quand il affirmeque le brouillon peut être interprété comme « tout ensemble complexed’états successifs en voie de stabilisation ».
3. Les textes que Fabre analyse furent écrits par des écoliers de 6 à 10 ans fré-quentant le Cours Préparatoire, le Cours Elémentaire et le Cours Moyen(conformément au système français d’enseignement). Dans le contexte sco-laire brésilien correspondant, les enfants de cette tranche d’âge fréquente-raient le premier et le second cycle de l’Enseignement Fondamental.
appartiennent ou encore sur les didactiques d’écriture qui valorisentou non les procédés liés à l’acte de raturer.
Il convient de préciser qu’un tel procédé méthodologique met enévidence les ratures en tant que traits graphiques figurant sur la feuillede papier, celles-ci pouvant exprimer, au travers de marques paralin-guistiques comme des flèches ou des rayures, des relations avec deséléments linguistiques et discursifs propres au processus d’écriture.
Dans le cadre de ses travaux manifestement descriptifs, cherchantà savoir si les ratures forment un système ou encore possèdent unegenèse, Fabre analyse des centaines de textes écrits par des écoliers.
Elle relève environ 6. 000 ratures et identifie quatre types d’opéra-tions métalinguistiques : la substitution, la suppression, le déplace-ment et l’addition. Cependant, l’auteur lui-même souligne le carac-tère relativement lacunaire des interprétations que ces opérationsautorisent, et avoue qu’il serait difficile d’établir des limites, indi-quant que le retour de l’élève sur le texte qu’il est en train d’écriren’apporte pas obligatoirement des « améliorations » (1986 : 60) ou desperfectionnements en ce qui concerne la qualité de ce qui s’écrit.
Dans la « substitution », un terme est substitué, remplacé soit parun autre, soit par lui-même (réécrit). Quand un terme est éliminé puisécrit de nouveau, d’après Fabre, l’hésitation montrerait que le jeuneauteur éprouve des difficultés à « choisir » le meilleur terme ; quandun terme est raturé puis substitué par un autre, la correction indi-querait « plutôt de l’apprentissage de la scription qu’une réflexionsur le discours » (1986 : 76), même si la mise en forme définitive nes’avère pas la plus correcte. Toutefois, elles (ces opérations) ne déri-vent pas toutes d’une activité métalinguistique. Par exemple, le chan-gement constant de « m » en « n », comme dans la « la ferne ferme »et dans « ...le père m n noel », paraît surtout relever, selon ce qu’affir-me Fabre (op. cit. : 74), de l’erreur motrice dans l’écriture de la lettre.
De fait, on ne peut nier qu’une question graphique interfère dansla confusion entre le “m” et le “n”, mais la question à prendre enconsidération est : peut-on nier l’existence d’une relation homopho-nique qu’impliquent entre elles ces deux formes signifiantes ?
Dans la « suppression », le terme choisi est rayé, raturé et non sub-stitué : ce sont des ratures non productives qui traduisent « soit l’aban-don de la vigilance linguistique, soit celui de l’invention » (op. cit. : 73).
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO66
En effet, le « déplacement », dans lequel des graphèmes, des syl-labes ou des mots entiers sont anticipés ou répétés, comme dans lecas de « un p tout petit hippotanes… », représente la troisième desopérations présentes dans les textes des écoliers. Dans l’exemple ci-dessus, le « p » serait une anticipation de « petit », et ceci « peut-êtreparce que la motricité de la main va, spécialement pour les débutants,moins vite que la parole intériorisée (...) […] La synchronisation,propre au scriptural, de la motricité de la main et d’une verbalisationen projet, n’est pas complète » (ibidop. cit. : 76).
Dans le cas des « additions », opérations les moins représentativesdes ratures produites par les écoliers de six à sept ans, l’auteur nous ditqu’elles sont les indices d’un processus de correction d’une lacuneantérieure. Quant à savoir pourquoi elles apparaissent avec une fré-quence moindre, Fabre assure que, à l’inverse des opérations de « sup-pression », où l’écriture est raturée, l’ajout de termes ou d’expressions,se révèle être, pour les écoliers ayant peu d’expérience de l’écriture,une opération très difficile. C’est dans ce sens que pour l’auteur la pré-dominance initiale des opérations de « substitution » et de « suppres-sion » serait en accord avec une perspective génétique culminant « dansl’hypothèse d’une émergence progressive de la conscience linguistique » (op.cit. : 78 ; ; caractères italiques de l’auteur).
Du point de vue quantitatif, les ratures de substitution rencontréesdans les manuscrits du CP et du CM2 furent celles qui présentèrentle plus grand intérêt : 45 % du total des modifications identifiées dansl’ensemble des documents, la raison étant que celles-ci relèventd’opérations métalinguistiques. Ce type de rature, selon Fabre, est« la plus fondamentale et […] la plus universelle c’est-à-dire la plususitée quels que soient le type d’écrit et le type de scripteur » (Fabre1990 : 132). Nous nous attacherons au statut et à la nature de cetteposition « méta » où surviennent les ratures de substitution.
Les limites d’une typologie des opérations métalinguistiquesUn premier point à souligner, parmi les descriptions et interprétationsde ces opérations métalinguistiques, réside dans les indications del’auteur concernant les problèmes de « motricité » et leur relation avecle « mot intériorisé ». Le type de relation auquel l’auteur se réfère restepeu clair. En outre, l’importance donnée aux problèmes de motricité
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 67
pour expliquer la présence initiale des ratures dans les textes des éco-liers de six à sept ans supprime la possibilité d’interpréter cesmarques dans le domaine linguistique.
Soulignant la récurrence de certains phénomènes, comme le retourd’un fragment raturé ou la prédominance de l’utilisation d’une opé-ration au détriment des autres en raison de l’extrême hétérogénéitéqu’impliquent les altérations, l’auteur conclut que les activités relè-vent de la relation très personnelle que chaque écolier entretient avecl’écriture.
Une autre question relative à ces opérations concerne les limites etinterrelations entre les opérations elles-mêmes, à savoir que, confor-mément aux définitions ci-dessus mentionnées, nous pourrions consi-dérer que dans la « substitution » se trouvent une « suppression » etune « addition », et que le « transfert » suppose une « suppression »initiale, suivie d’une possible « substitution » ou « addition ». Bien quel’auteur lui-même commente ces questions d’interrelations entre lesopérations (Fabre 1987 : 16), nous pouvons nous questionner sur leslimites qui existent entre ces interrelations. Nous pouvons aussi nousdemander comment une opération peut en générer une autre.
Il convient également de comprendre comment ces raturesdécrites comme des opérations métalinguistiques, ou bien la sup-pression ou encore le déplacement d’un terme de la chaîne syntag-matique, peuvent interférer sur le sens du texte, allant même jusqu’àproduire de nouvelles ratures.
Finalement, et c’est là le plus important mais le moins présent dansles travaux de l’auteur, il convient de définir la méthode d’enseignementde la langue écrite car elle constitue en soi un mode de signification.Celle-ci détermine les interventions du professeur face à ce qui est consi-déré dans les textes comme correct ou non, ou encore face au rôle quela rature exerce sur le texte. Rappelons que, dans les premières classesde l’école élémentaire, l’enseignement de l’écriture repose en grandepartie sur les aspects graphiques (forme des lettres, enseignement d’untype de lettre spécifique) et sur les conventions orthographiques.
Cela n’aurait-il pas pour conséquence de convoquer la présencede ces opérations de « suppression » et de « substitution », plus pré-cisément de celles qui sont identifiées en plus grand nombre dans lestextes écrits par les écoliers impliqués par la recherche de Fabre ?
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO68
Sans aucun doute, l’auteur prend en considération ces caractéris-tiques de l’enseignement de la langue écrite, mais n’accorde aucuneimportance au fait que la production de texte peut être signifiée dansle processus de scolarisation ; cela revêt une importance capitale sinous prenons conscience que notre dire se construit dans une altéri-té avec l’Autre. Altérité que Authier-Revuz nomme « hétérogénéitéconstitutive » à laquelle tout dire se trouve inévitablement soumis :
Tout discours se montre constitutivement traversé par « d’autres discours »et par le « discours de l’Autre ». L’autre n’est pas un objet (extérieur, dont on parle),mais une condition (constitutive, par qui on parle) du discours un sujet parlantqui n’est pas la source première de ce discours (Authier-Revuz 2004 : 69).
À cette hétérogénéité se confronte un sujet qui n’est plus le centrede son dire. Plus précisément, maintenir l’illusion d’un « moi » sour-ce de domination du dire est, pour le sujet, une fonction nécessairepour qu’il puisse fonctionner avec toutes ses claudications. De celadécoule la nécessité de nous assumer en tant que sujet divisé, décen-tré, entendu fondamentalement comme un « effet du langage » ; laposition d’extériorité du sujet face au langage se fait au travers del’illusion nécessaire de distance et de séparation : distance qu’il main-tient comme observateur et manipulateur d’un langage duquel il setrouve séparé. Les opérations métalinguistiques, au travers de leurpropriété réflexive, rendent cette illusion « réalité ». Elles effacent, ouencore, pour utiliser un mot plus précis, « dénient » l’hétérogénéitéqui la constitue. C’est précisément dans les « ratures équivoquées4 »que nous rencontrerons l’aspect incontournable de la relation dusujet avec la langue et avec le discours.
Car, s’il y a réellement « réflexion » consciente ou métalinguistique,pourquoi est-elle si intermittente, pourquoi bien souvent ne se mani-feste-t-elle pas ? Si la reformulation résulte d’une activité cognitive,pourquoi n’apparaît-elle pas dans l’ensemble du texte, ou, pour lemoins, dans une partie significative de celui-ci ? Si les reformulationsn’indiquent pas toujours un mouvement allant dans la direction dusuccès, du résultat probant ou bien du maintien d’une unité gra-phique, orthographique ou discursive ; si elles ne sont pas présentes
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 69
4. Néologisme qui sera justifié infra.
dans l’ensemble du texte, ou encore, si, dans un même passage, noustrouvons par hasard des « erreurs » pour lesquelles n’existe aucunindice de reformulation, et d’autres encore pour lesquelles il en exis-te (sans parler des reformulations résultant d’erreurs, lorsque l’élèvebiffe ce qui est bon et écrit à la place des « choses erronées »), alorspeut-être devrions-nous tenter d’interpréter ces phénomènes autre-ment que dans une optique cognitive. Nous pourrions reformuler cequi précède en posant la question suivante : comment interpréter unetelle hétérogénéité en considérant l’ordre de la langue elle-mêmecomme fondamentalement hétérogène ?
LA RATURE ET SA DIMENSION SUBJECTIVE
Bien que l’élève écrive les mots de la manière la plus « correcte »possible, certaines ratures présentes dans les manuscrits scolairesindiquent un chemin tortueux, le scripteur abandonnant l’écritureadéquate au profit d’une forme « incorrecte ». Nous appréhendonsdans ce cas l’émergence de l’« équivoque » simultanément provo-quée par et suscitant la rature. Notre intention est, alors, d’établir lesbases théoriques qui nous permettront de discuter les « erreurs dereformulation » ou, plus spécifiquement, les « ratures équivo-quées », en nous penchant particulièrement sur les modes de fonc-tionnement de la langue et sur la relation de celle-ci avec le scrip-teur.
La rature et le « semblant d’erreur »Considérant que l’acte de raturer est très largement fondé sur ce qui« paraît erroné », le scripteur rature seulement ce qu’il a écrit quandil se trouve affecté par son écriture, lorsqu’il l’écoute5 comme « erro-née » ou insatisfaisante (même si, de fait, elle ne l’est pas). Il entre-prend alors de reformuler.
Face à ce « semblant d’erreur » présenté par la rature, nous pou-vons nous demander quels rapports peuvent présenter les forces
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO70
5. La notion d’« écoute » que nous utiliserons a pour origine la psychanalyselacanienne, celle-ci étant réinterprétée dans les travaux d’acquisition du lan-gage oral développé au Brésil (Lemos 1998, 2000). Nous pouvons dire ici quele sujet reconnaît quelque chose qui se produit de façon imaginaire à l’inté-rieur d’un ordre symbolique.
sous-jacentes à l’acte de raturer avec l’écoute, ainsi qu’avec un cer-tain « sentiment d’étrangeté » que le scripteur ressentirait face à sapropre manière d’écrire.
Lorsque le scripteur, dans ce qu’il est en train d’écrire, reconnaît(« écoute ») que quelque chose n’est pas conforme, il éprouve un« sentiment d’étrangeté » pouvant provoquer un « retour » sur letexte, matérialisé par des ratures sur la feuille de papier. Ainsi, ilconvient de reconnaître que la rature ne survient pas uniquementlorsqu’il y a reconnaissance d’une erreur ; on peut raturer ce qui estcorrect. C’est pourquoi il est nécessaire de considérer la rature en sefondant sur le processus de subjectivation qui englobe sujet, langue,sens et possibilités d’« écoute ». Ce traitement est rendu nécessairedans la mesure où nous pourrions comprendre que le « semblantd’erreur » est lié à un registre imaginaire6 dans lequel les élémentslinguistiques et discursifs possèdent une « valeur de vérité », commenous tenterons de le montrer par la suite.
L’équivoque et la ratureSi nous observons que la langue, de façon structurelle, comporte unmanque irrémédiable, elle constitue un non-tout comme dirait Milner(1987) à partir de la notion de lalangue7 (Lacan 1985), nous constatonsque son fonctionnement inclut une manière singulière de produire deserreurs. Ainsi le registre du Réel, considéré comme ce qui échappe àl’appréhension totale du Symbolique, comme ce qui se fait présent danstout et qui compose la réalité humaine (science, histoire, langue, poli-tique, etc.), est la condition présidant à l’émergence de toute équivoque.
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 71
6. Nous nous référons ici à la triade Réel-Symbolique-Imaginaire, qui affleuredans toute la pensée lacanienne. À ce sujet voir, entre autres, Lacan 1998.Authier-Revuz (1995 : 188) commente l’importance de la position méta-énonciative pour l’énonciateur, car il y voit « un lieu privilégié de l’imagi-naire de l’énonciation », signifiant par là que le métalangage est une illusionvitale avalisée par l’imaginaire, lequel permet au sujet de fonctionner endépit de toutes ses claudications.
7. Lacan (1985 : 180) forme le terme « Lalangue » pour nommer le non-tout,tout ce qui ce qui ne se laisse pas appréhender en totalité et affirme que« tout ce qu’on sait faire avec la lalangue dépasse de beaucoup ce que nouspouvons concevoir au titre du langage […] un langage toujours hypothé-tique par rapport à ce qu’il soutient, c’est ça lalangue ».
L’équivoque est alors ce qui embrouille les strates de sorte qu’unénoncé puisse être simultanément lui-même et un autre. Pour citerMilner, nous dirions :
... il est également toujours possible – sans s’éloigner de l’expérience immé-diate – de faire valoir en toute locution une dimension de non-identique ; c’estl’équivoque et tout ce qu’elle promeut, homophonie, homosémie, homographie,tout ce qui fait surgir le double sens et le dire à demi-mot, incessant tissus denos conversations (1987 : 13).
Quelle possibilité de relation y aurait-il entre la rature et la dimen-sion de non-identique, de l’équivoque dans la langue ? De quellefaçon l’harmonie pourrait-elle promouvoir l’équivoque et interférerdans la rature ? Ces questions nous conduisent à la formulation sui-vante : l’apparition de l’équivoque dans la langue peut susciter chez le scrip-teur un étonnement dans la mesure où celui-ci reconnaît, quelque part dansla chaîne syntagmatique, une différence, laquelle manifeste, au travers de larature, une « valeur de vérité ». Cette écoute et son effet de retour surl’écrit, condition de l’acte de raturer, rendent le scripteur otage de ceque nous appelons « semblant d’erreur », laquelle produit, en retour,un effet imaginaire de contrôle et d’autonomie. Vu le caractère desubjectivité présent dans l’acte de raturer, nous entrevoyons alorsdeux mouvements : d’une part, la rature comme « élément stabilisa-teur », où l’on vise à atteindre les propriétés constitutives de lalangue, d’autre part, la rature comme « élément déstabilisateur », oùl’émergence de l’« équivoque » peut laisser penser que la présenced’éléments signifiants rompe un ordre prévisible de la langue, intro-duisant ainsi la dimension du « non-identique » qui menace à toutinstant « le tissus de nos conversations ». C’est précisément ce typede rature que nous appelons « rature équivoquée ».
Les axes de fonctionnement de la langue et le sujetSi nous nous arrêtons un moment sur la théorie de la valeur tellequ’elle est formulée par Saussure dans la deuxième partie de sonCours, selon laquelle la linguistique définit le fonctionnement de lalangue, qui repose sur deux axes, à savoir le syntagmatique et l’asso-ciatif, alors nous appréhendons toute la portée de l’affirmation saus-surienne selon laquelle « la langue est un système qui ne connaît que
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO72
son ordre propre » (Saussure 1995 : 31) – fonctionnement qui, du faitqu’il est étranger à la volonté et à la conscience individuelle, mani-feste de façon intrinsèque un savoir inhérent à la langue elle-même.
Nous considérons que, si le fonctionnement de la langue possèdecomme prémisses des relations et reste étranger à l’ordre de la per-ception, il n’est pas possible de le définir en termes de connaissancecommune à tous les individus. Comme l’affirme Saussure, les unitésde la langue seraient des produits d’un « mécanisme inobservable »,signifiant par là même l’impossibilité d’exercer un quelconque typede contrôle sur ce mécanisme (sauf par un effet imaginaire).
Ce mécanisme inobservable est mû par l’articulation des axes syn-tagmatique et paradigmatique, de sorte qu’on peut affirmer que lalinéarité de la langue laisse percevoir les termes disposés dans unerelation d’enchaînement et de continuité (métonymique) ainsi quedans une relation associative (métaphorique) au sein de laquelle lestermes qui subsistent in absentia peuvent déstabiliser la chaîne.Comme le déclare Milner :
Non seulement le langage est un objet susceptible de métaphore et de méto-nymie, mais il n’est susceptible que de cela. Pourquoi ? Parce qu’en fait la méta-phore et la métonymie sont les seules lois de composition interne qui soient pos-sibles là où seules les relations syntagmatiques et paradigmatiques sontpossibles (Milner 1989 : 390).
Inscrit dans ce double fonctionnement, le sujet se place dans uneposition réflexive, matérialisée dans la rature, qui lui donne la possi-bilité de se séparer, « lui et sa pensée, de la langue qu’il observe del’extérieur comme un objet » (Authier-Revuz 2004 : 73).
Dans ce sens, traiter ces activités métalinguistiques en considérantla « motricité », la « focalisation », la « motivation » ou la « cognition »comme des « causes » possibles du processus de rature paraît élimi-ner un fait du domaine linguistique. Cela ne reviendrait-il pas à pul-vériser l’objet langue en l’introduisant dans d’autres domaines et enempêchant d’interpréter la langue elle-même en son propre fonc-tionnement ? Ou encore ne considérerait-on pas la rature comme unemarque purement spatiale sur la feuille de papier dont les emplace-ments (selon qu’ils se situent au début, au milieu ou à la fin de laligne, avant ou après des mots ou catégories linguistiques déjà
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 73
constituées) indiqueraient l’intention première de celui qui écrit,sans tenir compte des effets de sens dont elles pourraient provoquerla mobilisation ?
RATURES, OPÉRATIONS MÉTALINGUISTIQUES ET ERREURS
Nous allons analyser quelques ratures équivoquées présentes dansun manuscrit scolaire écrit dans des contextes de production relati-vement divers d’où Fabre tira son matériel de recherche. Nous avonsrecueilli ce manuscrit par le truchement de la banque de données« Pratiques de textualisation dans l’école », dont l’objectif est de docu-menter, classifier et construire un patrimoine8 de textes écrits dansdes contextes scolaires, à différentes époques, et dans différentscontextes de production.
Le caractère proprement équivoque de la langue fait que lesratures ont elles-mêmes tendance à être équivoques. C’est-à-dire quel’élève, en tentant d’améliorer le texte ou de l’écrire correctement,finit parfois par produire des erreurs. Ces « ratures équivoquées »revêtent une dimension singulière, car on ne les rencontre dansaucun des cinq cents et quelques manuscrits qui composent notre cor-pus de recherche.
Dans le contexte que nous considérons, les ratures analysées pro-viennent d’une « histoire inventée » : situation didactique danslaquelle l’institutrice de troisième année d’école élémentaire9 propo-se à ses élèves d’inventer une histoire en vue de l’insérer dans le livrequ’ils écrivent tout au long de l’année scolaire. Sa stratégie didactiqueconsiste à rassembler les écoliers par groupes de deux, l’un étantchargé de dicter, l’autre d’écrire. Avant d’écrire le texte, les deux éco-liers se mettent tout d’abord d’accord sur ce qu’ils vont écrire, puisl’institutrice leur remet un crayon et une feuille de papier pour qu’ilspuissent commencer à écrire l’histoire convenue.
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO74
8. Ce patrimoine est la propriété de la cellule de recherche « Manuscrits sco-laires et Processus d’écriture » (www.manuscritosescolares.ufal.br). Dirigéepar le Professeur Dr Eduardo Calil, cette cellule est liée au CNPq (ConseilNational brésilien pour le Développement de la Recherche).
9. Cette année correspond à la deuxième année de l’école primaire du systèmed’enseignement brésilien.
Choisissons un petit passage du début du texte. Celui-ci nousaidera à réfléchir sur la nature et le statut des phénomènes métalin-guistiques qu’indiqueraient les ratures10 selon les auteurs sur les-quels nous débattons.
Dans ce bref fragment en portugais, nous constatons la présencede trois traces explicites de ratures :
1. la suppression et le déplacement de la lettre I [E]11 au début dela ligne ;
2. l’addition de NE [MA] après UN [UM] et, immédiatementaprès, sa suppression par l’utilisation d’une rature ;
3. la substitution de F [V] par [Z] dans le mot « FOIX » [VES].D’après la description de Fabre, il y aurait dans ce petit passage
une méta-opération de « déplacement » (1), une méta-opération de
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 75
10. Bien que la singularité des formes signifiantes de chaque langue rendeimpossible une traduction précise, nous avons choisi de traduire « Il était unefois » par « Il était une foix », en tentant de préserver, autant que possible, laproximité de la langue française et, tout à la fois, de garantir la littéralité del’erreur de l’élève. Nous présenterons le manuscrit en portugais, puis, uneillustration de ce que serait ce manuscrit en français (pour cela nous altéronsle manuscrit original).
11. L’italique indique la forme correspondante, et parfois de façon approxima-tive, en français. Le crochet indique la forme en portugais.
« suppression » (2) et une « substitution » (3). En présence de cettedescription, nous pouvons poser les questions suivantes : de quellefaçon cette description nous aide-t-elle à comprendre le processus dela rature et la relation de l’écolier avec le texte qu’il écrit, ou, pour êtreplus précis, qu’est-ce qui pourrait produire des interférences dans ceque l’on désigne par « opérations métalinguistiques » ? Quelle est lanature, quel est le statut théorique de cette description ? En considé-rant celle-ci uniquement sur la base du résultat final (le texte présen-té), pourrions-nous facilement supposer que les écoliers ont une« connaissance linguistique » ?
Cette absence d’autres marques de paragraphes au long du textemet en doute une domination supposée de l’élève sur cette notion,comme pourrait le laisser penser le déplacement de la lettre I [E] dansl’hypothèse où l’on considère l’activité réflexive propre à l’activitémétalinguistique.
Pour ce qui est de l’ordre de la syntaxe, comment expliquer la« suppression » de NE [MA] dans « IL ÉTAIT UNE FOIX » [ERAUMA VES] qui indiquerait justement la concordance de genre requi-se par la langue portugaise ?
Enfin, comment pouvons-nous comprendre la rature orthogra-phique commise au travers de la méta-opération dans laquelle lalettre [Z] remplace la lettre F [V] dans le mot « FOIX » [VES] ?
Pour pouvoir préciser ces points, il convient de recourir à un pro-cessus méthodologique permettant de mettre en lumière ce qui s’estpassé au moment où le texte a été raturé. Nous analyserons donc ledialogue au cours duquel Jacques (10 ans 11 mois) et Anderson (12ans 2 mois)12 élaborent l’histoire. Il est important de souligner quenous avons pris connaissance du dialogue et avons observé les éco-liers effectuant les ratures en les filmant au moment précis où ilsétaient en train d’écrire.
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO76
12. En dépit de leur âge, à l’époque, ces écoliers étaient scolarisés en deuxièmeannée d’une école publique de Maceió (Brésil). Comme nous le savons, dansles premières classes des écoles primaires brésiliennes, il est très banal deconstater la présence d’enfants en retard.
Fragment 113 : Jacques a terminé d’écrire « ÉTAIT UN NE »14
[era UM MA] quand Anderson, en train de dicter ce qui devait êtreécrit, demande à son collègue la feuille de papier et le crayon pourcorriger quelque chose et continuer d’écrire l’histoire.
1) Anderson : « Tu te trompes… (il prend la feuille et le stylo à billeque Jacques a en main)… donne-moi ça, va… (Anderson raye “ne”[ma] et il écrit “foix”[ves] à côté15) un… »
2) Jacques : « ... “une fois” est avec “U”. »3) Anderson : « (il regarde Jacques) fois… »4) Jacques : « … avec “S”16 [Z] … et avec “S” [Z]… »5) Anderson : « … “zois”17 va rester comme ça… D’accord, oh ! (en
se rapportant au mot “foix” [ves] qu’il avait écrit auparavant). »6) Jacques : « (il questionne l’institutrice) “une fois”ça prend un “S”
[Z] ? »
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 77
13. La traduction de la conversation ne pouvant être qu'approximative, noustenterons modestement de demeurer fidèles au sens des paroles prononcéespar les écoliers et aux significations que révèlent les ratures de leur dialogue.La traduction en français du texte original étant impossible, nous proposons,tant bien que mal, une translittération.
14. Divisant l’article féminin « UNE » [UMA], l’élève écrit tout d’abord « UN »[UM] et ensuite « NE » [MA].
15. Il s’agit d’écrire « IL ÉTAIT UNE FOIS » [ERA UMA VEZ] Nous retranscri-vons ce petit dialogue en français en faisant porter les ratures de l’écolie-renfant sur l’écriture de l’article « UNE » [UMA] et du nom « FOIX » [VES].En écrivant « FOIX » [VES] Anderson fait une faute d’orthographe assezcommune en portugais, en remplaçant la lettre S [Z] par la lettre X [S] quisont homophoniques à la fin de ce mot. Dans l’intention de rapprocher cetteerreur (le mot [VES] en portugais) de la langue française, nous avons choiside créer le mot « FOIX ».
16. En portugais, l’élève fait la correction orale du mot [VES] qu’il a écrit, endisant qu’il faut changer la lettre [S] pour la lettre [Z]. En français, le chan-gement équivaudrait à changer l’écriture de « FOIX » par l’écriture correctede « FOIS ». Dans l’intention de maintenir la cohérence des translittérationset de récupérer approximativement le sens de ce qui est en train de se dire,dans la parole de l’élève, nous indiquons la présence de la lettre S, commesi celle-ci était correcte dans l’orthographe française. Rappelons qu’en por-tugais, celui-ci dit [Z] comme indiqué entre les crochets.
17. Ici il est difficile de transcrire le démarche de l’élève, car aucune forme cor-respondante n’existe en français. Anderson décide de corriger la lettre fina-le [Z] en portugais, mais « il se trompe » et la place au début du mot « FOIX »[VES], et crée le mot « ZOIX » [ZES]. La forme correspondant en français« ZOIX », et la forme en portugais [ZES], n’existent pas.
7) Institutrice : « Si tu te trompes, tu rayes, n’est-ce pas ?… écrispar-dessus… (Tandis que l’institutrice parle, Anderson rature“F”[V] (“FOIX” [VES]) et il écrit au-dessus un [Z]18 . »
8) Jacques : « … tu vois bien que ça prend un “S” [Z], mongars… ça prend avec “S” [Z]… »
9) Anderson : « (il lit, sussure de façon rapide, presqueinaudible) “zois” [ZES] … “zois”. » [ZES] … »
Le bref dialogue entre les deux enfants enregistré par le film peutnous aider à comprendre avec plus d’exactitude ce qui est réellementécrit tout d’abord et raturé par la suite. Dans le fragment ci-dessus,la rature que fait Anderson sur « NE » [MA] relative à ce qu’il dit (« tute trompes… ») (1er tour) ; la « correction orale » de Jacques sur l’écri-ture du mot « FOIX » [VES] quand il dit « ... avec “S” [Z]… et avec“S” [Z]… » (4e tour) ; et l’« erreur » d’Anderson lorsqu’il rature lalettre F [V] du mot « FOIX » fragilisent théoriquement la notion derature en tant qu’opération métalinguistique, de sorte que la correc-tion du scripteur indique une réflexion sur la langue, ou encore uneperception ou focalisation sur ce qui est erroné ou exact.
Comment interpréter de telles occurrences dans une perspectiveenglobant sujet et langue considérés dans leurs effets réciproques dansle discours ? Comment abolir, à partir de cette relation, les articulationsentre le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire, si on considère l’équivoquecomme un élément qui menace et déstabilise tout le dire ?
Comme nous l’avons souligné antérieurement, l’enseignement del’écriture à cette période de la scolarité repose largement sur des dis-cours qui constituent un imaginaire du texte en fonction des conven-tions spatiales, graphiques, orthographiques et textuelles, telles que :l’espace pour marquer les paragraphes, l’usage des lettres majuscules,l’emplacement des titres et des marges, le type et le graphisme,l’orthographe, etc.
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO78
18. En conformité avec le manuscrit original, sur la forme [V] utilisée de façonadéquate en portugais, l’élève rature et écrit [Z].Ici il est difficile de trans-crire le démarche de l’éléve pois não há forma significante correspondenteem francês. Jaques décide de corriger la lettre finale ‘Z’en portugais, mais “ilse trompe” et la place au début du mot ‘FOIX’/ [‘VES’], criando a palavra‘ZOIX’/ [‘ZES’]. La forme correspondant en français ‘ZOIX’, et a forma enportugais ‘ZES’, n’existent pas.
Dans ce sens, la rature sur le I [E] à la première ligne et son « dépla-cement », qui indiquerait que l’écolier semble délimiter le paragraphe,ne serait-elle pas beaucoup plus l’effet (ou l’identification19) du dis-cours habituel en classe quand l’institutrice enseigne à l’élève qu’il fautcommencer le texte par « un paragraphe et une lettre majuscule » ? Ceteffet du discours relève-t-il d’une opération métalinguistique ? Ne ren-voie-t-il pas plus à une étape de l’enseignement de la langue portu-gaise où les règles formelles (majuscule, minuscule, paragraphe) sontprivilégiées dans le discours de l’institutrice sans pour autant qu’il yait chez les écoliers une « prise de conscience » de ces règles ? Dans cesens, on peut supposer que la rature effectuée par Anderson signale-rait un lien entre des dires qui normalisent la langue dans la salle declasse et le mode d’insertion de ces dires dans l’écriture de l’élève.
La rature sur « NE » [MA] effectuée par Anderson, dans le 1er tour,produit l’expression « IL ÉTAIT UN FOIX » [ERA UM VES] et susci-te également quelques interrogations. Pourquoi l’élève rature-t-il cequi était correct, sans rien remplacer à cet endroit ? Du fait qu’il nenous soit pas possible de formuler une hypothèse sur cette rature,nous pouvons seulement supposer que la rature concernerait peut-être la lettre N [M] de nouveau écrite par Jacques.
Une rature équivoquéePour continuer l’analyse de ce petit passage, portons notre attentionsur les ratures effectuées sur le mot « FOIX » [VES] (3e rature). Dansla langue portugaise, les sonorités des phonèmes/Z/et/S/sont trèsproches, pouvant, selon la position qu’ils occupent, se prononcerexactement de la même façon, comme dans les mots en portugais :
– « beleza » (beauté)/ « coisa » (chose),– « azar » (hasard)/ « asa » (aile),– « prazo » (délai)/ « caso » (case),– « coser » (coudre)/ « cozer » (cuire),– etc.
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 79
19. Le problème de l’identification du sujet dans ces discours est uniquementsuggéré ici. Pour l’heure, il ne nous est pas possible de l’analyser avec plusd’acuité, de façon plus rigoureuse. Nous considérerons ce fait comme unpoint faible de notre argumentation devant faire l’objet de travaux ulté-rieurs.
Il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour montrer combien, encontradiction avec les conventions orthographiques, sa substitutionest fréquente dans les textes écrits par les écoliers.
Dans le premier fragment, même après l’intervention de l’institu-trice (« Si tu te trompes, tu rayes, n’est-ce pas ?... écris par-dessus… (7e
tour) et du commentaire de Jacques (« ... tu vois bien que ça prend un“S” [Z], mon gars… ça prend avec “S” [Z]… » (8e tour), il fut impos-sible d’effectuer « une correction adéquate » de la part d’Andersonrelative à la position qu’occuperait la lettre [Z] dans le mot [VEZ]20.Dans ce sens, il paraît licite de supposer que les paroles de Jacques (4e,6e, 8e tours) peuvent être considérées comme l’indice d’une espèce de« bricolage » concernant des énoncés stéréotypés qui circulent dans lasalle de classe quand on essaie d’informer les écoliers ou de leurrépondre sur les questions d’orthographe. En outre, nous devons éga-lement prendre en considération l’existence possible d’une interfé-rence due à une ressemblance phonétique pouvant s’établir entre [Z]et [V], en portugais, laquelle peut contribuer à créer des équivoques.
Nous pourrions arguer du fait que le problème émane d’Andersonqui écrit, celui-ci ayant peut-être « confondu visuellement » lesformes graphiques « Z » et « V » ou s’étant tout simplement trompédans la position des lettres. Nous avons déjà montré qu’aucune desratures effectuées par les deux écoliers sur l’écrit ne « corrige » ce quiest « erroné » Au contraire, ils finissent par effacer ce qui est « cor-rect » au profit de ce qui est « erroné ».
En conséquence, si les opérations métalinguistiques se révèlentêtre des indices de l’action graduelle de l’écolier sur son texte, nouspouvons réinterpréter celles-ci à partir des articulations nouant lesinstances de l’Imaginaire, du Symbolique et du Réel et, par consé-quent, les modes de liaison entre sujet et langue, et interroger la rela-tion du sujet avec la langue sans la réduire à un aspect d’ordre sim-plement conceptuel, ce qui paraît n’être ni consistant sur le planthéorique, ni suffisant pour interpréter ce qui se passe ici même danscette relation.
Le geste de raturer semble bien résulter d’un effet imaginaire de la« correction » ou des pratiques discursives scolaires. En dépit des
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO80
20. En français, nous utiliserions la lettre S dans le mot « FOIS ».
opérations métalinguistiques qui les caractérisent, ce mode de fonc-tionnement des ratures indique donc aussi le jeu auquel sont soumisles écoliers dans le processus d’écriture.
La référence à l’écoute21 évoque pour nous quelque chose decontingent dont le fonctionnement repose sur les relations entrel’Imaginaire, le Symbolique et le Réel, montrant ainsi l’impossibilitéqu’il y a de prévoir sur quel point de la chaîne syntagmatique elle va émer-ger. Ainsi nous pouvons seulement affirmer la nécessité de recon-naître une différence ou quelque chose produisant l’effet d’une dif-férence.
Fabre observe également dans ses données que les ratures destextes scolaires, particulièrement les substitutions avec changement,vont dans le sens de la norme : « Elles fonctionnent donc comme des“corrections” proprement dites, même si le résultat final n’est pascorrect » (1986 : 75). Sans aucun doute, nous oublions volontairementque le sujet de Fabre est celui qui abstrait et infère des propriétés dela langue mais également que la rature est pour lui une « opération »et non pas un effet du langage sur le sujet. Ce que nous voulons sou-ligner, et les travaux de Fabre le montrent, encore que de façon laten-te, c’est que les ratures chez l’enfant invitent à rechercher la ressem-blance22, à distinguer ce qui se dit/ce qui se fait ou ce qu’on « doit »dire/ce qu’on « doit » faire. Loin de signifier « contrôle », « sépara-tion » et « distance », il faut reconnaître que cela tient plus de la sou-mission que du fonctionnement linguistique discursif.
Pour mieux expliciter cela, retournons à la rature sur le F [V],lequel est remplacé par S [Z] et sur ce que dit Jacques dans le 8e tour.Qu’est-ce qui fait que cet énoncé « correct » apparaît comme l’indiced’une « erreur » ou d’une rature plutôt singulière ?
D’un côté, nous constatons dans « FOIX » [VES] une écoute del’écrit dans laquelle Jacques reconnaît l’existence de problèmes d’ordreorthographique, en effet son langage peut être sensible à la pression
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 81
21. Nous ne devons pas oublier que la notion d’écoute est liée à l’hétérogénéi-té, à la singularité et à l’intermittence que les ratures représentent (cf. supra).
22. Il est intéressant de noter que chez le poète la rature va dans le sens opposéà celui qui semble prédominer chez l’enfant ; elle fonctionne comme un élé-ment de création, montre la recherche et la reconnaissance d’une différencechez le poète, d’une différence rompant l’ordre du prévisible.
des formes de corrections effectuées par l’institutrice quand elle sepenche sur les problèmes entre [S] et [Z], communs dans l’ortho-graphe du portugais et présents à ce niveau de l’apprentissage.
En outre, ce qui paraît produire l’équivoque de la rature sur« FOIX » [VES] se trouve dans le fait qu’il est très commun que lesécoliers des toutes petites classes utilisent le [Z] au lieu du [S]. Celaindique que ces lettres sont en relation constante à ce moment del’apprentissage de la langue écrite, principalement du fait de la rela-tion homophonique qui existe entre elles.
Dans le cas d’Anderson, ce qui paraît produire l’équivoque decette rature dans ‘FZOIX’/ [VZES] se trouve précisément dans laproximité phonétique entre/S/et/Z/lorsque ces lettres sont situéesà la fin des mots de la langue portugaise. Autrement dit, le son/S/setrouve dans son imaginaire tellement lié au son/Z/qu’il ne perçoitaucun problème orthographique lorsqu’il écrit [VES]. Si cette appa-rence imaginaire ne permet pas le déplacement du [S] dans [VES]dans le cadre d’une opération métalinguistique de substitution, ladifférence, c’est-à-dire la rectification réclamée par son collègue, seraancrée dans ce qui est correct.
Anderson écoute ce que dit Jacques bien qu’il ait attendu un instantpour reformuler et altérer le texte. Pourtant, quand il fait la « correc-tion », il ne se focalise pas sur le [S] dont l’homophonie avec la forme[Z] garantit la stabilité, mais sur le début du mot ; ainsi la forme [Z]prend-elle la place de la forme [V], elle est donc écrite « ZOIX » [ZES].C’est ce mouvement de retour au texte, de façon absolument subjecti-ve, qui confère à la rature l’effacement de quelque chose qui fait « sem-blant d’erreur ». Dans ce sens, l’acte de raturer ne peut escamoter la dimen-sion équivoque de la langue.
Par ailleurs, un autre facteur peut contribuer à effectuer cette ratureéquivoquée. Il est très fréquent, en salle de classe, que le professeurexplique une lettre d’un mot en se référant à un autre mot, en utilisantdes paroles du genre « “pierre” s’écrit avec un p comme “papa” », ou« le mot “chaussure” commence par c comme “cerise” », et ainsi desuite. C’est peut-être en raison de cette forte relation avec le discoursde l’Autre, que Jacques dit « ... avec “S” [Z]… et avec “S” [Z]… » (4e
tour) ; ce qui se trouve sur le droit chemin finit par s’égarer de maniè-re imprévisible en établissant un axe d’équivalence métaphorique
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO82
entre [V] et [Z] et en créant un mot inusité [ZES]. Bien qu’Anderson lerépète : « (il lit, sussure de façon rapide, presque inaudible) “zoix”[ZES]… “zoix” [ZES]… » (9e tour), il ne lui semble pas être suffisam-ment étrange pour qu’il le rejette.
L’homophonie existante entre ces formes, productrice de cetterature équivoquée, égare les strates linguistiques relatives aux sono-rités et au sens. C’est à cet instant précis que la relation entre le sujetet la langue tout à la fois se révèle et s’occulte, exposant ainsi la fra-gilité du scripteur face aux mouvements des formes signifiantes.
De cette manière, la « rature équivoquée » est un produit del’entrelacement du réel de la langue (lalangue) désigné par les articu-lations entre les formes signifiantes en jeu (dans cette rature l’homo-phonie tient une place déterminante) et le registre symbolique danslequel s’insèrent les propriétés, règles, contraintes structurales de lalangue, et la façon par laquelle, imaginairement, les formes signi-fiantes acquièrent unité et sens.
Cet entrelacement du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire et lespositions subjectives du sujet en rapport avec la langue pourraientnous conduire à une interprétation se fondant sur le fonctionnementlinguistique discursif lui-même pour expliquer les opérations méta-linguistiques et leur statut théorique.
En prenant ainsi en considération le statut « réflexif » et l’intentionqui se trouve présente dans les opérations métalinguistiques, nous pou-vons dire que les « éléments phonématiques du signifiant se dévelop-pent bien avant de rencontrer la ligne dans laquelle prend sa place cequi est appelé à l’être, l’intention du signifiant […] qui alors s’occulte »(Lacan 1992 : 238). De la sorte le signifiant prédomine l’intentionnalité.
L’analyse de cette rature peut mener à rendre suspect le présupposéthéorique sur lequel se fonde la conscience ou la capacité réflexive duscripteur du fait que celle-ci provoque une équivoque, cela veut direque l’équivoque apparaît également où il y a demande de correction.
QUELQUES MOTS POUR FINIR
À tout ce qui a été mentionné, il convient d’ajouter cette dernièreconsidération :
Si le métalangage est le moyen par lequel s'analyse le langage, quedire des occurrences que, dans ce contexte, l’on pourrait très bien
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 83
qualifier d’« erreurs de reformulation » ? Pourquoi non seulement les« erreurs » mais également celles de « reformulation », n’amènent-elles pas les chercheurs partisans d’une perspective énonciative à seméfier des opérations « métalinguistiques » en tant qu’elles peuventêtre considérées comme expression d’une capacité réflexive qui sépa-re le sujet et la langue ?
Risquons une réponse. C’est peut-être parce que le métalangageest l’effet que produit le langage lui-même ; la réflexivité et la « prisede conscience », quelles qu’elles soient, sont une question de langa-ge23, avant d’être une question cognitive, ou parfois même une ques-tion motrice, comme paraissent l’indiquer les propos de Fabre.
Le déplacement de « ÉTAIT » [ERA], l’effacement de « NE » [MA]et surtout le remplacement de « FOIX » [VES] par « ZOIX » [ZES]désignent surtout, soit dans l’erreur elle-même, soit dans sa refor-mulation, une incompatibilité par rapport à la notion d’opération« métalinguistique » ou ce qu’elle infère, autrement dit la possibilitéde se supposer un « métalangage », le suspens de ce système, mais,également, du statut cognitif de ces opérations. Comme l’ont faitobserver Lier-de-Vitto et Fonseca (1997), « le métalangage fait appa-raître un sujet qui choisit, fait abstraction et agit sur les propriétés dela langue, c’est-à-dire qui l’examine et le contrôle “de l’extérieur” :un sujet face au langage et hors la loi » (ibid. : 58).
Loi du fonctionnement linguistique et discursif, certainement.L’axiome lacanien « il n’est pas de métalangage » consiste précisé-ment à affirmer qu’il n’existe rien en dehors de la sphère du langage– « il n’est pas de langage de l’être », dit Lacan (1985 : 160). La décla-ration lacanienne consiste à attester que la langue touche la lalangueet se laisse traduire, comme l’exprime Milner (1983 : 49), par « il y aquelque chose du langage qui s’inscrit en tant que non-tout ». Ainsi,la croyance en l’existence d’un métalangage finit par mettre le cher-cheur dans une situation confortable en le soustrayant au fait que lesujet est traversé par le langage et qu’il n’en est pas le maître.
Pour finir, nous pourrions dire que, si les quatre métaopérationsaident à décrire le phénomène, elles ne peuvent pas encore l’interpréter.
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO84
23. Dans ce sens, nous pouvons approcher nos réflexions du travail de Derycke(2004).
De même, elles ne permettent pas de généraliser car elles achoppentsur la singularité d’un sujet inévitablement habité par la langue.
En tenant compte d’un sujet que la langue habite et structure, nousavons essayé ici de dépasser les descriptions et les généralisations deces opérations afin de comprendre la présence de la rature dans leprocessus de l’écriture.
Traduction : Georges Lebigre ([email protected])
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AUTHIER-REVUZ J. (1995), Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles réflexives et non-coïncidences du dire, Paris, Larousse (Sciences du langage).
— (2004), Entre a transparência e a opacidad: um estudo enunciativo do sentido,Porto Alegre, EDIPUCRS.
BORÉ C. & DAVID J. (1996), « Les différentes opérations de réécriture », EVA, del’évolution à la réécriture, Paris, INRP, Hachette Éducation : 120-138.
CULIOLI A. (1982), « Préface », in La genèse du texte: les modèles linguistiques, Paris,Éditions du CNRS.
DERYCKE M. (2004), « La parole représente-t-elle le faire et ses objets ? », dis-ponible dans http://www.reims.iufm.fr/Colloques/colloque/col_parler-apprendre.htm. (26 mars 2004).
FABRE C. (1986), « Des variantes de brouillon au cours préparatoire », Études delinguistique appliquée, n° 62 : 59-79.
— (1987), « La réécriture dans l’écriture : le cas des ajouts dans les écrits sco-laires », E. L. A ., n° 68 :17-39.
— (1990), « Frontières et variantes du discours rapporté dans quelques nar-rations de scripteurs débutants », Le français dans tous ses états, n° 13,Montpellier, CRDP.
— (2002), Réécrire à l’école et au collège: de l’analyse des brouillons à l’écriture accom-pagnée, Issy-les-Moulineaux, ESF Éditeur.
LACAN J. (1985), Seminário 20: Mais, ainda!, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora.
— (1992), Seminário VIII, A transferência, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora.
— (1998), Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editora.
QUAND LA RATURE (SE) TROMPE 85
LEMOS, C.T.G. (1998), « Os processos metafóricos e metonímicos como meca-nismos de mudança », Substratum: temas fundamentais em Psicologia eEducação, vol. I, n° 3, Porto Alegre, Artes Médicas.
— (2000), « Questioning the notion of development: the case of languageacquisition », Culture & Psychology, n° 6(2), New York : 169-182.
LIER-DE-VITTO M.F. & FONSECA S.C. (1997), « Reformulação ou ressignifica-ção? », Cadernos de Estudos Lingüísticos, n° 33, Campinas, IEL/Unicamp: 51-60.
MILNER J.-C. (1983), Les noms indistincts, Paris, Seuil.
— (1987), O amor da língua, Porto Alegre, Artes Médicas.
— (1989), Introduction à une science du langage, Paris, Seuil.
PENLOUP M.-C. (1994), La rature n’est pas un raté. Plaidoyer pour le brouillon,Rouen, MAFPEN.
REY-DEBOVE J. (1982), « Pour une lecture de la rature », in La Genèse du texte: lesmodèles linguistiques, Paris, Éditions du CNRS : 103-127.
SAUSSURE F. de (1995), Curso de Lingüística Geral, São Paulo, Cultrix.
TURCO G. (1988), Écrire et réécrire au cours élémentaire et au cours moyen, Rennes,CRDP.
EDUARDO CALIL ET CRISTINA FELIPETO86
Related Documents