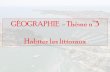Laurent Bouby Production et consommation végétales au Bronze final dans les sites littoraux languedociens In: Bulletin de la Société préhistorique française. 2000, tome 97, N. 4. pp. 583-594. Citer ce document / Cite this document : Bouby Laurent. Production et consommation végétales au Bronze final dans les sites littoraux languedociens. In: Bulletin de la Société préhistorique française. 2000, tome 97, N. 4. pp. 583-594. doi : 10.3406/bspf.2000.11166 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_2000_num_97_4_11166

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Laurent Bouby
Production et consommation végétales au Bronze final dans lessites littoraux languedociensIn: Bulletin de la Société préhistorique française. 2000, tome 97, N. 4. pp. 583-594.
Citer ce document / Cite this document :
Bouby Laurent. Production et consommation végétales au Bronze final dans les sites littoraux languedociens. In: Bulletin de laSociété préhistorique française. 2000, tome 97, N. 4. pp. 583-594.
doi : 10.3406/bspf.2000.11166
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_2000_num_97_4_11166
RésuméLes informations concernant les ressources végétales des communautés languedociennes du Bronzefinal étaient jusqu'à présent limitées aux sites de Г arrière -pay s. On présente ici les donnéescarpologiques obtenues sur deux sites littoraux, La Fangade, Sète, et Portai Vielh, Vendres (Hérault).Le gisement de La Fangade possède de plus l 'intérêt de constituer le premier ensemble de milieuhumide étudié pour V Age du Bronze en France méditerranéenne. L'amidonnier et l'orge polystiquevêtue sont les céréales les plus importantes. Les autres céréales sont moins fréquentes, bien que Vengrain soit bien représenté par les vannes à La Fangade. Le lin, et tout spécialement le pavot, sontlargement attestés alors que la fève constitue la seule légumi- neuse d'importance. Plusieurs fruitssauvages étaient cueillis, notamment les glands, les figues et les mûres de la ronce. Les premièrescomparaisons possibles entre données du littoral et de l'arrière-pays semblent indiquer que la principaledifférence réside dans l 'exploitation du lin et du pavot en milieu lagunaire. Il est cependant fort possibleque cet écart résulte essentiellement des différences qui existent, tant dans le mode de conservationdes semences que dans les méthodes ď échantillonnage, entre les deux ensembles de sites. Uneproduction agricole locale en domaine littoral est envisagée et on peut conclure qu 'il y avait au moins àLa Fangade une production d'orge. Les flores adventices indiquent que les semis étaient pratiquésautour du site durant l 'automne et le printemps.
AbstractInformation concerning plant resources of Late Bronze Age communities in Languedoc was, until now,restricted to sites located in the hinterland. This paper presents archaeobotanical results obtained fromtwo lagoon-shore settlements, La Fangade at Sète, and Portal Vielh at Vendres. The former providesthe first waterlogged assemblage for this period in the French Mediterranean region while the latterconsists of a dry settlement. Emmer and hulled six- rowed barley are the most common cerealsoccurring at both sites. Other cereals are less frequent, although einkorn chaff is common at LaFangade. Flax and, especially, the opium poppy are well represented while thefaba bean is the onlypulse of any importance. Many wild fruits were gathered, in particular acorns, figs and blackberries. Firstcomparisons with data from the hinterland seem to suggest that the main difference lay in the cultivationof the opium poppy and flax in the lagoon sites. However, this could well be an impression resultingfrom differences in preservation or sampling methods between hinterland and lagoon sites. Localproduction - as distinct from importation of crops - is considered and the conclusion is drawn that, atleast at La Fangade, hulled barley was grown locally. The arable weed flora indicates that sowing tookplace around the site during both autumn and spring.
Laurent BOUBY
Production
et consommation végétales
au Bronze final dans les sites
littoraux languedociens
Résumé Les informations concernant les ressources végétales des communautés languedociennes du Bronze final étaient jusqu'à présent limitées aux sites de Г arrière -pay s. On présente ici les données carpologiques obtenues sur deux sites littoraux, La Fangade, Sète, et Portai Vielh, Vendres (Hérault). Le gisement de La Fangade possède de plus l 'intérêt de constituer le premier ensemble de milieu humide étudié pour V Age du Bronze en France méditer
ranéenne. L'amidonnier et l'orge polystique vêtue sont les céréales les plus importantes. Les autres céréales sont moins fréquentes, bien que V engrain soit bien représenté par les vannes à La Fangade. Le lin, et tout spécialement le pavot, sont largement attestés alors que la fève constitue la seule légumi- neuse d'importance. Plusieurs fruits sauvages étaient cueillis, notamment les glands, les figues et les mûres de la ronce. Les premières comparaisons possibles entre données du littoral et de l'arrière-pays semblent indiquer que la principale différence réside dans l 'exploitation du lin et du pavot en milieu lagunaire. Il est cependant fort possible que cet écart résulte essentiellement des différences qui existent, tant dans le mode de conservation des semences que dans les méthodes ď échantillonnage, entre les deux ensembles de sites. Une production agricole locale en domaine littoral est envisagée et on peut conclure qu 'il y avait au moins à La Fangade une production d'orge. Les flores adventices indiquent que les semis étaient pratiqués autour du site durant l 'automne et le printemps.
Abstract Information concerning plant resources of Late Bronze Age communities in Languedoc was, until now, restricted to sites located in the hinterland. This paper presents archaeobotanical results obtained from two lagoon-shore settlements, La Fangade at Sète, and Portal Vielh at Vendres. The former provides the first waterlogged assemblage for this period in the French Mediterranean region while the latter consists of a dry settlement. Emmer and hulled six- rowed barley are the most common cereals occurring at both sites. Other cereals are less frequent, although einkorn chaff is common at La Fangade. Flax and, especially, the opium poppy are well represented while thefaba bean is the only pulse of any importance. Many wild fruits were gathered, in particular acorns, figs and blackberries. First comparisons with data from the hinterland seem to suggest that the main difference lay in the cultivation of the opium poppy and flax in the lagoon sites. However, this could well be an impression resulting from differences in preservation or sampling methods between hinterland and lagoon sites. Local production - as distinct from importation of crops - is considered and the conclusion is drawn that, at least at La Fangade, hulled barley was grown locally. The arable weed flora indicates that sowing took place around the site during both autumn and spring.
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
584 Laurent BOUBY
6
m
i // \ $
y"1
, ■ . 4
4 ^4#•5
\
' Montpellier/ (
zXXxjs
i 0
1
( \
гХХе_
i 50 km
0 - 200 m 200 - 500 m
□
I 500- 1500 m
g 1500 m et plus 1 - La Fangade, Sète (Hérault) 2 - Portai Vielh, Vendres (Hérault) 3 - Abri de St-Etienne-de-Gourgas
St-Etienne-de-Gourgas (Hérault) 4 - Grotte du Prévcl Supérieur,
Mon tel us (Gard) 5 - Grotte du Hasard, Tharaux (Gard) 6 - Baume Layrou, Trêves (Gard) 7 - Oppidum du Marduel, St-Bonnet-
du-Gard (Gard) Fig. 1 - Localisation des sites.
Le Languedoc peut être découpé en plusieurs unités paysagères bien tranchées, donnant lieu à des activités humaines spécifiques, qui grossièrement se succèdent depuis la Méditerranée jusqu'au milieu franchement montagnard du Massif central. Immédiatement derrière la mer, à l'abri du cordon littoral, on rencontre une succession d'étangs ou lagunes. Ces étendues d'eau se situent dans la basse plaine littorale, où elles occupaient autrefois, avec les marécages, une surface plus étendue qu'aujourd'hui (Ambert et Chabal, 1 992). À leur suite, Г arrière-pays se compose d'une succession de plateaux calcaires qui s'étagent jusqu'aux marges méridionales du Massif central. Traditionnellement, céréaliculture et arboriculture se concentraient sur les pentes et les fonds de vallées et bassins qui trouent régulièrement les plateaux, ces derniers étant le domaine de la garrigue et des troupeaux. À l'Âge du Bronze final II, l'occupation humaine touche l'ensemble de ces unités paysagères et cette implantation se renforcera fortement au Bronze final III. De nombreux villages littoraux s'installent au bord des étangs. À l'intérieur des terres, quelques sites de plaine sont aujourd'hui répertoriés mais les occupations les mieux connues sont les villages de hauteur et les grottes. Jusqu'à présent, la documentation carpologique se limitait dans la région à ces deux derniers types de sites (fig. 1). Les fouilles entreprises sur des gisements de plaine de Г arrière-pays demeurent rares et n'ont pas
encore donné lieu à des travaux carpologiques. En domaine littoral, plusieurs opérations ont notamment été conduites sur les habitats de l'étang de Mauguio mais elles n'ont livré aucun témoin carpologique (Dedet et Py, 1985). De plus, souvent issues d'études relativement anciennes, les données disponibles ne sont pas, dans la plupart des cas, exemptes de biais liés à l'échantillonnage. Ces limites sont de deux ordres: l'ampleur de l'échantillonnage est souvent restreinte et les tamisages fins sont rares. Les résultats que nous avons obtenus sur les gisements de La Fangade, Sète, et de Portai Vielh, Vendres (Hérault), viennent contribuer à combler ces lacunes. Ces deux opérations ont permis de collecter un nombre important de restes botaniques et d'établir, ainsi, une première base documentaire concernant l'économie végétale des sites littoraux au Bronze final II et III. De plus, les niveaux organiques conservés en milieu humide de La Fangade offrent la particularité d'avoir livré, outre des semences carbonisées classiques en zone méditerranéenne, un important ensemble de restes non carbonisés. L'ambiance anaérobie qui règne dans les milieux humides et qui autorise la conservation de restes végétaux non carbonisés ne permet pas seulement une plus riche collecte de témoins, elle offre une image plus complète des plantes exploitées et du paysage végétal environnant que les sites secs. Les milieux humides sont plus particulièrement susceptibles de fournir une information précise et développée sur la végétation synanthropique, sur les ressources fruitières et, plus généralement, sur les plantes cultivées autres que les céréales et les légumineuses, ces dernières étant souvent mieux représentées dans les ensembles carbonisés de milieux secs. L'intérêt d'étudier un site de milieu humide est ici d'autant plus fort que ce type d'assemblage est bien sûr extrêmement rare en domaine méditerranéen pour les époques pré- et protohistorique. Notre objectif premier est de déterminer les plantes exploitées et consommées par les communautés humaines littorales et d'évaluer leur importance respective. Tout en gardant à l'esprit les limites liées à l'échantillonnage sur les sites de Г arrière-pays et les conditions particulières de conservation à La Fangade, on pourra alors comparer ces données à l'économie végétale telle qu'elle est connue à l'intérieur des terres. Il apparaît tout particulièrement intéressant de s'interroger sur les conditions d'acquisition des plantes alimentaires et à valeur économique en milieu littoral. La densité de sites que l'on observe au Bronze final Illb, dans les différentes unités de paysage du Languedoc oriental, a permis à M. Py (1 990, 1993), à partir des différentes données archéologiques, de proposer un modèle de complémentarité économique, essentiellement fondé sur les activités pastorales, qui englobe les différents types d'implantation de la zone côtière et de Г arrière- pays. Cette complémentarité impliquerait pour les populations languedociennes de la fin de l'Âge du Bronze un système de semi-sédentarité. Les sites côtiers représenteraient des occupations saisonnières en relation avec l'exploitation des ressources lagunaires et le pâturage des troupeaux lié à une transhumance, probablement estivale. L'habitat principal et durable serait
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
Production et consommation végétales au Bronze final dans les sites littoraux languedociens 585
localisé dans les villages de hauteur de Г arrière-pays qui assureraient l'essentiel de la production agricole. L'obtention par la carpologie d'informations en relation directe avec l'agriculture doit permettre de discuter le mode d'approvisionnement des habitats côtiers ainsi que le système de production agricole qui le sous-tend.
LA FANGADE Le site est localisé à Sète (Hérault), sur le rivage sud de l'étang de Thau (fig. 1). Les couches archéologiques se trouvent sous 80 cm à 2 m d'eau, sur un petit promontoire à l'intérieur de l'étang, à environ 250 m de la rive. En 1 997, F. Leroy a dirigé deux sondages archéologiques subaquatiques, de 2 m2 chacun, afin de mieux appréhender le potentiel et la chronologie du site. Quatre niveaux organiques bien conservés ont été distingués. Les nombreux pieux de chêne vert n'étant pas
exploitables pour obtenir des éléments de datation par la dendrochronologie, seuls les vestiges céramiques et une datation par le radiocarbone (2980 ± 40 B.P., ARC 1706 : 1375-1055 cal. B.C.) permettent d'évaluer la période d'occupation du site. Ces données sont convergentes pour définir une période principale d'occupation durant une phase ancienne du Bronze final II. Toutefois, quelques éléments céramiques du Bronze final III ont pu être observés, suggérant une fréquentation du site moins importante à cette époque.
Méthode d'acquisition des données
L'étude a porté sur 1 1 prélèvements d'un volume individuel compris entre 0,5 et 5 1. Ceux-ci proviennent des différents niveaux et des deux secteurs. Neuf d'entre eux ont subi un pré-tamisage sur le site, à l'aide de deux cribles de 4 et 2 mm, afin d'extraire les éléments les plus grossiers (cailloux, gros coquillages, morceaux de
semences de plantes cultivées
flore aquatique, bords des étangs
14%
Panicům miliaceum Linum usitatissimum Papaver somniferum
forêt, forêt alluviale
2%
37%
garrigue, lisières, broussailles
31%
mauvaises herbes de printemps
vannes de céréales Hordeum vulgare Triticum dicoccum Triticum monococcum Triticum dicoccum/monococcum Panicům miliaceum
mauvaises herbes d'hiver
Amaranthus lividus Anagallis arvensis Anethum graveolens Atriplex patulus/hastatus Carduus cf. crispus Carduus pycnocephalus type Chenopodium album Chenopodium cf. bonus-henricus Chenopodium hybridům Chenopodium polyspermum agg. Cirsium arvense Cirsium vulgare type Fumaria ojficinalis Heliotropium europaeum Hyosciamus albus/niger
Malva parviflora Polygonům aviculare Polygonům cf. persicaria Potentilla reptans Ranunculus repens Reseda lutea Reseda luteola Rumex cf. longifolius Ruta graveolens Silène alba Solanum nigrům Sonchus asper Stellaria media Urtica urens Verbena ojficinalis
Adonis annua Ajuga chamaepitys Ammi majus/visnaga Arenaria cf. serpyllifolia Ballota nigra Bromus cf. arvensis Legousia cf. speculum-veneris
Lolium multiflorum/rigidum Papaver cf. rhoeas Reseda alba Reseda phyteuma Stachys annua Viola tricolor
Fig. 2 - Proportions des catégories de plantes attestées à La Fangade par les restes non carbonisés (nombre de restes = 20050).
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n" 4, p. 583-594
586 Laurent BOUBY
mauvaises herbes d'hiver semences de plantes cultivées Avena sp. Lolium multiflorum/rigidum divers
91%
Hordeum vulgare Lathyrus cf. sativus Triticum aestivum/turgidum Triticum dicoccum Triticum monococcum Linum usitatissimum Papaver somniferum
vannes de céréales Hordeum vulgare Triticum dicoccum Triticum monococcum Triticum dicoccum/monococcum Ce real ia
Fig. 3 - Proportions des catégories de plantes attestées à La Fangade par les restes carbonisés (nombre de restes = 4642).
bois. . .). Ce premier traitement a inévitablement causé une perte de matériel carpologique. Seuls deux prélèvements bruts ont pu être exploités. On a, dans un second temps, tamisé tous les échantillons en laboratoire sur une colonne de trois cribles de 2, 0,5 et 0,25 mm. Les différents refus de tamis ont ensuite fait l'objet d'une analyse sous stéréomicroscope afin d'identifier et de décompter les restes carpologiques qu'ils contenaient. Lorsqu'elles étaient volumineuses, nous n'avons traité que les 2/3 ou la moitié des fractions inférieures. Dans ce cas, le nombre total de restes est évalué, pour chaque fraction, selon le rapport du volume traité sur le volume total, puis un nombre total de restes est déduit pour l'échantillon dans son ensemble.
Résultats
La perte de matériel due au pré-traitement effectué sur le site peut difficilement être évaluée. Seule la comparaison entre les compositions des deux échantillons bruts et de deux échantillons pré-tamisés issus du même niveau et du même secteur peut fournir une information à ce sujet. Bien que provenant du même niveau, les deux échantillons bruts montrent une richesse sensiblement différente. Le premier a livré 415 restes/1 et 48 taxons alors que le second contenait 1 584 restes/1 et 54 taxons. Les deux échantillons pré-traités issus du même niveau ont procuré 454 restes/1 et 51 taxons pour l'un, 3 1 6 restes/1 et 53 taxons pour l'autre. On peut constater que le nombre de restes/1 semble légèrement inférieur pour les échantillons pré-tamisés mais le nombre de taxons paraît demeurer stable. La perte d'informations serait donc bien moindre que l'on aurait pu le présumer. Ceci s'explique vraisemblablement par l'aspect non exhaustif du tamisage pratiqué sur le site. Son objectif se limitait à l'extraction des plus gros éléments. Lors du second tamisage effectué au laboratoire, on a généralement pu observer que des agrégats d'argile et de matériel organique n'avaient pas été désorganisés par
ce premier traitement. Il est probable que ces agrégats aient piégé une grande partie des paléosemences, permettant à l'essentiel des taxons de demeurer présent. Cependant, le nombre de restes a certainement souffert de ce premier traitement et les données quantitatives doivent être maniées avec prudence, tout particulièrement dans les comparaisons entre échantillons et lorsqu'il s'agit de restes de petites dimensions. Cent sept taxons ont pu être mis en évidence sur le site, cumulant un total supérieur à 25 340 restes, 1 8,5 % étant carbonisés. Les végétaux identifiés appartiennent à différents types de milieux dans la flore actuelle (fig. 2 et 3). Cependant, on ne prendra en considération dans la présente étude que les plantes qui ont pu être exploitées, ou avoir une relation directe avec les activités agricoles (plantes cultivées et adventices). Les plantes cultivées représentent 42 % des restes imbibés et 98 % des éléments carbonisés. Ce groupe comprend potentiellement 10 espèces dont cinq céréales. L'importance relative de ces plantes est illustrée par la figure 4 qui est établie sur le nombre de restes cumulés et sur la fréquence d'apparition des taxons dans les échantillons. Il faut tout d'abord remarquer que les céréales sont principalement présentes sous la forme de vannes, éléments divers de l'épi. Quel que soit le mode de quantification, les deux principales céréales sont l'orge polysti- que vêtue (Hordeum vulgare) et surtout le blé amidon- nier (Triticum dicoccum) (fig. 4). Il est tout à fait remarquable que l'orge soit représentée par 452 entrenœuds de rachis de l'épi, auxquels s'ajoutent 222 fragments, alors que le nombre de semences ne s'élève qu'à 45 individus et 29 fragments. Le blé engrain (Triticum monococcum) est assez bien représenté mais uniquement par les vannes. En revanche, les deux dernières céréales, le blé nu (Triticum aestivum/turgidum) et le millet commun (Panicům miliaceum), sont très discrètes et leur taux de représentation est trop faible pour pouvoir affirmer qu'elles constituent bel et bien des plantes cultivées. Il n'est en effet pas exclu que des
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
Production et consommation végétales au Bronze final dans les sites littoraux languedociens 587
restes carbonisés fréquence absolue nombre de restes (NR) dans ies échantillons
0 200 400 600 800 1000 1 3 5 7 9 11 Hordeum vulgare NR : 74 et 705
T. aestivum/turgidum \ nr : 2 et о
Triticum dicoccum
T. monococcum
NR: 41 et 842
Linum usitatissimum H nr : 38 et 1 7
Papaver somniferum
Lathyrus cf. sativus
restes non carbonisés nombre de restes (NR)
500 1000 1500 fréquence absolue
dans les échantillons 2000 1 3 5 7 9 11
Hordeum vulgare
Triticum dicoccum
T. monococcum
Panicům miliaceum
Linum usitatissimum
Papaver somniferum
NR:0etl795
NR : 40 et 363
NR : 1049 cl 0
semences Fig. 4 - Plantes cultivées identifiées à La Fangadc : représentation de l'abondance en nombre de restes cumulés et de la fréquence d'apparition dans les échantillons.
plantes domestiques ne soient présentes qu'en qualité de "mauvaises herbes" à l'intérieur d'autres cultures. La même indécision se retrouve pour la seule légumi- neuse domestique attestée sur le site, la gesse cultivée (Lathyrus cf. sativus), dont une unique graine a été trouvée. En revanche, les oléagineux renvoient une image plus claire. L'exploitation du lin (Linum usitatissimum) laisse peu de doutes. La plante figure dans les échantillons sous la forme de graines et de fragments de capsules, à la fois carbonisés et imbibés. Le pavot (Papaver somniferum) n'est représenté que par ses graines, essentiellement sous forme non carbonisée, mais son abondance et surtout sa fréquence (90 % des échantillons) montrent son rôle économique. La présence de deux plantes dont le statut domestique est envisageable demeure plus énigmatique. L'aneth odorant (Anethum graveolens), déterminé dans un seul échantillon par de rares semences, est une mauvaise herbe et une rudérale assez fréquente en zone méditerranéenne. Cependant, la présence sporadique de
l'espèce dans les sites lacustres suisses à partir du Néolithique, hors de son aire de croissance spontanée, a permis à plusieurs auteurs d'envisager sa mise en culture dès cette époque (Jacomet, 1988 ; Brombacher, 1997). Il convient donc de prendre également cette hypothèse en considération pour le Bronze final languedocien. La présence de la gaude (Reseda luteola) est plus marquée. Celle-ci ne totalise que 28 graines mais elle est mentionnée dans 9 des 1 1 échantillons. La gaude est de nos jours commune dans les cultures et les lieux incultes du Midi méditerranéen. Or, cette importante plante tinctoriale est certainement originaire de la partie orientale du Bassin méditerranéen et du Sud-Ouest asiatique (Zohary et Hopf, 1994). Elle a donc été introduite en Méditerranée occidentale. Il peut s'agir d'une importation involontaire, notamment comme mauvaise herbe des récoltes, mais une acclimatation et une mise en culture de la gaude à des fins tinctoriales dès le Bronze final ne peuvent pas être exclues.
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
588 Laurent BOUBY
Dans les figures 2 et 3, deux catégories de mauvaises herbes sont distinguées : les mauvaises herbes des cultures d'hiver, principalement les céréales, et les compagnes des cultures de printemps. Cette classification est fondée sur les travaux portant sur les flores adventices actuelles, plus particulièrement ceux de J. Montégut (1997) et P. Jauzein (1995). Or, on sait que les groupements d'adventices préhistoriques étaient en partie différents des groupements actuels, notamment en raison de techniques agricoles beaucoup plus rudimentaires (voir par exemple Behre et Jacomet, 199 1 ). Les champs préhistoriques accueillaient probablement un nombre plus élevé de plantes bisannuelles et pérennes. Il est donc vraisemblable que certaines des plantes sauvages attestées à La Fangade, et considérées sur la base de leur écologie actuelle comme appartenant aux groupements des pelouses, des formations boisées ou même humides, soient en réalité également à mettre en relation avec les champs cultivés. À La Fangade, les mauvaises herbes, telles que les considère l'écologie actuelle, comprennent 44 plantes. La plupart n'est attestée que par de rares individus. Les espèces les plus fréquentes et abondantes sont l'ammi (Ammi majus/ visnaga), le bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), l'arro- che (Atripex patulus/hastatus), le chénopode blanc (Chenopodium album), l'héliotrope d'Europe (Helio- tropium europaeum) et, dans une moindre mesure, la renouée des oiseaux (Polygonům aviculare), le compagnon blanc (Silène alba), le réséda jaune (Reseda lutea) et la petite ortie (Urtica urens). Le groupe des mauvaises herbes d'hiver, caractéristique des cultures semées en automne, et plus particulièrement des céréales, comprend 14 taxons. Le second groupe, riche de 30 plantes, est celui des mauvaises herbes de printemps qui accompagnent les céréales, légumineuses ou oléagineux semés à cette époque de l'année. Parmi les autres grands groupements végétaux, on remarque, dans la catégorie des restes non carbonisés (fig. 2), la bonne représentation (3 1 %) des plantes de garrigue, lisières forestières, taillis et broussailles. La cueillette de fruits sauvages que les habitants ont rapporté sur le site est certainement à l'origine de la forte représentation de ce groupe de plantes. La cueillette est probable pour les fruits de la ronce (Rubus fruticosus), du figuier (Ficus carica), du prunellier (Prunus spi- nosa), de l'églantier (Rosa sp.), du sureau yèble (Sam- bucus ebulus), du noisetier (Corylus avellana), du chêne (Quercus sp.), du lentisque (Pistacia lentiscus), du coqueret (Physalis alkekengi) et de la vigne sauvage (Vitis sylvestris). Plusieurs arguments viennent appuyer l'hypothèse d'une cueillette de ces fruits. Les akènes de figuier et de ronce sont abondants et on les rencontre dans tous les échantillons. Certaines espèces, tout spécialement le figuier et le lentisque, sont cantonnées à des milieux secs et il est peu probable qu'elles aient poussé au Bronze final suffisamment près de l'étang pour que leur présence dans les dépôts s'explique par une dispersion naturelle. De plus, certains restes de lentisque et de chêne sont carbonisés. Il est donc très probable qu'ils aient subi une manipulation par l'homme. Les pépins de vigne sont peut-être plus fréquents sur le site que nos échantillons le laissent
supposer. Effectivement, J. Erroux (inédit) a pu observer, il y a une vingtaine d'années, un lot de 1 30 pépins provenant d'anciennes interventions sur le site.
PORTAL VIELH Le gisement de Portai Vielh (Vendres, Hérault) se situe en milieu sec, sur un petit promontoire en bordure nord de l'étang de Vendres (fig. 1). A. Burens et L. Carozza ont conduit deux campagnes de fouilles de sauvetage sur le site, en 1996 et 1997. L'occupation du site s'étend du Bronze final II au Bronze final Illb. Au Bronze final II/IIIa se rattachent notamment une nappe archéologique et différents aménagements en creux dont deux fosses silos. Au Bronze final Illb, la physionomie du site est transformée par la construction d'une fortification périphérique composée d'un fossé et d'une palissade. Différents aménagements se rapportent alors à la production de céramique, dont deux fours de potiers.
Méthodes d'acquisition des données
Deux types d'échantillonnages ont été pratiqués à Portai Vielh. Au cours des fouilles, l'équipe archéologique a tamisé, sur un seul tamis de 2 mm, de gros prélèvements de plusieurs dizaines de litres. Les analyses carpologiques ont porté sur 10 de ces échantillons, cinq datés du Bronze final II/IIIa et cinq du Bronze final Illb. Un second échantillonnage, portant sur huit prélèvements de 8 à 191, a été pratiqué. Ces prélèvements ont connu un tamisage par flottation sur deux cribles de 2 et 0,5 mm, selon la méthode classique utilisée en carpo- logie pour les sites secs. Cinq échantillons, soit un volume total de 641, se rapportent au Bronze final II/IIIa, et trois, soit 271 de sédiment, au Bronze final Illb. Tous les refus ont été analysés en totalité.
Résultats
Portai Vielh étant situé en milieu sec, seuls les carpores- tes carbonisés sont conservés. Il n'est donc pas surprenant d'observer une densité carpologique nettement moins élevée que sur le site précédent. Les échantillons tamisés sur le chantier, à la seule maille de 2 mm, sont nettement dominés par les semences de plantes cultivées. Ces échantillons étant plus nombreux, et surtout plus volumineux, ils offrent une meilleure représentativité en ce qui concerne l'abondance respective des principales plantes cultivées. La figure 6 est donc construite à partir des données de cet échantillonnage. En revanche, le second type d'échantillonnage, grâce à la maille fine de tamisage qui retient par exemple les vannes et la plupart des semences d'herbacées sauvages, offre une meilleure représentativité entre les grands groupes de plantes (fig. 5). Il n'est pas possible de percevoir des différences significatives dans la composition du corpus de plantes au cours de l'occupation du site, c'est pourquoi tous les échantillons sont considérés comme un groupe homogène. Les semences de plantes cultivées (42 %) et les plantes de formations forestières (37 %) constituent les deux principales catégories en nombre de restes (fig. 5). La
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
Production et consommation végétales au Bronze final dans les sites littoraux languedociens 589
forêt, forêt alluviale
37%
mauvaises herbes de printemps Chenopodium album Chenopodium. hybridům Chenopodium sp. Echinochloa crus-galli Portulaca oleracea
semences de plantes cultivées
42%
Hordeum vulgare Panicům miliaceum Triticum aestivum/turgidum Triticum dicoccum Papaver somniferum
vannes de céréales 19% Triticum dicoccum
Triticum dicoccum/monococcum Triticum cf. monococcum
Fig. 5 - Proportions des catégories de plantes attestées dans les échantillons finement tamisés de Portai Vielh (nombre de restes = 2747).
forte représentation de ces deux groupes est en partie causée par une importante fragmentation du matériel qui les concerne. L'ensemble des vannes atteint la proportion non négligeable de 19%, alors que le groupe des mauvaises herbes de printemps demeure plus discret avec seulement 2% des vestiges. Les mauvaises herbes d'hiver, les plantes de garrigue et de broussailles, les herbacées des prairies et pelouses et les espèces de milieux humides sont attestées par si peu de restes que leur total n'atteint pas 1 %. On distingue sept plantes domestiques dans l'ensemble des échantillons. La figure 6 montre, parmi les céréales, l'importance de l'orge polystique vêtue et celle de l'ami- donnier, que l'on se fie au nombre de restes ou à la fréquence d'attestation. Le blé nu, dont peu de restes ont pu être identifiés, est présent dans la moitié des échantillons. À l'opposé, la fève (Vicia faba) possède une représentation très forte en nombre de restes mais cette
légumineuse n'apparaît que dans un échantillon. Cet ensemble provient d'un four de potier daté du Bronze final Illb. L'importance de Г engrain semble très faible. Le rôle joué par le millet commun et le pavot demeure en revanche incertain. Ces plantes produisent des petites semences, aussi ne les a-t'on retrouvé que dans les échantillons finement tamisés. Leur représentation n'est pas négligeable dans ces échantillons mais ceux-ci ne permettent pas de se forger une opinion fiable. Les groupements de mauvaises herbes sont assez pauvres (fig. 5). Seules l'avoine (Avena sp.) et la véronique à feuilles de lierre (Veronica hederaefolia) pourraient attester le groupe des adventices d'hiver. L'ensemble des mauvaises herbes de printemps paraît mieux caractérisé. Quatre espèces peuvent lui être attribuées, le chénopode blanc, le chénopode hybride (Chenopodium hybridům), le pourpier (Portulaca oleracea) et le panic pied-de-coq (Echinochloa crus-galli).
fréquence absolue nombre de restes (NR) dans |es échantillons
0 500 1000 1500 2000 2500 0 2 4 6 8 10
Hordeum vulgare
T. aestivum/turgidum
Triticum dicoccum
T. monococcum
Vicia faba
vHm» • « ««r * <* J
Fig. 6 - Plantes cultivées identifiées à Portai Vielh dans les échantillons grossièrement tamisés : représentation de l'abondance en nombre de restes cumulés et de la fréquence d'apparition dans les échantillons.
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n" 4, p. 583-594
590
Site Commune Departement Auteur de l'analyse Référence Période Type de site Contexte Échantillonnage Tamisage fin (0,5 mm)
Céréales Hordeum vulgare Hordeum vulgare var. nudum Panicům miliaceum Triticum aestivum/turgidum Triticum dicoccum Triticum monococcum Légumineuses Lathyrus cicera Lens esculenta Vicia ervilia Vicia f aba
semences semences semences semences semences furca semences
semences semences semences semences
St-Etienne-de- Gourgas
St-Etienne Hérault Helbaek
Erroux 1981 BFII
abri sous roche foyer faible non
X X
- -
XX - X
- - - -
Prévél supérieur Montclus
Gard Erroux
Roudil 1972 BFII grotte foyer faible non
XXX XX
- X XX
- -
- - - -
Grotte du Hasard Tharaux
Gard Erroux
Roudil 1972 Erroux 1993
BFII grotte couche
d'occupation faible non
X - - X
XXX - X
- - - -
Baume Layrou Trêves Gard
Erroux Erroux, Fages
à paraître BFII grotte
stockage important
non
XX -
XX XX
XXX X -
X - X
XX
Laurent BOUBY
Oppidum du Marduel St-Bonnet-du-
Gard Gard
Marinval Marinval 1988
BF Illb village hauteur
remblai faible oui
X - - X X X
-
- X -
Tabl. 1 - Plantes cultivées attestées sur les sites intérieurs. BF - Bronze final, X = peu, XX = bien représenté, XXX = dominant.
La totalité des végétaux qui se rattache aux formations forestières ou de taillis et garrigues peut résulter d'une cueillette. Il s'agit tout d'abord des glands de chêne qui figuraient en nombre dans un dépotoir du Bronze final TTTb. Au chêne s'ajoutent la vigne sauvage, le noisetier, le sureau yèble et une rosacée indéterminée de type prunellier (cf. Prunus spinosa/padus).
RESSOURCES VÉGÉTALES DU LITTORAL ET DE L'ARRIÈRE PAYS
Un ensemble de plantes, qui ont manifestement constitué des ressources végétales, alimentaires ou techniques, pour les populations littorales du Bronze final, se dégage. On peut maintenant tenter de comparer ces résultats aux données disponibles pour les sites de Г arrière-pays, afin de discuter les convergences et les éventuelles différences entre ces deux milieux. Les sites étudiés pour Г arrière-pays sont relativement peu nombreux. Tls constituent un groupe de cinq gisements de l'Hérault et du Gard, la plupart représentant des occupations de grottes ou abris sous roche (tabl. 1). On a déjà évoqué les limites liées à l'échantillonnage qui concernent la majorité de ces ensembles. Le tableau 1 montre que, comme en domaine lagunaire, les principales céréales exploitées dans Г arrière-pays semblent être l'orge polystique vêtue et l'amidonnier. Le développement croissant de l'orge et le remplacement progressif des formes à grains nus par des formes vêtues sont des caractères bien connus de l'agriculture de la fin de l'Âge du Bronze (voir Marinval, 1988). Les
céréales qui apparaissent mineures sur les sites lacustres (blé nu, engrain et millet commun) sont souvent présentes dans l'intérieur des terres mais elles occupent toujours une position secondaire. La plus forte mention de Г engrain se rencontre à La Fangade. L'attestation du millet commun dans la grotte réserve de Baume Layrou est très intéressante car la présence de cette céréale sous forme de stocks est une preuve indiscutable de son exploitation et de sa mise en culture. On doit ici rappeler que le déficit de tamisages fins dans les sites de l'intérieur des terres a pu entraîner une perte importante d'informations à propos du millet et, de ce fait, provoquer une sous-estimation de son rôle réel. La catégorie des légumineuses est mal représentée sur les deux sites lagunaires. Hormis la fève, massivement attestée à Portai Vielh, la gesse est la seule espèce mentionnée à La Fangade. Il convient à ce propos de préciser que les sites humides se prêtent mal à la conservation d'un nombre élevé de graines de légumineuses. Dans Г arrière-pays, le groupe des légumineuses montre une certaine diversité mais la grotte de Baume Layrou assure seule une part importante de cette diversité. Il est remarquable que la fève soit, dans cet ensemble également, l'espèce la plus fortement présente. À Baume Layrou on rencontre la gesse chiche (Lathyrus cicera), mais aucun des sites de l'arrière-pays languedocien n'a livré de graines de gesse cultivée (Lathyrus sativus), espèce très probablement présente à La Fangade. Cependant, des quantités importantes de graines carbonisées appartenant certainement à cette légumi- neuse ont été trouvées dans le village des Gandus, à
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
Production et consommation végétales au Bronze final dans les sites littoraux languedociens 591
Saint-Ferréol-Trente-Pas (Drôme) (Marinval, 1988). Cette découverte, bien qu'un peu éloignée de La Fan- gade, montre certainement que la plante était cultivée au Bronze final dans le midi de la France. Aucune différence ne paraît se dégager entre les corpus de céréales et de légumineuses exploitées dans Г arrière- pays et sur le littoral. Il semble en aller tout autrement en ce qui concerne les oléagineux. Effectivement, on a noté la présence marquée du lin et du pavot à La Fan- gade. On a vu que le pavot se retrouvait à Portai Vielh. Or, aucune de ces plantes n'est mentionnée à l'intérieur des terres. Il faut toutefois se garder d'en tirer des conclusions d'ordre économique. 11 est vraisemblable que ces différences résultent principalement des méthodes d'échantillonnage mises en œuvre et, surtout, des modes de conservation. Un tamisage à la seule maille de 2 mm ne permet effectivement pas d'attester le pavot et la représentation du lin en est très affectée. Ces deux plantes sont d'autre part bien plus fréquemment attestées dans les milieux humides. Au cours du Néolithique et de l'Age du Bronze, dans les palafittes du lac de Zurich (Suisse), le pourcentage de graines carbonisées n'atteint jamais plus de quelques unités dans le total de graines de pavot retrouvées (Jacomet et al., 1989). On peut rappeler que le seul site en France méditerranéenne dans lequel le pavot était jusqu'à présent attesté est le port grec de Marseille (Bouches-du- Rhône), qui en a conservé les graines grâce à ses niveaux humides (Bouby et Marinval, 2000). De façon générale, dans les sites lacustres suisses du Néolithique et de l'Age du Bronze, les restes de lin sont retrouvés pour plus de 90 % à l'état non carbonisé (Jacomet et al, 1991). Une césure semble également se marquer entre sites de l'intérieur et du littoral en ce qui concerne les fruits cueillis. On a vu que les ressources de ce type étaient certainement très présentes et diversifiées à La Fangade et à Portai Vielh. Il se trouve en revanche qu'aucun fruit potentiellement cueilli ne figure sur aucun des cinq sites de l'intérieur. Il faut ici encore mettre en avant des causes liées à l'échantillonnage et au mode de conservation plutôt que d'interpréter cette différence comme le reflet de pratiques alimentaires divergentes. Les conditions humides de La Fangade ont, dans le groupe des fruitiers également, favorisé la diversité. Il est fort probable qu'un développement des études dans Г arrière-pays permettrait l'enregistrement de nombreuses ressources cueillies. On remarque que bon nombre des espèces attestées sur les deux sites littoraux est déjà mentionné dans différents sites d'autres zones du midi de la France entre le Chalcolithique et le premier Âge du Fer (Marinval, 1988 ; Ruas et Marinval, 1991). On peut cependant souligner l'intérêt que représente l'attestation du figuier à La Fangade qui montre que ce fruit, appelé à connaître un grand succès dans l'Antiquité, était déjà exploité au Bronze final. Cependant, la forte présence des petits akènes de figues ne suffit pas pour établir que l'espèce ait pu être cultivée dès cette époque. Le figuier est d'ailleurs supposé indigène en France méditerranéenne. Il était déjà mentionné au Bronze final par des charbons de bois sur l'oppidum du Mar- duel (Saint-Bonnet-du-Gard, Gard ; Chabal, 1997) et
par un unique akène au Ve s. av. J.-C. sur ce même site (Marinval, 1988).
PRODUCTION AGRICOLE OU IMPORTATION?
En gardant à l'esprit le modèle de M. Py (1990 et 1993), qui propose de voir en Languedoc oriental, au Bronze final ITIb, des occupations saisonnières en littoral et une production agricole concentrée autour des villages de hauteur de Г arrière-pays, il est intéressant de s'interroger sur les conditions d'acquisition des denrées agricoles à La Fangade et Portai Vielh. Bien que l'on travaille sur des restes qui constituent souvent les produits et les déchets directs de l'activité agricole, il est toujours délicat de caractériser par la carpologie un lieu de production. On peut distinguer deux types de démarches qui, jusqu'à présent, ont proposé des outils méthodologiques utilisables pour distinguer sites producteurs et sites consommateurs. Les travaux qui se fondent uniquement sur des observations archéologiques (Jones, 1985) sont, à notre sens, trop dépendants du contexte méthodologique, géographique et culturel dans lequel ils ont été définis pour que l'on puisse aisément étendre ces modèles à d'autres domaines. La démarche ethnographique paraît plus facilement exploitable en ce sens qu'elle donne une description des activités agricoles qui permet d'en dégager les étapes inévitables et d'évaluer leurs conséquences. L' archéobotaniste dispose d'études réalisées sur l'ensemble de la chaîne opératoire de traitement des récoltes, telle qu'elle est pratiquée par des sociétés agricoles de Turquie (Hillman, 1981 et 1984) et de Grèce (Jones, 1984), utilisant encore actuellement des techniques non mécanisées. À chaque étape de la chaîne, la composition de la récolte est modifiée. Ces travaux indiquent la nature des déchets produits et éliminés ainsi que la composition du produit qui poursuivra la chaîne. L'objectif est de pouvoir identifier, à partir de la composition en divers grains, éléments d'épis et mauvaises herbes des échantillons archéobotaniques, les différents produits et déchets des chaînes de traitement des récoltes. Il est illusoire de penser retrouver à La Fangade ou à Portai Vielh des échantillons purs, dont la composition ne refléterait qu'une seule étape des chaînes relativement complexes qui sont décrites. Il est cependant envisageable, à condition de simplifier les chaînes ethnographiques à leurs étapes les plus essentielles et inamovibles et de se fonder sur des restes caractéristiques grossièrement quantifiés, de rechercher les traces de ces étapes principales. La mise en évidence d'indicateurs des premières étapes du traitement des récoltes, celles qui interviennent avant le stockage, constituerait alors une preuve d'une production agricole locale. On considère effectivement que le battage ainsi que les vannages et tamisages qui en découlent s'effectuent sur le lieu de production, un éventuel commerce ou transport de la récolte n'étant susceptible d'intervenir qu'à partir du stockage. L'analyse repose essentiellement sur les données de La Fangade qui sont plus riches que celles de Portai Vielh ; ses résultats concerneront donc surtout le Bronze final
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
592 Laurent BOUBY
Indicateurs botaniques et abondance
Séquence simplifiée
Moisson
fr. paille XX *fr. barbes XXX
balle XXX * épillets non dévcl. X
Battage
Vannage
Tamisage grossier zones humide
Décorticage
épillets non dével. X * furca XXXX * bases glumes XXXX * entrenoeuds rachis XX
petites graines d'adventices XXX
Vannage
Tamisage grossier Point de stockage
Tamisage fin
* : reste caractéristique X : très rare XX : peu XXX : bien représenté XXXX : abondant
Fig. 7 - Éléments d'identification des différentes étapes de traitement des blés vêtus à La Fangade (d'après Hillman, 1981 et 1984). fr. = fragments, dévcl. = développés.
IL Les plantes considérées sont les deux principales céréales exploitées, l'orge et l'amidonnier, auxquelles on peut ajouter l'engrain qui suit une filière identique. Deux chaînes de traitement des récoltes simplifiées ont été établies à partir des données ethnographiques (fig. 7 et 8). La chaîne de traitement est effectivement spécifique au type de récolte (Hillman, 1981). Des différences importantes existent notamment entre la chaîne des blés vêtus (fig 7), qui s'applique à l'amidonnier et à l'engrain, et celle des céréales nues, qui concerne l'orge (fig. 8). Les restes pris en considération sont, avant tout, les vannes qui peuvent être clairement identifiées (entrenœuds, furca, bases de glumes, fragments de barbes). Les restes qui ne peuvent pas être associés à une plante cultivée précise, comme les fragments de glumes, de tiges, ou les semences de mauvaises herbes, sont utilisés avec prudence. En ce qui concerne les adventices, seul le groupe d'hiver est exploité car il est très probable qu'il soit en relation avec la céréaliculture alors que les mauvaises herbes de printemps peuvent accompagner d'autres types de cultures. À propos des blés vêtus, G. Hillman (1981 et 1984) affirme qu'en Turquie le stockage intervient à deux étapes différentes du traitement, selon le climat de la région où l'on se trouve. Dans les zones dont les étés sont humides, les blés vêtus sont mis en réserve sous la forme d'épillets, avant le décorticage. Dans les régions où l'été est sec, en revanche, le traitement est poursuivi jusqu'à son terme, après le décorticage, et les grains nettoyés sont stockés. Le climat méditerranéen du Languedoc est caractérisé par des étés secs. Cependant, on ne peut présumer du choix des communautés
Indicateurs botaniques et abondance
Séquence simplifiée
Moisson
fr. paille XX *fr. barbes XXX balle XXX * cpillets non dével. XX * entrenoeuds rachis XXXX
graines d'adventices petites et légères XXX
iattage
Vannage
Tamisage grossier
petites graines d'adventices XXX -Tamisage fin
* : reste caractéristique X : très rare XX : peu XXX : bien représenté XXXX : abondant
Point de stockage
Fig. 8 - Eléments d'identification des différentes étapes de traitement des céréales nues à La Fangade (d'après Jones, 1984 et Hillman, 1981). fr. — fragments, dével. = développés.
du Bronze final qui ont pu, en dépit des données climatiques conditionnant les pratiques turques, préférer pour d'autres raisons un stockage sous la forme d'épillets. Il est donc plus prudent de rechercher des traces des toutes premières étapes du traitement, avant le décorticage, afin de mettre en évidence une production agricole in situ. Or, ces étapes sont difficilement perceptibles en archéobotanique. Quelques restes caractéristiques peuvent leur être attribués à La Fangade (fig. 7). Il s'agit de quelques fragments de barbes et de rares épillets non développés. À ceux-ci peuvent s'ajouter les éléments moins caractéristiques que sont quelques fragments de paille et de glumes. La majorité des déchets du traitement des blés vêtus est constituée par les furca et bases de glumes qui sont des restes très typiques des étapes successives au décorticage. À Portai Vielh, les éléments exploitables pour la reconstruction du traitement des récoltes sont beaucoup plus rares, notamment en raison de conditions de conservation différentes, et seules ces étapes postérieures au décorticage des blés vêtus sont caractérisées. Il apparaît donc que les éléments dont on dispose dans l'ensemble demeurent trop fragiles pour affirmer une production locale des blés vêtus. Avant le stockage, le traitement de l'orge se poursuit généralement jusqu'au tamisage fin, ou même après cette étape. Afin de mettre en évidence une production locale, il est donc nécessaire d'attester les déchets produits par le battage, le vannage et le tamisage grossier qui constituent les premières étapes. Les principaux éléments caractéristiques de ces opérations à La Fangade sont les très nombreux entrenoeuds carbonisés. À ceux-ci on peut ajouter quelques fragments de barbes et épillets non développés, déchets également typiques des premières étapes, mais en nombre beaucoup plus restreint parmi les restes botaniques. Des carporestes moins caractéristiques pourraient résulter des mêmes opérations. Il s'agit des fragments de paille et de glumes
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n" 4, p. 583-594
Production et consommation végétales au Bronze final dans les sites littoraux languedociens 593
évoqués à propos des blés vêtus, mais également de plusieurs mauvaises herbes. Les graines très petites et légères qui sont typiquement éliminées par le vannage sont assez peu nombreuses. On peut certainement compter dans ce groupe la sabline (Arenaria cf. serpyl- lifolia), le miroir de Vénus (Legousia cf. speculum- veneris), le coquelicot (Papaver cf. rhoeas) et la violette (Viola tricolor). Il est également possible que certaines semences légèrement plus grosses ou plus lourdes que les précédentes représentent des déchets du vannage, notamment l'ammi, la ballote noire (Ballota nigra), le brome des champs (Bromus cf. arvensis) et le réséda blanc (Reseda alba). Les nombreux entrenœuds carbonisés et quelques autres indices discrets des premières opérations du traitement de l'orge plaident donc pour une production locale de cette céréale à La Fangade. De nombreux fragments de capsules suggèrent pour leur part que le lin fut battu sur le site. 11 apparaît donc que les habitants de La Fangade cultivaient localement leurs propres récoltes. Si les données de Portai Vielh se sont avérées trop limitées pour réellement permettre de discuter du mode d'acquisition des produits agricoles, des données archéologiques peuvent indiquer une production locale. On pense notamment aux deux fosses silos et au probable grenier surélevé qui ont été découverts.
LE SYSTEME AGRICOLE La présence conjointe à La Fangade de deux groupes bien constitués de mauvaises herbes, les adventices d'hiver et de printemps, suggère que les semis étaient pratiqués en automne et au printemps. Il semble donc que les habitants aient occupé le site tout au long de l'année, le travail de la terre et les semis se faisant de l'automne au printemps et les moissons en été. Sans doute en grande partie en raison du mode de conservation, les mauvaises herbes sont beaucoup moins nombreuses à Portai Vielh mais les deux groupes pourraient aussi être présents, bien que les adventices d'hiver ne comprennent que deux espèces. À partir des préférences écologiques des mauvaises herbes, on peut de plus espérer obtenir des informations sur les types de sols mis en culture. L'ensemble des mauvaises herbes d'hiver de La Fangade est largement dominé par les espèces préférant les sols secs et calcaires. La culture des céréales était donc, dans sa majorité, située dans des champs calcaires localisés au dessus des basses terres humides. Il est envisageable que cette culture se soit effectuée sur les pentes du Mont Saint-Clair qui domine le site. Les mauvaises herbes d'hiver sont probablement associées à la production des blés vêtus et peut-être de l'orge. La plupart de ces adventices n'atteignent pas des hauteurs de croissance très élevées. Elles suggèrent que les moissons étaient effectuées à un niveau moyen à bas sur la tige, à une hauteur inférieure à 50cm. Le groupe des adventices de printemps montre des préférences
écologiques plus variées. La plupart des plantes indiquent des sols à haute teneur nutritive mais certaines s'accommodent mieux de sols secs alors que d'autres préfèrent des conditions plus humides. Il semble donc probable que toutes les mauvaises herbes de printemps ne proviennent pas des mêmes terres. Les espèces les plus xérophiles sont peut-être issues de cultures de printemps localisées dans le même environnement que les céréales d'hiver, d'autant plus qu'elles regroupent toutes les calcicoles. Les espèces montrant une affinité pour des conditions plus humides indiquent vraisemblablement une exploitation agricole de terrains situés dans la plaine.
CONCLUSION Les analyses carpologiques conduites à La Fangade et à Portai Vielh livrent les premières informations dont on dispose sur les ressources végétales des villages lacustres du Bronze final en Languedoc. Cependant, le principal intérêt de ces études est plus probablement de montrer, s'il en était besoin, le bénéfice que peuvent apporter à la connaissance de l'économie végétale des tamisages fins généralisés et la recherche de nouveaux ensembles au travers de l'exploitation des milieux humides. Les résultats obtenus viennent enrichir nos connaissances sur les plantes produites et consommées. Lin et pavot, dont on soupçonnait bien sûr l'exploitation, mais qui n'avaient pas été détectés jusqu'à présent, prennent toute leur importance. Des hypothèses quant à l'exploitation de cultures aux fonctions différentes, condimen- taire avec l'aneth, tinctoriale avec la gaude, seront à prendre en considération. Le panel varié de fruits de cueillette vient rappeler l'importance que ces denrées occupaient dans l'alimentation. On voit, tout spécialement à La Fangade, que les ensembles carpologiques importants permettent d'aller beaucoup plus loin dans notre connaissance des méthodes agricoles. Une partie des pratiques et techniques des paysans de l'Âge du Bronze est ainsi mise en exergue. On constate que, au Bronze final II, les habitants de La Fangade étaient des cultivateurs au plein sens du terme, vraisemblablement attachés à leur terre pour la travailler tout au long de l'année. Les données purement archéologiques semblent également indiquer une telle sédentarité à Portai Vielh. Il est néanmoins souhaitable de pouvoir poursuivre à l'avenir les travaux carpologiques sur les sites lagunaires, afin d'avoir une vision plus générale de l'agriculture dans ce milieu particulier. Il faut souhaiter l'étude de nouveaux sites humides, mais il faut également souhaiter de nouveaux travaux sur les sites de Г arrière-pays. La simple comparaison entre les données acquises sur les deux gisements littoraux et les informations disponibles pour l'intérieur des terres a montré les lacunes de cette documentation, principalement dues aux méthodes d'échantillonnage anciennement utilisées.
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
594 Laurent BOUBY
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES AMBERT M., CHABAL L. (1992) - L'environnement de Lattara
(Hérault), potentialités et contraintes, Lattara, 5, p. 9-26. BOUBY L., MARINVAL P. (2000) - Ressources végétales à Marseille
et dans les sociétés indigènes au Bronze final et au premier Âge du Fer : premiers éléments de comparaison, in : T. Janin (dir.) : Mailhac et le premier Âge du Fer en Europe occidentale, Monographies d'Archéologie méditerranéenne, 7, Lattes, ARALO, p. 205-214.
CHABAL L. (1997) - Forêts et sociétés en Languedoc (Néolithique final, Antiquité tardive). L'anthracologie, méthode et paléoécologie, Documents d'Archéologie Française, 63, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 192 p., 50 iig.
BEHRE K.E., JACOMET S. (1991) - The ecological interpretation of archaeobotanical data, in W. Van Zeist, K. Wasylikowa, K.E. Behre (dir.), Progress in Old World Palaeoethnobotany, Rotterdam, Bal- kema, p. 81-108.
BROMBACHER С (1997) - Archaeobotanical investigations of Late Neolithic lakeshore settlements (Lake Biel, Switzerland), Vegetation History and Archaeohotany, 6, p. 167-186.
DEDET В., PY M. (1985) - L'occupation des rivages de l'étang de Mauguio (Hérault) au Bronze final et au premier Âge du Fer. III - synthèse et annexes, Caveirac, 13, p. 5-84.
ERROUX J. ( 1 98 1 ) - Étude de graines de sites préhistoriques des causses : La Poujade, Saint-Éticnne-de-Gourgas, Pompignan, Paléobiologie continentale, 12 (1), p. 273-278.
ERROUX J. (1993) - Les céréales carbonisées, in: J.-L. Roudil, B. Dedet, Les débuts du Bronze final dans les gorges de la Cèze (Gard), I, La grotte du Hasard à Tharaux, Documents d'Archéologie Méridionale, 16, p. 157-158.
ERROUX J., FAGES G. (à paraître) - Analyses des graines carbonisées de Baume Layrou, Trêves (Gard) : habitat et réserves de l'Âge du Bronze final, in : P. Marinval et Ruas M. -P. (dir.), Mémoires de plantes, 1 (à paraître).
HILLMAN G. (1981) - Reconstructing crop husbandry practices from charred remains of crops, in : R. Mercer (dir.), Farming practice in British prehistory, Edinburgh, Edinburgh University Press, p. 123-162.
HILLMAN G. (1984) - Interpretation of archaeological plant remains : the application of ethnographic models from Turkey, in : W. Van Zeist, W.A. Casparie (dir.), Plants and ancient man. Studies in palaeoethnobotany, Rotterdam, Balkcma, p. 1-41.
JACOMET S. (1988) - Pflanzen mediterraner Her-kunft in: neolithis- chen Seeufersiedlungen dcr Schwcitz, in : H. Kiistcr (dir.), Derprahis- torische Mensch und seine Umwelt, Forschungen und Berichte zur Vor- und Friihgeschichte in : Baden- Wiirtenberg, 3 1 , Stuttgart, Theiss, p. 205-212.
JACOMET S., BROMBACHER C, DICK M. (1989) - Archaobotanik am Ziirichsee. Ackerhau, Sammelwirtschaft und Umwelt von neolithis- chen und bronzezeitlichen Seeufersiedlungen im Raum Zurich, Zurcher Denkmalpflege, Monographien 7, Zurich, Orell Fiissli, 348 p., 85 fig., 98 tabl., 13 pi.
JACOMET S., BROMBACHER C, DICK M. (1991) - Palaeo- ethnobotanical work on Swiss Neolithic and Bronze Age lake dwellings over the past ten years, in: J.-M. Renfrew (din), New light on early farming, Edinburgh, Edinburgh University Press, p. 257-276.
JAUZEIN P. (1995) - Flore des champs cultivés, Paris, INRA, 898 p. JONES G.E.M. (1984) - Interprétation of archaeological plant remains :
ethnographic models from Greece, in W. Van Zeist, W.A. Casparie (dir.), Plants and ancient man. Studies in palaeoethnobotany, Rotterdam, Balkema, p. 43-61.
JONES M. (1985) - Archaeobotany beyond subsistence reconstruction, in : G.W. Barker, C. Gamble (dir.), Beyond domestication in prehistoric Europe, London, Academic Press, p. 107-128.
MARINVAL P. (1988)- Cueillette, agriculture et alimentation végétale de I ' Epipaléolithique jusqu'au W Age du Fer en France méridionale. Apports palethno graphique s de la carpologie, Mémoire de thèse, Paris, EHESS, 2 vol., 458 p., 98 fig., 30 tabl.
MONTEGUT J. (1997) -Évolution et régression des messicoles, in: Faut-il sauver les mauvaises herbes ? Gap-Charance, Conservatoire Botanique National de Gap-Charance, p. 1 1-32.
PY M. (1990) - Culture, économie et sociétés protohistoriques dans la région nîmoise, collection de l'École Française de Rome, n° 131, 2 vol., Rome, École Française de Rome, 957 p., 302 fig.
PY M. (1993) - Les gaulois du Midi. De la fin de l'Âge du Bronze à la conquête romaine, Paris, Hachette, 288 p., 51 fig.
ROUDIL J.-L. (1972) - L'Âge du Bronze en Languedoc oriental, Paris, Klincksieck, 355 p
RUAS M.-P, MARINVAL P. ( 199 1 ) - Alimentation végétale et agriculture d'après les semences archéologiques (de 9000 av. J.-C. au XVe siècle), in : J. Guilaine (dir.), Pour une archéologie agraire, Paris, A. Colin, p. 409-439.
ZOHARY D., HOPF M. (1994) - Domestication of plants in the Old World, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 279 p., 45 fig., 25 cartes.
Laurent BOUBY Centre d'Anthropologie, UMR 8555
39, Allées Jules-Guesde, 3 1000 Toulouse
Bulletin de la Société Préhistorique Française 2000, tome 97, n° 4, p. 583-594
Related Documents