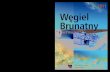RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE PAR UN APPRENTISSAGE POST-CRISE : UNE ÉTUDE LONGITUDINALE SUR DEUX PÉRIODES DE TURBULENCE Gulsun Altintas et Isabelle Royer AIMS | M@n@gement 2009/4 - Vol. 12 pages 266 à 293 ISSN Article disponible en ligne à l'adresse: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://www.cairn.info/revue-management-2009-4-page-266.htm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pour citer cet article : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Altintas Gulsun et Royer Isabelle,« Renforcement de la résilience par un apprentissage post-crise : une étude longitudinale sur deux périodes de turbulence », M@n@gement, 2009/4 Vol. 12, p. 266-293. DOI : 10.3917/mana.124.0266 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distribution électronique Cairn.info pour AIMS. © AIMS. Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit. 1 / 1 Document téléchargé depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. © AIMS Document téléchargé depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. © AIMS

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
-
RENFORCEMENT DE LA RSILIENCE PAR UN APPRENTISSAGEPOST-CRISE : UNE TUDE LONGITUDINALE SUR DEUX PRIODESDE TURBULENCE
Gulsun Altintas et Isabelle Royer
AIMS | M@n@gement
2009/4 - Vol. 12pages 266 293
ISSN
Article disponible en ligne l'adresse:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.cairn.info/revue-management-2009-4-page-266.htm--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour citer cet article :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altintas Gulsun et Royer Isabelle, Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tudelongitudinale sur deux priodes de turbulence , M@n@gement, 2009/4 Vol. 12, p. 266-293. DOI : 10.3917/mana.124.0266--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution lectronique Cairn.info pour AIMS. AIMS. Tous droits rservs pour tous pays.
La reproduction ou reprsentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorise que dans les limites desconditions gnrales d'utilisation du site ou, le cas chant, des conditions gnrales de la licence souscrite par votretablissement. Toute autre reproduction ou reprsentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manire quece soit, est interdite sauf accord pralable et crit de l'diteur, en dehors des cas prvus par la lgislation en vigueur enFrance. Il est prcis que son stockage dans une base de donnes est galement interdit.
1 / 1
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
266
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
Gulsun Altintas
Isabelle Royer
IAE de [email protected]
IAE de [email protected]
Les recherches sur les crises ont beaucoup tudi la prvention et la gestion des crises qui permettent lorganisation dabsorber le choc et ainsi de faire preuve de rsilience. Des travaux plus rcents et moins nombreux se sont intresss la phase suivante que constitue lapprentissage post-crise. Notre recherche prolonge ces travaux en tudiant les consquences de la gestion de crise et de lapprentissage post-crise sur limpact et la gestion de la turbulence suivante. Pour cela, nous avons men une tude longitudinale rtrospective de quatre processus de gestion de crise dans le secteur du tourisme, depuis le dclenchement de la crise jusqu la gestion de la turbulence suivante. Nos analyses montrent quune crise issue dune turbulence de lenvironnement peut renforcer la rsilience de lorganisation par deux processus complmen-taires lis : un apprentissage de renforcement positif au niveau de labsorption du choc et un apprentissage double boucle incluant des changements strat-giques permettant de rduire la vulnrabilit de lorganisation.
Mots cls : crise, rsilience, apprentissage, changement stratgique, industrie du tourisme.
Research on organizational crises has so far focused on prevention and on management, highlighting how businesses could absorb jolts and show resi-lience. More recently, a few studies have been devoted to post-crisis learning. In this article, we extend previous work by focusing on the consequences crisis management and learning have on the impact and management of the subse-quent environmental jolt. To do so, we conducted a longitudinal retrospective analysis of four cases in the tourism industry, from the inception of the crisis up to the management of the subsequent environment jolt. Our analyses show that an organization can reinforce its resilience following an external crisis through two related processes: 1/positive reinforcement learning at the time of impact absorption, and 2/double loop learning including strategic change to reduce the vulnerability of the organization.
Key words: crisis management, resilience, learning, strategic change, tourism industry
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
267
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
INTRODUCTION
Notre recherche sintresse lapprentissage issu dune crise dorigine externe, en dautres termes la capacit apprendre dune crise pour augmenter la rsilience de lorganisation face une nouvelle turbu-lence. La rsilience organisationnelle est entendue ici comme la capa-cit dune organisation rsister une menace ou retrouver un tat de stabilit aprs lavoir subie (Hollnagel, 2006). Notre recherche pro-longe les tudes empiriques sur les crises et turbulences, qui se sont focalises sur les priodes prcdentes : prvention et prparation, gestion de crise puis apprentissage post-crise. Ainsi, le courant des organisations hautement fiables (HRO) sest intress aux facteurs de rsilience permettant dviter une catastrophe (e.g., Weick, 1987, 1990 ; Rochlin, 1988 ; Roberts, 1990). Une grande partie de la littrature sur la crise concerne la prparation et la gestion de crise, cest--dire les facteurs de rsilience qui permettent de retrouver un tat de stabilit (e.g., Pearson et Mitroff, 1993). Enfin, des travaux plus rcents sint-ressent lapprentissage post-crise (e.g., Roux-Dufort, 1996, 2004) qui a pour objectif daugmenter la rsilience des organisations, bouclant ainsi le cycle de gestion des crises par un retour la prvention et la prparation. Toutefois, ces travaux sarrtent gnralement lap-prentissage, cest--dire aux changements effectus suite aux leons tires de la crise, et ne vrifient pas leur efficacit, cest--dire leur effet positif suppos sur la rsilience. Ltude des catastrophes successives de Challenger et Columbia la NASA constitue une exception notable dans laquelle Vaughan (2005) explique linefficacit de lapprentissage post-crise par des problmes situs au niveau de la structure profonde de lorganisation. Contrairement cette tude des checs successifs de la NASA, notre tude se focalise sur les crises dorigine externe. Les recherches sur les crises dorigine externe ou sur les turbulences sont plus rares, bien que certaines soient clbres, telles que lincendie de Mann Gulch (Weick, 1993) ou la grve des mdecins hospitaliers de San Francisco (Meyer, 1982). Les crises issues de lenvironnement ne semblent pourtant pas moins pertinentes que celles dorigine interne dans la mesure o les organisations doivent faire face un environ-nement de plus en plus turbulent (e.g., Hamel et Vlikangas, 2003), caractris par la prolifration de ruptures technologiques, de chocs conomiques et de conflits politiques (Duncan, 1972 ; Hamel et Vli-kangas, 2003).Notre recherche vise tendre les connaissances relatives leffica-cit de lapprentissage effectu dans le cadre dune crise dorigine ex-terne. Plus prcisment, elle tudie comment la gestion dune crise issue dune turbulence de lenvironnement affecte limpact et la gestion dune nouvelle turbulence. Pour mener cette tude, nous avons tudi quatre processus de gestion de crise dans le secteur du tourisme, de-puis la turbulence ayant provoqu une crise jusqu la turbulence sui-vante et sa gestion. Ainsi, nos observations stendent au-del de la priode habituelle tudie dans les travaux empiriques. Nos analyses montrent les processus et la nature des changements qui ont permis de renforcer la rsilience dans les entreprises tudies.
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
268
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
La littrature sur la gestion des crises et turbulences servant de cadre thorique est prsente dans la premire partie. La deuxime partie dcrit la mthodologie et prsente les cas tudis. Les analyses sont prsentes dans une troisime partie.
CADRE THORIQUE : LA GESTION DES CRISES ET TURBULENCES DE LENVIRONNEMENT
La littrature sur les crises et turbulences distingue trois phases : pr-vention et prparation, gestion de crise, apprentissage post-crise. Nous avons regroup les deux premires qui se focalisent sur la comprhen-sion de la rsilience de lorganisation alors que la troisime sintresse la possibilit dapprendre dune crise pour accrotre la rsilience de lorganisation.
Turbulence, crise et rsilience organisationnelle Suivant de nombreux auteurs (Meyer, 1982 ; Weick, 1993 ; Weick et al., 1999 ; Boin et McConnell, 2007), nous considrons la rsilience or-ganisationnelle comme la capacit surmonter un danger manifeste. Plus prcisment, la rsilience est la capacit dune organisation garder ou retrouver un tat de stabilit dynamique qui lui permet de poursuivre ses oprations pendant et aprs un incident majeur ou en prsence dun stress continu (Hollnagel, 2006 : 16). Sur le plan thorique, cette capacit comporte deux dimensions (Meyer, 1982) : la capacit rsister ou limiter limpact dun incident et la capacit rsorber limpact. La dfinition retenue est donc large dans la mesure o elle ne limite pas la rsilience la rsorption de limpact ou la rduction des pertes (Mileti, 1999 ; Burby et al., 2000) mais inclut la ca-pacit viter les chocs (Roux-Dufort, 2003). Suivant cette dfinition, toute entreprise qui parvient surmonter une crise ou une turbulence fait preuve de rsilience mais faible dans la mesure o une plus forte rsilience lui aurait permis dviter la crise. Les sources de rsilience variant en partie en fonction de lorigine de la crise, nous prcisons les diffrents types de crise avant de prsenter les travaux relatifs la crise et la rsilience.Les crises et turbulences de lenvironnementLa crise revt des acceptions varies. Elle est dfinie ici comme la perception dune rupture de la normalit (Boin, 2005) qui menace la viabilit de lorganisation (Hermann, 1963 ; Shrivastava, 1992 ; Pear-son et Clair, 1998 ; Nathan, 2000 ; Boin, 2005) et semble requrir des actions immdiates (Hermann, 1963 ; Pearson et Clair, 1998). Ainsi, notre dfinition ne prend pas en considration le fait que la crise soit parfois considre comme un vnement (Hermann, 1963 ; Mitroff et al., 1988 ; Pearson et Clair, 1998) ou comme un processus (Perrow, 1984 ; Pauchant, 1988 ; Pauchant et Mitroff, 1992), mais se focalise sur la perception dune discontinuit ou rupture par rapport la nor-male (Pauchant, 1988 ; Boin, 2005). Enfin, la crise a une issue ind-termine qui peut tre aussi bien ngative que positive (Boin, 2005 ;
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
269
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
Boin et McConnell, 2007). Elle se distingue ainsi dune catastrophe qui qualifie un jugement collectif sur lissue ngative dune crise (Boin, 2005 ; Ursacki-Bryant et al., 2008 : 175). Les turbulences de lenvironnement sont des perturbations transitoi-res dont loccurrence est difficile prvoir et dont les effets perturbent lorganisation . Ce sont des vnements extrieurs qui se distin-guent de leurs interprtations varies dans les organisations comme des opportunits, menaces, crises ou catastrophes (Meyer, 1982 : 515). titre dillustration les attentats du 11 septembre constituent une catastrophe. Cette catastrophe a gnr des turbulences de lenviron-nement du secteur touristique, par exemple un blocage de lespace arien aux tats-Unis et une chute de la demande mondiale de trans-port passager. Ces turbulences ont provoqu des perturbations plus ou moins importantes dans les entreprises de tourisme qui ont t inter-prtes comme des crises ou pas. Les crises issues dune turbulence de lenvironnement qui font lobjet de notre recherche constituent des crises dorigine externe selon la typologie de Mitroff, Pauchant et Shrivastava (1988) qui distinguent les crises en fonction de lorigine interne ou externe lorganisation de lin-cident dclencheur. Cette distinction en fonction de lorigine de la crise a des consquences sur la gestion de crise qui mritent dtre signa-les, la plus simple tant la possibilit pour lorganisation de diminuer loccurrence dincidents gnrateurs de crise. En effet, alors quune or-ganisation peut diminuer loccurrence dincidents gnrateurs de crise dorigine interne par des mesures prventives, elle na pas demprise sur loccurrence dincidents extrieurs qui sont par dfinition en dehors de son contrle.Crise et rsilienceLes travaux sur la gestion des crises et des turbulences comportent de nombreux points communs concernant les rponses qui permettent de rsorber un choc, mais ils prsentent galement quelques particulari-ts selon lorigine de la crise au niveau des facteurs de prvention et dimpact relatifs la vulnrabilit de lorganisation. La littrature est riche de recommandations pouvant favoriser labsorp-tion dun choc (e.g., Pearson et Mitroff, 1993). La rapidit de dcision des rponses mettre en uvre constitue un lment cl (Weick et Sutcliffe, 2001). Ces rponses concernent aussi bien la communica-tion pour satisfaire les demandes externes que les actions visant rsorber le choc. En plus des rponses spcifiques chaque crise, les rponses incluent gnralement une rationalisation des frais (Huy et Mintzberg, 2003 ; Meyer et al., 1990) et une relance de lactivit par une stratgie marketing (Smart et Vertinsky, 1984). Ces rponses oprationnelles rapides gagnent seffectuer dans le cadre dune cen-tralisation temporaire de lautorit (Barnard, 1938 ; Hermann, 1963 ; Meyer et al., 1990). Toutefois, dautres travaux montrent une tendance oppose des dcideurs qui consiste viter de prendre des dcisions et laisser dautres la responsabilit des oprations (Forgues, 1993). Les rponses oprationnelles dpendent de caractristiques organisa-tionnelles telles que le slack organisationnel qui fournit les ressources ncessaires durant la pnurie, une structure qui facilite la coordination
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
270
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
des activits et une idologie participative dans le cadre de la mission de lorganisation (Meyer, 1982).Les travaux relatifs la prvention et limpact prsentent des par-ticularits selon lorigine interne ou externe de la crise. Dans les cri-ses dorigine interne, les sources de rsilience se focalisent sur lop-timisation du systme de production pour viter ou contenir lincident (Weick, 1987 ; Rochlin, 1988 ; Weick, 1990 ; Roberts, 1990). Ainsi, le courant des organisations hautement fiables (HRO) montre limpor-tance de lentranement, de la simulation, de la redondance (Rochlin, 1988 ; Roberts, 1990), et dune culture de conscience du risque et de vigilance collective (Weick, 1987 ; Grabowski et Roberts, 1999). Ces caractristiques permettent ces organisations dapprendre de faon continue, y compris de quasi-accidents. La rsilience en tant que ca-pacit viter la crise est ainsi le rsultat dun apprentissage continu. Contrairement aux crises dorigine interne, la principale source de r-duction de limpact des turbulences externes est structurelle et concer-ne le dcouplage des activits avec lenvironnement (Meyer, 1982). Par exemple, des activits diversifies permettent de rduire limpact dune turbulence de lenvironnement (Meyer, 1982). Toutefois, sur un plus long terme, une forte rsilience qui permet dviter les consquen-ces ngatives dun environnement turbulent requiert des changements continus ncessitant veille informationnelle et exprimentations (Ha-mel et Valikangas, 2003).La distinction thorique pertinente entre limpact et la rsorption du choc est toutefois difficile observer car limpact mesur prend n-cessairement en compte des effets des rponses de rsorption. Ces rponses ont gnralement un effet positif, mais elles peuvent aussi tre inadquates et aggraver la situation (e.g., Meyer, 1982 ; Gotham et Greenberg, 2008).Notre comprhension de la littrature sur les sources de rsilience en gestion des crises et turbulences montre une convergence concernant les rponses visant rsorber un choc et des contingences lorigine de la crise concernant la vulnrabilit. Lamlioration de la rsilience suite une crise fait lobjet de lapprentissage post-crise.
Turbulence, crise et apprentissage post-crise Lapprentissage post-crise commence gnralement aprs la mise en place des rponses durgence visant absorber le choc. Toutefois, cest davantage son contenu que sa temporalit qui distingue la phase dapprentissage post-crise de celle o lorganisation fait preuve de sa capacit de rsilience, les deux phases pouvant se chevaucher. Elle est en effet le lieu privilgi des apprentissages et adaptations de lor-ganisation (Meyer, 1982 ; Pauchant, 1988 ; Richardson, 1994 ; Roux-Dufort, 1996). Les travaux relatifs cette phase sont toutefois moins nombreux que ceux qui sintressent la rsilience et prsentent des rsultats divergents ou parcellaires concernant la capacit des organi-sations apprendre efficacement dune crise. La difficult dapprendre dune crise Un petit ensemble de travaux a montr que la crise peut tre un mo-ment privilgi pour dcouvrir ce qui en temps normal demeurait invisi-
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
271
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
ble et par suite pour introduire des changements dans le but de pallier des dfaillances organisationnelles (Meyer, 1982 ; Morin, 1994 ; Roux-Dufort, 1996, 2004). La crise peut constituer une source essentielle dapprentissage organisationnel destin aussi bien prvenir les crises qu rduire leur impact ou les grer plus efficacement (Roux-Dufort, 2004 ; Ursacki-Bryant et al., 2008). En dautres termes, elle peut ainsi tre le lieu de changements visant rendre lorganisation plus rsi-liente. Par exemple, Meyer (1982) et Meyer et al. (1990) montrent que la grve massive des anesthsistes des hpitaux San Francisco en 1975 a parfois t source dadaptations des oprations, ainsi que d-clencheur dautres changements latents. Roux-Dufort (2004) prsente plusieurs exemples trs diffrents dapprentissage, y compris une crise ayant provoqu un pisode cosmologique (Weick, 1993). Il montre en effet que lentreprise Herbapol a perdu tous ses repres lors de sa pri-vatisation mais a ensuite russi sadapter la nouvelle conomie de march polonaise par un apprentissage double boucle.Dautres travaux sur lapprentissage post-crise insistent sur la difficult dapprendre dune crise. Ainsi, plusieurs recherches indiquent que les organisations ne tirent souvent aucun enseignement de la crise quelles ont surmonte (Elliott et Smith, 1993, 1997, 2006 ; Roux-Dufort, 2000) ou bien que les modifications organisationnelles suite une crise im-portante sont gnralement limites (Bourrier, 2002). Les freins lap-prentissage sont nombreux (Smith et Elliott, 2007) et produisent des rationalisations errones (Pearson et Mitroff, 1993). Par exemple, des comportements de dfense limitent la collecte dinformation ncessaire la comprhension : des individus ayant souffert prfrent oublier plu-tt que se remmorer les vnements et dautres peuvent craindre des poursuites (Bourrier, 2002). La rigidit des croyances et valeurs rduit la cration de sens (Smith et Elliott, 2007). Des processus de normali-sation de la crise peuvent aussi conduire chercher un bouc missaire plutt que des explications (Roux-Dufort, 2000 ; Bourrier, 2002). Les freins potentiels tant tels au niveau de la direction, Lagadec (1996) d-fend lide que seul un engagement rel de la direction gnrale peut amener une organisation apprendre dune situation de crise. Lapprentissage post-crise, malgr lopportunit que celui-ci reprsente daccrotre la rsilience dune organisation, apparat ainsi comme un phnomne peu probable et limit. De plus, ces travaux ne sintres-sent gure lefficacit de lapprentissage lorsquil a t ralis. Linefficacit de lapprentissage post-criseSi les recherches sur lapprentissage post-crise sont moins nombreu-ses que celles portant sur la rsilience, celles portant sur lefficacit de lapprentissage sont rares. En effet, la phase dapprentissage post-crise est destine augmenter la rsilience de lorganisation en prve-nant les crises, en rduisant leur impact ou en les grant plus efficace-ment (Meyer, 1982 ; Roux-Dufort, 2004 ; Ursacki-Bryant et al., 2008). Les recherches se limitent toutefois lapprentissage, cest--dire aux changements mis en uvre, elles ntudient pas son efficacit sur la prvention dune crise ou la gestion dune crise suivante, lexception notable de ltude des accidents de Challenger et Columbia la NASA (Farjoun et Starbuck, 2005).
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
272
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
Lanalyse des accidents successifs de Challenger et Columbia mon-trent quun apprentissage nest pas ncessairement efficace (Vaughan, 2005). Ainsi, malgr la volont de tirer des leons, une importante col-lecte dinformations, des analyses pertinentes, de nombreuses modi-fications organisationnelles montrant quun apprentissage important a eu lieu, cet apprentissage na pas permis dviter un nouvel accident (Vaughan, 2005). Ces travaux rcents montrent que toutes les leons ne sont pas toujours tires, notamment concernant les causes les plus profondes telles que lenvironnement institutionnel, la structure orga-nisationnelle et la culture (Vaughan, 1996, 2005). Les leons peuvent galement tre fausses et donner lieu un apprentissage superstitieux (March et Olsen, 1976). Par ailleurs, les changements ncessaires ne sont pas toujours correctement effectus en raison de difficults de mise en uvre ou de conflit avec dautres priorits (Farjoun et Star-buck, 2005). De plus, dans de tels systmes complexes avec des cou-plages forts, les changements effectus peuvent accrotre la complexi-t et favoriser de nouveaux accidents dit normaux (Perrow, 1984 ; Vaughan, 2005). Enfin, le dsapprentissage des mauvaises habitudes nest pas toujours ralis (Farjoun et Starbuck, 2005). Ces travaux, qui expliquent ou montrent les limites de lefficacit de lapprentissage, reposent sur des cas de crise dorigine interne. notre connaissance, il nexiste pas de recherche similaire dans le cadre des crises dorigine externe.Au total, notre analyse de la littrature sur la gestion des crises et turbulences montre une grande richesse sur les antcdents et les r-ponses qui permettent aux organisations dabsorber le choc. En revan-che, la priode dapprentissage post-crise a t moins tudie, notam-ment son efficacit dans le cadre dune crise dorigine externe. Alors que la littrature suppose que lapprentissage post-crise vient boucler le cycle de gestion de crise dans lobjectif de renforcer la rsilience, cette relation na pas t vrifie empiriquement. Notre tude quali-tative, qui explore les consquences de la gestion dune crise issue dune turbulence sur limpact et la gestion de la turbulence suivante, prolonge ainsi les travaux prcdents en sintressant lefficacit de lapprentissage. Les crises issues des turbulences de lenvironnement prsentant des particularits par rapport aux crises dorigine interne en termes dantcdents, notre analyse utilise le cadre thorique de Meyer (1982) sur les turbulences, enrichi des rponses traditionnelles des travaux sur les crises. Toutefois, alors que Meyer (1982) mobilise son cadre thorique pour tudier les antcdents de la rsilience et de ladaptation, nous le dployons sur la priode suivante pour tudier les consquences de la gestion dune crise sur limpact et la gestion de la turbulence suivante.
MTHODOLOGIE
Lobjectif de la recherche tant danalyser les consquences de la ges-tion dune crise sur limpact et la gestion de la turbulence suivante, nous avons choisi une dmarche dtude de cas (Yin, 2003). Un cas est ici
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
273
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
le processus de rponse dune organisation deux turbulences layant successivement affecte. Limprvisibilit des turbulences a conduit adopter une dmarche rtrospective. Un cas unique tant souvent criti-qu en raison de son caractre idiosyncrasique, nous lavons complt par lanalyse de trois autres processus afin denrichir les catgories danalyses mises en vidence dans ltude du premier cas (Glaser et Strauss, 1967) et dtendre la validit des rsultats en montrant la trans-frabilit des rsultats dautres organisations (Leonard-Barton, 1990).
Choix du terrainNous avons slectionn les quatre processus tudis dans le secteur du tourisme. Notre recherche impliquant que lorganisation ait connu deux turbulences qui lont affecte, dont lune ayant conduit une cri-se, nous avons choisi un secteur connaissant des perturbations fr-quentes. Le secteur du tourisme remplit cette condition. En effet, au cours des dix dernires annes, les entreprises du secteur ont subi de multiples chocs externes majeurs de nature varie tels que des catas-trophes naturelles (tsunami, 2004), des conflits arms (guerre dIrak, 2003), des crises conomiques (crise mondiale, 2001), des pidmies (SRAS, 2003) ou encore des actes de terrorisme (attentats du 11 sep-tembre 2001 aux tats-Unis). Parmi les acteurs du secteur, notre choix sest opr sur les voyagistes qui sont la figure emblmatique du sec-teur (Dornier et Karoui, 2005) en raison de leur activit qui consiste assembler les diffrents lments qui composent un voyage.
Slection des casLe design de recherche repose sur une tude de cas longitudinale r-trospective complte par ltude de trois autres processus dont les principales caractristiques sont prsentes dans le tableau 1. Le premier cas, appel ici Monde Exotic , a t choisi en raison de labsence de spcificit marquante de son organisation qui la ren-drait atypique. Ainsi, lentreprise est un voyagiste gnraliste, de taille moyenne selon la dfinition du secteur (Dornier et Karoui, 2005), ayant le statut juridique ordinaire de SA. Implante en France, lentreprise se dfinissait comme un multispcialiste du voyage disposant dune agence intgre. Elle proposait initialement des sjours et vols secs vers des destinations lointaines dont plus de 30 % vers les tats-Unis. Lentreprise a t fonde par cinq amis, qui dtiennent toujours plus de la moiti du capital, dont trois participent aux dcisions stratgiques. Les trois autres processus ont t slectionns selon des critres tho-riques de comparaison par rapport au premier cas (Eisenhardt, 1989 ; Giroux, 2003). Ce sont galement des voyagistes implants sur le territoire franais afin de faciliter les comparaisons. En revanche, ils varient en termes de taille, de degr de spcialisation et de type de spcialisation afin denrichir les analyses et dtendre la validit des rsultats. La taille et la diversification ont en effet une incidence po-sitive sur la crise et sa gestion (Meyer, 1982). Une taille leve a une incidence positive sur la capacit de lorganisation rsister un choc (Levinthal, 1997), notamment en raison dun plus grand slack organisa-tionnel (Meyer, 1982). La diversification, quant elle, rduit limpact de
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
274
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
lvnement sur lorganisation en diminuant le risque que lensemble des activits soit touch (Meyer, 1982). La premire entreprise, appe-le ici Oriental, est une petite entreprise familiale dirige par un des membres de la famille en concertation avec les autres et spcialise sur le Moyen-Orient. La deuxime, appele Plongial, est une socit par actions simplifie appartenant un groupe du mme secteur. La dernire, appele Agora, est un oprateur gnraliste initialement sp-cialis sur la Turquie et dirig par le patron fondateur et propritaire de lentreprise. Le tableau 1 prsente les quatre cas tudis.
Tableau 1. Caractristiques des quatre voyagistes et des turbulences les ayant affects Monde Exotic Oriental Plongial Agora
Date de crationGouvernance
TailleSpcialisation
Turbulence 1 (crise perue)1
Perception de rupture de lactivit normale 1
Impact dclar de la turbulence sur le CA 1
Impact mesur 2 (volu-tion du CA)Retour au mme niveau de CA2
Retour aux bnfices 2
Turbulence 2(pas de crise perue)1
Impact mesur 2 (volu-tion du CA)Retour aux bnfices 2
1979SA dirige par cinq amis actionnaires ma-joritairesMoyenneMultispcialiste
Attentats du 11 septem-bre (2001) Le 12 septembre, il ny avait plus personne dans lagence.
30 %
36 %
3 ans
< 1 anTsunami (2004)
> 0
< 1 an
1991SARL familiale
PetiteSpcialiste du Moyen-Orient
Attentats du 11 septem-bre (2001) On na plus eu de ventes.
22 %
22 %
3 ans
1 anGuerre en Irak (2003)
0,1 %
< 1 an
1982
SAS appartenant un groupe
PetiteSpcialiste de la plon-ge en Mditerrane
Attentats en gypte (2005) Les ventes ont baiss... et pendant six mois ctait trs difficile de vendre lgypte.
30 %
ND
ND
ND
Grippe aviaire (2005)
ND
ND
1983
SARL dtenue par un patron propritaire majoritairePetiteGnraliste initiale-ment spcialiste de la TurquieGuerre du Golfe (1991)
Il ny avait plus beau-coup de demandes sur la Turquie.
60 %
34 % et 7 % en t + 14 ans
2 ansTremblement de terre en Turquie (1999)> 0
< 1 anSources : 1.interview, 2.comptable.
Pour slectionner les cas, vingt voyagistes implants en France, r-pertoris sur Internet, ont t contacts par e-mail. Les cinq premiers acceptant de participer aprs relance tlphonique et rpondant aux critres de slection ont t enquts. Aprs entretien, le cinquime cas a t supprim en raison de son manque de conformit avec les critres de slection, en loccurrence avoir connu deux turbulences dont la premire avait entran une crise.Notre dfinition de la crise comportant une dimension subjective lie la perception de rupture de la normalit (Boin, 2005), ce sont les in-terlocuteurs qui ont choisi la priode tudie en indiquant la premire
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
275
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
turbulence quils ont qualifie de crise et la turbulence suivante ayant affect leur organisation. Indpendamment de la dfinition retenue de la crise et contrairement ltude des turbulences de lenvironnement (Meyer, 1982), ltude de crises ne permet pas au chercheur de s-lectionner des turbulences communes lensemble des cas dans la mesure o une mme turbulence nentrane pas ncessairement une crise dans toutes les organisations. Cette caractristique, qui distingue les crises des turbulences, rduit les possibilits de comparaisons prin-cipalement des lments qualitatifs.Le cinquime cas, un spcialiste des tats-Unis, na pas t retenu car, contrairement toute attente, la premire turbulence (les attentats du 11 septembre 2001) na pas t considre comme une crise par lin-terlocuteur mais seulement la seconde (la loi sur les passeports biom-triques en 2005). Au moment des attentats, lentreprise avait un surcrot dactivit d une opration exceptionnelle qui a trs bien russi et a mme conduit un accroissement de son chiffre daffaires de 2001 par rapport 2000. Lentreprise na pas peru de situation de crise, na pas entrepris de modification stratgique ou structurelle mais a t affecte lanne suivante par la baisse de la demande rgulire destination des tats-Unis qui sest traduite par une chute de 25 % de son chiffre daffaires par rapport 2000 et des profits ngatifs. Bien que ce cas ne puisse pas tre retenu pour les analyses suivantes portant sur les consquences de la gestion dune crise sur limpact et la gestion de la turbulence suivante, il illustre labsence de lien systmatique entre une turbulence et les entreprises du secteur quelle affecte. Il naffaiblit pas nos analyses dans la mesure o il suggre, conformment la littrature, que les rponses rsultent davantage de la perception de la situation de crise plutt que de la turbulence ou de ses consquences financires.
Collecte des donnesLes donnes du premier cas reposent sur six entretiens semi-directifs raliss auprs de la directrice de la communication et des directeurs rgionaux (tats-Unis et monde arabe), complts par des articles de presse issus de la presse quotidienne (Le Monde par exemple) et dun magazine spcialis dans le secteur du tourisme, Lcho touristique. Les donnes des trois autres cas reposent sur un entretien conduit auprs du directeur ou du grant de lentreprise. Elles ont t com-pltes par des articles de presse. Les entretiens semi-directifs ont t mens en face face, enregistrs et retranscrits en intgralit par le premier auteur. Tous les interlocuteurs ont t interviews en 2007 aprs la deuxime turbulence. Toutes les personnes interroges exer-aient leur fonction actuelle au moment de la crise, except la directrice de la communication du premier cas qui exerait la fonction de direc-teur des ressources humaines.Le guide dentretien a t labor de manire respecter la chronologie des vnements pour favoriser la mmoire (Pettigrew, 1990 ; Pentland, 1999). Il a t structur en quatre parties. La premire partie concernait le dclenchement de la crise : son impact sur le chiffre daffaires, ses rpercussions sur le personnel, lambiance au sein de lentreprise. La
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
276
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
deuxime sintressait aux rponses de lorganisation durant la crise (attitude lgard des informations manant de lenvironnement, mise en place dune cellule de crise, prises de dcisions, actions mises en uvre pour enrayer la crise). La troisime partie concernait les chan-gements intervenus durant la phase dapprentissage post-crise. Enfin, la dernire partie tait consacre la seconde turbulence : son impact, sa gestion puis limpact peru de la crise prcdente sur ces deux aspects.
Codage des donnesLes donnes collectes ont t codes en unit de sens (Allard-Poesi, 2003). Dans les rcits des rpondants, nous avons cherch identifier des expressions ou des phrases relatives aux concepts cls contenus dans la littrature prsente prcdemment. Dans un premier temps, nous avons vrifi si les situations qualifies de crise par les interlocu-teurs prsentaient les critres qui permettent de qualifier une situation de crise selon la littrature : une perception de rupture de la normalit qui menace la viabilit de lorganisation (Boin, 2005). Conformment la littrature, ce que les interlocuteurs ont caractris de crise sest traduit par une rupture de lactivit normale. Ainsi, la directrice de la communication de Monde Exotic dcrit la crise suite aux attentats du 11 septembre : Du jour au lendemain et quasiment dune heure lautre, a a t un rel traumatisme dans lentreprise. Le tlphone sest arrt de sonner, plus de passage dun jour lautre entre le 11 et le 12 septembre. Le 12 septembre, il ny avait plus personne dans lagence. a a t vraiment quelque chose de physiquement, de vi-suellement palpable. Dun seul coup, tout sest arrt. a a t un rel traumatisme au niveau international et national et du coup, au niveau du voyage et du loisir, il y a eu une vraie priode de flottement. Nous avons mesur limpact des turbulences par lincidence dclare sur le chiffre daffaires que nous avons ensuite triangul avec les sour-ces comptables. Les deux sources convergent pour indiquer un fort impact ngatif des turbulences qualifies de crise et une absence dim-pact significatif pour les turbulences qualifies de non-crise, confor-mment au critre relatif la menace de la viabilit de lorganisation (e.g., Pearson et Clair, 1998). La rsilience a t mesure par la dure de retour lactivit prcdant la crise (Meyer, 1982) laquelle nous avons ajout le retour aux bnfices qui marque le retour la stabilit, conformment la dfinition de la rsilience que nous avons retenue (Hollnagel, 2006). Les turbulences ont conduit des impacts diffrents et des dures de rsorption plus ou moins longues selon les organi-sations (voir tableau 1). Toutefois, il est difficile de comparer la rsi-lience des diffrentes organisations en raison de la nature diffrente des vnements les ayant affectes. Seules Monde Exotic et Oriental peuvent tre compares. De mme, la deuxime turbulence tant dif-frente de la premire, la comparaison des impacts et rsiliences entre les deux turbulences est insuffisante pour en dduire une amlioration de la rsilience des organisations. Par suite, les conclusions reposent essentiellement sur les descriptions et explications fournies par les di-rigeants interrogs.
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
277
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
Nous avons cod les rponses la crise des organisations tudies selon celles prsentes dans notre cadre thorique concernant la r-silience. Il est apparu dans les cas des changements en termes dac-tivit et de positionnement durant la phase dapprentissage post-crise que nous avons qualifis de stratgiques suivant Mintzberg et Westley (1992) qui distinguent les changements stratgiques des changements organisationnels ou structurels. Enfin, les antcdents organisationnels des rponses ont t classs selon les catgories de Meyer (1982). Afin de rduire les biais rtrospectifs, nous avons ralis une analyse de la cohrence interne des entretiens, notamment la correspondance entre les actions dclares au dbut de lentretien et la perception de lincidence des actions lors de la deuxime turbulence. Cette compa-raison nous a par exemple permis de constater des omissions concer-nant les licenciements. Pour limiter les biais, nous avons galement effectu une triangulation des entretiens du premier cas, qui se sont rvls converger, en plus de la triangulation entre entretiens et docu-ments effectue pour lensemble des cas. Le premier cas a ensuite t compar aux trois autres processus pour identifier les similarits et les diffrences.
ANALYSES
Lanalyse des consquences de la gestion dune crise issue dune tur-bulence de lenvironnement sur limpact et la gestion de la turbulence suivante implique une analyse chronologique et la comparaison entre la premire et la seconde turbulence qui sont prsentes successi-vement. Les analyses sont illustres par des citations du cas Monde Exotic. Les trois processus complmentaires tudis figurent essen-tiellement sous forme synthtique dans les tableaux comparatifs. Ces analyses montrent que la gestion de la crise a gnr des apprentissa-ges simple boucle de rsorption du choc et double boucle incluant des changements stratgiques qui ont permis daccrotre la rsilience de lorganisation lors de la turbulence suivante.
Turbulence 1 : gestion de la criseSuivant le cadre thorique prsent prcdemment, nous prsentons successivement la priode durant laquelle les entreprises montrent leur capacit de rsilience, notamment au travers des rponses visant rsorber le choc, puis la phase dapprentissage post-crise.La rsilienceLanalyse des cas montre des rsultats conformes la littrature, que ce soit en termes de rponses ou dantcdents organisationnels. Les attentats du 11 septembre ont frapp fortement Monde Exotic par un arrt brutal de lactivit qui sest ensuite traduit par une chute du tiers de son chiffre daffaires. Cet impact fort provient notamment de la part importante des destinations vers les tats-Unis qui reprsentaient plus du tiers du chiffre daffaires. Lincidence ngative dune forte dpen-dance est cohrente avec la faible diversification identifie dans la lit-trature (Meyer, 1982).
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
278
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
En revanche, lentreprise a fait preuve dune capacit de rsorption de limpact relativement rapide. Bien que lentreprise nait retrouv son niveau de chiffre daffaires quaprs trois annes, elle a retrouv son quilibre financier ncessaire sa survie en quelques mois. En effet, elle a ralis des bnfices lanne de la turbulence malgr la chute de 36 % de son chiffre daffaires (voir tableau 1). Pour cela, lentreprise a mis en uvre des rponses de rationalisation des frais et dactions commerciales influences par ses antcdents organisationnels (voir tableau 2). Les rponses ont t particulirement rapides et efficaces, comme lin-dique la directrice de la communication : On a eu la chance grce nos dirigeants daller trs, trs vite, de prendre lampleur de lvne-ment. Au dbut, dans le secteur du tourisme on les traitait de fous. Ds le 15 septembre, leur plan dattaque, leur plan de riposte tait prt. On gle les recrutements... Au dbut, on disait : cest une dcision totalement prcipite, nimporte quoi, ils saffolent, etc., etc.... Plus on a avanc dans le temps, plus on sest rendu compte, aussi bien en interne et ailleurs dans le secteur, que cest eux qui avaient raison. Ces rponses ont t dcides et mises en uvre dans le cadre dune centralisation temporaire de lautorit, conformment aux recomman-dations de nombreux auteurs (Barnard, 1938 ; Hermann, 1963 ; Meyer et al., 1990) : Toutes nos quipes avaient besoin dtre rassures, donc davoir une parole couter. La question de tout le monde ctait : Quest-ce quon fait ? Donc cest pour a que a a t trs, trs important que ce soit nos dirigeants qui ds le dpart prennent les rnes et tiennent lentreprise pendant cette priode-l. Cette rapi-dit, qui favorise la rsilience, provient de lidologie entrepreneuriale ouverte sur lenvironnement. Ainsi, notre interlocutrice dclare : Pour garder notre position, pour continuer dvelopper notre chiffre daf-faires, on doit tre en veille permanente dinnovation, de mouvements et de rponses des changements qui se passent sur le march, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc a, a fait partie de no-tre culture de bouger tout le temps. Cette idologie entrepreneuriale ouverte sur lenvironnement et le changement est de plus soutenue par une organisation qui permet de traiter linformation en temps rel : Nous avons un dispositif interne qui nous permet dtre informs en temps rel du chiffre daffaires de lentreprise. Les jours qui ont suivi le 11 septembre, ce chiffre tait... ngatif, cest--dire que nous avions plus de clients qui avaient dj rserv leurs voyages et qui venaient se faire rembourser que de nouveaux clients. Cette situation est trs, trs exceptionnelle et a fait comprendre tout le monde dans lentre-prise que la situation tait trs grave et quil fallait ragir vite et bien. Cette ouverture sur lenvironnement saccompagne dune analyse pru-dente des informations, comme le souligne notre interlocutrice : Nos dirigeants ont dvelopp des sources dinformations varies et quils croisaient pour se faire leur propre opinion : des mdias, des concurrents mais aussi des autres secteurs dactivit, statisticiens et professionnels de la prospective conomique. Les solutions de rationalisation des frais ont privilgi la flexibilit et la solidarit. On a donc pris des dcisions de premier niveau rapi-
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
279
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
dement. a a t de geler les recrutements..., de ne pas reconduire les contrats dure dtermine quand on avait des contrats dure dtermine en cours, bref de limiter les cots pour viter des licen-ciements secs Et on sest relay pour faire du front line et de la hot line de 9 heures du matin 8 heures du soir pendant les 15 jours qui ont suivi cet vnement-l. On leur a demand beaucoup de flexibilit, on leur a demand : Bon coute ! En ce moment, sur ton activit de commercial, tu nas plus grand-chose faire. On a besoin de monde en comptabilit, on ne va pas recruter la compta, tu vas la compta. On va te former, tu vas faire de la comptabilit. Ces rponses qui favorisent la flexibilit et la solidarit sont cohrentes avec lidologie participative qui reflte la structure de gouvernance particulire de len-treprise, dtenue par cinq amis qui possdent plus de la moiti du ca-pital de lentreprise. Par ailleurs, la multispcialisation de la structure a galement favoris la rsorption du choc en permettant la raffectation de certains clients vers dautres destinations ainsi que le redploiement du personnel : On a redploy nos forces vers lEurope, vers les les, vers les destinations qui paraissaient plus scurisantes nos clients, vers lesquelles ils acceptaient quand mme daller pour reporter leur voyage. Enfin, les donnes comptables montrent que Monde Exotic disposait de ressources financires qui ont contribu mettre en place ses rponses oprationnelles (voir tableau 2).Les trois cas complmentaires corroborent les observations de Monde Exotic. Limpact du choc provient notamment de leur spcialisation ex-trme ou relative (voir tableau 2, ligne stratgie ). Les entreprises sont parvenues rsorber le choc par des rponses de nature simi-laire de rationalisation des frais et dactions commerciales, mme si elles prennent des formes parfois diffrentes mais cohrentes avec les antcdents organisationnels de lentreprise. Par exemple, Oriental a pouss trs loin la rationalisation des frais en cohrence avec le ca-ractre artisanal et familial de lentreprise. Vraiment, on a fait des conomies drastiques, et sur tous les points. Tout lhiver, on na pas chauff. On teignait les lampes en permanence. Enfin, tout ce quon pouvait faire comme conomies mme drisoires, on les a faites. Sur le plan commercial, plusieurs entreprises ont eu recours la pu-blicit rdactionnelle. Par exemple, le dirigeant de Plongial explique : On envoie tout de suite des journalistes dans le pays, ils sont nos invits, donc une dizaine de journalistes. Au retour, ils crivent dans les journaux comme Le Figaro, Le Monde... Ils crivent des articles sur lgypte en disant : Oui il y a eu des attentats tout a, mais [] la vie continue. Ya des articles dans ce sens-l, pour rassurer un peu les gens. Enfin, Agora, o le style de management tait plus autoritaire, a adopt le licenciement comme premier recours au lieu du dernier pour Monde Exotic : Tout dabord, il y a eu des licenciements , indique notre interlocuteur chez Agora.Au total, les cas prsentent des rsultats similaires entre eux et confor-mes la littrature sur la gestion des crises et des turbulences, que ce soit en termes de rponses ou dantcdents favorisant ces rponses (Meyer, 1982). On note toutefois que la diversification ne semble pas seulement avoir une incidence au niveau de limpact, mais aussi sur
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
280
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
les rponses par le redploiement quelle permet aussi bien au niveau de la clientle que du personnel. Certaines de ces rponses nouvelles ont impliqu un apprentissage durant la crise, cest notamment le cas de la raffectation temporaire du personnel mise en uvre au sein de Monde Exotic. Toutefois ces apprentissages disparaissent lorsque le choc est rsorb (Meyer, 1982), contrairement aux apprentissages post-crise qui visent perdurer.
Tableau 2. Turbulence 1 : gestion de crise et apprentissage post-criseMonde Exotic Oriental Plongial Agora
AntcdentsStratgie
Structure
Idologie
Slack
Impact dclarturbulence 1
Multispcialiste des voy-ages dans des destinations lointaines
Dpartements par zone gographiqueSystme dinformation trs dveloppImportance de lenvironnement Idologie entrepre-neuriale participa-tive et solidaire
Rserves financires
Attentats du 11 septembre (2001) 30 %
Spcialiste du Moyen-Orient
Structuresimple
Importance de lenvironnement Idologie entrepreneuriale familiale
Absence de rserves financiresUne marque commerciale peu utiliseAttentats du 11 septembre (2001) 22 %
Spcialiste de la plonge en Mditerrane
Structuresimple
Importance de lenvironnement Idologie entrepreneuriale
Rserves au niveau du groupe
Attentats en gypte (2005) 30 %
Spcialiste de la Turquie avec prestations immobil-ires intgres
Structuresimple
Importance de lenvironnement Idologie entrepreneuriale autoritaire
Rserves financires
Guerre du Golfe (1991) 60 %
Rponses oprationnelles (effectues dans un dlais dun mois) : absorption du chocInformation des clients1
Rationalisation des frais2
Raffectation des clients3
Transfert du personnel4
Promotions sur les desti-nations sinistres4
Communication4
Front lineHot lineArrt des recrutementsArrt des CDDLicenciements Vers lEurope
Conseillers tats-Unis et monde arabe vers Europe et comptabilit
Rduction de 10 15 % sur les tats-Unis et le Moyen-Orient
Standard
Dparts ngocisBaisse du budget de fonctionnement et des rmunrationsVers lgypte
Standard
Optimisation des vols (annulation de vols et re-groupement de voyageurs)
Rduction de 150 200 sur lgypte
Articles de presse et autres supports mdias
Standard
LicenciementsBaisse des budgets de fonctionnement et de com-munication
Rduction de 150 200 sur la Turquie
Articles de presse
Apprentissage post-crise : changements commencs plus dun mois aprs la turbulenceDfaillances identifies
Changements strat-giques
Changements organisa-tion-nels
Trop forte dpendance vis--vis dune destinationCloisonnement des d-partements gnrateur de rigidits DiversificationCration de la destination FranceDveloppement des destina-tions EuropePlafond pour chaque desti-nation 15 % du CA
Flexibilit structurelleFusion des services en double destination
Trop forte dpendance vis--vis de la zone gographique
Diversification Lancement dune activit de rceptif finance par la vente de la marque com-merciale
Manque dattractivit de loffre
Diffrenciation Cration de sjours orig-inaux incluant des activits complmen-taires la plonge
Trop forte dpendance vis--vis de la destinationTrop dinvestis-sements immobiliers
DiversificationRachat dun voyagiste gnraliste financ par une augmentation du capital du propritaireRduction de lintgration Rduction des investisse-ments immobiliers au profit de la location
Notes : 1 dans la journe, 2 dans la semaine, 3 dans la quinzaine, 4 dans le mois suivant la turbulence.
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
281
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
Lapprentissage post-criseLanalyse des cas montre un apprentissage post-crise visant aug-menter la rsilience de lorganisation une nouvelle turbulence. Aprs les rponses durgence destines rsorber limpact de la turbulence, Monde Exotic a entrepris des changements stratgiques et organisation-nels pour rsoudre les faiblesses de lorganisation identifies lors de la crise. Face la dpendance de son activit vis--vis des tats-Unis et plus largement du contexte international, Monde Exotic a diversifi ses zones dactivit par la cration dune nouvelle destination : la France, et le dveloppement dautres destinations de proximit plus sres en cas de nouveau choc international : On a cr des nouvelles destinations, notamment la France. Le lancement de la destination France a t im-mdiatement une consquence du 11 septembre. Si les gens se replient chez eux, autant quon soit aussi prsent dans ce march-l, alors quon ntait pas du tout prsent sur le march franais La seconde a a t de, on tait dj prsent sur les voyages en Europe, mais pas ce niveau-l. On a mis beaucoup, beaucoup de moyens sur lEurope, en disant que ce sera une destination de repli pour quon soit plus fort l-dessus. Ce dveloppement de destinations nouvelles et le renforce-ment de destinations faibles sinscrivent dans un plan stratgique plus global visant rduire la dpendance de lorganisation vis--vis dune destination particulire, comme lindique la directrice de la communica-tion : Cest--dire quaucune de nos destinations ne devait reprsenter elle seule plus de 15 % du chiffre daffaires de lensemble des desti-nations.En plus des changements stratgiques, la crise a gnr une prise de conscience de la faiblesse dune structure trs spcialise par destina-tion en cas de problme dans une zone. Par suite, Monde Exotic a en-gag des modifications organisationnelles destines accrotre sa flexi-bilit pour mieux rpondre un nouveau choc ventuel : Une fois que tout le travail des annulations tait fait, on avait une quipe de vendeurs qui navait plus rien faire. Et l, on sest rendu compte dune vraie fai-blesse de notre organisation... Cest la suite du 11 septembre quon a commenc retravailler toute notre organisation interne pour faire des binmes de destinations pour que tous nos conseillers voyageurs soient susceptibles, si leur destination principale est en crise, de travailler sur une autre destination, de reporter nos forces sur une autre destination. Donc on a coupl nos destinations entre elles, par exemple lAustralie fonctionne avec locan Indien, lle Maurice Les trois autres cas prsentent des rsultats similaires dans la mesure o tous ont engag des changements stratgiques. Plusieurs ont opr une diversification des activits pour rduire leur dpendance vis--vis de leur destination principale. Toutefois, les activits choisies diffrent dune entreprise lautre (voir tableau 2, suite). Ainsi, contrairement aux autres entreprises qui ont diversifi leurs zones gographiques dans le cadre dune diversification concentrique, Oriental a cr une activit de rceptif qui consiste organiser des sjours en France pour les voya-geurs en provenance de ltranger. En plus des activits, les modalits de mise en uvre varient en fonction des ressources : raffectation des ressources pour Monde Exotic, dveloppement interne financ par la
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
282
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
cession dune marque pour Oriental et acquisition finance par aug-mentation des fonds propres du propritaire pour Agora. En plus de la diversification commune plusieurs cas, Agora a augment sa flexibi-lit en diminuant son intgration amont dans le parc htelier au profit de la location: On a cinq htels en Turquie, [] nos confrres, eux, ne travaillent pas avec leur propre structure, contrairement nous, on travaille avec nos propres htels, nos salaris... La leon cest [...] pas beaucoup dinvestissement sur une destination, malheureuse-ment cest comme a. Cette anne [...], on a deux htels nous et les autres, on les a lous. Enfin, contrairement aux autres voyagistes, Plongial na pas choisi de diversifier ses activits. En effet, son diri-geant, passionn de plonge, a prfr diffrencier son offre en crant des sjours originaux incluant des activits complmentaires la plon-ge telles que la photographie ou la biologie. Ces nouveaux produits, des tarifs 30 % suprieurs aux prcdents, ont attir une clientle plus fidle, comme lindique le dirigeant : a nous a permis de nous positionner sur un march diffrent du march moyen. Ces analyses indiquent un apprentissage post-crise dans les quatre cas. Elles montrent de plus que la crise peut tre une opportunit de changements stratgiques o lentreprise modifie son portefeuille dac-tivits ou sa stratgie gnrique alors que les recherches prcdentes montrent des adaptations de nature essentiellement organisationnelle et oprationnelle (Meyer, 1982 ; Roux-Dufort, 2004). Toutefois, conna-tre lefficacit de cet apprentissage implique de mesurer ses cons-quences au cours de la priode suivante.
TURBULENCE 2 : LEFFICACIT DE LAPPREN-TISSAGE
Pour estimer lefficacit de lapprentissage, nous avons demand aux voyagistes dindiquer quelle tait la turbulence suivant la crise les ayant affects. Tous ont dclar que cette turbulence navait pas entran de crise, contrairement la premire. Ces dclarations sont cohrentes avec lvolution du chiffre daffaires des donnes compta-bles qui ne montrent pas de baisse, hormis pour Oriental. Cette baisse est toutefois trs limite : 0,1 % (voir tableau 1). Ces donnes sont cohrentes avec une augmentation de la rsilience dans la mesure o limpact de la nouvelle turbulence est beaucoup plus faible que celui de la prcdente. Toutefois, elles sont insuffisantes pour en dduire une efficacit de lapprentissage dans la mesure o la deuxime turbulen-ce nest pas identique la premire. Cest pourquoi nos conclusions reposent sur les arguments fournis par les interlocuteurs et la compr-hension des mcanismes dapprentissage qui ont permis daccrotre la rsilience de lentreprise.
La rduction de limpact grce aux changements stra-tgiquesLa diversification des activits effectue pour limiter la baisse des ventes a permis de rduire limpact de la turbulence suivante. Ainsi,
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
283
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
Monde Exotic estime que les activits de diversification ont rduit limpact du tsunami car : Au moment du tsunami, les destinations asiatiques ne reprsentaient plus que 15 % alors quavant elles reprsentaient 25 %. De faon similaire, Oriental et Agora ont bnfici de la rduction de la part de la destination touche par la nouvelle turbulence (voir tableau 3). En plus de cet effet structurel mcanique de rduction du pour-centage de lactivit touche, les interlocuteurs insistent sur son effet positif sur la rsorption du choc.
Tableau 3. Turbulence 2 : gestion de la turbulence et apprentissage post-turbulence
Monde Exotic Oriental Plongial AgoraAntcdents et leur volution par rapport la turbulence 1*Stratgie
Structure
Idologie
Slack
Impact turbulence 2
Effet des diversifica-tions sur limpact
Multispcialiste des voyages tous conti-nents, Dpendance dune zone : 15 % CA maximum
Dpartements regroupant au moins deux zones gographiques
Inchange
Rserves financires
Tsunami (2004)Pas de baisse de CA
15 % de lactivit affec-te au lieu de 25 %
Spcialiste du Moyen Orient avec activits de rceptif en France
Deux divisions
Inchange
Rserves financires
Guerre en Irak (2003)Baisse de CA de 0,1 %
50 % de lactivit affec-te au lieu de 100 %
Spcialiste de la plon-ge en Mditerrane Diffrenciation et exten-sion de loffre produit
Structuresimple inchange
Inchange
Rserves au niveau du groupe
Grippe aviaire (2005)ND
Activits diversifies tous continentsBaisse de la part des investissements im-mobiliers
Structuresimple inchange
Inchange
Rserves financires
Tremblement de terre en Turquie (1999)Pas de baisse de CA
70 % de lactivit affec-te au lieu de 100 %
Rponses oprationnelles et leur volution par rapport la turbulence 1*Rponses utilises lors de la turbulence 1*
Nouvelles rponses
Apprentissage post-turbulence
Ractivation des rponses opra-tionnelles, except le licenciement
Mise en place dune procdure de localisa-tion des clients
Modification du sys-tme de rmunration
Ractivation des rponses opra-tionnelles, except les dparts
Ractivation des rponses opra-tionnelles
Ractivation des rponses opra-tionnelles
Raffectation des clients vers dautres destinations
Note : Italique : volutions des antcdents et rponses de la turbulence 2 issues des changements stratgiques raliss durant lapprentissage post-crise turbulence 1 (voir tableau 2 apprentissage post-crise).* Voir tableau 2 pour les analyses de la turbulence 1.
Lamlioration de la rsorption du choc grce aux chan-gements stratgiquesLa diversification permet aussi doffrir un plus large choix de reports pour la clientle dsireuse dannuler son voyage. Aprs le tsunami, les gens ne voulaient plus aller en Thalande ou en Indonsie mais ils avaient quand mme prvu des voyages, donc ils voulaient aller
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
284
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
ailleurs. Aprs, si lentreprise [...] est suffisamment ractive pour chan-ger, pour proposer autre chose, une autre partie du monde qui corres-pond la demande des clients qui ne veulent plus partir en Thalande ou en Indonsie, on va rcuprer du chiffre daffaires. Dans le cas de Monde Exotic, les modifications organisationnelles de regroupe-ment gographique facilitent les reports dans la mesure o un mme conseiller peut proposer une destination diffrente. Ainsi, au sein du dpartement Asie, les conseillers voyageurs ont russi reporter une partie de leur clientle pour lIndonsie sur la Chine, destination qui t couple lIndonsie suite la crise du 11 septembre.De faon similaire, lentreprise Agora estime que la seconde turbu-lence a t mieux gre essentiellement parce que, vu quon sest diversifi, on pouvait proposer plus de destinations, on a pu reporter sur dautres destinations . Plongial, quant elle, estime que lentre-prise est mieux parvenue rorienter les clients vers dautres sites de plonge lors de lvnement suivant (grippe aviaire, 2005) en raison de la diffrenciation de son offre.Ainsi, pour les quatre voyagistes, les changements stratgiques et or-ganisationnels mis en place aprs la crise ont rduit limpact et amlio-r la rsorption de la nouvelle turbulence (voir tableau 3). Ces rpon-ses efficaces sont conformes aux recommandations de la littrature en stratgie qui consistent diversifier les zones gographiques pour rduire limpact global dune zone risque (Lozato-Giotart et Balfet, 2007) et permettre de redployer les forces de lorganisation en fonc-tion de la conjoncture (Lengnick-Hall et Beck, 2005 ; Sheffi, 2007). La flexibilit de la structure est galement une recommandation stra-tgique pour sadapter aux variations (Grabowski et Roberts, 1999). Les changements stratgiques et organisationnels des cas tudis montrent ainsi lexistence dun apprentissage post-crise efficace qui augmente la rsilience.
Lamlioration de la rsorption du choc grce la rac-tivation des rponses oprationnellesLaccroissement de la rsilience est galement d lapprentissage effectu au niveau des rponses oprationnelles destines rsorber le choc. Les cas tudis montrent un apprentissage de renforcement positif qui consiste ractiver plus rapidement des solutions positives dveloppes durant la gestion de crise prcdente. Au moment du tsunami, on a ractiv la procdure du transfert des conseillers voya-geurs, on a t beaucoup plus rapide La formation a t plus rapide au cours du tsunami parce quon savait que, on lavait vu pendant le 11 septembre, quon tait dans une situation qui serait relativement lon-gue. Il a fallu ragir tout de suite, former les gens assez rapidement... On sest appuy sur leurs connaissances personnelles, par exemple untel qui tait parti au Mexique pour ses vacances, on sest appuy sur ses connaissances pour le former sur le Mexique , indique notre interlocutrice de Monde Exotic.La plus grande efficacit des rponses oprationnelles, ajoute une moins grande vulnrabilit due aux changements stratgiques, impli-
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
285
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
que une rduction des rponses ncessaires pour absorber le choc. Ainsi, Monde Exotic na pas eu besoin de recourir aux licenciements, mesure que lentreprise essaie dviter. Aprs le tsunami, on a pu conserver tous les emplois de lentreprise grce justement aux change-ments quon a faits. Le fait de rquilibrer les destinations, eh bien, a a permis de rduire les pertes au niveau des rsultats du dpartement Asie. [...] Aprs on a eu un sureffectif moins important car les gens fonctionnaient en binmes. Mais cest surtout les reports [vers dautres destinations] qui nous ont permis de rcuprer du chiffre daffaires. La ractivation de la plupart des procdures de rsorption du choc d-veloppes durant la crise est galement prsente dans les autres cas (voir tableau 3). Ces procdures dj exprimentes par lorganisation sont plus efficaces dans la mesure o elles sont prises plus rapidement, ce qui contribue augmenter la rsilience (Weick et Sutcliffe, 2001).Cette ractivation des anciennes rponses nempche pas le dvelop-pement de nouvelles rponses aux nouveaux problmes perus. Ainsi, Monde Exotic a dvelopp lors du tsunami une procdure de localisa-tion de ses clients dont elle navait pas peru limportance durant les attentats du 11 septembre. Aprs [...] le 11 septembre, [...] il a fallu quon vrifie si personne ntait touch parmi nos clients. Mais a, a nous a pris une demi-journe, [...] donc on ne sen est pas rellement rendu compte. a a t beaucoup plus compliqu avec le tsunami [...] et effectivement la suite du tsunami on a vraiment commenc tra-vailler avec le Quai DOrsay, une procdure commune pour pouvoir dans des zones justement qui ntaient pas des pays dvelopps, enfin pas aussi dvelopps que New York en termes dinfrastructures, de moyens de communication, etc., pour pouvoir recenser trs, trs vite nos voyageurs o ils sont, dans quel tat ils sont et les rapatrier.
De nouveaux apprentissages post-crise mais sans changement stratgiqueLes cas tudis montrent une absence dadaptation stratgique et de faibles ajustements organisationnels suite la deuxime turbulence. Ainsi, relance sur de nouveaux changements stratgiques, notre in-terlocutrice de Monde Exotic rpond : On na pas fait de changements ou de choses comme a. En revanche, on a mis en place un systme de prquation de prime sur rsultat... En cas de crise internationale majeure ou catastrophe naturelle affectant une destination, on a mis en place un systme de solidarit interne qui fait que les autres destina-tions qui [...] ont justement augment par le dport de clients de la zone tsunami vers dautres zones vont contribuer au rsultat de la zone Asie touche par la catastrophe. De mme, les trois autres entreprises nont pas engag de change-ments stratgiques suite la nouvelle turbulence. Ces analyses confir-ment lopportunit de la prise de conscience de problmes et de chan-gement que constitue la crise (Morin, 1984 ; Roux-Dufort, 2004) et suggre quen labsence de perception de difficults les changements stratgiques et organisationnels sont moins probables.
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
286
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
DISCUSSION
Lensemble des analyses est rsum dans la figure 1 qui dploie le modle de Meyer (1982) partir de limpact dune premire turbulence dans lorganisation jusqu la phase de rajustement suite une se-conde turbulence. Ce modle est plus spcifique que celui de Meyer (1982) tant donn que la premire turbulence a un impact fort inter-prt comme une situation de crise par lorganisation. Surtout, contrai-rement au modle de Meyer (1982) dont lobjectif est de montrer leffet des antcdents organisationnels au cours du processus dadaptation, notre modle vise montrer comment la gestion de crise affecte lim-pact et la gestion de la turbulence suivante, notamment via le chan-gement des antcdents stratgiques (flches vers le haut figure 1). Partant des quatre antcdents organisationnels (stratgie, structure, idologie et slack) et des trois phases du processus dadaptation (anti-cipation, rponse, rajustement) de Meyer (1982), notre modle dcrit deux modes dapprentissage qui tous deux augmentent la rsilience de lorganisation aux crises issues dune turbulence de lenvironnement.
Figure 1. Consquences de la gestion dune crise issue de lenviron-nement sur limpact et la gestion de la turbulence suivante
Lgende :mode dapprentissage : 1 simple boucle renforcement positif, 2 double bouclea : priode dapprentissage, b et c : utilisation des apprentissages, a nouvelle priode dapprentissage+/ : effet des apprentissages de la turbulence 1 sur gestion de la turbulence suivante
Le premier mode dapprentissage est un apprentissage de renforce-ment positif en simple boucle (Argyris et Schn, 1978 ; Roux-Dufort, 2004) o les rponses oprationnelles ayant donn satisfaction sont stockes dans le rpertoire dactions de la structure (1a). Ces rponses (voir tableau 2, rponses oprationnelles) sont ensuite partiellement ractives lors de la seconde turbulence (voir tableau 3, rponses uti-lises lors de la turbulence 1) pour rsorber limpact (1b) avec une plus grande rapidit et une plus grande efficacit due lexprience. En amliorant ainsi les rponses, lapprentissage de renforcement positif
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
287
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
participe la rduction des rponses oprationnelles utilises pour ab-sorber le choc () et laccroissement de la rsilience (+).Le second mode dapprentissage est un apprentissage double boucle o lorganisation modifie sa stratgie et sa structure (2a) dans lobjec-tif daugmenter sa rsilience (voir tableau 2, apprentissage post-crise, et tableau 3, antcdents en italique). Les modifications stratgiques, notamment la diversification des activits, affectent la rsilience de lor-ganisation en rduisant sa vulnrabilit, en plus de faciliter la rsorp-tion de limpact. En effet, les changements stratgiques et organisa-tionnels agissent dabord au niveau de limpact (2b) qui est rduit (). Par exemple, les diversifications entrainent une rduction mcanique de limpact dune perturbation locale (de 10 % 50 % du CA dans les entreprises tudies, voir tableau 3, effet des diversifications sur limpact). Les changements affectent galement les rponses (2c) en augmentant le rpertoire de rponses oprationnelles (par exemple la possibilit de raffecter des passagers vers dautres destinations, voir tableau 3, nouvelles rponses) ou en facilitant leur mise en uvre (par exemple en rduisant les transferts de personnels en raison de leur double comptence). Les deux modes dapprentissage post-crise, simple boucle et double boucle, permettent chacun daugmenter la rsilience de lorganisation. Les modifications stratgiques et structurelles permettent de rduire limpact de la nouvelle turbulence (). La rduction de limpact, conju-gue des rponses oprationnelles plus adaptes et plus efficaces dues aux deux modes dapprentissage, rduit lintensit des rponses ncessaires pour rsorber le choc () tout en augmentant la rsilience (+). Enfin, un plus faible impact () et une plus forte rsilience aux tur-bulences (+) rduisent le dveloppement de nouveaux apprentissages post-turbulence ().Ces rsultats confirment les travaux qui considrent la crise comme une source essentielle dapprentissage et de changements organi-sationnels (Meyer, 1982 ; Morin, 1994 ; Roux-Dufort, 2004 ; Ursacki-Bryant et al., 2008). Inversement, un faible impact et une rsorption ra-pide de celui-ci sont moins favorables de nouveaux apprentissages, notamment stratgiques, parce quils ne sont pas ncessaires ou pas perus comme tels. Notre tude ajoute que les entreprises rsilientes une crise sont capables dapprendre efficacement de la crise et de sa gestion pour augmenter leur rsilience des turbulences ultrieures. Lapprentissage apparat ainsi comme un lment fondamental de la construction de la rsilience (Hollnagel, 2006). Au travers de lappren-tissage, notamment double boucle, les organisations font preuve dan-ticipation. Ces anticipations et les apprentissages quelles induisent permettent aux organisations non seulement de ractiver des solutions prouves mais aussi de faciliter limprovisation de nouvelles solutions grce lextension des ressources disponibles. Ainsi, lanticipation, loin de sopposer la rsilience dans sa dimension ractive (Marcus et Nichols, 1999), peut participer son amlioration en tendant les pos-sibilits dimprovisation de nouvelles solutions ex-post et en facilitant leur mise en uvre.
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
288
Renforcement de la rsilience par un apprentissage post-crise : une tude longitudinale sur deux priodes de turbulence
M@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions
de la performance organisationnelle
CONCLUSION
Alors que la rsilience a fait lobjet de nombreux travaux convergents en gestion de crise et de turbulence, la possibilit dun apprentissage post-crise est plus controverse dans la littrature en raison de nom-breux freins lapprentissage dus prcisment la crise (Lagadec, 1996 ; Bourrier, 2002 ; Elliott et Smith, 1993, 1997, 2006 ; Roux-Dufort, 2000) auxquels sajoute une inefficacit de cet apprentissage (Farjoun et Starbuck, 2005). Notre tude auprs des voyagistes, qui porte sur deux priodes de turbulence successives, complte les recherches prcdentes en montrant comment des entreprises rsilientes ont ac-cru leur rsilience principalement par un apprentissage post-crise in-cluant des changements stratgiques. Cette tude apporte une contribution empirique la littrature sur la gestion de crise et ladaptation aux turbulences par lextension des analyses deux turbulences successives. Cette extension empirique a permis de tester lefficacit de lapprentissage. Celle-ci tait jusqualors suppose thoriquement dans la littrature sous forme dune boucle de rtroaction de la phase dapprentissage post-crise la phase de prvention ou danticipation dans le cycle de gestion des crises ou des turbulences (Meyer, 1982 ; Pauchant, 1988), la seule tude notre connaissance sur lefficacit de lapprentissage post-crise expliquant son inefficacit (Farjoun et Starbuck, 2005). Notre tude contribue galement la littrature sur la gestion de crise par la nature de lapprentissage post-crise mise en vidence : le chan-gement stratgique, notamment la modification du portefeuille dac-tivits et la diffrenciation. Ce nouveau domaine de lapprentissage post-crise vient complter les travaux existants, montrant des appren-tissages au niveau organisationnel dans le cas de crises dorigine in-terne (Elliott et Smith, 1993, 1997, 2006 ; Vaughan, 2005) aussi bien quexterne (Meyer, 1982 ; Roux-Dufort, 2004).Enfin, notre tude indique que la rsilience participe la performance de lorganisation. En absorbant les chocs, la rsilience constitue une capacit ncessaire la survie dans un environnement turbulent. Au-del, notre tude suggre quen rduisant la vulnrabilit et en aug-mentant la capacit dabsorption par lapprentissage, la rsilience contribue plus largement la performance de lorganisation. En effet, la rsilience est souvent perue comme grevant la performance parce quelle requiert un slack organisationnel (quil soit financier, humain ou structurel) qui rduit dautant lefficience. Mais, inversement, ce slack organisationnel est favorable lapprentissage et limprovisation de solutions nouvelles qui constituent des caractristiques du chan-gement continu (Weick et Quinn, 1999) observ dans les entreprises performantes (Hamel et Vlikangas, 2003). Lincidence moyen terme de la rsilience semble donc plus positive dans la mesure o elle per-met potentiellement daugmenter lefficience de lorganisation. tout le moins, il existe des relations complexes entre rsilience et efficience qui mriteraient de plus amples investigations.Notre tude atypique, qui permet denrichir la littrature, prsente des limites. Le fait davoir tudi deux turbulences successives, qui est un
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 18h13. AIMS
-
289
Gulsun Altintas, Isabelle RoyerM@n@gement vol. 12 no. 4, 2009, 266-293Special Issue: Fiabilit et rsilience comme dimensions de la performance organisationnelle
lment indispensable pour observer lefficacit de lapprentissage, in-troduit un biais de slection. Nous navons ainsi pu retenir que des entreprises rsilientes dans la mesure o elles ont toutes survcu une crise. Bien que le fait davoir survcu nimplique pas ncessai-rement davoir appris, il le rend plus probable. Lapprentissage dans les entreprises tudies a de plus t efficace dans la mesure o les changements stratgiques ont permis daccrotre durablement leur r-silience. Mme au-del de la priode tudie, aucune dentre elles na connu de nouvelle crise, bien que plusieurs aient rencontr dautres turbulences. Elles lexpliquent par leur apprentissage, comme lindique notre interlocuteur chez Agora : Ce nest pas le 11 septembre qui nous a affects le plus, vu quon tait dj habitu... on avait appris des vnements prcdents. Cet apprentissage russi ne prjuge toutefois pas de loccurrence dune nouvelle crise, mme sil laisse sup-poser que lorganisation montrera davantage de capacits de rsorp-tion que dautres. En effet, lapprentissage des entreprises tudies a augment leur rsilience envers des turbulences de lenvironnement relativement similaires et ne prjuge pas de leur capacit surmonter des turbulences de nature trs diffrente ou des accidents dorigine interne, affectant leur systme dinformation par exemple. Par ailleurs, au cours du temps, de nouveaux changements organisationnels moti-vs par de nouvelles priorits stratgiques peuvent rduire la rsilience de lorganisation (Farjoun et Starbuck, 2005). Nanmoins, la capacit mobiliser les ressources quelles ont montre pour improviser des rponses une crise et laccroissement de la varit des ressources disponibles suggrent que ces entreprises seraient capables de sur-monter une nouvelle crise. Ensuite, le secteur dactivit et lorigine de la crise, qui contribuent loriginalit de la nature de lapprentissage, limitent la transfrabilit des rsultats des contextes similaires, cest--dire des crises issues de turbulences dans des secteurs qui en sont frquemment affects. Nos analyses du contexte suggrent que la relative facilit dapprentis-sage post-crise et la nature de lapprentissage sont contingentes ces deux particularits. En effet, les crises tudies tant dorigine externe lorganisation, lapprentissage ne connat pas les freins dus aux rac-tions dfensives issues de la responsabilit potentielle de lorganisation concernant lorigine de la crise (Bourrier, 2002). Par ailleurs, lorigine externe de la crise explique en partie la nature de lapprentissage post-crise qui ne peut consister empcher lincident dclencheur mais seulement attnuer son impact en modifiant sa position dans lenvi-ronnement. La stratgie de diversification, mise en uvre par la plupart des entreprises tudies, constitue une solution classique de gestion du risque capable de rduire lincidence des turbulences de lenviron-nement par un simple effet mcanique sur la part que reprsente lac-tivit affecte (Hoskisson et Hitt, 1990). Enfin, le fait que les quatre cas tudis appartiennent un secteur turbulent, rgulirement perturb par des incidents, accidents ou catastrophes, rduit le frein lappren-tissage relatif au caractre exceptionnel peru de la situation de crise (Pearson et Mitroff, 1993 ; Bourrier, 2002).Ces environnements turbulents susceptibles de gnrer des crises
Doc
umen
t tl
cha
rg
depu
is ww
w.ca
irn.in
fo -
CERI
ST -
- 193
.194
.76.
5 - 2
4/04
/201
5 18
h13.
A
IMS
Docum
ent tlcharg depuis www.cairn.info - CERIST - - 193.194.76.5 - 24/04/2015 1
Related Documents