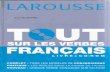LES TRANSCENDENTAUX TOUT COURT Nous voyons évoqués « les transcendentaux tout court » 1 dans un article intitulé « Medieval Theories of Transcendentals » 2 . L’évocation en français dans le texte et le titre de l’article indiquent bien les deux pôles entre lesquels oscille aujourd’hui une compréhension correcte des transcendentaux 3 : d’une part une enquête historique (par exemple sur ce qui se pensait au Moyen Age) traitant des théories sur le sujet (comme celle de l’Aquinate), d’autre part une investigation intempestive des transcendentaux tout court. C’est une telle investigation que nous voudrions esquisser ici, sous un angle directement philosophique, sans pour autant ignorer la généalogie du sujet. 1. L’inventaire des transcendentaux avant la lettre par Platon Dans le Théétète de Platon, Socrate ayant déclaré à Théétète qu’« aucune notion, plus que celle d’être, n’est pour toutes choses un accompagnement », l’échange se poursuit ainsi : THEETETE : Je la mets parmi les représentations que l’âme aspire par elle-même à obtenir. – SOCRATE : Et en fais-tu autant pour le semblable et le dissemblable, pour l’identique et le différent ? – THEETETE : Oui. – SOCRATE : Est-ce tout ? le beau et le laid aussi ? le bien et le mal ? – THEETETE : De ces notions, l’existence est à mon avis, celle qui au plus haut point comporte la considération de rapports mutuels, puisque c’est en elle- même que l’âme fait sur le passé et le présent des supputations qui se rapportent à l’avenir. Un peu plus loin l’inventaire se conclut : SOCRATE : Mais est il possible d’atteindre la vérité par ce qui n’atteint même pas l’existence ? – THEETETE : Impossible. 4 1 Avec « tout court » en français dans le texte. 2 Wouter Goris & Jan Aersten, « Medieval Theories of Transcendentals », Stanford Encyclopedia of Philosophy, Première publication le 4 avril 2013 (en bref MTT). 3 Orthographe retenue et justifiée par le Vocabulaire technique et critique de la Philosophie dirigé par André Lalande (PUF). 4 Théétète, 186 a-c.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LES TRANSCENDENTAUX TOUT COURT
Nous voyons évoqués « les transcendentaux tout court »1 dansun article intitulé « Medieval Theories of Transcendentals »2.L’évocation en français dans le texte et le titre de l’articleindiquent bien les deux pôles entre lesquels oscilleaujourd’hui une compréhension correcte des transcendentaux3 :d’une part une enquête historique (par exemple sur ce qui sepensait au Moyen Age) traitant des théories sur le sujet (commecelle de l’Aquinate), d’autre part une investigation intempestivedes transcendentaux tout court. C’est une telle investigation quenous voudrions esquisser ici, sous un angle directementphilosophique, sans pour autant ignorer la généalogie du sujet.
1. L’inventaire des transcendentaux avant la lettre par Platon Dans le Théétète de Platon, Socrate ayant déclaré à Théétètequ’« aucune notion, plus que celle d’être, n’est pour touteschoses un accompagnement », l’échange se poursuit ainsi :
THEETETE : Je la mets parmi les représentations que l’âmeaspire par elle-même à obtenir. – SOCRATE : Et en fais-tuautant pour le semblable et le dissemblable, pourl’identique et le différent ? – THEETETE : Oui. – SOCRATE :Est-ce tout ? le beau et le laid aussi ? le bien et lemal ? – THEETETE : De ces notions, l’existence est à monavis, celle qui au plus haut point comporte laconsidération de rapports mutuels, puisque c’est en elle-même que l’âme fait sur le passé et le présent dessupputations qui se rapportent à l’avenir.
Un peu plus loin l’inventaire se conclut :
SOCRATE : Mais est il possible d’atteindre la vérité parce qui n’atteint même pas l’existence ? – THEETETE :Impossible.4
1 Avec « tout court » en français dans le texte.2 Wouter Goris & Jan Aersten, « Medieval Theories of Transcendentals »,Stanford Encyclopedia of Philosophy, Première publication le 4 avril 2013 (en brefMTT).3 Orthographe retenue et justifiée par le Vocabulaire technique et critique de laPhilosophie dirigé par André Lalande (PUF).4 Théétète, 186 a-c.
Nous trouvons d’abord ici, avant la lettre, la première listedes termes transcendentaux : l’Être, le Temps, le Même ou l’Un(« le semblable » ou « l’identique »), le Vrai, le Bien et leBeau. Ce sont les transcendentaux tout court dans leur inventaire leplus originaire. Mais Platon ne se contente pas d’une telle « définition enextension » de ces termes (par simple énumération). Platonpropose même deux définitions proprement dites, définitions encompréhension ou intension, du concept. Nous laisserons de côtéla définition par le rapport à la pensée (« les représentationsque l’âme aspire par elle-même à obtenir ») qui a le défautd’être subjective. Nous ne nous intéresserons qu’à ladéfinition objective, par le rapport logique aux autresconcepts : l’inventaire ci-dessus est selon Platon celui desnotions qui sont pour toutes choses un accompagnement. Déjà, donc, lestermes énumérés sont conçus comme transcendant les frontières quipeuvent empêcher une notion d’accompagner toutes choses. Mêmesi le mot « transcendentaux » manque, il a trouvé un conceptqui l’apppelle et le fonde à l’avance. Pour obtenir dans la langue de la scolastique une liste destranscendentaux comparable à celle de Platon, il nous fauteffectuer la somme logique de la liste dressée par saint Thomasd’Aquin, énumérant « ens, unum, verum et bonum »5 et d’un termeajouté par saint Bonaventure : pulchrum. Nous obtiendrons ainsila Liste scolastique : l’Être, l’Un, le Vrai, le Bien et le Beau(Ens ou Esse, Unum, Verum, Bonum et Pulchrum). Nousl’appellerons aussi constellation transcendentale. Il faut remarquer d’ailleurs que le mot transcendentalis (aupluriel transcendentalia) n’a été introduit qu’aux XVe et XVIesiècles6. L’Aquinate, comme les autres scolastiques avantl’invention de ce néologisme, désignait les transcendentaux parle mot transcendentia (pluriel de transcendens). Les caractérisercomme les notions qui sont pour toutes choses un accompagnement ainsi quele faisait Platon était ainsi une manière au moins aussiappropriée de les réunir que le mot transcendentia et avait mêmesur ce vocable l’avantage d’éviter l’amphibologie avec« transcendant ». L’absence du mot « transcendental » chezPlaton n’est donc pas davantage une raison de lui dénier la
5 De Veritate, Articulus primus, Sed contra, § 5. Quelque part entre ens et unum estajouté aliquid (Responsio, l. 145-150).6 MTT, p. 2.
connaisance du concept correspondant qu’elle ne l’est chezThomas d’Aquin. Et la conclusion est inévitable : la découverte destranscendentaux est due à Platon, même si la liste scolastique destranscendentaux fournit sans doute le meilleur point de départen extension pour dégager l’intension exacte du concept. Mais plus important que ce point généalogique, il y a le faitque les transcendentaux donnent à la philosophie ses objets.D’où la définition de la philosophie7 que nous avons publiée en1999 : La philosophie est la science des transcendentaux. Ce rapportconceptuel entre transcendentaux et philosophie déterminel’enjeu du sujet. Il peut d’ailleurs être aisément vérifié. Dans uneencyclopédie de Philosophie bien faite on trouvera en effet uneMétaphysique, une Logique, une Ethique et une Esthétique. Dedeux choses l’une alors. Ou bien ces disciplines sontdistinguées sans raison, ou bien leur distinction trouve saraison dans leurs objets respectifs. Or l’Être et l’Un, leVrai, le Bien et le Beau se trouvent être ces objets. Donc ladivision de la philosophie par la tradition est fondée en raisonpar la définition de la philosophie comme science destranscendentaux. L’élément de la philosophie n’est donc pas le général (commele croyaient Comte et Quine). L’élément de la philosophie est leTranscendental (puisque la plus grande généralité qualifieseulement, au mieux, la métaphysique).
2. La définition des transcendentaux Etant donné la constellation transcendentale, quelledéfinition permet de comprendre la réunion de ses termes ? Ladirection de recherche est sans doute indiquée par l’adageTranscendentalia omnia genera transcendunt. Mais une indication plusprécise est donnée par terme « transcatégorial »8 qui seraitsans doute le plus approprié pour désigner les transcendentaux. C’est en effet l’emboîtement aristotélicien des espèces,genres et Catégories qui va fournir le cadre général rendantpossible la définition des transcendentaux. L’emboîtement desespèces dans des Genres de plusen plus vastes ne peut sepoursuivre indéfiniment. Il faut s’arrêter à des Genressuprêmes de l’Être qu’Aristote appelle Catégories. 7 J.Cl. Dumoncel, « Comment s’orienter dans la métaphysique ? » in RenéeBouveresse (éd.), La Métaphysique, Ellipses, Paris, 1999, pp. 67-84 : §« Qu’est-ce que s’orienter en philosophie ? », pp. 67-68.8 Ibid.
Par exemple Socrate appartient à l’espèce humaine inclusedans le genre animal qui est inclus dans la catégorie desIndividus ou « substances ». Le bleu de céruléum appartient àl’espèce des bleus incluse dans le genre des couleurs qui estinclus dans la catégorie de Qualité. Le nombre des pointscardinaux appartient à l’espèce des entiers naturels inclusedans le genre des nombres nombrés qui est inclus dans lacatégorie de Quantité. Le siècle de Périclès appartient àl’espèce des siècles qui est inclus dans le genre des époques,lui-même inclus dans la catégorie de Temps. Paris appartient àl’espèce des capitales incluse dans le genre des villes qui estinclus dans la catégorie de Lieu. L’amitié de Montaigne et LaBoétie appartient à l’espèce des amitiés incluse dans le genredes rapports humains qui est inclus dans la catégorie deRelation. Etc. Tous les êtres sont ainsi répartis entredifférents Genres suprêmes de l’Être ou catégories telles queSubstance, Qualité, Quantité, Temps, Lieu, Relation, etc. Cet emboîtement de classes, d’espèces et de genres, jusqu’auxCatégories, constitue ce qu’il faut appeler le règne de laGénéralité, allant du moins général au plus général, et qui estaussi une distribution de l’Être en ses différentes catégorieshétérogènes. Mais outre les espèces, les genres et les catégorie de l’Êtrequi balisent le règne de la généralité, il existe encored’autres concepts. Ce sont les transcendentaux, ainsi nommésparce qu’ils transgressent les frontières entre catégories. C’est cequ’encapsule correctement le mot « transcatégorial »9. Untranscendental est un transcatégorial. Mais que signifie exactement« transcatégorial » ? Hic Rhodus, hic saltus. Nous venonsd’atteindre le point de bifurcation entre deux définitionsconcevables des transcendentaux, que nous appellerons ladéfinition « illimitée » d’une part, et d’autre part ladéfinition sémantiquement sélective. D’après la définition illimitée les transcendentalia sont lescommunissima (MTT, p. 3). Selon Jorge J.E. Gracia « X est untranscendental ssi l’extension du terme qui nomme X est plusgrande et inclut les extensions combinées des termes quinomment chacune des différents catégories dans lesquellesl’être peut être divisé »10 Alors que la classe des hommes ne
9 MTT, p. 2.10 Gracia, Jorge J.E. « The Transcendentals in the Middle Ages : AnIntroduction », Topoi 11 (2): pp. 113-120.
peut s’étendre au-delà des la catégorie des individus, ni laclasse des couleurs au-delà de la catégorie de qualité, ni laclasse des époques au-delà de la catégorie de temps, ni laclasse des capitales au-delà de la catégorie de lieu (etc.),les termes transcendentaux s’étendraient sur la totalité descatégories et s’y étendraient universellement, c'est-à-direqu’ils couvriraient totalement chacune des catégories. Cette thèse tient sans doute sa plausibilité au fait qu’elleest vraie de l’Être. Les individus, les qualités, lesquantités, les temps et les lieux sont tous des chosesexistantes et donc des êtres. L’Être couvre ainsi la réunion detoutes les catégories, posant à partir de là le problème desavoir si cette catholicité catégoriale se fait dans l’univocité del’Être, ou dans son analogicité transcendentale, ou encore dansune constellation de significations focales centrées sur lefoyer offert par la catégorie de substance. Nous n’avons pas àdécider ici entre ces théories. Le point et que toutes, parhypothèse, doivent s’arranger avec le fait que l’Être remplittoutes les catégories. Mais en va-t-il de même pour les autrestranscendentaux ? C’est ce qu’il faut maintenant examiner11. Un problème parent est posé par le cas du nombre. Si la tabledes catégories d’Aristote offre bien la base appropriée à ladéfinition des transcendentaux, les nombres y sont rangéspréalablement dans la catégorie de Quantité. Mais si l’Un estun transcendental, n’en est-il pas de même, du Deux, du Trois(etc.) ? De fait nous pouvons dénombrer dans toutes lescatégories, et le mystère de la Trinité dénombre même lespersonnes divines. Mais alors, si notre définition de laphilosophie comme science des transcendentaux est adéquate, laconclusion est inéluctable : les mathématiques sont une branche de laphilosophie (simplement une branche si grande qu’il a fallu ladéposer à côté de l’arbre sous peine de le déséquilibrer).Cette conséquence paradoxale peut se comprendre à partir de laliste due à Platon, où l’Un est celui d’un x qui ne fait qu’unavec un y, c'est-à-dire la même chose que le Même. Car nouspouvons avoir affaire non seulement à un même individu, mais à
11 Selon Duns Scot « il appartient au sens de ‘transcendental’ de n’avoiraucun prédicat au dessus de lui sinon ‘être’ ; cependant, qu’il soit communà beaucoup d’inférieurs est inessentiel » (Ordinatio I, dist. 8, p. 1, q. 3,n. 114) : « Unde de ratione transcendentis est non habere praedicatum supraveniens nisi ens,sed quod ipsum sit commune ad multa inferiora, hoc accidit ». Duns Scot semble donc avoirvu que la définition illimitée des transcendentaux est intenable et s’êtreorienté dans la direction d’une position qui s’en affranchisse.
une même qualité, à une même lieu, à une même relation (etc.) ainsiqu’à un même nombre (dans l’origine du symbole ). Cetteubiquité du Même est sur le même pied que celle du Nombre. Cequi signifie que la branche démesurée déposée au pied del’arbre philosophique est en fait l’édifice logicomathématique dans satotalité. C’est pourquoi toutes les bonnes encyclopédies dephilosophie comportent un cours de Logique, de manière àinclure dans le cursus philosophique la tête du corpslogicomathématique permettant d’y pénétrer plus amplement àmesure des besoins en outils mathématiques. Le caractère formelde la logique formelle, entraine sa compétence transcendentale.La logique formelle est la logique transcendentale (ce qui laisse ouverte laquestion de l’existence d’une « logique transcendantale »). De surcroît, la mathématisation de la logique modale12, enexigeant que la logique-organon issue de Frege et C.I. Lewisreçoive en complément l’Algèbre de la logique issue de Boole etde Peirce, a établi définitivment le double statut de ce parvisphilosophique des mathématiques. Le caractère coalgébrique dela logique modale13, relevant de la théorie des Catégoriesmathématiques en a renforcé les liens avec le reste desmathématiques. Mais l’omniprésence du logicomathématique et celle de l’Être,par elles-mêmes, font voir que cette omniprésence ne sauraitêtre attribuée indifféremment à tous les transcendentaux. Lecas de la vérité demandera une élucidation à part. Mais d’oreset déjà nous pouvons remarquer qu’il est essentiel autranscendental Bien de diviser les choses en bonne choses et enmauvaises. Cela suffit à réfuter la définition illimitée destranscendentaux mais cela demande l’exposition du cadresystématique lui donnant tout son sens. Dans la totalité infinie des faits, trois faits brillent d’unéclat qui les distingue de tous les autres : 1° Il existe quelquechose (plutôt que rien), 2° Non seulement il existe quelquechose mais certaines choses sont des objets (de conscience, depensée, etc.), 3° Non seulement certaines choses sont desobjets (intentionels) mais certaines choses possèdent unevaleur. Dans cet enchaînement onto-intentio-axiologique, chacune des12 Cf. Robert Goldblatt, « Mathematical Modal Logic: A View of ItsEvolution », in M. Gabbay & J. Woods (eds.), Handbook of the History of Logic,Elsevier, 2005.13 Cf. Corina Cîrstea, Alexander Kurz, Dirk Pattinson, Lutz Schröder & YdeVenema, « Modal Logics are Coalgebraic », The Computer Journal, 54, 2011, pp.31-41.
propositions précédées implique celles qui la précèdent maisaucune des propositions suivies n’implique celles qui lasuivent. C’est un enchaînement émergent. Il s’ensuit quel’omniprésence dans toutes les catégories ne saurait appartenirpar essence à des transcendentaux comme le Bien ou le Beau.Donc elle ne peut appartenir non plus au concept detranscendental pris en général. D’après la définition sémantiquement sélective des transcendentauxque nous proposons ici, ce qui est essentiel à tous lestranscendentaux, ce qui les définit en tant que tels, n’est pasde s’étendre en totalité sur toutes les catégories, mais depouvoir être attribués sensément dans toutes les catégories. Lestranscendentaux transcendent les frontières entre toutes lescatégories, non pas nécessairement au niveau de la réalité, oude la vérité dans le langage, mais, en amont, au niveau de lapossibilité, ou du sens dans le langage. C’est sans doute sur le Beau que cette ubiquité sémantiqueest la plus facile à mettre en évidence. Nous pouvons parlerd’une belle fille (dans la catégorie des Individus) mais aussid’une belle ville (dans la catégorie des Lieux), d’une bellematinée, d’une belle journée, d’une belle saison ou d’une belleépoque (dans la catégorie des Temps), d’une belle amitié (dansla catégorie de Relation), d’une belle couleur (dans lacatégorie de Qualité), sans oublier les beaux poèmes et lesbelles mélodies, ainsi que les belles démonstrations (sur leterritoire du transcendental Vrai) ou encore les beaux gestes(sur le territoire du transcendental Bien). Etc. Il n’est pasimpossible que le sens du mot « beau » doive être modulé seloncette variation (comme nous avons vu déjà le sens du mot« être ») mais ce n’est pas ici notre problème. Chacune de cesvariétés du Beau produit dans l’âme un retentissement affectifqui en est caractéristique. Le point est par conséquent que letranscendental Beau déploie le champ d’une Esthétiquegénéralisée qui s’étend à la totalité des catégories de l’Êtreet même à d’autres transcendentaux. Dans l’orbe du Bien, si l’on doit parler en particulier debonnes actions, cela n’épuise nullement le champ designification du terme14. Car on peut parler aussi d’un bon couteauou d’une bonne paire de bottes, et d’une bonne terre, d’un bon repas,d’un bon œil, d’une tête bien faite, d’une bonne compagnie et
14 Cf. G.H. von Wright, The varieties of Goodness, Gifford Lectures, 1958-1960,Routledge & Kegan Paul, 1963.
d’une bonne soirée, d’une bonne éducation, d’une bonne personne, etmême du Bon Dieu. Or les bonnes actions sont surtout requises enréaction à des formes du mal (comme la misère ou la faim). Parconséquent l’assiette naturelle du Bien se trouve plutôt etprioritairement (selon l’ordre des choses) dans les cas où ilqualifie une bonne personne (dans la catégorie des individus,qui retrouve ainsi son rôle de catégorie focale) et ce quis’ensuit : la bonne compagnie, la bonne éducation de lagénération suivante et les bonnes soirées. Or la bonnecompagnie est une disposition, une bonne éducation et une bonnesoirée sont des processus, catégories qui ne figurent pas dansla table d’Aristote, laquelle ne doit donc pas fonctionnercomme un lit de Procuste. Cela nous apprend au contraire que lecaractère transcendental ne se limite pas à transcender lesfrontières entre les cases d’une table des catégories déjàdéfinies mais peut nous révéler un réseau catégorial plus richeque ce qui est déjà traditionnellement répertorié dans ceregistre. Etant donné que les transcendentaux dominent lescatégories elle-mêmes, le fait que, selon l’ordre des raisons, lescatégories nous fournissent la base ontologique à partir delaquelle on s’élève aux transcendentaux dans une dialectiqueascendante faisant fond sur les ressources de l’héritagephilosophique, selon l’ordre des choses, en revanche, ce sont lestranscendentaux qui déploient en dialectique descendante le jeucatégorial sur lequel ils pourront s’étendre.
3. Platon déploie l’espace où Gorgias descend son escalier Considérons la trilogie paradoxale qui suit, que nousappellerons l’escalier de Gorgias :
1° Rien n’existe.2° Même si quelque chose existait, nous n’en saurions rien.3° Même si nous le savions, nous ne pourrions pas le dire.
La confrontation de l’escalier de Gorgias avec notreenchaînement onto-intentio-axiologique ci-dessus nous place dans unealternative sévère. Où bien nous maintenons notre thèse« Quelque chose existe » comme prémisse métaphilosophique dansune élucidation des transcendentaux, mais alors nous devonsexclure de la philosophie le paradoxe de Gorgias. Ou bien nousadmettons que ce paradoxe a bien droit au titre dephilosophème, et alors nous devons, sinon rétracter notre
enchaînement onto-intentio-axiologique, du moins en limiter la portéeà une certaine option théorique, dans une alternative pluslarge qui reste à définir. Evidemment c’est la seconde branchedu dilemme qu’il faut choisir. Dans l’alternative plus large qui vient d’être évoquée, lapremière branche est celle qui admettra notre enchaînement onto-intentio-axiologique et que nous appellerons « branched’émergence ». Il nous reste donc seulement à décrire l’autrebranche, qui sera dite « branche sélective », ce qui se fera enpartant d’une reformulation de l’option opposée. Suivant notre branche d’émergence, nous avons reconnu quel’omniprésence dans toutes les catégories ne saurait appartenirpar essence à des transcendentaux comme le Bien ou le Beau.Mais en revanche cette omniprésence caractérise effectivementdes transcendentaux comme l’Être. En langage platoniciens’inspirant du schéma odysséen des prétendants qui entourentCalypso pendant qu’Ulysse tarde à rentrer au foyer, celasignifie que le Bien et le Beau prétendent seulement occupertoutes les catégories de l’Être, tandis que l’Être, évidemmenty parvient par définition. Suivant la branche sélective définied’après Platon par Deleuze, tous les transcendentaux ne font queprétendre à l’ubiquité dans toutes les catégories de l’Être, ycompris l’Être lui-même. Plus positivement : sur la Ligneverticale dressée par Platon avant l’allégorie de la Caverne15,tous les Transcendentaux de la liste du Théétète, placés à tourde rôle dans le segment supérieur en position d’objet X de ladialectique, sont des enjeux pour autant de prétentions. Uncorollaire en est que si l’être manque sa participation àl’Être, si l’être n’est pas être Vrai, alors il y a place pourl’amorce de Gorgias : « Rien n’existe ». La motivation la plusprofonde animant le platonisme, c'est-à-dire la lutte entre lesprétendants à l’Idée (participations ou simulations), déploiedonc l’espace dialectique où Gorgias descend son escaliersophistique sur l’axe des simulacres.
4. Compulsion de convertibilité ou débat Denys-Damascène ? Au sujet des transcendentaux, le Moyen Âge s’est illustréprincipalement par deux contributions qui sont d’abord trèsinégalement connues et surtout de valeur très inégale, outre
15 Cf. J.L. Austin, « The Line and the Cave in Plato’s Republic » (1930s-1940s), in Philosophical Papers, ed. Urmson & Warnock, Oxford University Press,1979.
leur hétérogénéité de statut théorique, puisqu’il s’agit d’unethèse à prétention de principe ou de loi et d’une querellequasiment oubliée. La thèse est celle qui affirme la convertibilité de tous lestranscendentaux et qui a trouvé son énoncé canonique dansl’adage ens unumque, verum, bonum convertuntur. D’après cetteprétendue loi, donc, tous les transcendentaux seraientconvertibles entre eux. Cette convertibilité a son modèle dansle principe Ens et Unum convertuntur. Si, en effet, comme le ditQuine, il n’y a pas d’entité sans identité, si de surcroît laréciproque est vraie, alors l’Être est convertible avec l’Un ausens de l’identique déjà dégagé par Platon. Mais cetteconversion peut-elle être universalisée ? Peut-elle-même êtreétendue plus loin ? C’est ce qui reste à établir. La querelle tombée dans l’oubli a eu lieu entre le VIe siècleet le VIIIe. C’est ce qu’Etienne Gilson, dans ses Gifford Lectures,désigne comme la « question Damascène-Denys »16. Telle qu’elleest décrite par Gilson, elle tient dans « la contradictionentre le primat du bien affirmé par Danys l’Aréopagite, à lasuite de Platon, et le primat de l’Être affirmé par JeanDamascène » à la suite d’Aristote. Il s’agit donc d’une Querelledes Transcendentaux que nous appellerons aussi le débat Denys-Damascène mais qui est d’abord une gigantomachie Aristote vs.Platon. Elle est en amont de la querelle des universaux, nonseulement du point de vue historique mais d’abord du point devue purement conceptuel, puisque la querelle des universaux estconfinée à l’ontologie formelle alors qu’une querelle destranscendentaux intéresse toute la philosophie. D’elle dépendla détermination de ce qui sera « philosophie première »,c'est-à-dire première partie de la philosophie. A elle estsuspendu le problème du commencement correct en philosophie. Dans la « question Damascène-Denys » nous n’avons pas pourl’instant à décider qui va sortir vainqueur. Le point principalest qu’elle implique de déterminer un ordre naturel entretranscendentaux. Mais s’il y a un ordre naturel entre destranscendentaux, alors cela entraîne que tous lestranscendentaux ne sont pas convertibles. Entre la thèse de laconvertibilité des transcendentaux et la problématique de laphilosophie première illustrée par l’antagonisme entre Platon
16 Etienne Gilson, L’Esprit de la Philosophie médiévale, Gifford Lectures de 1931(Vrin, 1989), p. 53, n. 2 (cf. p. 51, n. 1).
et Aristote reproduit dans le débat entre Denys et Damascène, ilfaut donc choisir. Or la thèse de la convertibilité des transcendentaux a pourcondition nécessaire leur définition illimitée. Si tous lestranscendentaux ne s’étendent pas sur la totalité descatégories, s’il y a la moindre différence quant à ce point,alors c’est est fait de la convertibilité qui est en effet unerelation d’équivalence (relation symétrique, transitive et doncrélexive). Or nous avons vu qu’à ce sujet il y a au moins ladifférence entre l’Être, dont l’omniprésence est effective, etle Bien ou le Beau qui ont conduit à la définitionsémantiquement sélective. Donc il n’y a pas de convertibilité universelleentre les transcendentaux. Tout au contraire la querelle Denys-Damascène conduit à poser le problème général de l’ordreinhérent à la constellation transcendentale, qui passe par laquestion de sa division naturelle. La thèse de la convertibilité apparaît alors pour ce qu’elleest : le produit d’une compulsion de convertibilité. Quant on estparvenu à l’abstraction raréfiée des catégories, lestranscendentaux semblent seulement accomplir un pas de plusdans la généralité. La relation de convertibilité, commerelation d’équivalence produisant mécaniquement une classed’équivalence, ferait des transcendentaux une généralitésupplémentaire. Ainsi la thèse de la convertibilité provientd’une confusion entre le général et le transcendental.Inversement la querelle Denys-Damascène révèle que laconstellation transcendentale est un réseau hétérogène dontl’hétérogénéité reste à explorer dans une division méthodique.
5. L’Arbre des cinq Transcendentaux La summa divisio des transcendentaux est indiquée par ledivision des jugements afférents où nous trouvons le distinguoentre jugements de réalité d’une part, et jugements de valeurd’autre part. Ainsi les transcendentaux se divisent d’abord enRéalités d’une part et Valeurs d’autre part, que nous nommeronsrespectivement transcendentaux métaphysiques et transcendentauxaxiologiques. L’ordre entre Réalités et Valeurs est déterminé différemmentpour la Vérité d’une part et d’autre part pour le Bien et leBeau. La vérité dont il est question ici est la correspondanceà la Réalité. Donc la Réalité vient avant la Vérité à sonpropos. Quant au Bien et au Beau, ce sont des valeurs qui
qualifient ce que Scheler appelle des Choses de valeur. Ces chosesdoivent donc être données d’abord parmi les réalités afin derecevoir une valeur. Les Réalités couvrent deux transcendentaux : l’Être et l’Un.Etant donné que tous les transcendentaux sont définisrelativement aux catégories de l’Être, l’Être est le premier detous les transcendentaux. Les Valeurs transcendentales sont au nombre de trois : leVrai, le Bien et le Beau. En tant que correspondance à la réalité, le Vrai se trouvecoextensif à cette réalité, ce qui lui confère la primautéparmi les valeurs. Enfin, dans le couple formé par le Bien etle Beau, le Bien est évidemment le nécessaire et le Beau est leluxe ou le dessert. Donc le Bien passe avant le Beau qui lesuit. La division et l’ordre des transcendentaux sont donc donnésen totalité dans l’arbre que voici :
Transcendentaux
Réalités Valeurs ÊtreUn Vrai Bien Beau Il s’ensuit que, dans la Philosophie, la philosophie premièreest bien la Métaphysique17, suivie dans l’ordre par la Logique,l’Ethique et l’Esthétique.
6. Le Bien et le Vrai au-delà des transcendentaux Nous devons à Scheler une double observation au sujet de laVérité, dont la seconde est capitale :
La logique ne peut pas être située sur le même plan quel’éthique et l’esthétique… nos énonciations-axiologiques,elles aussi, doivent être « vraies » et peuvent être« fausses », tandis que ce serait pur non-sens qued’exiger d’un jugement théorique qu’il fût « bon » ou« mauvais ».18
17 Incluant la logique modale en tant que métaphysique au sens de Williamson.
Scheler fait ici une « remarque grammaticale » (au sens deWittgenstein) tout à fait capitale. C’est qu’il y a vérité nonseulement au sujet des triangles, des trous noirs, des ratons-laveurs et du sexe des anges, dans l’Être ou le Néant, maisaussi vérité au sujet du Bien ou au sujet du Beau, et même au sujet de laVérité même. La Vérité n’est donc pas un transcendental commeles autres car le Vrai transcende les frontières entre les transcendentaux eux-mêmes. Inversement le vrai, le bien et le beau, voire même l’êtrelui aussi, sont, par opposition au groupe néant-faux-mauvais-laid,des formes du Bien en un sens axiologique universel, dont le senséthique n’est plus qu’un cas particulier, ambiguïté que Schelerévite à juste titre en parlant plutôt de valeurs positives ounégatives. En ce sens il y a effectivement une sorte deconvertibilité du Bien avec tous les transcendentaux. Et c’estle Bien qui se qualifie comme Transcendental desTranscendentaux, d’une manière qui ne se trouve pas même dansl’Être. Nous condenserons et distinguerons ces deux points en disantque le Vrai se qualifie comme ultratranscendental et le Bien commetranstranscendental.
7. L’Être & de la Vérité dans l’Algèbre de Boole Dans l’Algèbre de Boole, on sait que le couple 0, 1 a deuxinterprétations possibles, que nous noterons 0, 1 et 0, 1.Si l’Algèbre de Boole est interprétée comme calcul des classes,1 et 0 y signifient respectivement Tout et Rien, autrement ditl’Être et le Néant. Si elle est interprétée comme calcul despropositions, 1 et 0 y désignent le Vrai et le Faux. A partir delà, pour comprendre ce que Boole a découvert sur ces deuxtranscendentaux, nous devons distinguer deux sortes de« convertibilité » : la convertibilité formelle et la convertibilitéconceptuelle. Boole a vu, d’abord, que les opérations et d’intersection et d’union de classes portant sur 1 et 0 enAlgèbre de la Logique se répercutent comme suit en opérations et de conjonction et disjonction portant sur despropositions évaluées par 1 et 0 :
18 Max Scheler, Le formalisme en éthique et l’Ethique matériale des valeurs. Essai nouveau pourfonder un personnalisme éthique [1916], traduction Maurice de Gandillac, NRF 1955,pp. [191-192] de l’édition allemande.
L’Être Le VraiA B A
B1 1 10 1 01 0 00 0 0
p q p q
1 1 10 1 01 0 00 0 0
L’Être Le VraiA B A
B1 1 10 1 11 0 10 0 0
p q p q
1 1 10 1 11 0 10 0 0
En outre la formule algébrique A B donnera la tabled’une opération A B sur des classes qui sera répercutée en p q dans le calcul des propositions, où elle équivaut à laformule (p q) :
Les tables garnies de 0 et de1 sont connues comme Tables deVérité. Les tables garnies de 0 et de1 doivent être d’abord dites desTables de l’Être. Entre les Tables de l’Être et les tables de Vérité il sembley avoir seulement une « différence notationnelle ». Ce qui nousconduit à revenir sur la thèse de « convertibilité » entre lestranscendentaux Être et Vérité. Que pourrait bien signifierleur convertibilité ? Trois acceptions peuvent lui être données, de valeur trèsinégale :(i) Si cela signifie que les termes « être » et « vrai »
s’appliquent aux mêmes choses, la thèse est évidemment
A B ( A B )
A B
1 1 1 1 0 0 1
1
0 1 1 0 0 0 1
1
1 0 0 1 1 1 0
0
0 0 1 0 0 1 0
1p q ( p
q)p
q1 1 1 1 0
0 11
0 1 1 0 0 0 1
1
1 0 0 1 1 1 0
0
0 0 1 0 0 1 0
1
fausse : le mot « être » s’applique à tout ce qui est, maisle prédicat « vrai », au sens qui nous intéresse ici,s’applique seulement à quelque chose comme despropositions, des pensées ou des phrases ;
(ii) De même que le mot « être » s’applique à tout ce qui est, il y ades vérités sur tout ce qui est, mais cette fois-ci, c’est le Vraiqui se trouve en excédent sur l’Être, puisqu’il y aaussi, de surcroît, des vérités sur le Vrai, le Bien etle Beau ;
(iii) La convertibilité de l’Être et du Vrai se trouve dansle parallélisme entre les deux interprétations du 0 et du1 par Boole.
C’est bien cette troisième acception qui nous semble seule àretenir. L’isomorphisme ou parallélisme structural entre lesTables de l’Être et les Tables de Vérité dans l’Algèbre deBoole établit effectivement une convertibilité formelle entre lestranscendentaux Être et Vérité. La convertibilité formelle de l’Être et duVrai affirmée par la Scolastique n’a été démontrée que par Boole. Mais il faut préciser qu’il ne s’agit que d’une convertibilitéformelle. Et en tant que telle cette convertibilité formellenous cache encore le principal., à savoir une différence essentielleet capitale entre les deux types de tables et les conceptsrespectifs qu’elles exposent. Dans les tables de vérité la colonne de droite, celle quidéfinit la fonction de vérité considérée, n’est fondée enraison que si l’on donne au 1 et au 0, respectivement, le sensde Vrai et Faux. C’est seulement cette interprétation qui permetde décider, par exemple, que c’est uniquement dans le cas oùles deux propositions des colonnes de gauche son vraies que leurconjonction à droite est vraie. Inversement, le sens mathématique(arithmétique ou algébrique) des symboles 1 et au 0, réduits àdes conventions d’écriture, ne joue aucun rôle dans laconstruction de la table. La logique des fonctions de vérité,par ailleurs, a son origine dans l’école mégaro-stoïcienne. Ladéfinition de l’opération « si … alors … », en particulier, oùréside sa seule difficulté, y remonte à l’interprétation del’« implication » due à Philon de Mégare. Il en va tout autrement des tables de l’Être. Pour qu’ellessoient en tant que telles fondées en raison, il faut cettefois-ci que 1 et 0 y prennent respectivement le sens de Tout etRien. Mais, de surcroît, 1 et 0 sont aussi dotés ici d’un sens
numérique leur conférant un rôle algébrique. C’est ce que stipuleBoole19 comme suit dans le symbolisme usuel :
0 vérifie la loi
0 y 0
et
1 vérifie la loi
1 y y
Ce qui révèle algébriquement que, dans le produit logique, leNéant est élément absorbant et l’Être élément neutre. C’est le débutd’une mathématisation de l’ontologie. Objectivement, Boole commence ici, par le côtéMultiplication, la percée d’un tunnel dont Leibniz avait déjàcommencé la percée côté Addition. Nous lisons en effet chezLeibniz20 :
Il est sans importance que rien soit posé ou ne le soitpas, autrement dit : A rien A.
C’est la loi leibnizienne de Neutralité du Néant dans l’additionalgébrique. Le fait que, dans les Tables de Multiplication et d’Additionde l’Être ou du Néant, 0 est 1 possèdent non seulement le sensde classe vide ou universelle mais aussi les rôles algébriquesde l’élément neutre ou absorbant sera dit la double inscription deLeibniz-Boole. Cette double inscription sur l’Être a deux échos parmi lesfonctions de vérité. Le premier de ces échos est constitué par les cas limites dela tautologie T et de la contradiction où la table de vériténe comporte respectivement que des 1 ou que des 0. Mais ils’agit donc de la vérité formelle ou de la fausseté formelle, nonde la Vérité ou de la Fausseté simpliciter.19 Les Lois de la Pensée, 1854, trad. Souleymane Bachir Diagne, Vrin, 1992,chapitre 3, Proposition II, pp. 63-64.20 Op. & frgst Couturat p ; 267 : « Nihil sive ponatur sive non, nihil refert. seu A Nih.A. » ; trad. in Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités, PUF, p. 436,n. 42.
Le second écho porte bien sur la Vérité tout court, puisquec’est le double écho des paradoxes de l’implication matérielle ouphilonienne : « le Faux implique tout », et « le Vrai estimpliqué par tout ». Le « tout » est bien ici une écho du« Tout » de Boole mais seulement un écho, puisqu’il signifieseulement « toutes les propositions » comme sujets desprédicats « vrai » ou « faux ». Comme la double inscription de Leibniz-Boole qui caractérisel’Être n’a pas son équivalent pour la Vérité, il s’ensuit quel’Être et la Vérité, bien que formellement convertibles, ne sontpas conceptuellement convertibles.
Donc l’Être et le Vrai ne sont pas boole-convertibles
L’Être possède une affinité
donc l’Être vient algébriqement avant la Vérité.
8. L’investigation des transcendentaux d’après Wittgenstein De retour à Cambridge Wittgenstein a prononcé une conférenceinaugurale présentant l’enseignement qu’il allait commencer21.Le point de départ en est la définition de l’éthique par G.E.Moore : « L’éthique est l’investigation générale de ce qui estbien ». A partir de là, Wittgenstein déclare qu’il va« utiliser ce terme dans un sens un peu plus large », incluant« la partie essentielle de ce qu’on appelle communémentesthétique ». Il parvient ainsi à envisager « l’investigationde ce qui a une valeur » ou « l’investigation du sens de lavie ». Ce qui va le conduire à ce qu’il caractérise comme son« expérience par excellence22 ». A savoir celle qu’il décrit commesuit :
lorsque je fais cette expérience, je m’étonne de l’existence dumonde.
Le second Wittgenstein vient de retrouver ainsi quatreaphorismes capitaux de son Tractatus logico-philosophicus :
21 Leçons et conversations suivies de la Conférence sur l’Ethique, NRF, 1971, pp. 141-175.22 En français dans le texte.
5.552. L’« expérience » dont nous avons besoin pourcomprendre la logique n’est pas qu’il y ait tel ou telétat de choses mais que quelque chose est : cependant cen’est pas là une expérience. La logique est antérieure à toute expérience – que quelquechose est ainsi. Elle est antérieure au Comment, non au Quoi.
6.44. Ce n’est pas comment est le monde qui est leMystique, mais qu’il soit.
6.13. La logique est transcendentale.
6.421. L’éthique est transcendentale. (Ethique etesthétique sont une seule et même chose.)
Dans la conférence inaugurale de Wittgenstein, un seultranscendental manque à l’appel : c’est la vérité. Mais enrevanche nous y lisons que c’est « un non-sens de dire » telleou telle chose. La mutation caractéristique de Wittgensteindisciple de Russell est d’être passé d’une problématique du Vraià la problématique du Sens qui se situe en amont et laconditionne. Or cette transition allant de la Vérité au Sensest exactement ce qui, sur la nature des transcendentaux, nousa fait passer de leur définition illimitée à leur définitionsémantiquement sélective. La définition illimitée voulait quetous les transcendentaux soient vrais de tout ; la définitionsémantiquement sélective remarque seulement qu’il y a un sens àleur application dans toutes les catégories. On voit par conséquent que la fameuse « Conférence surl’Ethique » de Wittgenstein devrait en réalité avoir pour titreConférence sur la Philosophie, de même que l’Ethique de Spinozacontient sous forme compacte un système complet de philosophie.
8. L’énigme du Vatican Le visiteur du Vatican qui arrive dans la Chambre de laSignature se trouve immédiatement confronté à une grave énigmeau sujet des transcendentaux. Les célèbres fresques de Raphaëlqu’il voit devant lui, en effet, trouvent manifestement leurssujets respectifs dans le Vrai, le Bien et le Beau. Le Vrai yest divisé entre le Vérité selon la raison qu’illustre L’Ecole
d’Athènes ou La philosophie (prise lato sensu)23 et la Vérité selon lafoi, qu’illuste La dispute du Saint Sacrement ou La théologie. Le Bien yest distribué entre La loi et Les vertus cardinales et théologales. LeBeau y est représenté par Le Parnasse, avec Apollon et les Muses.L’énigme est de trouver où est passé l’Être. Victor Cousin a prononcé en 1818 un cours publié sous letitre Du Vrai, du Beau et du Bien en 1836. Le néokantiens croientqu’avec ses trois Critiques (de la Raison pure théorique, de la Raison purepratique et du Jugement de goût) Kant s’est acquitté dans l’ordred’une doctrine du Vrai, du Bien et du Beau et que cela nousdonne un système exhaustif de philosophie. Mais ce ne sont làque des symptômes subjectifs de l’étroitesse du territoire oùse meut la modernité. Le fresques de Raphaël dans la Chambre dela Signature, c’est une autre affaire. Nous sommes au Vatican.Elles ont ét exécutées entre 1508 et 1511. Par rapport ausiècle de saint Thomas d’Aquin et de saint Bonaventure où lelisting des transcendentaux énumérait doctement ens, unum,verum, bonum et pulchrum, que s’est-il passé ? Qui a amputé laliste des transcendentaux ? C’est l’énigme du Vatican.
9. La solution de l’énigme L’article « Medieval Theories of Transcendentals » de laStanford Encyclopedia of Philosophy contient sans doute la solution del’énigme. Dès le titre le terme clef y est « théorie ». De laliste du Théétète à l’inventaire de Wittgenstein, lestranscendentaux sont seulement des termes, nommant autant deproblèmes, de difficultés ou de perplexités. La solastique en faitl’objet de théories ou des doctrines (MTT, p. 3), chacunecondensant ou fondant comme telle des solutions supposées de tousces problèmes, cela dans un contexte ou la philosophie estpratiquée principalement comme outil en théologie. Parmi ces doctrines, la plus caractéristique est probablementcelle de Thomas d’Aquin, offrant « ce qu’on a appelé ladéduction ou la dérivation des transcendentaux »24, c’est àdire d’abord de la suite « ens, unum, verum et bonum ». Avant même cette déduction, une indication capitale estdonnée dans le Sed contra au § 5 : « en Dieu, l’être, l’un, levrai et le bien, sont tous les quatre appropriés de tellemanière que l’être (ens) relève de l’essence (essentiam), l’un de23 Puisque l’on y voit, entre autres, Euclide.24 Christian Brouwer et Marc Peeters, Introduction à la Première questiondisputée : La Vérité (De Veritate) de Thomas d’Aquin, Vrin, 2002, p. 21. Nous citonsle De Veritate dans cette traduction, non sans modifications.
la personne du Père, le vrai de la personne du Fils, le bien dela personne du Saint-Esprit ». Cette proposition contient déjàune division des transcendentaux, séparant de l’unique être ceuxqui correspondent aux personnes trinitaires, ce qui présupposeune inscription préalable des transcendentaux dans le contextethéologique. Bien que figurant dans le sed contra, cetteinscription ne se verra opposer, dans sa solution, qu’un nonsequitur. En elle-même elle est tenue pour vraie, indiquant quel’être est mis à part d’un point de vue théologique, du fait mêmequ’il n’a pas de teneur théologique, par opposition à la triadeformée par l’un, le vrai et le bien. C’est ce que nousappelerons la ségrégation théologique des transcendentaux. Et il s’agitjustement de l’obtenir par déduction philosophique, indépendammentde son alignement théologique. Cette déduction prend la forme d’un Arbre obtenu pardistinctions successives et où le point de départ ainsi que lesconcepts à deduire seront écrits en gras. 0. Le sommet de l’Arbre est l’Être selon la thèse d’Ibn Sina(Avicenne) soutenant que le concept en lequel se résolvent tousles autres est l’être ou que « toute nature est par essenceêtre » (quaelibet natura est essentialiter ens) A partir de là leproblème est de déterminer comment quoi que ce soit peut êtreajouté à l’être par addition (additione). 1. Une addition est intérieure ou extérieure. Une addition intérieure est celle qui s’ajoute au genre commedifférence (comme dans « animal raisonnable ») ou au sujetcomme accident (comme dans « Socrate marié ») . Mais Aristote a prouvé que l’être n’est pas une genre, doncles additions à l’être sont extérieures en tant que modes del’être. 2. Un mode de l’être est spécial (specialis) ou consécutif(consequens). Un mode spécial est une catégorie ou genre suprême de l’être,comme la substance, la qualité, le relation, etc. L’Aquinate a ainsi rejoint la table des catégorie à partir delaquelle s’édifie la définition des transcendentaux. Sadivision se poursuit alors naturellement dans l’autre branche,celle des modes consécutifs. 3. Un mode consécutif est soit consécutif « à chaque être ensoi » (unumquodque ens in se), c'est-à-dire « dans l’absolu »,soit consécutif « à un être dans son ordonnancement à unautre » (in ordine ad aliud) et donc relativement à cet autre.
4. Un mode consécutif à un être en soi est affirmatif ou négatif. Le mode affirmatif, alors que selon Ibn Sina, ens « est prisde l’acte d’être » (esse, ou « quoddité »), donne letranscendental chose (res) désignant « la quiddité ou l’essencede l’être ». Le mode négatif est l’Un (unum) : « la négation consécutiveà tout être pris dans l’absolu est une non-division ; elle estexprimée par le nom « un », car l’un n’est rien d’autre quel’être non-divisé ». 5. Un mode consécutif à un être dans son ordonnancement à unautre est ou bien selon la division de l’un par l’autre ou bienselon la convenance d’un être à un autre. Un mode consécutif à un être selon la division de l’un parl’autre est un cas du transcendental quelque chose (aliquid) :« en effet ‘quelque chose’ se dit pour ‘quelque autre chose’ »(dicitur enim aliquid quasi aliud quid). Un mode consécutif à un être selon la convenance d’un être àun autre « ne peut être (non potest esse) que s’il est admis qu’unquelque chose (aliquid) est de nature à convenir à tout être :c’est l’âme, qui ‘d’une certaine manière est toutes choses’(quodam modo est omnia)», comme il est dit au livre III du DeAnima ». 6. Les pouvoirs de l’âme se divisent en cognitifs et appétitifs. La convenance de l’être à l’intellect est le Vrai. La convenance de l’être à l’appétit est le Bien. Le but visé par l’Aquinate est atteint : la ségrégationthéologique des transcendentaux qui place l’Être d’un côté,l’Un, le Vrai et le Bien de l’autre en faisant agir la Trinitécomme emporte-pièce est maintenant obtenue indépendamment parun filtrage purement philosophique faisant coopérer entreautres Aristote et Avicenne. Il ne s’agit donc pas d’une« déduction » à proprement parler, mais d’une division méthodiquedes transcendentaux qui les fait entrer en scène à point nommédans un ordre naturel. Deux autres transcendentaux, res etaliquid, ont surgi comme des fruits sur l’Arbre en cours dedivision. Dans le raisonnement de l’Aquinate, ils jouent unrôle analogue à celui de ces lignes supplémentaires qui, dansla démonstration géométrique, ne figurent pas dans les donnéesmais permettent d’obtenir le théorème, comme des catalyseurs enchimie, qui sont indispensables à la réaction maisdisparaissent de son résultat.
Qu’il sagisse de la ségrégation théologique ou de la divisionphilosophique, d’ailleurs, le résultat est qu’à partir del’être seul, dans le rôle de racine, les autres transcendentauxforment une triade rassemblant « les propriétéstranscendentales de l’être » (MET, § 4, p. 7), le tout étantformé par « ‘l’être’ est ses propriétés transcendentales »(MET, § 3, p. 7). D’où la tentation d’identifier lestranscendentaux à des « propriétés transcendentales del’être ». Par ailleurs, chez Marsile Ficin (1433-1499), la Beauté, laBonté et la Vérité vont s’imposer comme les trois valeursémergeant de ses commentaires des dialogues platoniciens.Diderot (1713-1784) comparera le Vrai, le Bien et le Beaurespectivement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans lerôle de la Trinité comme emporte-pièce des « propriétéstranscendentales » de l’Être, la triade aquinate des « modes »a donc été remplacée par celle des valeurs. Il est parconséquent compréhensible que Raphaël (1483-1520) ait peint leVrai, le Bien et le Beau comme propriétés transcendentales de l’Être enoubliant le sujet de ces propriétés.
10. Le territoire des transcendentaux et ses prétendants Une religion quelconque se prononce quant à ce qui est (desdieux, des esprits, le mana, un au-delà, etc.), quant à ce quiest vrai (des mythes, un credo, etc.), ainsi que sur ce qui estbien ou mal (par des interdits ou des tables de la loi, etc.).Le christianisme, par exemple, est la religion des deux outrois Mystères (Trinité, Incarnation et Rédemption), des deuxTestaments et des trois vertus théologales. Il a samétaphysique, sa logique et son éthique. A l’échelle del’histoire universelle, donc, bien avant l’invention de laphilosophie, les transcendentaux ont été investis par la religion. Mais ce ne serait pas assez dire que, comme Hegel a su ledéclarer, religion et philosophie (par ordre d’entrée en scènedans l’histoire) ont le même « objet ». Depuis le procès deSocrate jusqu’à l’accusation d’athéisme contre Fichte et à lamise à l’index de Bergson ou aux démêlés de Russell avec lelobby de la bigoterie américaine, en passant par le martyred’Hypatie et le bûcher de Giordano Bruno, les transcendentaux sont lelieu d’un conflit plus ou moins ouvert ou larvé mais perpétuel entre la religion et laphilosophie, dont le « problème scolastique » et Le conflit des Facultésde Kant ne sont que les déclarations édulcorées. Il s’agit de
savoir laquelle des deux, religion ou philosophie, a préemptionsur les transcendentaux. La religion réclame le droit du premieroccupant. La philosophie argue que C’est le conflitsacerdophilosophique. Une comparaison avec le cas de la science est éclairante. Laloi des trois états d’Auguste Comte raconte comment la sciencea progressivement conquis des pans de réalité qui, après avoirété arrachés à la religion, furent chez Aristote et encore chezDescartes réputés relever de la philosophie. Mais dans cedevenir-positif des sciences, la science n’a jamais concurrencéla philosophie que sur l’Être, laissant le Vrai, le Bien et le Beauà sa juridiction. Alors que le conflit sacerdophilosophiqueporte sur la totalité des transcendentaux. Tout cela signifie que la constellation des transcendentauxforme un territoire des transcendentaux. Nous appelons territoireun ensemble qui fait l’enjeu d’une lutte entre prétendants. Or c’estla réalité agonistique des transcendentaux, tiraillés entotalité entre la religion et la philosophie, en partie entrela philosophie et la science. Ils sont le théâtre véritable dela « loi des trois états ». Fermer les yeux sur ce statutagonistique est passer à côté de ce qui fait leur importance.Mais cette importance vitale rend d’autant plus indispensablel’éclaircissement de leur teneur conceptuelle.
Jean-Claude Dumoncel.
Related Documents