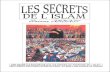22 Les Britanniques et l'islam dans le sous-continent indien : pourquoi l'indépendance a-t-elle correspondu à la Partition? Aminah Mohammad-Arif Pourquoi la décolonisation du sous-continent indien en 1947 s'est- elle accompagnée de sa Partition en deux États, l'Inde et le Pakistan? Et, cela, au prix d'une violence inouïe : des centaines de milliers de morts en quelques mois et quelque quatorze millions de déracinés ; certaines régions, comme le Pendjab, furent les témoins d'une véritable purification ethnique avant l'heure. Nous sommes donc face à l'une des plus grandes tragédies du xx.e siècle. n n'existe pas de réponse tranchée à cette question, tant les avis sur le sujet divergent, tant les causalités sont croisées et les responsabilités partagées entre les principaux protagonistes de 1' époque que sont la Ligue musulmane, le Congrès et les Britanniques. La Partition aura été le résultat d'une conjonction de facteurs. Nul ne peut dire même si elle aurait pu être évitée, son inéluctabilité n'étant apparue que très tardivement. Pendant très longtemps, en effet, personne, ni du côté hindou, ni du côté musulman, ni même du côté britannique, n'avait envisagé la division de 1 'Inde en deux États. La plupart des historiens (sud-asiatiques et occidentaux) s'accordent néanmoins sur le point suivant, à savoir que la Partition aura été par-dessus tout l'aboutissement d'une compétition entre élites hindoues et élites musulmanes, les Britanniques ayant, pour leur part, contribué à creuser le fossé entre les communautés et à aggraver les tensions. Reste à savoir si c'est vraiment la politique «religieuse» de l'autorité coloniale qui est à l'origine des clivages croissants entre hindous et musulmans à partir du :x:oce siècle. • Tous mes remerciements les plus vifs vont à Marc Gaborleau pour sa relecture attentive de mon texte.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
22
Les Britanniques et l'islam dans le sous-continent indien : pourquoi
l'indépendance a-t-elle correspondu à la Partition?
Aminah Mohammad-Arif
Pourquoi la décolonisation du sous-continent indien en 1947 s'estelle accompagnée de sa Partition en deux États, l'Inde et le Pakistan? Et, cela, au prix d'une violence inouïe : des centaines de milliers de morts en quelques mois et quelque quatorze millions de déracinés ; certaines régions, comme le Pendjab, furent les témoins d'une véritable purification ethnique avant l'heure. Nous sommes donc face à l'une des plus grandes tragédies du xx.e siècle. n n'existe pas de réponse tranchée à cette question, tant les avis sur le sujet divergent, tant les causalités sont croisées et les responsabilités partagées entre les principaux protagonistes de 1' époque que sont la Ligue musulmane, le Congrès et les Britanniques. La Partition aura été le résultat d'une conjonction de facteurs. Nul ne peut dire même si elle aurait pu être évitée, son inéluctabilité n'étant apparue que très tardivement. Pendant très longtemps, en effet, personne, ni du côté hindou, ni du côté musulman, ni même du côté britannique, n'avait envisagé la division de 1 'Inde en deux États.
La plupart des historiens (sud-asiatiques et occidentaux) s'accordent néanmoins sur le point suivant, à savoir que la Partition aura été par-dessus tout l'aboutissement d'une compétition entre élites hindoues et élites musulmanes, les Britanniques ayant, pour leur part, contribué à creuser le fossé entre les communautés et à aggraver les tensions. Reste à savoir si c'est vraiment la politique «religieuse» de l'autorité coloniale qui est à l'origine des clivages croissants entre hindous et musulmans à partir du :x:oce siècle.
• Tous mes remerciements les plus vifs vont à Marc Gaborleau pour sa relecture attentive de mon texte.
410 LE CHOC COLONIAL BT L'ISLAM
Mais, avant de traiter de la période coloniale, il convient d'abord de faire un détour rapide par l'histoire et d'examiner la place qu'occupait l'islam dans l'appareil d'État et le sort réservé aux minorités religieuses avant l'anivée des Britanniques. Nous verrons ensuite, à travers notamment la réforme du système judiciaire et l'institutionnalisation des statuts personnels, si la politique des Britanniques envers l'islam joua un rôle ou non dans le processus qui mena à la Partition.
LES SOUVERAINS MUSULMANS: ENTRE DOMINATION
ET ACCOMMODATION
La présence des musulmans dans le sous-continent indien remonte au VID" siècle, mais c'est quelque cinq siècles plus tard qu'ils y établirent leur domination: à travers le sultanat de Delhi d'abord (xnr-xw siècles), puis de l'Empire moghol (XW-xvm<' siècles). lls seront progressivement supplantés par les Britanniques à partir du xvm<' siècle.
En dépit de leur domination politique, les musulmans demeurèrent largement en situation de minorité (à peine 20 % de la population totale à l'anivée des Anglais 1)~ sultans de Delhi comme empereurs moghols régnant sur une population qui comprenait essentiellement des hindous, auxquels s'ajoutaient des jaïns, des bouddhistes, des sikhs, des parsis (zoroastriens) et, enfin, des chrétiens et quelques juifs. Face à cette majorité de non-musulmans, les musulmans étaient loin (et ils le sont aujourd'hui encore) de constituer un bloc homogène: la noblesse incluait dans ses rangs des 'fures, des Afghans, des Iraniens, et quelques habshi2,
tandis que les dignitaires religieux étaient plutôt d'origine arabe; surtout, la population musulmane, dont la majorité se composait de convertis, se caractérisait par une diversité ethnique plus importante encore, compte tenu du fait que le processus de conversion avait couvert l'ensemble du sous-continent. On observait, cependant, de grandes variations selon les régions: dans certaines, les conversions furent massives (zones comprenant l'actuel Pakistan et l'actuel Bangladesh, Cachemire, quelques poches du Kerala), tandis que, dans les autres, elles furent de bien moindre ampleur. L'hétérogénéité de la population musulmane se manifestait également par le fait que tous n'appartenaient pas à la même école de droit: hanafites en grande majorité, les musulmans comprenaient également quelques shaféites. lls étaient, en outre, traversés par des différences sectaires : · sunnites pour la plupart, les musulmans
1. D'après le premier recensement effectué en Inde en 1872-1874. 2. Africains que communément on désigne de la sorte en Inde, qu'ils soient ou non
originaires d'Abyssinie.
LESBRr
incluaient auss: cimains et eni~ taristes, reprod hiérarchisation réclamant d'UIJ hiérarchisée) OJ chiquement. Cc état de cause, c comparables à la théorie des hindous et mus
Concernant souverains mu~ dans l'ensemb politiques, étai réalité, l'islam d'État du sultaJ ne régissait pas de manœuvre r souverains mus 1994a et 19941 propre régime j
Reste que D
tolérance, toute un pied d'égali1 hindous, qui ét soumis à des mt tenus de payer nombre d'binde pas moins écru 1999, p. 453]. : été la religion C:
non plus l' éga religion d'État>: ficiaient pas du « étrangères » à toires, ostracisn hindous étaient presque, que les traitaient donc 1 des barrières rin et échanges de r
LEs BRITANNIQUES ET L'ISLAM DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 411
incluaient aussi une minorité de chiites, eux-mêmes subdivisés en duodécimains et en ismaéliens. Enfin, les musulmans en Inde, loin d'être égalitaristes, reproduisirent le système des castes, en établissant une véritable hiérarchisation sociale fondée sur l'origine ethnique, les musulmans se réclamant d'une extraction étrangère formant une noblesse (elle-même hiérarchisée) opposée aux convertis locaux subdivisés, eux aussi, hiérarchiquement. Cette réappropriation du système des castes montre, en tout état de cause, que ces derniers partageaient des conceptions amplement comparables à celles des hindous sur la vie en société, ce qui met à mal la théorie des essentialistes sur l'incompatibilité des valeurs entre hindous et musulmans [Gaborieau, 2003].
Concernant le statut officiel de l'islam pendant le règne des souverains musulmans, la chari'a était théoriquement la loi en vigueur dans 1 'ensemble du royaume. Des qazi, désignés par les autorités politiques, étaient chargés de veiller à son application. Mais, dans la réalité, l'islam occupait une place assez négligeable dans l'appareil d'État du sultanat tout comme dans celui de l'Empire moghol: l'islam ne régissait pas la conduite du gouvernement, ce qui laissait une marge de manœuvre plutôt étroite aux dignitaires religieux, et permettait aux souverains musulmans de s'accommoder au contexte local [Gaborieau, 1994a et 1994b]. C'est ainsi que chaque-communauté relevait de son propre régime juridique et bénéficiait d'une certaine liberté de culte.
Reste que malgré cette politique d'accommodation et de relative tolérance, toutes les communautés religieuses n'étaient pas traitées sur un pied d'égalité: les musulmans jouissaient d'un statut supérieur aux hindous, qui étaient considérés comme des dhimmi (non-musulmans, soumis à des mesures discriminatoires dans un État musulman) et donc tenus de payer la jizya, une taxe discriminatoire. On trouvait, certes, nombre d'hindous dans l'appareil d'État, mais ces derniers n'en étaient pas moins écartés des plus hautes fonctions politiques [Gaborieau, 1999, p. 453]. Force est de constater que, lorsque l'hindouisme avait été la religion dominante, les souverains hindous n'avaient pas prôné non plus l'égalité des religions. L'hindouisme «faisait figure de religion d'État» [ibid.] et toutes les communautés religieuses ne bénéficiaient pas du même traitement: celles qui étaient classées comme «étrangères» à 1 'hindouisme étaient infériorisées (taxes discriminatoires, ostracisme social, etc.). Appelés mleccha (barbares), les nonhindous étaient en outre considérés comme des êtres aussi impurs, ou presque, que les intouchables. Souverains musulmans comme hindous traitaient donc l'Autre comme des sujets de seconde zone, tandis que des barrières rituelles séparaient les deux communautés (inter-mariages et échanges de nourriture interdits par les hindous par exemple).
412 LE CHOC COLONIAL ET L'ISLAM
~ORME DU SYSTÈME JUDICIAIRE PAR LES BRITANNIQUES ET
INSTITUTIONNAJ.JSATION DES STATUTS PERSONNELS
Lorsque les Britanniques arrivèrent en Inde, ils ne bouleversèrent pas immédiatement les institutions mises en place par les souverains musulmans. La Compagnie des Indes Orientales n'avait d'abord pour seul droit que celui de collecter les impôts. Le fonctionnement de la justice demeurait tel qu'il était sous le règne des Moghols, c'est-à-dire relevant du droit hanafite et administré, on l'a vu, par les qazi. C'est à partir de 1772 que la situation commença à évoluer, les Britanniques renforçant peu à peu leur contrôle sur les institutions : ils commencè~ rent par mettre en place un nouveau système judiciaire comprenant une hiérarchie de tribunaux (dont le plus élevé s'appelait le Privy Council, sorte de Cour suprême) chargés d'appliquer le droit civil et le droit criminel. Les qazi ne tardèrent pas à être remplacés par des magistrats britanniques qui, dans un premier temps, furent assistés dans leurs tâches par des muftis, jusqu'à ce qu'en 1864, la position de ces derniers (de même que celle des Pandits, leurs «équivalents» hindous) ftlt également abolie: le droit était désormais administré exclusivement par des juges britanniques ou par des juges indiens (pas nécessairement musulmans) formés au droit anglais. La chari'a, bien qu'elle subit des modifications successives, demeura la base du droit pénal jusqu'en 1862, date à laquelle les reliquats du droit criminel islamique furent supprimés au profit du Code pénal indien. Une grande partie du droit civil, de son côté, subit une codification à partir du modèle anglais, les concepts juridiques britanniques, comme la doctrine du précédent (1872) et les principes généraux du droit commun anglais et de l'équité (ce que les Britanniques, reprenant une formule romaine, appellent le principe de «justice, équité et conscience») pénétrant progressivement dans le droit islamique [Schacht, 1966, p. 83-84]. Dans le domaine du droit familial, en revanche, les Britanniques ne rompirent pas avec la société traditionnelle moghole, les communautés religieuses conservant leur propre droit canonique pour régler leurs problèmes familiaux. C'est ainsi que, dès 1772, ils reconnaissaient aux musulmans, mais aussi aux hindous, un «statut personnel» (Personal Law) distinct, mais placé sur le même plan, pour régler les questions relatives au mariage, au divorce, aux successions, aux donations et aux fondations pieuses. Autrement dit, le droit fut progressivement sécularisé, la religion demeurant progressivement confinée au domaine du droit familial. Le « sécularisme » à l'indienne, soit le traitement de toutes les religions sur un pied d'égalité, tel qu'il est défini depuis 1950 par la Constitution, plonge ses racines dans ce processus-là.
LEsBRJ
Conceman ques, peu fw l'extrême héU définir claire! arabes qui fai dans une poli1 mode de fe ConformémeJ d'appliquer la Ces textes n' é musulmans in autorité exclu: Deux textes de (texte du :me 1
dont la compc (1658-1707) a que ce dernie1 comme une so· à affirmer le c lesquels lui-mi teintées de mé: appliqué aux d· considéré com fit l'objet d'ut Hidaya et une · la base de ce ~ S'y ajoutaient c classés de façOJ qui, à l'instar è codes [Andersc les Britannique l'exemple du F textes classiqt coutumières, cl circonstances è [Gaborieau, 19~
3. Son auteur es ûgion de Farghana,
LEs BRITANNIQUES ET L'ISLAM DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 413
Concernant les modalités d'application de la loi, les juges britanniques, peu familiarisés avec la chari'a et confrontés, d'une part, à l'extrême hétérogénéité de la population et, de l'autre, à la difficulté de définir clairement les termes du droit islamique à partir des textes arabes qui faisaient autorité, contournèrent le problème en se lançant dans une politique de codification et d'uniformisation, calquée sur le mode de fonctionnement de leur propre système juridique. Conformément à cette logique, les cours coloniales chargées d'appliquer la loi reposaient en priorité sur un corpus limité de textes. Ces textes n'étaient, certes, pas dépourvus d'importance aux yeux des musulmans indiens, mais les Britanniques leur firent endosser une autorité exclusive et immuable qu'ils n'avaient pas nécessairement. Deux textes de la tradition hanafite retinrent leur attention: la Hidaya (texte du xne siècle produit en Asie centrale3) et les Fatawa 'Alamgiri dont la composition fut ordonnée par l'empereur moghol Aurangzeb (1658-1707) au xvne siècle [Fyzee, 1964, p. 67]. n est remarquable que ce dernier n'avait jamais tenté de les imposer aux musulmans comme une source de loi incontournable ; elles étaient plutôt destinées à affirmer le contrôle de l'empereur sur les dignitaires religieux avec lesquels lui-même et ses prédécesseurs avaient entretenu des relations teintées de méfiance [Kozlowski, 1985, p. 105]. Le droit chi 'ite étant appliqué aux duodécimains à partir du xnce siècle, le Chara 'i ul-Is lam, considéré comme fondamental par les musulmans de cette obédience, fit l'objet d'une traduction en anglais, tout comme l'avaient été la Hidaya et une partie des Fatawa 'Alamgiri. Ces trois textes formèrent la base de ce que l'on appellera bientôt l'Anglo-Muhammadan Law. S'y ajoutaient des compilations de fatwas sur les thèmes les plus variés, classés de façon thématique, et, plus tard, des productions de manuels, qui, à l'instar de la Hidaya et des Fatawa 'Alamgiri, avaient force de codes [Anderson, 1993]. À partir de la deuxième moitié du xnce siècle, les Britanniques, se rendant compte, en raison en particulier de l'exemple du Pendjab, qu'il pouvait exister de vastes écarts entre les textes classiques sur lesquels ils se basaient et les pratiques coutumières, cherchèrent à codifier également la coutume qui, en des circonstances données, aura désormais précédence sur la loi écrite [Gaborieau, 1993, p. 157].
3. Son auteur est un certain Burbanuddin Marghinani (mort en 1197), originaire de la région de Farghana, à l'est de l'Ouzbekistan actuel. Cf. A. A. A. Fyzee, 1964, p. 67.
414 LB CHOC COLONIAL ET L'ISLAM
EFFETS DE LA POUTIQUE BRITANNIQUE
Cette codification tous azimuts des Britanniques ne fut pas sans conséquence sur la façon dont les musulmans appréhendaient la chari'a et sur la perception qu'ils avaient d'eux-mêmes.
La dépendance des Britanniques par rapport à un nombre très circonscrit de textes commença par transformer la chari'a en un ensemble de règles immuable:~, alors que l'histoire moghole et l'histoire islamique, par-delà les continents, montrent que plusieurs interprétations de la chari'a pouvaient coexister. Elle eut également pour effet de minimiser les différences doctrinales entre musulmans. Même la coutume, système pourtant aux contours plus mal définis encore, fut perçue comme figée (au sein d'une société, elle aussi, considérée comme statique).
La codification opérée par les Britanniques exerça également un impact sur les figures de 1' autorité religieuse et leur lecture de la chari'a. Face à l'importance conférée par les Britanniques à l'autorité d'un certain nombre de commentateurs des textes sacrés, les oulémas renforcèrent en effet leur pratique du taqlid («imitation»), et lui conférèrent une importance, mais aussi une rigidité, sans précédent. A partir de quoi, une nouvelle forme de littéralisme fut adoptée par les oulémas. Le fait que les Britanniques considèrent la loi islamique comme arbitraire (argument avancé pour justifier la codification) et les autorités musulmanes chargées de la faire appliquer comme peu fiables, incitait d'autre part les oulémas à démontrer que, quoi qu'en dissent les Britanniques, leurs lois étaient tout à fait . prévisibles, certaines et immuables. n en découla que, par une sorte de choc en retour, la rhétorique d'une loi immuable incita les oulémas à nourrir une interprétation de la chari'a de moins en moins flexible [Zaman, 2002, p. 23-31]. Plus généralement, l'introduction de lois séculières occidentales dans certains domaines juridiques consolida la position de la chari'a dans les affaires qui demeuraient sous son emprise.
L'administration de la loi islamique par un pouvoir colonial nonmusu1man eut pour effet, en dernier lieu, de transformer la chari'a et le statut personnel en enjeux politiques majeurs. A la fin du XIXe siècle, en effet, alors que s'amorçait le mouvement pour l'indépendance de l'Inde, plusieurs groupes adoptèrent une approche plus scripturaliste de 1 'islam, se réapproprièrent un langage islamique et se mobilisèrent autour d'une identité musulmane par opposition au pouvoir colonial, d'une part, et aux missionnaires très actifs dans certaines régions de l'Inde, de l'autre. TI serait cependant erroné de considérer l'émergence d'une lecture scripturaliste de l'islam comme résultant uniquement de
LBs]
la politique dynamique~ l'époque o't tant chez 1· s'étaient fix, ce que les comme le« similaire, à extérieures 1 réformistes : commun, la Tradition à tl pas celui de. inspiration d origines. Le 1
de l'âge d'or pagna d'und du « déclin» d'or védique invasions mu orientaliste. l les «vrais in islamique, m1 lamentable. ( hindous qui Britanniques, déchéance de à quitter l'lndt le réformisme du nationalisn: de leur côté, déchu. RepréSt Deoband4, ils dans les pratiqt constater que 1 1' islam de la pt d' accommodati des origines ct
4. Les Deobanc continent indien. n importante de leun (1833-1877) et Rasl
LES BRITANNIQUES ET L'ISLAM DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 415
la politique des Britanniques. Au tournant des xzxe et :xxe siècles, des dynamiques endogènes étaient également à l'œuvre. C'est, en effet, 1' époque où surgissent des mouvements de réforme socio-religieuse, tant chez les musulmans que chez les hindous. Ces mouvements s'étaient fixés comme objectif de réfléchir et de remédier aux causes de ce que les réformistes, hindous comme musulmans, considéraient comme le «déclin » de leur communauté. lls proposaient un remède similaire, à savoir la purification et l 'élimination des influences extérieures perçues comme responsables de cette «déchéance». Les réformistes hindous et musulmans partageaient, comme autre point commun, la réinterprétation de leur passé et la réinvention de la Tradition à travers l' idée d'un âge d'or. Mais l 'âge d'or des uns n'était pas celui des autres, et cela d'autant moins que chacun puisait son inspiration dans· ses propres textes et ne partageait pas les mêmes origines. Le revivalisme chez les hindous se traduisit par une exaltation de l'âge d'or védique, antérieur à la présence musulmane, et s'accompagna d'un dénigrement des musulmans, perçus comme responsables du «déclin» des hindous. Force est de constater que l'idée d'un âge d'or védique et d'un «déclin» de l'hindouisme provoqué par les invasions musulmanes s' avérait être essentiellement une construction orientaliste. Les orientalistes considéraient en effet les hindous comme les « vrais indigènes» de l'Inde dont la civilisation ancienne, préislamique, méritait l'attention, mais dont la condition actuelle était lamentable. Ce discours se trouva réapproprié par les réformistes hindous qui poussèrent cependant la logique plus loin : les Britanniques, tout comme les musulmans, étaient responsables de la déchéance de l'hindouisme~ aussi, les colonisateurs étaient-ils appelés à quitter l'Inde [van der Veer, 1994, p. 20]. Par voie de conséquence, le réformisme religieux apparaissait de plus en plus comme un ferment du nationalisme [Jaffrelot, 1994, p. 543]. Les réformistes musulmans, de leur côté, appelaient, eux aussi, à la revitalisation d'un l'islam déchu. Représentés par divers mouvements, dont la célèbre école de Deoband4
, ils préconisaient l'élimination de toute influence hindoue dans les pratiques islamiques et le retour aux textes. TI est intéressant de constater que les réformistes musulmans ne prônaient pas un retour à l'islam de la période médiévale (marquée, on l'a vu, par une politique d' accommodation des souverains musulmans), mais un retour à l'islam des origines conçu, imaginé comme le remède salvateur face à la
4. Les Deobandi forment la plus importante école d'oulémas sunnites dans le souscontinent indien. Ds tirent leur nom de la ville de Deoband, située en Inde, où la plus importante de leurs ITUldrasas fut fondée en-1867 par Muhammad Qasim Nanautawi (1833-1877) et Rashid Ahmad Gangohi (1829-1905). (cf. Metcalf B., 1982).
416 LE CHOC COLONIAL ET L'ISL.\M
dégénérescence interne. En tout état de cause, l'histoire de la période coloniale montrera que cet islam aura un pouvoir d'unification et de mobilisation des musulmans, par-delà leurs appartenances sociales, culturelles, linguistiques, etc. [Hardy, 1972, p. 24]. Réformistes hindous et musulmans se rejoignaient sur d'autres points: les uns comme les autres prônaient également la régénérescence de leur religion par l'éducation. Parmi les musulmans, tous ne préconisaient pas le même type d'éducation : certains proposaient un enseignement traditionaliste rénové (Deoband), tandis que d'autres se faisaient les champions de l'enseignement moderniste, comme à Alîgarh, où prendra corps le concept d'une communauté musulmane représentant un groupe socialement et politiquement exclusif [Lelyveld, 1978]. TI est remarquable que ce sont ces derniers qui prôneront plus tard la voie séparatiste, tandis que les preiniers lutteront pour l'indépendance de l'Inde aux côtés du parti du Congrès. L'idée d'un «déclin» des musulmans, développée notamment dans l'ouvrage de W. W. Hunter, The Indian Mussalmans (1871), représentait également une construction des Britanniques, tandis que l'émergence d'un islam scripturaliste concordait, on l'a vu, avec la lecture de l'islam, fondée sur un corpus circonscrit de textes; de l'autorité coloniale. Mais, une fois encore, cette concordance ne signifie pas que le discours réformiste, chez les musulmans en particulier, constituait uniquement une réaction à la présence britannique, d'autres facteurs internes participant également de ce processus. n faut, en fait, remonter à une période plus ancienne où des réformistes, comme Shah Waliullah (1703-1762), avaient appelé, dès le :xvnre siècle, à établir un lien entre 1' affaiblissement politique et l'affaiblissement « moral» de la communauté musulmane : il proposait, comme remède, la substitution des coutumes arabes aux coutumes dites étrangères (c'est-à-dire perçues comme influencées par l'hindouisme). Au début du xœ= siècle, un autre réformiste, Sayyid Ahmad Barelwi (1786-1831), préconisa une réforme socio-religieuse qui remettait en cause la mystique traditionnelle (il se prononçait notamment pour l'abolition du culte des saints), et s'élevait contre les coutumes sociales proches de celles des hindous (il encourageait par exemple le remariage des veuves, alors que les musulmans indiens tendaient à suivre la coutume hindoue qui s'y oppose). Ces preiniers mouvements s'inscrivaient donc non seulement dans le contexte de la perte de pouvoir des musulmans en Inde-même si les Britanniques ne représentaient pas nécessairement les cibles principales-, mais aussi dans celui d'une réévaluation de l'idéologie et des pratiques religieuses également manifestée ailleurs en terres d'islam, ces réforinistes subissant notamment l'influence des wahhabites d'Arabie
[Gaboriea\ àdiffusert des réform
Po un.
En tout de la fin d1 voire dans : fut non se\ dirigeants IJ
taliser à des de ce phén entrer dans plusieurs ty ment à leur lement), ela Les cours c1 « charitable rent à cell~;
fondateur, l1 de la loi is Council fin: indiens en 1 suivantes, cc musulmans Jinnah (187 (commebieJ avec le saut Act, qui ren1 ~familial».
censée être également I certaines ela Jinnah argm endossant pa l'islam mise
5. Pour une 6. C'est-fl-dil
LEs BRITANNIQUES ET L'ISLAM DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 417
[Gaborieau, 1994d]. Reste que la politique des Britanniques contribua à diffuser une vision scripturaliste de l'islam et à encourager les efforts des réformistes religieux.
POLITISATION DU STATIIT PERSONNEL ET AUTRES MANIPULATIONS
DES SYMBOLES RELIGIEUX
En tout état de cause, la chari 'a fut progressivement perçue, à partir de la fin du XIX" siècle, comme un élément central dans le maintien, voire dans la survie, de l'identité musulmane. Son pouvoir symbolique fut non seulement exploité par les oulémas, mais également par les dirigeants modernistes et/ou laïques, qui n'hésitèrent pas à l'instrumentaliser à des fins politiques. L'une des illustrations les plus intéressantes de ce phénomène est la loi sur les fondations pieuses (wakj). Sans entrer dans les détailss, mentionnons simplement le fait qu'il existait plusieurs types de fondations pieuses, que les Britanniques, conformément à leur politique simplificatrice (mais pas forcément intentionnellement), classèrent en fondations de type « public» et de type « privé». Les cours coloniales ne touchèrent pas aux premières (dons à caractère «Charitable» et «religieux6» faits à des i-nstitutions), mais s' attaquèrent à celles dont les revenus étaient réservés aux descendants du fondateur, les considérant comme contraires à (leur interprétation de) de la loi islamique [Kozlowski, 1985]. En 1894, un juge du Privy Council finit par les rendre illégales, au grand dam des musulmans indiens en général, et des élites foncières en particulier. Les années suivantes, cette question devint le thème autour duquel se rallièrent les musulmans mécontents. Au terme d'une campagne, Muhammad Ali Jinnah (1876-1948), le fondateur du Pakistan, avocat de formation (comme bien des leaders nationalistes de l'époque), fit passer en 1913, avec le soutien d'importants oulémas de l'époque, le Walif Validating Act, qui rendait de nouveau légales les fondations pieuses à caractère «familial». Sous prétexte de vouloir rétablir une situation antérieure censée être plus conforme à la lettre de l'islam, cette loi avait également pour objectif de protéger les intérêts économiques de certaines classes foncières. Quoi qu'il en soit, durant son plaidoyer, Jinnah argua de la nature ancienne et immuable de la loi islamique, endossant par là-même, sans critique aucune, la vision scripturaliste de l'islam mise en avant par les Britanniques. Jinnah, pas plus que les
5. Pour une étude détaillée, cf. Koz.lowski, 1985, en particulier p. 177-191. 6. C'est-à-dire destinées à financer des mosquées, des sanctuaires de saints, des madrasas.
418 LE CHOC COLONIAL ET L'ISLAM
autres leaders musulmans de l'époque, ne tenta de montrer que les cours coloniales interprétaient la chari 'a de façon bien trop rigide, alors que celle-ci avait largement évolué à travers l'histoire. Comme le suggère à juste titre Gregory Kozlowski, l'explication de cette acceptation passive de la redéfinition de la chari'a réside probablement dans le fait que ces leaders étaient des avocats formés selon la tradition britannique: leur connaissance de la chari 'a étant nulle ou presque, ils n'étaient pas annés pour remettre totalèment en cause la façon dont les Britanniques appréhendaient l'islam [Kozlowski, 1985, p. 153]. Fils de bourgeois et de fonctionnaires, la plupart d'entre eux n'était pas non plus originaires de familles au sein desquelles existait une tradition d'enseignement religieux [idem, p. 195].
Cette affaire permit à Jinnah de remporter sa première victoire politique majeure. Une autre occasion se présenta à lui grâce au Chari'at Application Act de 1937 qui, une fois encore, vit s'imposer l'influence sur la loi de l'islam scripturaliste. Cette législation mettait officiellement fm au double système (islamique et coutumier) régissant le statut personnel musulman au profit de la seule chari'a [Anderson, 1993]. Elle visait théoriquement à redresser les torts causés aux femmes en matière d'héritage: dans une région comme le Pendjab, les femmes étaient en effet exclues du droit de succession, en vertu de la loi coutumière. Mais cette loi contribua aussi à réaffirmer la nature ancienne et immuable de la loi islamique. Force est de constater que les hommes politiques musulmans de l'époque participèrent donc, tout comme les Britanniques, à la codification et à la rigidification de la loi islamique, même si pour un personnage aussi «laïque» que Jinnah, le soutien à cette forme d'islam était purement opportuniste: il s'inscrivait dans le cadre de son combat nationaliste contre les Britanniques. Ainsi, au Pendjab, dans les années 1930, les défenseurs de la loi coutumière se comptaient notamment au sein du Parti unioniste, une force politique qui regroupait des propriétaires fonciers d'appartenances religieuses diverses plutôt favorables aux Britanniques, les uns et les autres partageant des intérêts communs. Le Chari'at Act de 1937 n'améliora pas dans les faits le droit des femmes de façon significative, mais il servit de vecteur à l'expression d'une identité musulmane dans les instances juridiques officielles ; il conforta aussi Jiimah dans son désir de se revendiquer comme le porte-parole des musulmans en Inde. Cette législation donna l'occasion au père fondateur du Pakistan d'acquérir une certaine légitimité religieuse, d'autant plus qu'il bénéficiait de l'appui de la plupart des oulémas. Par une ironie de l'histoire, la chari'a devint donc une arme que les musulmans retournèrent contre les Britanniques. Les leaders de l'époque comprirent
LEsBRITA
qu'un discours I [Kozlowski, 19: internes et jouis:
Cephénomè1 groupes se serva sation contre l'a sants est celui d 1920). A l'origi1 ces derniers re d'interdire l'ab~
tensions entre hi 1893), car le mé exercé par ces ru mêmes des vac musulmans et le! comme de barbi sauvagerie, et dét hindous [van det titre Paul Brass musulmanes, vin titre : il s'inscriv unité interne et communautaires. utiliser à la fois pratiques religie~ y voyaient une fa~ du nationalisme musulmans qui cr pendante, et voya un signe annone opprimés dans un 1991, p. 78-80]. comme arme de r pendance (en rais' il eut aussi pour musulmans. Cert~ d'obédience «séct même (pourtant < pour l'indépendan' leur combat pour 1
Une autre gr~ organisée, cette fo:
LEs BRITANNIQUES ET L'ISLAM DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN
qu'un discours politique fondé sur<< une foi, une communauté, une loi» [Kozlowski, 1985, p. 191] pennettait de camoufler les discordances internes et jouissait d'un pouvoir mobilisateur certain.
Ce phénomène était également observable chez les hindous, certains groupes se servant également de la religion comme vecteur de mobilisation contre l'autorité coloniale. L'un des exemples les plus intéressants est celui du mouvement pour la protection de la vache (1880 et 1920). À l'origine, ce mouvement était dirigé contre les Britanniques, ces derniers refusant d'obtempérer à la demande des hindous d'interdire l'abattage des vaches. Reste qu'il créa également des tensions entre hindous et musulmans (il y eut même des émeutes en 1893), car le métier de boucher, et donc d'«abatteur» de vache, était exercé par ces derniers; certains musulmans sacrifiaient en outre euxmêmes des vaches lors de la célébration de l' Id-ul Adha. Les musulmans et les Britanniques étaient donc considérés par les hindous comme de barbares «mangeurs de vache», alliés dans une même sauvagerie, et déterminés à insulter les sentiments les plus profonds des hindous [van der Veer, 1994, p. 86-92]. Comme le remarque à juste titre Paul Brass, plusieurs groupes, parmi les élites hindoues et musulmanes, virent dans ce mouvement un symbole efficace à double titre : il s'inscrivait dans le cadre de leurs efforts pour construire une unité interne et possédait la capacité d'amplifier les conflits intercommunautaires. La vache constituait un symbole que pouvaient utiliser à la fois les hindous orthodoxes au nom de la défense des pratiques religieuses traditionnelles, les leaders revivalistes hindous qui y voyaient une façon de promouvoir une fonne spécifiquement hindoue du nationalisme indien, et enfin les leaders politiques et religieux musulmans qui craignaient la domination hindoue dans une Inde indépendante, et voyaient dans le mouvement contre l'abattage des vaches un signe annonciateur de la façon dont les musulmans seraient opprimés dans un système où les hindous seraient en majorité [Brass, 1991, p. 78-80]. Force est de constater que le recours au religieux comme anne de mobilisation eut son utilité dans la lutte pour l'indépendance (en raison de ses vertus unificatrices et mobilisatrices), mais il eut aussi pour effet de creuser les différends entre hindous et musulmans. Certains membres du Parti du Congrès (parti pourtant d'obédience « séculariste » ), à commencer par Gandhi (1869-1948) luimême (pourtant désireux d'associer les musulmans au mouvement pour l'indépendance), eurent même recours à un langage religieux dans leur combat pour l'indépendance.
Une autre grande mobilisation sur des bases religieuses fut organisée, cette fois à l'initiative du leadership musulman: il s'agit du
420 LE CHOC COLONIAL ET L'ISLAM
mouvement pour la défense du califat de l'Empire ottoman menacé par les Britanniques (1919-1924). Au cours de ce mouvement, les musulmans indiens reçurent le soutien de Gandhi, qui y voyait une excellente occasion d'associer les musulmans au mouvement d'indépendance, puisque les Britanniques représentaient la cible des manifestants. Mais ce mouvement provoqua en même temps l'hostilité d'une fraction des élites hindous qui désapprouvaient cette mobilisation pour une cause transnationale. Aussi contribua-t-il à envenimer les relations entre les deux communautés [Minault, 1982].
LEs BRITANNIQUES SONr-ll.S RESPONSABLES DE LA PARTITION?
Tout cela étant dit, peut-on faire endosser la responsabilité, même partielle, de la Partition aux Britanniques ? Si responsabilité il y eut, celle-ci ne peut pas être attribuée à la politique des Britanniques envers l'islam. Ces derniers, en sécularisant le droit, ont même contribué, au contraire, à mettre sur le même plan les communautés musulmane et hindoue, alors que, précédemment, la communauté détenant le pouvoir maintenait l(es) Autre(s), on l'a vu, en position d'infériorité. En outre, la délimitation des identités, aussi fluctuantes soient-elles, entre hindous et musulmans était antérieure à la présence des Britanniques (elle est attestée dès le xme siècle),les deux communautés s'affrontant même à partir du XVIr' siècle [Gaborieau, 2001, 2003]. La période précoloniale n'aura donc pas été l'âge d'or où prévalait l'harmonie communautaire, tel qu'il est décrit par la littérature anticoloniale [Pandey, 1990]. Mais (re)-précisons toutefois que la fixation des identités et les affrontements, qui restaient fragmentaires et localisés [Subrahmanyam, 1996, p. 58], entre hindous et musulmans, ne signifiaient pas pour autant que ces communautés nourrissaient nécessairement une hostilité séculaire l'une envers l'autre, qui aurait interdit toute cohabitation, comme le prétendent les essentialistes.
La part de responsabilité plus directe des Britanniques réside dans leur politique vis-à-vis non pas de l'islam, mais plutôt des élites musulmanes. Ou, plutôt, il y eut à un moment donné une collusion d'intérêts entre élites musulmanes et colonisateurs britanniques, tel que le suggère l'exemple des recensements : selon certains auteurs, la formalisation, à partir de la fin du ~ siècle, par le truchement des recensements, de catégories séparées entre hindous et musulmans, contribua à renforcer le nationalisme religieux et à creuser, par voie de conséquence, le fossé entre communautés [Metcalf, 1995]. Si la colonisation n'a pas créé les identités en tant que telles, il est vrai qu'elle
LEs BRITM
les a cristallisées communautés rel que cette formali1 (énumérer pour 1
qui l'accession a privilèges et de de Cipayes de 185~ musulmans avec instigateurs des 1
coloniale vit pro~ du Parti du Con11 rapport aux hind' occidental, se ser tions politiques e: politiques musulr création en 1885, lement hindou et reconnaissaient p qu'il ne parvint pi politiques, mais musulmane. En tc revendications na1 alliés potentiels, considérer les B majorité hindoue. vache les conforta la protection du p telle pour convain
La collusion d musulmanes se m dernières, qui fur tistes, comprenaie1 tout premier lieu. obéissait à des r. inquiétude de cel domination hindo1 vertu de la seule avaient régné six s dans ces inquiétud décriée de «divise demande de la Li~ fraction de ces éli
LEs BRITANNIQUES ET L'ISLAM DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 421
les a cristallisées et figées en systématisant par écrit les catégories de communautés religieuses et de castes. Mais, force est de constater aussi que cette formalisation servit à la fois les intérêts de r autorité coloniale (énumérer pour mieux dominer) et ceux des élites musulmanes pour qui l'accession au statut de communauté permettait de conserver des privilèges et de défendre des intérêts. Rappelons qu'après la révolte des Cipayes de 1857, les Britanniques commencèrent par regarder les musulmans avec suspicion, en les considérant comme les principaux instigateurs des troubles. Mais, à partir des années 1880, l'autorité coloniale vit progressivement en eux un contrepoids face à la montée du Parti du Congrès. Or, les musulmans, en raison de leur retard par rapport aux hindous à s'engager dans les institutions d'enseignement occidental, se sentaient en position défavorable face aux transformations politiques en cours [Markovits, 1994a, p. 437]. Aussi, les élites politiques musulmanes restèrent-elles à l'écart du Congrès lors de sa création en 1885, parce qu'elles le voyaient comme un parti essentiellement hindou et non pan-indien et, par voie de conséquence, ne s'y reconnaissaient pas. L'un des échecs du Congrès réside dans le fait qu'il ne parvint pas à convaincre du contraire non seulement ces élites politiques, mais également une grande partie de la population musulmane. En tout état de cause, les Britanniques, inquiets face aux revendications nationalistes du Congrès, virent dans les musulmans des alliés potentiels, tandis que certains parmi ces derniers tendaient à considérer les Britanniques comme des «protecteurs» face à la majorité hindoue. L'affaire du mouvement pour la protection de la vache les conforta dans cette idée que les musulmans avaient besoin de la protection du pouvoir colonial, et cette affaire fut exploitée comme telle pour convaincre le reste de la population musulmane.
La collusion d'intérêts entre Britanniques et une partie des élites musulmanes se manifeste également dans le fait que celles, parmi ces dernières, qui furent progressivement gagnées par les idées séparatistes, comprenaient essentiellement des modernistes, comme Jinnah en tout premier lieu. Pour lui, on l'a vu, la mobilisation autour de l'islam obéissait à des motivations purement opportunistes. La principale inquiétude de ces élites résidait dans l'idée de se retrouver sous domination hindoue dans une Inde indépendante et démocratique, en vertu de la seule arithmétique électorale, alors que les musulmans avaient régné six siècles durant sur les hindous. Les Britanniques virent dans ces inquiétudes une bonne occasion d'appliquer leur politique tant décriée de «diviser pour mieux régner», en cédant notamment à la demande de la Ligue musulmane qui, pourtant, ne représentait qu'une fraction de ces élites, afin de réserver aux musulmans une partie des
422 LE CHOC COLONIAL ET L'ISLAM
sièges des conseils législatifs: c'est la fameuse loi de 1909, qui établit des électorats séparés pour les hindous et les musulmans. Cette décision était lourde de conséquences pour l'avenir, car elle entérinait la division politique entre les deux communautés. Ce sont donc les changements institutionnels introduits par les Britanniques qui encouragèrent la polarisation politique autour d'enjeux religieux, les Indiens étant encouragés par le système électoral mis en place à voter selon leur confession.
La Ligue musulmane alla ensuite plus loin en revendiquant, à partir des années 1940, c'est-à-dire en fm de compte très tardivement, un État séparé pour les musulmans. Elle s'appuyait sur «la théorie des deux nations», énoncée par Jinnah, en vertu de laquelle hindous et musulmans constituaient des civilisations distinctes incapables de cohabiter l'une avec l'autre. Mais, une fois encore, cette vision essentialiste répondait à des motivations avant tout politiques. Soulignons que les Britanniques, en reconnaissant à Jinnah cette prétention à se poser en représentant de la communauté musulmane tout entière, entérinaient en quelque sorte le discours séparatiste. Ce sont eux également qui, en conférant à l'islam scripturaliste une importance qu'il n'avait pas nécessairement avant leur arrivée, encouragèrent indirectement les leaders musulmans à s'approprier le langage islamique dans leur lutte politique et à confessionnaliser en d'autres termes le mouvement pour l'indépendance, jouant par là-même un rôle d'apprentis sorciers.
Paradoxalement (au moins à première vue), ce n'est donc pas dans l'esprit des élites religieuses, dont le combat en faveur d'un islam scripturaliste répondait à des motifs avant tout idéologiques, que germèrent les idées séparatistes. Pendant le mouvement pour l'indépendance, la plupart des oulémas, les réformistes de la fameuse école de Deoband en particulier, défendirent au contraire l'idée d'un nationalisme unitaire composite, en vertu duquel les hindous et les musulmans formaient une seule nation (qaum), tout en étant divisés en communautés religieuses (millat). Aussi recommandèrent-ils aux musulmans de s'allier aux hindous pour chasser les Britanniques de l'Inde. Cette vision ne plongeait pas seulement ses racines dans le désir de voir les hindous et les musulmans lutter ensemble contre l'impérialisme britannique; elle reposait également sur une hostilité à l'égard du concept de territoire séparé pour les musulmans, contraire à la notion de communauté transnationale des croyants. Outre cette vision panislamique, les oulémas se méfiaient du projet du très anglicisé Jinnah et de la Ligue musulmane, qui défendaient l'idée d'un État pour les musulmans, où ces derniers verraient leurs droits protégés, mais n'envisageaient aucunement l'idée d'un État islamique. Les oulémas ne s'y trompèrent pas et s'opposèrent
LEs BRf.
au mouvemen 2002, p. 33-3' 1' autonomie d multiconfessio importait guèl"l
Jusqu'au 1
communautés Partition inélu virent une escé que s'envenim communautés· jusqu'au point
Les Britan différends entr Partition pour , même probabl avant tout, en l concernant l'a Tous les princi] sables, à des de déroula: Jinna1 1979), le dern] précipitation, f
Gandhi et sa rr Congrès, Nehr probablement préférant un po qu'une confédc voulait Jinnah
Notons, pc personnels par sur les musulm derniers demet au Pakistan, le en 1961, il e~ musulmans in' l'identité mus\ d'autant plus il
7. C'est notam
LEs BRITANNIQUES ET L'ISLAM DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 423
au mouvement pour le Pakistan [Hardy, 1972, p. 243-244; Zaman, 2002, p. 33-37]. Lems efforts se bornaient à assurer la préservation et l'autonomie d'un système juridique islamique au sein d'une société multiconfessionnelle, alors que le séparatisme politique, lui, ne leur importait guère.
Jusqu'au milieu des années 1940, la polarisation entre les communautés n'avait pas encore atteint un stade tel qu'elle rendait la Partition inéluctable. Mais les deux années précédant l'indépendance virent une escalade de la violence entre hindous et musulmans, tandis que s'envenimaient les relations entre les principaux leaders des deux communautés- tout aussi intransigeants les uns que les autres, jusqu'au point de non-retour qui aboutit à la Partition et à ses horreurs.
Les Britanniques contribuèrent sans nul doute à aggraver les différends entre hindous et musulmans, mais ils ne souhaitaient pas la Partition pour autant, pas plus que ne le voulait le Parti du Congrès, ni même probablement Jinnah qui, selon certains historiens, cherchait avant tout, en brandissant la menace séparatiste, à obtenir des garanties concernant l'avenir politique (plutôt que religieux) des musulmans 7 •
Tous les principaux protagonistes de 1' époque furent néanmoins responsables, à des degrés divers, de la Partition et de la façon dont celle-ci se déroula: Jinnah et sa soif inconsidérée de pouvoir, Mountbatten (1900-1979), le dernier vice-roi des Indes, qui, s'il avait agi avec moins de précipitation, aurait pu au moins éviter une Partition aussi sanglante, Gandhi et sa manipulation des symboles religieux, enfin les leaders du Congrès, Nehru (1889-1964) et Patel (1875-1950), qui se montrèrent probablement trop intransigeants vis-à-vis de la Ligue musulmane, préférant un pouvoir central fort au prix de 1' amputation de l'Inde, plutôt qu'une confédération avec un gouvernement central faible telle que le voulait Jinnah [Markovits, 1994b, p. 578-582].
Notons, pour conclure, que l'institutionnalisation des statuts personnels par les Britanniques a continué d'avoir des conséquences sur les musulmans du sous-continent indien après l'indépendance. Ces derniers demeurent, en effet, régis par ce statut aujourd'hui encore. Si, au Pakistan, le statut personnel et familial a été partiellement réformé en 1961, il est demeuré pratiquement inchangé en Inde: pour les musulmans indiens, la chari'a continue d'incarner le symbole de l'identité musulmane et l'enjeu qu'elle représente est perçu comme d 'autant plus important qu'ils se trouvent en situation minoritaire.
7. C'est notamment la thèse dl5fendue par l'historienne Ayesha Jalal, in Jalal, 1985.
424 LE CHOC COLONIAL ET L'ISLAM
~CES BŒUOORAPHIQUES
ANDERSON M. (1993), «lslamic Law and the Colonial Encounter in British India », in ARNOlD D. et ROBB P. (ed.), Institutions and Ideologies, Curzon FTess,!Jondres,p. 165-185.
BRASs P. (1991), Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, Sage, Delhi.
FYzEB A. A. A. (1964, 3• éd. mise à jour, pae éd. 1949), An Outline of Muhammadan Law, Oxford University Press, Londres.
GABORIEAU M. (1993), «<slamic Law, Hindu Law and Caste Customs : a Daughter's Share of Inheritance in the In di an Subcontinent », Annales lslamologiques, Institut Français, Le Caire, t. XXVD, p. 157-168.
-(1994a), «Les États indiens: les sultanats», in MARKovrrs C. (dir.), Histoire de l'Inde moderne, 1480-1950, Fayard. Paris, p. 29-49.
-(1994b), «Akbar et la construction de l'Empire», in MARKovrrs C. (dir.), op. cit., p. 97-114.
- (1994c ), « Société et culture (dans l'empire moghol) », in MARKovrrs C. ( dir.), op. cit., p. 179-205.
-(1994d), «Les transformations culturelles et religieuses (1780-1857)», in MARKovrrs C. (dir.), op. cit., p. 404-409.
- (1999), «La tolérance des religions dominées dans l'Inde traditionnelle : ses prolongements modernes au Népal et au Pakistan», in SAUPIN G., FABRE R. et LAUNAY M., lA tollrance. Colloque international de Nantes (mai 1998). Quatrième centenaire _de . l'Édit. de Nantes, Presses Universitaires de Rennes/Universit6 de Nantes, p. 451-461.
- (2001), «<dentités musulmanes, orientalisme, ethnographie: Faut-il réhabiliter les auteurs coloniaux'!», in RACINE J.-L. (éd.), La Question identitaire en Asie du Sud, Éditions de l'EHESS, Paris, p. 71-89 (Collection Purusartha, no 22).
- Guillet-aoilt 2003), «La partition était-elle inéluctable 7», L'Histoire, n° 278, (numéro spécial Les mystères de l'Inde. Du Bouddha à Gandht), p. 84-87.
IIARDY P. (1972), The Muslims of British India, Cambridge University Press, cambridge.
JAFFRELOT C. (1994), «Réformes socio-religieuses et nationalisme (1870-1948) », in MAR.Kovrrs C. (dir.), op. cit., p. 541-547.
JALAL A. (1985), The Sole Spokesman: Jinnah, the Muslim League and the Demandfor Pakistan, Cambridge University Press, Delhi.
KoZLOWSKI G. (1985), Muslim Endowments and Society in British lndia, Cambridge University Press, Cambridge.
LELYVELD D. (1978), Aligarh s first Generation. Muslim Solidarity in British India,Princeton University Press, Princeton.
MARKOVITS C. (1994a), «L'État colonial et la sociét6 indienne (1858-1914) ,., in MARKovrrs C. (dir.), op. cil., p. 413-437.
-(1994b), «La fin de l'Empire des Indes. La naissance de l'Union indienne et du Pakistan (1942-1950)», in MARKovrrs C. (dir.), op. cit., p. 561-589.
MBTcALF B. (1982), lslamic Revival in British lndia: Deoband, 1860-1900, Princeton Utùversity Press, Princeton.
MBTcALF T. (1995), Ideologies of the Raj, Cambridge University Press, Cambridge.
LESBRITA1
!vfiNAULT G. (1982: Mobilization in
PANDEY G. (1990), Oxford Univen
SCHACHT J. (1966), SUBRAHMANYAM S
State in Pre-0 (ed.), Unravellr Penguins Book
V AN DER VEER P. (l of California Pl
ZAMAN M. Q. (200. Princeton Univ
LBS BRITANNIQUES ET L'ISLAM DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN 425
MINAULT G. (1982), The Khilafat Movement, Religious Symbolism and Political Mobilization in India, Oxford University Press, New York.
PANDBY G. (1990), The Construction of Communalism in Colonial North India, Oxford University Press, Delhi.
SCHACHT J. (1966), An Introduction to Islamic Law, Clarendon Press, Oxford. SUBRAHMANYAM S. (1996), «Before the Leviathan: Sectarian Violence and the
State in Pre-Colonial lndia», in KAusiDK Basu et Sanjay SUBRAHMANYAM (ed.), Unravelling the Nation. Sectarian Conflict and India s Secular Identity, Penguins Books India (P) Ltd, Delhi, p. 44-80.
VAN DER VEER P. (1994), Religious Nationalism: Hindus and Muslims, University of California Press, Berkeley.
ZAMA.~ M. Q. (2002), The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change, Princeton University Press, Princeton et Oxford.
Related Documents