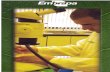Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95. LE SOUCI DE LA POESIE BRESILIENNE À la différence des moments qui l’ont préparée, la poésie qui a suivi la période militaire au Brésil reste nimbée d’une lumière diffuse. On a souvent souligné, non sans pertinence, l’absence de « projet collectif » qui la caractérise. C’est toutefois ignorer ce qui motive le phénomène, dont le dévoilement pourrait nous acheminer vers une autre manière de comprendre le contemporain. À première vue, en effet, la poésie brésilienne publiée à partir des années quatre-vingts semble marquée par un mouvement de retrait, de reflux, si l’on compare la période aux tensions des années précédentes. Il arrive alors fréquemment qu’on republie en livres des ouvrages produits dans les années soixante-dix, en particulier par les poètes de la « poésie marginale » associée à l’ethos du quotidien, tels Cacaso, Chacal ou Francisco Alvim 1 . Leurs écrits, circulant naguère sur des supports souvent précaires, hors des circuits conventionnels, profitèrent d’une reprise du marché éditorial et de l’ouverture politique, parvenant même à intéresser de grandes maisons. La parole changeait de lieu, en même temps qu’elle se fixait publiquement. Se pliant aux modalités du processus culturel, la poésie renonçait aux idéaux de résistance qui l’avaient caractérisée. 1 Cacaso, pseudonyme d’Antônio Carlos de Brito (1944-1987), a été à la fois un des poètes et un des “théoriciens” de la poésie “marginale” carioca. Outre une réédition anthologique par Brasiliense en 1985, Beijo na boca, on retrouvera son œuvre critique dans Não quero prosa (Vilma Arêas, dir., Ed. da Unicamp, Campinas/ Ed. Da UFRJ, Rio, 1997) et son œuvre poétique dans Lero-lero (Rio, 7Letras/ São Paulo, Cosac & Naify, 2002). Chacal (Ricardo de Carvalho Duarte, né à Rio en 1951) a vu son premier fascicule ronéoté, Muito Prazer (1972), repris en 1997 dans une édition commémorative (Rio, Sette Letras). Pour Francisco Alvim, voir dans ce numéro, p.171 sq.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
LE SOUCI DE LA POESIE
BRESILIENNE
À la différence des moments qui l’ont préparée, la poésie qui a suivi la
période militaire au Brésil reste nimbée d’une lumière diffuse. On a souvent souligné, non sans pertinence, l’absence de « projet collectif » qui la caractérise. C’est toutefois ignorer ce qui motive le phénomène, dont le dévoilement pourrait nous acheminer vers une autre manière de comprendre le contemporain.
À première vue, en effet, la poésie brésilienne publiée à partir des années quatre-vingts semble marquée par un mouvement de retrait, de reflux, si l’on compare la période aux tensions des années précédentes. Il arrive alors fréquemment qu’on republie en livres des ouvrages produits dans les années soixante-dix, en particulier par les poètes de la « poésie marginale » associée à l’ethos du quotidien, tels Cacaso, Chacal ou Francisco Alvim1. Leurs écrits, circulant naguère sur des supports souvent précaires, hors des circuits conventionnels, profitèrent d’une reprise du marché éditorial et de l’ouverture politique, parvenant même à intéresser de grandes maisons. La parole changeait de lieu, en même temps qu’elle se fixait publiquement. Se pliant aux modalités du processus culturel, la poésie renonçait aux idéaux de résistance qui l’avaient caractérisée.
1 Cacaso, pseudonyme d’Antônio Carlos de Brito (1944-1987), a été à la fois un des poètes et un des “théoriciens” de la poésie “marginale” carioca. Outre une réédition anthologique par Brasiliense en 1985, Beijo na boca, on retrouvera son œuvre critique dans Não quero prosa (Vilma Arêas, dir., Ed. da Unicamp, Campinas/ Ed. Da UFRJ, Rio, 1997) et son œuvre poétique dans Lero-lero (Rio, 7Letras/ São Paulo, Cosac & Naify, 2002). Chacal (Ricardo de Carvalho Duarte, né à Rio en 1951) a vu son premier fascicule ronéoté, Muito Prazer (1972), repris en 1997 dans une édition commémorative (Rio, Sette Letras). Pour Francisco Alvim, voir dans ce numéro, p.171 sq.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
Parallèlement, l’époque mit en lumière des poètes jusqu’alors méconnus, sans doute parce qu’ils ne correspondaient guère aux références traditionnelles. Des projets poétiques comme l’anti-rhétorique viscérale d’Armando Freitas Filho2 ou l’écriture réflexive et tourmentée d’Orides Fontela3 commencèrent à toucher un public plus large. À mesure que refluaient les positionnements politiquement radicaux, se faisait jour un intérêt pour les arrangements particuliers de matières poétiques contrastantes. C’est le cas pour la « grammaire » naturelle de Manoel de Barros: « Pour se mettre dans la peau d’un arbre il faut partir d’une torpeur animale à 3 heures de l’après-midi, au mois d’août4. » Ou de la mystique du féminin chez Adélia Prado:
Il est des femmes qui disent: Mon mari, si tu veux pêcher, pêche, mais tu nettoieras tes poissons. Moi non. À toute heure de la nuit je me relève, je l’aide à écailler, ouvrir, découper, saler. […] Étincellent des choses argentées : nous sommes de jeunes fiancés5.
Ou de la modestie ironique chez José Paulo Paes:
Jambes pourquoi vouloir de vous ? […] Si j’ai désormais renoncé à aller quelque part.
2 Ce poète, né en 1940 à Rio, a réuni récemment son œuvre, revue, dans Máquina de escrever, Rio, Nova Fronteira, 2003. Voir Anthologie de la nouvelle poésie brésilienne, présentée et organisée par Serge Bourjea, L’Harmattan, 1988. 3 Voir l’anthologie poétique publiée dans ce numéro. 4 Manoel de Barros (Cuiabá, Mato Grosso, 1916), La Parole sans limites (une didactique de l’invention), trad. Celso Libânio, Paris, Jangada, 2003, p. 27 (O livro das ignorãças, 1994). Voir aussi Europe, n° 827, mars 1998. 5 Adélia Prado (Divinópolis, Minas Gerais, 1935), « Casamento » [Mariage], Terra de Santa Cruz [Terre de Sainte-Croix, l’un des premiers noms donnés à la terre « brésilienne » par les Portugais], 1981 (in Poesia reunida, São Paulo, Siciliano, 1991, p. 252). Voir un choix de poèmes dans Pleine Marge, n° 25, mai 1997, et dans Anthologie de la nouvelle poésie brésilienne, op. cit.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
Des jambes ? Une suffit6.
Ou encore de la métaphysique érotique chez Hilda Hilst:
Si je te semble nocturne et imparfaite Regarde-moi encore. Parce que cette nuit Je me suis regardée, comme tu l’aurais fait. […] Regarde-moi encore. Avec moins de hauteur. Plus d’attention7.
De ce supposé « retrait » des enjeux poético-politiques collectifs ne découle pas nécessairement un appauvrissement de la poésie. Non, d’ailleurs, que la poésie brésilienne ait perdu quelque chose (formulation qui relève plus d’un jugement de valeur que de l’analyse) : elle est devenue autre chose, porteuse d’un sens spécifique, en un moment historique nouveau. On assiste aujourd’hui, d’une certaine manière, à un déplacement des critères de reconnaissance du poète, de ce qui l’insère dans une série littéraire et constitue sa « tradition ». Il y a là quelque chose qui change et demande à être compris, avant même de décider de ce qui manquerait ou non. Les valeurs du « modernisme » brésilien – le nationalisme, l’humanisme utopique, le rapport à la « modernisation » – y semblent ébranlées et ne plus suffire à soutenir le sens du nouveau monde qui se présente devant nous.
Quand certains stigmatisent la « pauvreté » culturelle et idéologique de la poésie contemporaine, d’autres diagnostiquent un bond en avant de la qualité moyenne de ce qui se publie. Selon eux, on n’aurait jamais vu autant de bons poètes : on assisterait à une transformation structurelle de la création poétique qui, étant resté au Brésil une manifestation nettement « savante » – comme l’a été le modèle européen du genre poétique –, a toujours relevé de l’exploit personnel, d’une forme de virtuosité, c’est-à-dire de la valeur de l’exception.
Les conditions culturelles ont-elles changé à ce point ? Rien n’est moins sûr. Il n’empêche : quelque chose arrive aujourd’hui à la culture
6 José Paulo Paes (Taquaritinga, État de São Paulo, 1926-1998), « À minha perna esquerda » [À ma jambe gauche – dont le poète avait dû être amputé], Prosas seguidas de odes mínimas [Proses suivies d’Odes minimales], 1992 (in Melhores poemas, São Paulo, Global, 1998, p. 189). 7 Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão [Jubilation, mémoire, noviciat de la passion], São Paulo, Globo, 2001, p. 17.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
qu’on ne peut plus décrire avec les formules d’autrefois. C’est pourquoi l’idée répandue selon laquelle la poésie brésilienne, dans cette épreuve de la diversité et de la pluralité, manquerait de propriétés clairement définies, semble l’aveu d’un désarroi et d’un manque de moyens d’interprétation face à la complexité du présent.
Rappelons que la dernière polémique significative du XXe siècle remonte, au Brésil, à 1985. Il s’agit peut-être du dernier soupir du schisme expérience X expérimentation8. La querelle eut pour ancrage un poème visuel d’Augusto de Campos, « Pós-tudo » [Post-tout], imprimé en majuscules blanches sur fond noir et que Jacques Donguy traduit de façon quasi linéaire par : « J’AI VOULU/ CHANGER TOUT/ J’AI CHANGE TOUT/ MAINTENANTPOST-TOUT/ EX-TOUT/ MUET/ JE CHANGE9. » En apparence, par le « mutisme » annoncé, le poète prétend clore ainsi l’ère des ruptures et des projets collectifs. En fait l’ambivalence demeure avec la polysémie du « mudo » final, qu’on peut traduire aussi bien par « muet », que par « je change », reconvoquant subrepticement la notion de mutation. Quelques mois plus tôt, son frère Haroldo de Campos avait publié un essai annonçant l’ère de la « poésie post-utopique10 ». Cette poésie de la « présentité », et non plus du présent, sonnait le glas de l’esprit d’avant-garde, que les poètes du concrétisme avaient au Brésil incarné plus que tout autre. En dépit d’un diagnostic discutable, cette défense d’une poésie postérieure aux utopies collectives ne laisse pas de doutes : emblématique de l’épuisement des paradigmes d’une époque, elle place les enjeux du contemporain sous le signe d’une multiplicité amorphe.
Doit-on se contenter de le constater ? N’a-t-on le choix, pour évaluer ce qui arrive, qu’entre deux jugements de valeur : l’hypothèse d’un
8 Une partie des pièces du dossier (le poème d’Augusto de Campos, paru dans le supplément « Folhetim » du quotidien Folha de S. Paulo (27 janvier 1985), l’analyse critique de Roberto Schwarz parue dans le même journal, le 31 mars 1985) se trouve dans Roberto Schwarz, Que horas são ?, São Paulo, Companhia das letras, 1987 ; hormis la vive réponse du poète, « Dialética da maledicência » [Dialectique de la médisance], le 7 avril 1985. Signe de la portée de cette polémique, Roberto Schwarz revient encore sur le sujet dans un entretien donné à un magazine émanant de la recherche brésilienne, Pesquisa Fapesp (n° 98), près de vingt ans plus tard, en avril 2004. 9 Augusto de Campos, Anthologie (despoesia), trad. Jacques Donguy, Al Dante, 2002, pp. 120-121. 10 « De la mort de l'art à la constellation, le poème post-utopique », trad. Inês Oseki-Dépré, Banana Split, septembre l985. Il s’agit d’une conférence prononcée par Haroldo de Campos pour les 70 ans d'Octavio Paz, à Mexico, en août l984. Sur Haroldo de Campos, voir plus loin, p.208 sq.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
mouvement d’émancipation de la tradition moderniste, ou celle d’une déchéance face aux valeurs conquises depuis les années vingt ? En fait, ces versions convergent sur un point : l’idée d’une absence de perspective offerte par la poésie d’aujourd’hui, comme si la difficulté de penser ses traits propres fournissait à elle seule la grille de compréhension. Ce postulat déniant tout sens aux événements semble en fait le symptôme d’un malaise théorique, indécis quant à la nature et l’état de la poésie contemporaine. Le sentiment, d’autant plus fort qu’il est largement partagé, pourrait expliquer en partie l’intérêt actuel pour les anthologies et les synthèses sur la « situation » poétique.
Les poètes eux-mêmes ont parfois l’impression de vivre une sorte d’impasse. Conscients que « la nation », « le sujet », « l’expérimentation », « le nouveau » etc., ne permettent plus de donner sens à un projet poétique, les jeunes auteurs ne sont pas pour autant en mesure d’apporter des réponses générales, en dépit de leurs vœux. Et pourtant le souci est là, comme l’indiquent ces vers de Carlito Azevedo :
Personne n’est le même Après un cataclysme. Moins que spasme, Plus que marasme, Il reste ce souci11.
L’IMPASSE DE LA MODERNISATION
Ce quelque chose de l’ordre de l’embarras, qui marque la poésie brésilienne des deux dernières décennies, n’empêche pas (c’est même souvent le
11 Carlito Azevedo, « Cataclisma », Collapsus Linguæ, 1991 (2e éd. revue : Rio, Sette Letras, 1998, p. 41). Le terme final « cisma », qui rime avec « cataclisma », est extraordinairement polysémique, son sens pouvant aller ici du souci à l’inquiétude, en passant par la préoccupation, la méfiance, le soupçon, voire la rêverie, l’imagination…, autrement dit signale une posture intellectuelle d’attention.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
contraire !) qu’on lui reconnaisse une expérience digne de la crise (ainsi désigne-t-on d’ailleurs, parfois, cet embarras) qui fonde la modernité. Les événements qui la précipitent sont certainement très hétérogènes entre eux et il ne faudrait se méprendre ni sur l’importance des faits politiques nationaux (l’amnistie, le « retour à la démocratie »12…), ni sur le poids de l’actualité mondiale (la chute du communisme, puis cette occidentalisation des rapports qu’on appelle « mondialisation »). Tant du point de vue politique que des données technologiques, l’horizon de la poésie et de la littérature s’inscrit dans un renouvellement de la situation culturelle dont on mesure encore mal les retombées. Cependant, les situations instables (historiquement, poétiquement) ouvrent des brèches où s’engouffre volontiers la poésie et où ne se manifeste peut-être jamais plus clairement le sens du rapport au contemporain. Nous nous contenterons, ici, de signaler ce qui peut affecter la tradition poétique brésilienne.
En premier lieu, la dénégation par certains poètes de leur lien avec la tradition qui les précède souligne que quelque chose est en jeu du rapport à l’héritage, fondé en l’occurrence sur la fracture entre poésie concrétiste, sémiotique, technologique, formaliste d’une façon générale, et poésie du quotidien, celle qui cherche à s’inspirer du populaire, éditorialement marginale, critiquant le rôle conservateur de la modernisation au Brésil. Pendant près de trente ans, pour des raisons en partie politiques, mais en partie seulement, c’est cette ligne de partage qui s’est imposée. Il n’est pas simple d’y échapper, comme en témoigne un jeune poète qui, tout revendiquant une « parenté » avec les idéaux concrétistes de la poésie visuelle, déclarait récemment dans un quotidien qu’il n’aimerait pas avoir à « hériter d’une discussion qui n’est pas la [s]ienne ». Paradoxe émouvant de spontanéité, qui affirme à la fois la continuité et la rupture de l’héritage.
Il arrive pareillement à beaucoup de poètes, depuis une dizaine d’années, de se chercher des filiations par-delà le passé immédiat, au sein du canon moderniste : Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Murilo Mendes… Quels effets attendre d’un tel refoulement qui « ignore » la génération qui leur est
12 Le régime militaire issu du Coup d’État de 1964 a engagé un lent et progressif retour à la démocratie à partir du milieu des années soixante-dix. En 1980, les militants politiques condamnés par la dictature (ainsi que les tortionnaires du pouvoir) ont été pour la pluspart amnistiés, ce qui a permis le retour au pays de nombreux exilés. La restauration d’un régime civil n’a eu lieu qu’en 1985.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
chronologiquement la plus proche, fertile en idées sur la poésie ? Certes les discours d’avant-garde exercent encore leur pouvoir de contrôle ici et là, ressassant la sempiternelle quête du « nouveau » au moment même où le conservatisme néoclassique reconquiert d’importants prix littéraires. Mais surtout règne, dans ce que la poésie brésilienne a aujourd’hui de meilleur, comme une hésitation méfiante (« cisma »), une attention soucieuse et vigilante face à ce qui apparaît comme les traumas du passé récent. Auprès de cela, anthologies, revues militantes ou « lettres ouvertes » sur la poésie (assez rares, il faut bien le dire) font pâle figure.
On a peut-être oublié ce que fut la puissance de feu de la « pédagogie poétique » concrétiste, en termes de théorie, de redécouverte des poètes brésiliens, de traduction des poètes étrangers, à partir des années cinquante. Elle a si fortement marqué son temps qu’elle en ébranla les piliers vivants de la tradition moderniste, au point que Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade et d’autres aient à leur tour expérimenté la manière concrétiste, pas toujours au second degré. L’impact fut tel qu’il marqua un grand nombre de débutants, dans les années soixante. Au même moment, des intellectuels d’inspiration marxiste, rétifs à « l’importation » d’une technique conçue à leurs yeux en termes capitalistes, vont se retrouver proches d’une série de manifestations poétiques occupant les années soixante et soixante-dix. Ferreira Gullar13, par exemple, après avoir participé aux prémices du concrétisme, a fondé son projet poétique en s’opposant très fermement à l’artificialité des avant-gardes. Cette guerre, jamais assez froide, regorge de subtilités qui dépassent le cadre de cet essai. Il suffit de rappeler qu’elle s’impose comme un vrai cataclysme au milieu du XXe siècle, avec vraisemblablement des conséquences à rebours sur une façon de lire les poètes modernistes qui surdétermine leur questionnement du rapport entre technique et quotidien, artifice et simplicité.
Ces tremblements de terre, et leurs implications esthétiques et idéologiques, ont instauré de telles dissensions que les blessures ouvertes au sein du corpus poétique semblaient dès lors interdire d’écrire hors d’un champ balisé, dont les enjeux étaient décidés d’avance. Sortir de ce modèle a imposé, non moins dramatiquement, à la nouvelle poésie brésilienne de retrouver une voix propre, mission tout à la fois banale (que peut-on demander d’autre à un poète ?) et exorbitante (car c’est aux
13 Voir plus loin, p.146 sq.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
poètes et à eux seuls qu’on le demande). Autrement dit, tout se passe comme si la poésie devait s’expliquer sur l’impasse de la technique pour pouvoir commencer à parler ; comme si, par sa seule manifestation, elle devait se mesurer à l’ampleur des questions qui la précèdent. Chez bien des poètes, cette préoccupation relève du topos, de sorte que l’inflexion qu’ils donnent à la question du rapport à la « formalité » (technologique, modernisante, poétique) sert de critère pour juger de l’accès ou non de la poésie actuelle au devenir de sa voix.
AFFRONTER LES RUINES
La génération qui a suivi ces séismes, celle publiant dans les années quatre-vingts, en a été encore marquée. Préoccupée par sa mission paradoxale : se faire autre dans le même, cette poésie s’est caractérisée par une réévaluation des héritages, qu’elle s’attachait à traverser de son propre élément. C’est pourquoi, souvent, il importe moins d’y reconnaître les filiations que la part du legs prise en considération par chaque poète, dont les plus remarquables surent éprouver au plus près le désaccord, la tension conflictuelle entre formalisme et informalité, et ressentir les difficultés propres aux projets qu’ils s’étaient eux-mêmes donnés au départ.
Ce fut le cas d’Ana Cristina Cesar et de Paulo Leminski dont les poétiques, bien que prenant forme dans les années soixante-dix, ont dû attendre le début des années quatre-vingts pour se voir publier en recueils de grande circulation.
Malgré la brièveté de sa trajectoire, Ana Cristina Cesar est certainement un des noms les plus passionnants de la poésie de cette époque. Son œuvre a exploré le caractère déchirant du désordre moral et esthétique de l’expérience contemporaine, avec un parti pris très clair en faveur de l’expérience vécue, en affinité avec l’univers poétique et les propositions de la poésie marginale :
Le temps se couvre. Je suis fidèle aux événements biographiques. Plus que fidèle, ah, si captive ! Ces moustiques qui ne nous lâchent
pas ! Mes saudades qu’assourdissent les cigales ! Qu’est-ce que je fais ici en pleine campagne à déclamer au kilomètre des vers longs et plaintifs ? Ah comme je suis plaintive et portugaise, et maintenant c’est fini,
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
regarde, je ne suis plus sévère ni revêche : maintenant je suis professionnelle14.
Cependant, au moment même où il s’énonce (dans l’obsession du trait autobiographique), ce projet est pris à contrepied, presque à contre-courant, en ce qu’il voit nier l’anti-intellectualisme et la spontanéité en vogue. L’expression spontanée y reçoit le qualificatif parodoxal de « professionnelle ». Ses dispositifs de mise en place des conflits, à savoir concentration et construction, ne servent nullement à composer une lucidité poétique apollinienne, à la façon de João Cabral, mais un phénomène d’excès et de dissonance cohabitant avec la logique du corps. Se faisant biographie (« Autobiographie, non. Biographie », dit un poème15), le rapport à l’expérience vécue, quotidienne, déplace la position du sujet vers un lieu qui n’est pas le simple artisanat poétique, mais devient objet d’une interruption que les poèmes traitent à de multiples niveaux. L’artifice interrompt le flux spontané de l’expérience, de même que la matérialité formelle du « corps du poème » est interrompue par l’irruption du corps :
je regarde longtemps le corps d’un poème jusqu’à perdre de vue ce qui ne serait pas corps et sentir séparé entre les dents un filet de sang sur les gencives16
Tandis que je lis mes seins sont à découvert. Il est difficile de me concentrer en voyant leurs pointes. […]17
Cette poétique de l’interruption devient la trace d’un passage tumultueux par une conception du poétique fondée sur l’idée de l’écoulement biographique (dans son sens sentimental ou dans son inflexion politique), se déversant au sein du poème-contenant. L’interruption met le projet en court-circuit et en indique les
14 Ana Cristina Cesar (Rio, 1952-1983), Gants de peau & autres poèmes, trad. Michel Riaudel et Pauline Alphen, Chandeigne, 2005, pp. 8-9 (A teus pés, 1982). Voir aussi La Quinzaine littéraire, n° 484, 16 avril 1987 ; Anthologie de la nouvelle poésie brésilienne, op. cit. ; Europe, n° 748-749, août-septembre 1991 ; Infos Brésil, n° 85, octobre 1993 ; Digraphe, n° 70, Mercure de France, sept. 1994 ; Europe, n° 827, mars
1998 ; Sigila, n° 2, octobre 1998 ; Action poétique, n° 155, 2e trimestre 1999.
15 A teus pés, 1982, p. 7. 16 Ibid. (Cenas de abril), p. 59. 17 Inéditos e Dispersos, 1985, p. 94.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
contradictions, qui finissent par s’identifier au destin de la poésie et du poète eux-mêmes.
Suivant une autre voie qui gagne néanmoins à être analysée en parallèle, Paulo Leminski porte lui aussi des marques très claires des forces poétiques en action. Poète et traducteur, il s’est littérairement construit dans la proximité (personnelle et poétique) des concrétistes. Le recours à l’élément visuel, l’obsession paronomastique et des jeux phonétiques, les déclarations rejetant le mimétisme des tenants de la « réalité » – ce « baixo astral18 », déclare un poème – en font l’un des principaux élèves de l’école concrétiste. Cependant quelque chose d’essentiel à sa poésie, relevant de son aventure singulière, le situe en des lieux très hétérogènes, voire contradictoires. Sa façon d’utiliser la dimension visuelle, les « charades » formelles, est décalée par rapport à l’usage concrétiste. Plus hétérodoxes encore du formalisme et de la langue savante du concrétisme sont ses contacts avec la culture des médias, l’exotisme oriental (Leminski se montre habillé en samouraï et écrit des haiku), la chanson populaire et l’hétérogénéité des registres. Chez lui, une sorte d’hédonisme s’oppose à l’ascétisme de la structure et fait bien souvent dérailler la forme vers une critique de la planification et de l’absence de sujet. À propos de Brasília, symbole pour les poètes concrétistes de la construction programmée, Leminski dit préférer « l’erreur » à la « loi », le sang qui coule entre les pierres à leur agencement. Le titre du poème où se trouve cette affirmation est déjà en lui-même tout un programme : « Claro calar sobre uma cidade sem ruinas. (Ruinogramas)19 ». Contre la positivité formaliste, Leminski réintroduit souvent une négativité dont la figure centrale est la dégradation (évidement, dilution, effacement, destruction) :
m’effacer me diluer me démanteler
18 Littéralement : « astral bas », soit « sous les astres », mais aussi par métaphore astrologique, « moral bas », « déprime ». 19 « Claro calar » joue avec le « clair de lune » (luar) : ce qu’on pourrait traduire par « Clair de silence sur une ville sans ruines. (Ruinogrammes) », le dernier terme évoquant à la fois le formalisme de la structure et l’hexagramme du Yi King. In : Paulo Leminski (Curitiba, 1944-1989), Distraídos venceremos [Distraits nous vaincrons], São Paulo, Brasiliense, 1987, p. 39. Rappelons que le chantier de la nouvelle capitale, à la fin des années cinquante, fut payé d’un lourd tribut en vies humaines.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
jusqu’à ce qu’ensuite de moi de nous de tout il ne reste plus que le charme20
D’une certaine manière, cette dégradation figure non seulement la poésie de Leminski, mais les valeurs qui l’ont rendue possible, au moment où la poésie brésilienne tente de « traverser » les problèmes qui sont les siens et ne suffisent plus à la définir.
Si l’œuvre de certains vit intensément, de l’intérieur, cette désagrégation des valeurs politico-poétiques, d’autres comme Arnaldo Antunes et Manoel de Barros – aussi différents soient-ils – adoptent une espèce de position régressive ou plutôt de retrait, non au sens téléologique du discours des avant-gardes, mais en récupérant activement, positivement, certains traits oubliés : notamment un « primitivisme » du sens et du style.
Connu du grand public d’abord comme chanteur, Arnaldo Antunes commence à publier des recueils de poésie à la fin des années quatre-vingts, en explorant l’élément visuel, puis en croisant divers supports, la technologie des médias et l’arsenal des écritures formalistes. Cependant, dans un regard plus attentif, ses textes les plus réussis témoignent d’une dette envers la poésie objective, à la manière pongienne de la « leçon de choses » :
Le profil est un fil. Le profil est la fin de l’objet. L’horizon est couché. La fin est ce qui est achevé. Le profil est ce qui est de côté. L’horizon est distant. La fin est devant nous. Le profil est ce qui longe. L’horizon est plus avant. Là où le ciel se replie. L’eau de la mer déborde. La fin est ce qui ne fait pas retour. Le profil est le contour. Le profil est creux. La fin est ce qui se transforme. Enfin la fin est là. Le profil est ce qui est contre. L’horizon est une croûte. La terre est un plateau. Là où la mer se jette. Le profil est un sein. L’horizon est entre les deux. La fin est proche. La maison finit avec le toit. L’enfant finit avec le petit-enfant. La fin est un fœtus. L’horizon est la fin de la terre. Là où le ciel s’achève. Le profil est un visage. Le
soleil est couché21.
20 Caprichos e relaxos [« capricho » désigne à la fois le soin, le zèle et le caprice ; « relaxo » associe le relâchement et le repos], São Paulo, Brasiliense, 1983, p. 64. 21 Arnaldo Antunes (São Paulo, 1960), As coisas [Les choses], 1992 (8e éd. : São Paulo, Iluminuras, 2002, p. 39). Ce poème est écrit à quatre mains, avec le parolier Nando Reis.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
Comme pour la dimension visuelle, qui flirte souvent chez lui avec la calligraphie, le calligramme, les formes organiques (autant d’éléments « naïfs » au vu de la forme graphique et fonctionnelle du concrétisme), l’héritage de la poésie objective marque une sorte de retrait face à l’« évolution » supposée de la visualité et de la fonctionnalité formelle : la nomination « substantive » du poème fait un pas vers la rigueur constructive, tout en inversant l’avancée historique de la poésie vers sa disposition iconique. Tout se passe comme si le poète revenait à un état « naïf », primitif, « tribaliste22 ». Le mot n’est ni innocent ni étranger à l’iconographie qui accompagne les livres et les disques d’Arnaldo Antunes. En même temps que le langage se spécialise dans une fonction presque scolaire : la définition (« Un champ est fait de terre. Et de choses plantées dedans. La terre peut s’appeler sol. C’est tout ce qui se voit si le champ est un champ de vision23 »).
le poème fait coïncider le recours maximum à la technologie appliquée et le retrait le plus extrême de la syntaxe, c’est-à-dire de sa capacité linguistique à formaliser du sens. Le primitif, l’enfance, l’ignorance viennent figurer cette régression par laquelle la poésie relance et renouvelle l’usage des technologies les plus avancées, tout en dédramatisant les enjeux du métalangage savant et programmatique et en écartant les débats sur la portée culturelle de la poésie. Ainsi, la poésie technologique du contemporain paraît renoncer au projet humaniste propre à la poésie des avant-gardes qui l’avait précédée.
Chez Manoel de Barros, l’aspect primitiviste d’un recours massif aux éléments locaux (naturels, à tout le moins, et surtout « insignifiants ») est déjoué par une très féconde machine syntaxique produisant du sens par « délire ». Discrètement à contre-courant de l’anti-humanisme contemporain, le poète revendique une « didactique de l’invention » (et de la transformation active du regard), relevant aussi bien, comme chez un João Cabral ou un Guimarães Rosa, de la stylisation (très réussie) du paysage ou du langage régional, que de l’alchimie du verbe de Rimbaud ou de la métaphysique négative de Pessoa. Ces références hétérogènes expliqueront peut-être l’étrange trajectoire de ce poète, né en 1916, qui n’a été connu d’un large public qu’après la réunion de plusieurs de ses recueils, en 1990. Or c’est bien parce que la situation actuelle en a
22 Nom d’un disque qui réunit Marisa Monte, Carlinhos Brown et Arnaldo Antunes : Tribalistas. 23 As coisas, op. cit., p. 18.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
finalement permis la lecture qu'il peut être rangé dans les représentants de la poésie « contemporaine ». Le retentissement immédiat de son œuvre n’est imaginable qu’après le déclin des critères poétiques des années soixante, soixante-dix, qui a laissé le champ libre aux projets apparemment excentriques. Car cet univers demeure très étranger à la tradition moderniste, à ses questions et aux enjeux politiques qui l’accompagne. En guise de matériau, le poète ne revendique plus l’expérience vécue ni le goût de l’expérimentation formelle, mais une complicité avec les éléments les plus « inutiles », les restes délaissés par la culture et la modernité technique :
MATIERE DE POESIE
1.
Toutes les choses dont la valeur peut être décidée au crachat à distance servent à la poésie L’homme qui possède un peigne et un arbre sert à la poésie Un terrain de 10 x 20, sale de ses friches – ceux qui en lui gazouillent24 : des
déchets qui se déplacent tout seuls, des boîtes de conserve servent à la poésie Une Chevrolet poisseuse Une collection de scarabées abstinents La théière de Braque sans bec sont bons pour la poésie Les choses qui ne mènent à rien sont de grande importance […]25
Préférant l’image au nom (qui l’appauvrit), l’enfance à l’âge de raison, le dictionnaire aux livres savants, le poète suggère une simplicité qui, sans
24 Formule rappelant deux vers célèbres de la « Chanson de l’exil », de Gonçalves Dias, souvent parodiés (Anthologie de la poésie romantique, trad. Adrienne Álvares de Azevedo Macedo, Didier Lamaison et Cécile Tricoire, Eulina Carvalho-Unesco, 2002, pp. 24-25). 25 Gramática expositiva do chão (Poesia quase toda) [Grammaire expositive du sol (Presque toute la poésie)], Rio, Civilização brasileira, 1990, p. 179 (1ère éd. : Matéria de poesia, Rio, Livraria São José, 1974).
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
être insensible aux douleurs du monde (« Les choses au rebut/ sont de grande importance/ – comme un homme au rebut », Gramática expositiva do chão), évite d’aborder certains points cruciaux, comme en témoigne son approche quelque peu nostalgique d’une langue édénique :
Désinventer des objets. Le peigne, par exemple. Attribuer au peigne des fonctions de non-peigner. Jusqu’à le prédisposer à
devenir bégonia. Ou taillis.
Utiliser quelques mots qui n’ont pas encore d’idiome26.
Quoi qu’il en soit, c’est en faisant de l’origine un problème que l’œuvre de Manoel de Barros paraît se rapprocher des états actuels de la poésie.
LA POESIE DES PASSAGES
On doit, pour parvenir à sortir de l’impasse concernant, au Brésil, le sens à donner à la modernisation, reconnaître les ressorts poétiques et politiques de la question. Même s’il n’est pas raisonnable d’imposer cette tâche au seul poète, la poésie doit pouvoir nous intéresser à ces problèmes et nous amener à penser les catégories à notre disposition – la « réalité », le « sujet », « l’origine », le « sens » – en nous enseignant une certaine façon de lire le monde. Souvent vue comme expression ou formalisation des structures composant sa situation (sociale ou esthétique), la poésie est aussi porteuse d’une force de « dramatisation » des difficultés du présent qui appellent à refonder du sens. Le poème ne peut contrarier le regard sur le réel qu’en perturbant et décevant le sens stable et univoque, s’imposant aussi de réagir à ce qui reste à comprendre. Et il reste à comprendre en matière de poésie contemporaine non pas au nom d’une prétendue prudence – d’ores et déjà entérinée le sens commun – sur le caractère forcément inaccompli de l’actualité, mais parce qu’elle dramatise une certaine angoisse du sens.
Il est deux poètes brésiliens chez qui ce désarroi est potentiellement riche de conséquences pour ce qui est de notre rapport à la réalité et à la poésie. Reste à savoir quelle puissance de déplacement il y revêt.
Comme Manoel de Barros, Sebastião Uchoa Leite a débuté bien avant les années quatre-vingts : son premier recueil date de 1959. Néanmoins, la réunion de ses poèmes, en 1988, dans la collection « Claro Enigma »,
26 La Parole sans limites, op. cit., p. 21.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
constitue une référence importante dans sa trajectoire. Obras em dobras (1960-1988), c’est le titre du volume27, a permis en effet de réarticuler et d’approfondir la lecture de son œuvre et des figures qu’elle met en place, en s’émancipant des traits jugés caractéristiques des années soixante qui privilégiaient les textes d’inspiration concrétiste, et ceux des années soixante-dix, souvent adossés à la culture des médias. Sebastião Uchoa Leite a préféré à ces grilles l’obliquité du regard, celle qui guette et insinue, rejetant « l’exhibitionnisme » et le « dogmatisme » des grandes affirmations poétiques. Ses vers cessent d’être une arme dans la guérilla culturelle, pour devenir une espèce de poison énigmatique instillé par le serpent du poème. Il ne faut y voir là nulle manière oblique d’affirmer, la poésie se confrontant au sphynx labyrinthique du mensonge. D’ailleurs, comment dire « je mens » sinon en le faisant suivre d’un point d’interrogation, comme dans le poème « Anti-méthode 228 » ? Dans un univers de « jeu » conçu comme « piège », la différence entre le passif et l’actif devient problématique, l’illusionnisme et la magie figurent une « règle secrète » où l’on ne sait ce qui importe le plus, de la simulation de la difficulté ou de la fiction de la solution. La magie escamote le procédé technique faisant passer de l’impossible au possible. Souffrant du vertige exacerbé de l’ironie et de l’auto-ironie, la vie, la mort sont des fictions, comme le suggère le titre d’un recueil, A ficção vida :
ANNOTATION 1 : L’OISEAU CRITIQUE
Mozart avait un étourneau Qui imitait sa musique Ce n’est pas tout : une parodie Ou désaccord D’oiseau railleur Se jugea une fois morceau De Mozart en personne Défiant toute harmonie
27 São Paulo, Duas Cidades, 1988. Plus généralement, en publiant treize poètes entre 1988 et 1990, la collection « Claro enigma », dont le fondateur Augusto Massi a choisi le titre en référence à un recueil de Carlos Drummond de Andrade, a été un jalon marquant de ce processus de réévaluation des œuvres poétiques contemporaines. 28 A Regra secreta [La règle secrète], São Paulo, Landy ed., 2002, p. 62.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
Éternuement musical Comme si le compositeur Se moquait de lui-même Devenant alors, le musicien, Son étourneau moqueur29
Les contradictions introduites dans ces vers approche la poésie de sa perte. Les poèmes sont des « notes », des « ébauches », leur écriture joue de l’improvisation, rejette le regard poétisant, les tournures rhétoriques « élégantes » et recherchées. Ces mécanismes d’ellipse de l’exhibitionnisme poétique confrontent le lecteur à la technique du joueur magicien et à la déchéance imminente de sa qualité de sujet, incapable qu’il est de donner sens au jeu du monde et de la poésie : « Personne ne sait finalement qui a convaincu, quand le performer se retire, toujours occulte, sur la civière, retournant à son origine30 ».
Plus jeune, Carlito Azevedo commence à publier dans les années quatre-vingt-dix. C’est alors un poète proche des stylèmes du concrétisme, et dont le regard se tourne en même temps vers le quotidien, notre monde, « sublunaire » dit le titre de son dernier recueil31. Sa poésie semble brouiller, autant qu’elle la défie, la ligne de partage à laquelle s’était habituée la poésie brésilienne. Chez lui, la vie de tous les jours n’est plus simplement le familier, mais ce qui inquiète, est étrange. Par ailleurs, la spatialité, présente dès les premiers poèmes, se tourne souvent vers la peinture et le « modèle vivant » pour formuler le rapport au problème du visible. Relevant à la fois de la manifestation du vécu et du domaine de l’art, « l’éclair » finit par résumer ces modes d’ouverture de la réalité. La chose « vivante » est ici rapprochée non d’une conception déterminée de la vie, mais de ce qui lui fait défaut dès l’origine, de ce qui, sur ses bords, ne se produit pas en tant que tel : la géométrie et sa « désertion » :
OUVERTURE
De cette fenêtre s’est domestiqué à l’équerre l’infini depuis le lointain au-delà, où le pourpre sur la montagne
29 Sebastião Uchoa Leite (Timbaúba, Pernambouc, 1935 – Rio, 2003), A ficção vida, São Paulo, editora 34, 1993, p. 63. 30 « O artiste e o coyote » [L’artiste et le coyote, en référence à une performance de Joseph Beuys], A ficção vida, op. cit., p. 42. 31 Carlito Azevedo (Rio, 1961), Sublunar, 7Letras], 2001.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
s’élève comme une fumée s’échapperait du bois, jusqu’ici, en cette fleur tranquille sur le parapet – sur les bords de laquelle se lisent les premières désertions de la géométrie32.
De cet espace intermédiaire (fenêtre, battants, bordures) découle un
intérêt pour ce qui passe, le passage ou, mieux, « la passante » – thème baudelairien réinscrit dans l’isthme reliant une origine défaillante et une arrivée incertaine. Le vertige de ce passage se manifeste dans l’éclair. La foudre, lumière imprévue, n’y est pas figure de l’illumination poétique, restée dans la « nuit grise », mais tout au plus dramatisation de son événement. Car, pour le poème, l’explosion de ce qui a lieu ne se sépare pas de ce qui n’est pas arrivé (« Liliana Ponce n’a pas oublié sa veste dans le salon de thé/ Liliana Ponce ne portait même pas de veste […]33 ») ; le feu n’échappe pas à la glace ; la mobilité est fixe. Les oxymores essaient d’atteindre la circulation du vertige (« qu’on en soit à la fin ou à son origine34 ») et la lucidité du poème se veut résistance à la « tentation » de fixer le délire : « L’idée est de ne pas céder à la tentation / d’écrire le poème de ce non- / lieu […]35 ».
Si le rapport à la tradition moderniste est toujours à l’horizon, certains poètes ouvrent, on le voit, de nouvelles pistes en lien avec l’expérience du présent. Ceci devrait inciter non seulement à repenser la poésie contemporaine, mais aussi à creuser ou déplacer la discussion sur la compréhension de ce qui, de fait, échappe, à en juger par les recensions et les critiques. Se défiant chaque fois plus de la tradition héritée par, par exemple, Ana Cristina Cesar et Paulo Leminski, il arrive que la poésie fasse du réel non plus une hypothèse mais un problème. C’est ainsi que Sebastião Uchoa Leite termine un poème douloureux, justement intitulé « Réalité36 », sur une exquise ironie : « Je me suis réveillé le jour suivant sans avoir rêvé / C’était simple réalité ».
Cette réalité redécouverte dans la dénonciation de son théâtre pourrait-elle aider à repenser la situation et le sens de la poésie ? Pourrait-elle
32 As banhistas [Les baigneuses], Rio, Imago, 1993, p. 13. 33 Versos de circunstância [Vers de circonstance], Rio, 7 Letras, 2001. 34 « Ao rés do chão » [Au ras du sol], Sob a noite física [Sous la nuit physique], Rio, Sette Letras, 1996, p. 19. 35 Idem. 36 « Realidade », A ficção vida, op. cit., p. 17.
Europe (Revue Littéraire Mensuelle), Littérature du Brésil, nov.-déc. 2005, p.74-95.
réorienter, au Brésil, le rapport à la « modernisation conservatrice », ou ne fait-elle que creuser encore un peu plus la question ? Rien n’est tranché d’avance, tout reste ouvert, de la dispersion de l’esprit critique à l’indication de nouvelles voies concernant notre rapport au monde. Reste une nécessité, aujourd’hui, pour la poésie brésilienne : qu’elle fasse le pas vers son (avoir) lieu. À la pensée, il revient d’accueillir ce souci de déplacement du poème en le laissant faire l’épreuve de ses nouveaux paradigmes. S’il ne s’agit plus simplement d’attribuer des lieux d’origine aux choses et aux idées (qu’ils aient noms « moi », « nation », « homme », « poésie » ou « art ») pour mieux en dénoncer, ensuite, les déplacements illégitimes, c’est que sont mis en cause les conditions même de la légitimité de cette appartenance aux lieux, ou même qu’est interrogé ce que veut dire : lieu, avoir lieu.
Un certain malaise pourrait contribuer à identifier les blocages contemporains si le sentiment d’épuisement, exacerbé, ne finissait par se plier au jeu « culturel » des institutions. Celles-ci réduisent en effet la diversité au catalogue (fuyant la confrontation) et se soucient davantage de promouvoir des individus que de former le public. En tout cas, le climat quelque peu mélancolique de la critique actuelle, reprochant aux poètes de ne pas poser de « grandes questions », signale clairement que les questions ont changé ou qu’elles sont sur le point de le faire. L’insignifiance du monde, la confiscation du sens, la privation de monde, sont les conditions de nouveaux événements, s’ils ne se sont déjà produits. La vitalité inouïe de la poésie brésilienne, que l’on constate aujourd’hui dans les revues, à travers la circulation des lectures et des opinions, doit nous rendre attentifs à ce qui peut avoir lieu. Qu’on lui confie la responsabilité du sens du contemporain montre que, pour beaucoup d’entre nous, même dans la « détresse », la poésie reste un lieu de promesse et de maturation de ce qui advient.
Marcos SISCAR
Related Documents