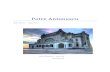Chapitre X : L’agencement musical des voix 1 L’AGENCEMENT MUSICAL DU PETRE CLEMENS Lorsque nous avons traité de ce genre de motet qu’est le motet que nous avons appelé d’exhortation (Chapitre 1), nous avons vu que les procédés d’écriture de cette forme étaient grandement complexes. Le Petre Clemens n’échappe pas à la règle. Les procédés d’analyse des motets médiévaux définis par Bernard Vecchione suivent l’ordre des opérations de composition auxquelles semblent s’être livrés les compositeurs de motets médiévaux. Celui-ci commence par l’étude de l’« inventio » du Ténor, avant d’en venir à l’analyse de la « compositio » des voix chantées, 1 en partant de leurs textes et de leurs sous-textes, pour aller à leurs mises en musique, puis aux relations entre musique et matériau littéraire pris en son ensemble, textes et hypotextes. On procédera donc à l’étude de l’agencement musical du Petre Clemens en commençant par s’interroger sur la nature, l’origine, la réécriture par Vitry et le rôle du Ténor, puis en tentant de comprendre son importance au plan des interactions avec les autres voix, musiques et textes. L’ « inventio » du Ténor Le Petre Clemens est un motet composé au plus haut de la carrière de Vitry, dans une période politiquement stratégique pour le pape Clément VI. Bien que purement instrumental, le choix d’un emprunt avant réécriture pour le Ténor doit être particulièrement lié à cette circonstance qui a suscité la composition de l’œuvre et qui est la démonstration de la légitimité de l’exercice de Clément VI dans son siège d’Avignon. Mais qu’est ce qu’une œuvre musicale peut apporter à un pontife pour l’expression des grands axes de ses conceptions politiques ? Par quels moyens singuliers l’œuvre musicale peut-elle exprimer sens, parole, discours, et agir sur des auditoires ? Par quels moyens, ostentatoires, liturgiques, littéraires, musicaux, interactifs, l’œuvre exprime-t-elle un message et vise-t-elle à en persuader des auditoires ? Et à quels auditoires aussi cette œuvre s’adresse-t-elle – sachant, comme Vecchione l’a montré pour les motets de circonstance qu’il a étudiés, que ces œuvres à la fois liturgiques et politiques s’adressent simultanément à un double auditoire : de la Terre et du Ciel (ce qui pour lui expliquerait la nature de double discours qu’elles tiennent, par la surface, le paraître, destiné aux contemporains de la Terre, et par les sous-jacences, les 1 Selon les termes mêmes des théoriciens de la musique aux alentours des années 1360, comme, pour définir sa méthodologie, le remarque Bernard Vecchione (op. cit.).

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Chapitre X : L’agencement musical des voix
1
L’AGENCEMENT MUSICAL DU PETRE CLEMENS
Lorsque nous avons traité de ce genre de motet qu’est le motet que nous avons
appelé d’exhortation (Chapitre 1), nous avons vu que les procédés d’écriture de cette
forme étaient grandement complexes. Le Petre Clemens n’échappe pas à la règle.
Les procédés d’analyse des motets médiévaux définis par Bernard Vecchione suivent
l’ordre des opérations de composition auxquelles semblent s’être livrés les
compositeurs de motets médiévaux. Celui-ci commence par l’étude de l’« inventio » du
Ténor, avant d’en venir à l’analyse de la « compositio » des voix chantées,1 en partant de
leurs textes et de leurs sous-textes, pour aller à leurs mises en musique, puis aux
relations entre musique et matériau littéraire pris en son ensemble, textes et
hypotextes.
On procédera donc à l’étude de l’agencement musical du Petre Clemens en
commençant par s’interroger sur la nature, l’origine, la réécriture par Vitry et le rôle
du Ténor, puis en tentant de comprendre son importance au plan des interactions
avec les autres voix, musiques et textes.
L’ « inventio » du Ténor
Le Petre Clemens est un motet composé au plus haut de la carrière de Vitry, dans une
période politiquement stratégique pour le pape Clément VI. Bien que purement
instrumental, le choix d’un emprunt avant réécriture pour le Ténor doit être
particulièrement lié à cette circonstance qui a suscité la composition de l’œuvre et qui
est la démonstration de la légitimité de l’exercice de Clément VI dans son siège
d’Avignon.
Mais qu’est ce qu’une œuvre musicale peut apporter à un pontife pour l’expression
des grands axes de ses conceptions politiques ? Par quels moyens singuliers l’œuvre
musicale peut-elle exprimer sens, parole, discours, et agir sur des auditoires ? Par
quels moyens, ostentatoires, liturgiques, littéraires, musicaux, interactifs, l’œuvre
exprime-t-elle un message et vise-t-elle à en persuader des auditoires ? Et à quels
auditoires aussi cette œuvre s’adresse-t-elle – sachant, comme Vecchione l’a montré
pour les motets de circonstance qu’il a étudiés, que ces œuvres à la fois liturgiques et
politiques s’adressent simultanément à un double auditoire : de la Terre et du Ciel (ce
qui pour lui expliquerait la nature de double discours qu’elles tiennent, par la surface,
le paraître, destiné aux contemporains de la Terre, et par les sous-jacences, les
1 Selon les termes mêmes des théoriciens de la musique aux alentours des années 1360, comme, pour définir sa méthodologie, le remarque Bernard Vecchione (op. cit.).
Chapitre X : L’agencement musical des voix
2
subtilités, destinés aux personnages du Ciel ?2 Or cette double dimension, pour lui, se
trouve non seulement dans l’écriture du Ténor, emprunt liturgique et réécriture pour
l’adapter à la circonstance, mais aussi dans l’écriture des voix chantées, un texte,
chanté, et des hypotextes, dissimulés, cachés.
Nous allons tenter de répondre à ces questions en commençant par étudier la
typologie du matériau musical formé dans le Ténor de son Petre Clemens par Philippe
de Vitry, afin de pouvoir par la suite mieux appréhender l’interaction entre
dimensions littéraires et musicales que produit ce motet.
Un type de Ténor
Pour cela, commençons par déchiffrer le fondement de l’architecture du motet : la
partie de Ténor.
L’organisation en Taleæ de la teneur du Petre est longtemps demeurée, au moins
jusqu’en 1993, le seul élément structurel que les musicologues avaient détecté dans sa
construction. Les agencements de la teneur des motets de Philippe de Vitry sont en
général considérés comme exemplaires de l’organisation de la voix de Ténor
(séquences de durée et séquences de hauteurs) en système d’« iso-structures ». Une
même séquence de durée, la Talea, de même qu’une même séquence de hauteurs, le
Color, se reproduisent un certain nombre de fois, parfois indépendamment l’une de
l’autre d’ailleurs, tout le long du Ténor. Le Petre Clemens revêt un caractère
d’exception par rapport à cet agencement double : son Color n’est pas clairement
identifiable, non plus que ses réénonciations successives, au contraire de sa Talea et
de la forme d’ensemble que les réénonciations successives de sa séquence rythmique
permettent d’apercevoir. Le Petre appartient à un genre de motets pour lesquels
reproduire un Color, à l’identique ou dans des variations très perceptibles, n’a pas de
signification. Le sens de ce dispositif d’écriture est lié à la fonction des procédés
utilisés dans l’inventio des Ténors de motets : fonction du Color et fonction de la
Talea, comme Bernard Vecchione l’a très précisément montré dans ses études de
« poétique du motet médiéval ».3 Comme il l’a montré, le Color est lié aux temps
cosmologiques et à l’action du Créateur, alors que la Talea est liée aux temps éthiques
et à l’action de la Créature vis-à-vis de son Créateur, et donc de sa Création, piété ou
2 Vecchione, 1998, op. cit.
3 Bernard VECCHIONE, 2006, « Entre herméneutique et poétique... », op. cit. ; 2009, « Fictions d’incorporel », op. cit. ; 2014, « Une poétique du motet médiéval : textes, hypotextes et niveaux de discours dans l’Ave Regina celorum de Marchetto da Padova », in Marco Gozzi, Agostino Ziino & Francesco ZImei, dirs, L’ars nova italiana del Trecento, VIII. Beyond Fifty Years of Ars Nova Studies at Certaldo (1959-2009), Lucca, LIM, p.69-133.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
3
impiété. Les opérations permettant d’inscrire en isorythmie ces significations
changent au cours du XIVe et surtout du XVe siècle. Du temps du Vitry du Petre
Clemens, nous sommes encore dans le système qui s’était mis en place au tout début
du XIVe siècle, et que l’on retrouve encore intact par exemple dans le Plange de
Guillaume de Machaut (1358) ou l’anonyme padouan Gratiosus fervidus (1384). Dans
les motets ou voix comportant à la fois une mise en forme au moyen d’un Color et
d’une Talea, c’est le lien de l’éthique à la cosmologie qui est le thème essentiel du
discours. Dans les motets ou voix qui ne comportent qu’un Color ou qu’une Talea,
c’est alors d’un discours axé sur la dimension cosmologique ou la dimension éthique
seules dont il est question. Ainsi d’un motet comme l’anonyme vénitien Ave corpus
sanctum en l’honneur des reliques d saint Etienne (1329) où le Ténor comporte un
Color et une Talea qui lui est subordonnée, et le Contreténor qu’une Talea seule
insistant sur la dimension éthique du discours supporté par cette voix4.
L’agencement multiple du Ténor
L’agencement en Talea
Lorsque, dans le manuscrit d’Ivrea, on observe le Ténor, on est particulièrement
frappé par l’organisation structurelle extrêmement poussée que lui donne Vitry. Les
passages en hoquet, écrits en semi-brèves et silences de semi-brèves, sont aisément
repérables et permettent de déterminer une structuration précise de la voix. Le Ténor
a une durée totale de 251 brèves. Pour Olivier Cullin,5 il s’organise en trois sections
distinctes, A, B et C, qui auraient chacune une fonction « rhétorique » précise. A est
une introduction de 14 brèves de durée ; B, un long développement de 231 brèves,
agencé en 7 énonciations successives d’une Talea de 33 brèves de durée ; et C, une
coda de 6 brèves au total de durée. L’ensemble se décompose alors en 8 sections
successives : AI, puis BII, BIII, BIV, BV, BVI, BVII, et CVIII prolongeant BVII.
L’introduction AI s’énonce sur une durée de 14 brèves, tandis que chacune des
sections BII à BVII s’énonce sur une durée de 33 brèves chacune, et la section CVIII
sur une durée de 6 brèves. Le Ténor, comme la pièce donc, a une durée totale de :
(14) + [(33 x 6) + (33 + 6)] = (14) + (198) + (39) = 251 brèves.
On remarque la rupture métrique entre l’introduction A et les 7 autres sections de la
pièce. De même que la différence entre les systèmes de nombres symboliques : 14, 7
et 2, pour la partie introductive A ; 6 et 33, en (33 x 6) puis (33 + 6) pour les autres
4 Vecchione, 2009, op. cit., plus particulièrement p.280-85.
5 Cf. Olivier CULLIN, 2004, op.cit.. , p. 91-110.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
4
sections. Mais également la rupture isorythmique, la section introductive A étant
hors-isorythmie et les sections B formant corps de l’œuvre étant isorythmiques.
Dans cette décomposition, le Ténor se retrouve intimement lié à l’agencement des
voix supérieures, que ce soit pour le matériau littéraire comme pour l’agencement
musical ; Vitry organise les bases de son motet dans une très nette optique
d’interrelation entre les voix. Il compose son Ténor en suivant les règles de l’Ars
Nova, mais en ajoutant, dans le cas précis de notre partition, nombre de subtilités
intellectuelles, démontrant que cette production se destine avant tout à de multiples
auditoires d’un très haut niveau intellectuel – voire même, et c’est l’hypothèse de
Vecchione pour ce genre de pièce liturgique, à des auditoires du Ciel.
Bien plus, l’agencement en trois parties, A, puis B, et C, avec Introduction et Coda,
rattache le déploiement de l’œuvre au discours de nature « rhétorique » :
Introduction, Développement, Conclusion ; Prologue, Corps du discours, et Exorde.
Du point de vue du rythme, le Ténor est écrit dans un tempus imperfectum prolatio maior.
L’unité de temps est la longue, au tempus deux fois plus lent que celui des voix
supérieures. Ce qui correspond, là aussi, à l’écriture habituelle des rythmes dans les
manuscrits de motets de l’Ars Nova. On remarque toutefois que la ligature terminale
a la durée d’une longue parfaite, ce qui crée différence d’avec le restant de l’œuvre.
L’introduction (A)
Elle s’énonce sur une durée de 7 fois 2 longues imparfaites (soit 14 brèves en tout)
(figure, ci-après), et se distingue nettement, par sa musique, de toute la suite du
Ténor.
Dans sa composition nous retrouvons différents chiffres : 14, 7 et 2. À propos du 7,
Clark propose une hypothèse intéressante. Comme nous l’avons vu plus haut, le
chiffre 7 pourrait symboliser la personne de Clément, et représenter sa signature
formulée à la voix de Triplum.6 Mais la question demeure entière de savoir pourquoi
la signature de Clément
6 Il est fréquent d’observer ces types de relations numériques dans les compositions musicales du Moyen Age. Cf. A. V. CLARK, 1999, « New tenor sources for fourteenth-century motets », in Plainsong and Medieval Music, 8, 2, Cambridge University Press, p. 107-131.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
5
Fig. 1
Partie introductive du Ténor du Petre Clemens (Manuscrit d’Ivrea)
s’inscrit au moyen du nombre symbolique 7. Cela renverrait-il à la dimension sacrée
de la personne du pontife ? Et le chiffre 14, quelle pourrait en être la signification ?
Ce chiffre est central dans des motets comme le Nuper rosarum flores de Guillaume Du
Fay pour la consécration de la cathédrale de Florence, ou l’Ave regina celorum de
Marchetto da Padova (voix de Duplum) où il s’associe aux 14 allégories des Vertus et
de Vices peintes à fresque par Giotto dans la chapelle des Scrovegni qu’il sert à
consacrer. Dans ces motets de consécration, Bernard Vecchione a proposé de le lier
à la signification de la rédemption et de la voie vers le salut de l’âme. Mais en général
pour lui le chiffre 7 est plutôt lié au sacré tandis que le 9 est lié au divin. Dans cette
introduction, on remarquera que, non seulement nous sommes hors-isorythmie, mais
que de plus, au Ténor l’ensemble s’organise en 7 longues imparfaites de durée.
1
2
3
4
5
6
7
1
Chapitre X : L’agencement musical des voix
6
Le long développement central (B)
Le développement central du Ténor s’énonce sur une durée 231 brèves, soit 7 fois 33
brèves. Il est composé de sept énonciations successives d’une Talea, même séquence
de 36 valeurs de durée (voir la figure, ci-après).
Fig. 2
Talea du Ténor du Petre Clemens
Les premières énonciations de la Talea s’achèvent toutes sur un silence de brève (Cf.
Annexe 7), qui scande ainsi par une sorte de respiration (ponctuation) l’agencement
en Talea du Ténor. Les séquences des valeurs sont strictement identiques. Elles
comprennent 36 valeurs, qui s’agencent en 29 valeurs de note, 1 silence terminal de
brève, 3 de semi-brève et 3 de minime. Les silences de minime n’ont pas vraiment
valeur de silences de durée. Ils ne sont présents que pour produire le hoquet. Ce qui
fait que la réunion des 29 valeurs de note, des 3 silences de semi-brève et du silence
de brève terminal donne de nouveau le chiffre 33.
La structuration interne de la Talea est relativement complexe. On peut la lire de
diverses façons.
Karl Kugle et Manuel Pedro Ferreira proposent par exemple de la lire selon la
structuration mathématique suivante :
33 = 18 + 15 = [15 + 3] + [12 + 3]
= [(12 + 3) + 3] + [(9 + 3) + 3].
Margaret Bent,7 propose quant à elle :
33 = (15+ 3) + (12 + 3).
7 Margaret BENT, 1998, « Early Papal Motets », in Richard SHERR, dir., Papal Music and Papal Musicians in Late Medieval and Renaissance Rome, Oxford University Press, p. 17.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
7
Mais en réalité cet agencement interne de la Talea est plus complexe. Il est formé
d’une succession de cinq séquences a, b, c, d, e. On remarque que le hoquet est en
fait formé de deux types successifs, en semibrèves et en minimes. Ces hoquets font
suite à une première séquence (a) de 7 brèves de durée (mesures 15 à 21 comprise,
pour la première énonciation de la Talea, Cf. Annexe 1). La durée de cette séquence
en hoquets (b) est de 2 fois 3 brèves, soit 6 brèves au total (mesures 22 à 27
comprise). S’ensuivent deux ligatures successives, formant une troisième séquence (c)
dont la réunion des durées est de 7 brèves (mesures 28 à 34 comprise). Puis une autre
séquence (d) de 7 brèves, formée de la succession de deux longues et d’une ligature
de 3 brèves de durée (mesures 35 à 41 comprise). Et pour finir une séquence (e)
formée d’une seule ligature de trois notes et du silence de brève de ponctuation
(mesures 42 à 47 comprises). La succession des durées des séquences est alors de 7,
6, 7, 7 et 6 brèves.
On remarque que la séquence (a) et la séquence (c) ont la même structure interne : B,
puis (B, L), puis (L, B). Tandis que la séquence est formée de deux sections
successives de 3 brèves chacune de durée, monnayées, pour la première en trois
énonciations identiques de deux minimes (mesures 22-24), et pour la seconde en trois
énonciations identiques de trois minimes, dont la dernière est hoquetée (mesures 25-
27). La séquence (d) est elle aussi formée de deux sections successives, l’une de deux
longues (mesures 35-38), et l’autre de trois brèves en ligature (mesures 39-41). La
séquence terminale (e) est elle formée d’une ligature Longue, Brève, Longue
(mesures 42-46) et du silence de brève terminal (mesure 47). Mais on remarque aussi
que, si l’on ne tient pas compte de la ligature, sa structure interne est alors formée de
deux sections de trois brèves de durée chacune, formant la succession (L, B), (L, B).8
Et que, si sa structure alors se rapproche de celle de la section (b) en hoquet, 6 en (3
+ 3), sa composition en diffère, non seulement par les types de valeurs employées,
Longues et Brèves au lieu de Brèves monnayées en semi-brèves et minimes, mais
aussi de par l’identité de l’itération.
À ce niveau de structuration de la forme du Ténor prévalent aussi les chiffres 6 et 7.
Et l’ensemble de la Talea peut alors se lire comme décomposée en trois moments de
13, 7 et 13 brèves de durée successives.
33 [(7 + 6) + 7 + (7 + 6)] = [(13) + 7 + (13)].
8 Dans la méthodologie d’analyse proposée par Bernard Vecchione, les valeurs de silence au Ténor sont soulignées.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
8
Kugle a insisté sur la symbolique des nombres 6, 7 et 33 dans ce motet.9 Le fait alors
que ce développement central du Ténor, d’une durée de 231 brèves décomposée en 7
énonciations successives d’une Talea de 33 brèves de durée, elle-même agencée en 5
séquences de 7 et 6 brèves de durées, montre toute l’importance de la symbolique des
nombres, 6 exprimant le pouvoir et 7 le sacré. Toute la signification de l’inventio de ce
Ténor se déploierait dans l’espace du pouvoir sacré du pontife qu’est Clément. On
peut ajouter aux nombres sur lesquels insiste Kugle le chiffre 13, qui additionne, au
sein de la structure interne de la Talea, deux énonciations des nombres 7 et 6,
séparées par une énonciation du nombre 7. La signification du chiffre 13 apparaît
alors comme l’adjonction du pouvoir (6) au caractère sacré du pontife (7).
Agencement du Ténor et
élévation polyphonique du motet
Mais si on rapporte maintenant le Ténor aux autres voix du motet, son agencement
se lira bien entendu d’une tout autre manière. Le Ténor respecte parfaitement la
structure décasyllabique des textes des voix chantées. La multiplication des lectures
est pratiquée au Moyen Age en musique liturgique comme elle l’est en exégèse des
textes bibliques.10
Ainsi par exemple pour l’Introduction A1, dont les 14 brèves de durée donnent lieu
tout d’abord à une entrée en caccia aux deux voix chantées. La durée de la figure (a)
reprise est de 5 brèves. La 5ème formant pivot, l’ensemble a une durée de 9 brèves, les
deux énoncés s’organisant en quelque sorte selon la figure architecturale de deux arcs
reposant sur un pilier central. Puis cette figure initiale est de nouveau reprise (b), mais
tronquée de son incipit : la première brève sur la note Do répétée. La même note Do
termine au Triplum la première section en caccia, de telle sorte que le passage se fait
aisément entre la première et la seconde sections de cette Introduction. La figure (b)
a une durée cette fois de 3 brèves, et elle aussi reprise en caccia, selon le même
symbole architectural des deux arcs se rejoignant sur une colonne centrale. La reprise
au Duplum de la figure (b) subit une altération mélodique pour former conclusion de
cette Introduction. Cette altération revient (première brève de la mesure 7) sur la
note Do répétée du départ, de même que la figure mélodique de transition au
Triplum revient sur cette note Do. L’ensemble tourne autour de cette signature
musicale caractéristique du <PETRE> : m.1 (Triplum), 5 (Duplum), 9 (Triplum), 13
9 Karl KUGLE, 1993, op. cit., p. 196-198.
10 Voir à ce sujet, Bernard VECCHIONE, 1997, « Modélisation et heuristique… », op. cit. ; ou 1998, « Entre rhétorique et pragmatique… », op. cit. Et pour la conception médiévale des sens multiples de l’écriture, Henri DE LUBAC, 1993, Exégèse médiévale. Les quatre sens de l’écriture, Paris, Cerf/Desclée de Brouwer, 4 Tomes, cité par Bernard Vecchione.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
9
(Duplum) et 15 (Triplum), avec cette circulation de la figure alternativement d’une
voix à l’autre.
L’agencement en Color et l’origine liturgique de la teneur
Intéressons-nous maintenant à l’agencement du Ténor selon le Color. Un Ténor de
motet isorythmique s’agence par une Talea et un Color en même temps, mais pas
toujours de façon identique. La règle des sens multiples de l’écriture s’applique aussi à
l’agencement interne du Ténor. Bernard Vecchione a montré dans sa poétique du
motet médiéval de circonstance,11 que l’agencement du Ténor selon le Color avait à
voir avec l’agencement cosmologique de la Création, tandis que son agencement
selon la Talea (quantification du temps) avait à voir avec l’éthique, c’est-à-dire le
comportement de la Créature vis-à-vis de la Création : impietas et pietas, contritio,
demande de pardon, absolution.
Organisation de la séquence de hauteurs du Ténor
Les difficultés sont nombreuses pour comprendre l’organisation du Ténor selon son
Color.
Le Petre possède une originalité de conception par rapport à d’autres motets
semblables : son Ténor est de très longue durée, et son matériau est fait de très
nombreuses hauteurs de son. Sans répétition claire de séquences de hauteurs, c’est-à-
dire de Color, il ne semble guère structuré. Mais ce n’est là qu’une illusion. Vecchione
a principalement étudié des motets à reprises textuelles de Color ou de Talea. Mais il
se posait aussi la question de la signification discursive de cette opposition entre ce
type de motets et ceux à reprises libres, tant de Color que de Talea. Manifestement,
avec ce motet de Vitry, nous avons affaire à une sorte de mixte : avec reprise
textuelle de la Talea mais une reprise variée du Color, qui devrait nous amener à nous
poser la question des raisons discursives de ce choix par Vitry.
Alice V. Clark suggère de corriger une erreur du Codex d’Ivrea.12 Le Ténor porté sur le
Codex est de 215 notes. Mais il semblerait qu’il manque une répétition du SOL dans
la section terminale qui forme Coda. L’ensemble des notes du Ténor serait alors de
216. Douze sont affectées à la section introductive (A) et 29 à chaque section
d’énonciation de la Talea (de BII à BVII). La section terminale avec Coda en
11 Bernard VECCHIONE, 2006, « Entre herméneutique et poétique… », op. cit.
12 Alice V. CLARK, 1999, op.cit. p.119. note 34.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
10
renferme 29 aussi sur le manuscrit, mais 30 si l’on suit la leçon d’Alice V. Clark. En
sa totalité le Ténor s’énonce ainsi en :
(12) + [(7 x 29) + (1)] = 12 + (203 + 1) = 216 notes.
La répartition de ces notes est caractéristique. Les 29 notes de la Talea se répartissent
en 5 pour (a), 12, soit 3 et 9, pour chacune des deux sections en hoquet de (b), 5
pour (c), 5 pour (d) et 3 pour (e). Une autre décomposition peut alors se lire dans
son ensemble : (5 + 3), puis (9 + 5), et (5 + 3) de nouveau pour finir, séparant les
deux sections en hoquet, qui, rythmiquement et harmoniquement s’opposent, et
isolant au centre le nombre de 14 de chaque côté duquel se répartissent des
séquences de 8 notes décomposées de la même façon, (5 + 3). De nouveau le chiffre
14, au centre, avec sa symbolique, et le chiffre 5 (les 5 sections de la Talea, de (a) à
(e), et les 5 notes que renferment 3 d’entre elles), associé maintenant à 3 dans les
deux ensembles de 8. Non plus (5 x 3), comme pour les sections internes à la Talea,
mais (5 + 3) maintenant.
Origine liturgique de la teneur
Quand le Ténor est d’origine liturgique, celle-ci nous indique ce pour quoi est écrit le
motet. Certains Ténors, pourtant, ne sont pas de provenance grégorienne. Le
problème se pose d’identifier l’origine du Ténor du Petre, puisque sa source musicale
d’origine, dans le Codex d’Ivrea, ne donne aucun incipit grégorien. Comme nous
l’avons vu cependant, le livre de sermons de Clément VI, rédigé dans les années
1340-1342, fournit en revanche une indication. Les textes du motet sont réunis avec
l’incipit « Non est inventus similis illi » (Il n’existe personne de semblable à toi.).
Comment interpréter ce manque d’incipit dans le Codex d’Ivrea ? Aurait-il été omis
par le copiste ? S’agissait-il d’une pièce liturgique fort connue ? Ou bien encore,
comme le suggère Vecchione, au-delà de considérations pratiques, le fait de ne pas
l’inscrire doit-il être considéré, au Moyen Age, aussi comme signifiant ? Les avancées
de Wathey ne lui avaient pas permis d’authentifier cette origine. Mais tant est-il que
nous savons maintenant à quel chant de la liturgie rapporter ce motet. L’incipit, qui
plus est, se retrouve presque à l’identique comme dernier vers, comme chute, le 30ème
du poème de la voix de Duplum : « Cui non est inventus tuus similis ». Mais, pour
Vecchione, avec cependant deux altérations : (1) le <ILLI> terminal passe en
pronom relatif initial <CUI> pour relier cet emprunt textuel au restant du motet ; (2)
l’adjonction du mot <TUUS> qui transformerait ainsi le participe passé
<INVENTUS> en un substantif : <INVENTUS TUUS>, « ton invention, ton
innovation ». <CUI NON EST INVENTUUS TUUS SIMILIS> : « …de quoi ton
innovation n’a pas d’équivalent ». Pour lui, cette transformation en conclusion du
motet pourrait expliquer le choix du Color varié employé par Vitry. Il ne s’agirait pas
Chapitre X : L’agencement musical des voix
11
d’utiliser textuellement le Ténor liturgique mais d’en produire lecture justement par
cette dérivation, cette glose, ce commentaire. Et l’a ction de Clément VI
n’apparaîtrait pas alors dans ce motet comme se coulant dans une liturgie, une
théologie préalables, mais comme s’appuyant sur elle pour produire justement du
neuf.
Il faudra attendre la thèse d’Alice V. Clark13, pour avoir une piste sérieuse
d’identification. L’incipit prend prendre sa source dans le verset du graduel, Ecce
sacerdos, de l’office du commun d’un pontife confesseur, office tout particulièrement
destiné à la personne même du pape. Wathey puis Clark se sont efforcés d’apporter
une réponse à cette question de l’origine du Ténor. On la connaît manifestement
liturgique.
Mais leurs sources divergent. Pour Wathey, il s’agirait d’une référence à un verset de
l’Ecclesiasticus14, le livre de l’Ecclésiaste. Ce livre, qui est également nommé Siracide, en
raison de son auteur Jésus fils de Sira, fut très utilisé par l’Église pour ces précieux
renseignements sur le déroulement des catéchumènes. Cette production fort
ancienne remonte à 180 av. J.-C. Il est révélateur du milieu dans lequel le
christianisme naissant a pris ses racines. Écrit d’abord en hébreu, il fut traduit par le
petit fils de Jésus de Sira vers 132 av. J.-C en Égypte. Nous trouvons la citation du
« Non est inventus similis illi » au paragraphe 44-20:
Abraham magnus pater multitudinis gentium
Et non est inventus simillis illi in gloria
Qui concervavit legem Excelsi
Et fuit in testamento cum illo
Pour Clark, il pourrait s’agir d’une citation d’un graduel du commun d’un confesseur,
dont le texte est inspiré du livre de l'Ecclésiaste. Ce graduel fait partie d’une liturgie
très importante pour les objectifs que nous poursuivons : le commun d’un
confesseur. C’est un office dédié aux plus hautes personnalités de la hiérarchie
cléricale et en particulier au pape. Nous y trouvons clairement évoqué l’incipit du
Ténor présent dans le livre de sermon de Clément VI. Le texte du verset du graduel
est particulièrement lié à notre propos, et singulièrement à la circonstance de
composition même du Petre Clemens : la reconnaissance de la toute-puissance du pape
en Avignon. Le texte, en référence à Abraham, évoque ici le pontife : « qui conservavit
legem Excelsi » (celui qui a conservé la loi des Cieux).
13 Alice V. CLARK, 1996, Concordare cum materia : The Tenor in the Fourteenth-Century Motet, Ph.D., University of Princeton; 1999, op. cit., p. 107-131.
14Andrew WATHEY, 1993, op. cit., p. 149.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
12
Voici le texte du graduel et du verset et leur traduction :
Graduel :
Ecce sacerdos magnus qui in diebus suis placuit Deo
« Voici le grand prêtre qui, en ce jour, a suppléé Dieu. »
Verset :
Non est inventus similis illi qui conservaret legem excelsi
« Il ne s’en n’est pas trouvé de semblable à lui pour observer la loi du Très Haut ».
Différents autres points relevés par Clark appuient l’hypothèse que le Ecce sacerdos
serait à la source du Non est inventus. Notamment sur le point historique et bien
entendu musical. Il n’existe pas à priori de source du Ecce qui soit directement dédiée
à Clément Ier, source d’inspiration pour Pierre Roger. Mais ce n’est peut-être pas la
question qui nous intéresse le plus. Nous recherchons plutôt un lien historique qui
pourrait corroborer le fait que le « Non est inventus » fait partie d’une source attestant
la légitimité du pouvoir pontifical. La bibliothèque municipale d’Arras conserve un
Codex, Ms CAO 6609 V, qui renferme une version du Ecce Sacerdos dédié à Clément.
Cette pièce semble fréquemment en usage dans la ville. Or un premier lien apparaît
sur les rapports entre Vitry et Pierre Roger. Pierre Roger fut nommé évêque d’Arras
en 1328, et Philippe de Vitry fut, à Paris, élève au Collège des Bons Enfants d’Arras.
Il serait possible, imagine Clark, que la pièce en association avec Clément soit une
sorte d’évocation d’un lien symbolique qui lie les deux hommes. Mais une autre
hypothèse de Clark semble encore plus importante à nos yeux. Le fait notamment
que ce motet ait pu être joué aux alentours de la Nativité de 1342 permet d’évoquer
le rapport avec la fête de la St Sylvestre, le 31 décembre, commémoration du pape
Sylvestre Ier, qui fut l’un des fondateurs de l’Église et un des premiers papes légitime
et reconnu par le pouvoir romain déclinant, du temps de l’empereur Constantin.
Même si nous savons aujourd’hui que la fameuse légende de la déposition de
Constantin est une invention de toutes pièces, nous savons que l’empereur a mis en
place des préceptes et notamment les sept lois, piliers de l’Église chrétienne, dont une
nous parlent du pouvoir pontifical en nous précisant que ce dernier est le pouvoir le
plus important à la tête et au dessus de tous. La donation de Constantin est une pure
invention du VIIIe siècle. C’est un texte qui prétend que le pape possède la primauté
de la souveraineté temporelle. Le pape Adrien en usa même pour imposer sa
Chapitre X : L’agencement musical des voix
13
supériorité et son pouvoir à Charlemagne. L’influence de ce faux sera pourtant
effective jusqu’à la Renaissance.15
En continuant d’explorer les hypothèses de Clark, on remarque qu’elle tente une
étude comparée de différentes versions du Ecce Sacerdos.
Fig. 3
Verset « Non est inventus similis illi »
(Perugia, Biblioteca Comunale 'Augusta', Ms 2801 Folio 131r)
La démarche peut être fructueuse, mais elle peut être d’une certaine manière
réductrice. Regardons son deuxième exemple (Fig.22).16
Comme Clark le souligne, « il existe de vagues ressemblances avec la source, et ce,
après les six premières notes (qui correspondent aux mots “non est inventus”) ». Il est
évident que ce n’est que le début du verset sur lequel est cité le texte repris dans le
Ténor « Non est inventus similis illi ». La suite de la pièce ne semble pas avoir été
réemployée dans la teneur du Petre. On peut remarquer cependant qu’à la fin du
psaume, sur le mot « excelsi », l’orientation mélodique comporte des éléments repris
par la teneur.
15 Cf., Dictionnaire de la papauté, « Silvestre », p.1578-1580, et « Constantin », p. 472-474.
16 Alice V. CLARK, 1999, op. cit., p. 120.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
14
Fig. 4.
Interprétation de l’emprunt liturgique
Comment comprendre alors l’emprunt de la teneur à la liturgie du sacerdoce ?
Pour commencer, il serait souhaitable de recadrer la démarche de Clark. Si nous
reprenons cette hypothèse qui consiste à considérer la pièce Ecce sacerdos comme
source originelle de la teneur du Petre, il nous faut cependant éviter l’écueil du travail
comparatif. Chaque œuvre est spécifique, elle produit une parole singulière, formée
relativement à la circonstance en vue de laquelle elle a été composée. Même si elle
s’est réglée sur un certain nombre d’éléments récurrents types, il convient de repérer
tout élément singulier et de le replacer dans son contexte d’énonciation.
La composition du Color du Petre pose problème car elle n’offre qu’une citation assez
peu identifiable de la pièce grégorienne dans sa première occurrence. Pourtant,
comme nous pouvons le voir dans beaucoup de motets de l’Ars Nova, nous savons
qu’une citation peut être fort différente de sa source, et tropée dans sa présentation
sans pour autant supprimer tout lien avec la liturgie de laquelle elle vient. Anne Maria
Busse Berger17 souligne que « les motets sont des compositions dans le sens
moderne du terme, dans laquelle le compositeur fixe plusieurs facteurs de hauteurs et
17 Anna Maria BUSSE BERGER, 2005, Isorythmic motets and the art of memory, Berkeley University of California Press. Voir en particulier le Chap. 6, p. 251-305.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
15
de rythme […]. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de variations dans l’application
des sources du motet. Néanmoins, les parties isorythmiques sont généralement
transmises avec peu ou pas de variations ». Les musicologues s’accordent aujourd’hui
assez sur ce point. Mais encore faudrait-il tenter de comprendre pourquoi des motets
du type du Petre Clemens se produisent depuis des teneurs largement réécrites.
Le lien est considéré par Bernard Vecchione comme de tropation plus ou moins
complexe. Et c’est justement dans cette fonction de constitution de liens entre le
texte source et sa réutilisation tropée en teneur de motet que réside, pour lui, tout le
problème de la signification de ces tropations. L’étude de toutes les occurrences du
Color du Petre nous enseigne qu’il possède beaucoup de similitudes avec son original.
« L’art de la mémoire » est fortement sollicité dans ce processus, puisqu’une partie
seulement du chant grégorien est directement appliquée, une autre partie, très vaste
souvent, seulement suggérée. Ce procédé rhétorique, assimilable à la figure de la
synecdoque (partie énoncée mais pour signifier le tout), est fréquent dans la mentalité
de l’époque et se retrouve dans l’usage de citations.18 C’est une époque où l’on a
pour habitude de retravailler les choses, de les remanier, de les réénoncer. Pour
Bernard Vecchione, c’est le propre de l’opération d’inventio, cet emprunt et tout à la
fois ce remaniement, cette réécriture, si caractéristique du travail de composition d’un
Ténor de motet. De fait, l’écriture du Ténor peut faire l’objet de nombreuses
tropations qui n’en altère pas la nature de fondement de l’œuvre par référenciation à
un rituel, et n’est pas toujours ni obligatoirement une simple citation, respectueuse
dans ses formes, du texte de sa source. Tout dépend de l’usage qu’on fait d’un
fragment liturgique et surtout de sa puissance de référenciation à un office voire à
plusieurs offices reliés de l’année liturgique. C’est l’idée même de « source » et celle
aussi de « neuf » dans cette période de l’histoire qui sont ici en question.19 C’est pour
Vecchione l’idée même de « citation » qui serait à revoir. A proprement parler le
motet ne « cite » pas, il évoque, il fait référence à. Et quand il cite réellement, la
citation textuelle a du sens, justement parce que textuelle ; comme quand elle ne l’est
18 Vecchione (2004, op. cit.) cite même le cas du Plange (1358) de Guillaume de Machaut où la forme du motet n’est pas celle du fragment de pièce liturgique utilisé, la section <APPREHENDE ARMA ET SCUTUM ET EXURGE> du verset du Graduel de la liturgie du mercredi de la semaine sainte, mais celui de l’ensemble Graduel-Verset de cette liturgie duquel le fragment utilisé n’est qu’une partie seulement. Il met ainsi l’accent sur le fait que les fragments liturgiques ne sont en motet toujours utilisés qu’en relation avec leur fonction dans une liturgie, et qu’avec ce sens qu’a la liturgie elle-même dont ils deviennent les marqueurs. De la même façon il a suggéré qu’un Color réécrit par centonisation créait des liens entre divers offices de l’année liturgique pour montrer que l’année n’était pas seulement faite d’une succession cloisonnée de fêtes, mais devait se comprendre comme un tout aux éléments parfaitement tissés.
19 Voir à ce sujet son texte, Vecchione, « Dolce Stil Novo, Ars Nova, Nova Musica : l’idée de “raison trope” dans le motet de circonstance du Moyen Âge tardif », in Rossana Dalmonte & Francesco Spampinato, dirs, Il nuovo in musica, Lucca, LIM, 2008, p.105-22.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
16
pas, elle a du sens justement parce qu’elle ne l’est pas, qu’elle remanie, réécrit,
réforme le sens du nouveau en le rapportant à l’ancien tout en l’en dérivant, en s’en
détachant, « en en sortant », dit Vecchione, « mais dans le double sens du terme : elle
en sort parce qu’elle en provient, et tout à la fois elle en sort parce qu’elle s’en
détache ».20
La « mémoire de rappel » dans le cas du Petre Clemens peut sembler inexistante, au
bénéfice plutôt d’un rappel « de mémoire ».
Pourtant, si l’on considère son Color comme une réécriture subtile de différentes
hauteurs de sons, on peut y lire une structure, assez inhabituelle certes, mais bel et
bien présente et significative. Nous savons que lorsqu’on reconsidère la construction
d’une pièce grégorienne on est obligatoirement confronté au « ton » dans lequel la
pièce est écrite. Ce mode, par ses caractéristiques « morphologiques », lui donne une
orientation mélodique toute particulière. Les éléments qui permettent de reconnaître
un mode sont généralement au nombre de deux : la corde de récitation et la note
finale. Chaque échelle s’organise en fonction de ces deux paramètres, qui permettent
de bien les différencier à l’oreille. Mais la théorie de la musique médiévale ne prend
généralement pas en compte un élément important que l’on va pourtant rencontrer
assez souvent dans les teneurs de motets isorythmiques. L’utilisation d’éléments
formulaires participe activement à la reconnaissance du mode, comme le montre les
travaux de H. S. Powers.21 En réalité, il importe peu à l’oreille qu’une échelle modale
soit réemployée dans un ordre différent de sa source liturgique, pourvu que les piliers
musicaux essentiels soient présents.22
Une analyse de la source grégorienne du Non est inventus dans le verset du graduel
pour l’office des pontifes, Ecce sacerdos, nous permettra de mieux comprendre
l’agencement en Color de la teneur du Petre. On peut observer dans un premier
temps, comme l’avait remarqué A. V. Clark,23 que le début de ce verset possède de
larges ressemblances avec la première citation du Color du Petre Clemens, et que, au fur
et à mesure des occurrences de ses sections isorythmiques, le Ténor semble s’éloigner
de la musique du verset d’origine. L’organisation interne du verset Non est inventus
20 Vecchione, 2008, op. cit.
21 H. S. POWERS, 2002, « Mode », in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres, Macmilan; 1992, « Modality as a European cultural construct », Secondo convegno europeo di analisi musicale, R. DALMONTE et M. BARONI, dirs, Trento, p. 207-219; et 1992, « Is mode real ? », Basler Jahrbuch für historische Musikpraxis, 16, p. 9-52.
22 « Le motet isorythmique se sert de toutes sortes de techniques qui n’auraient pu exister sans écriture. La plus importante concerne les manipulations du ténor en usant notamment de la diminution, du mouvement rétrograde » cf., A. M. Busse BERGER, op. cit., p. 1-2.
23 Clark, 1996, Op.cit, p 180.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
17
s’organise en plusieurs sections distinctes. Une première intonation nous amène sur
le Do Corde de récitation. Une corde de récitation composée de cinq Do. Puis, après
deux éléments suspensifs (qui rappelle la flexe, mais qui ne se termine pas sur le La,
mais sur le Sol), un long développement mélismatique qui présente la suite du texte
« qui conservaret legem excelsi ». Enfin une conclusion basée sur un aller-retour entre la
note finale Fa et la corde Do, toujours mélismatique (Fig. 23).
Cette organisation modale s’articule autour d’un noyau pentatonique Fa-sol-la-do-ré.
L’organisation de certaine formule, comme l’intonation du début, mais également
l’usage d’une corde de récitation importante au début de la pièce, nous permet de
faire le rapprochement entre ce verset et le ton psalmodique du Ve mode (Fa
authente) (Fig. 24).
Quoique ce rapprochement soit à prendre avec prudence, car nous ne sommes pas
dans une psalmodie à proprement parler.
Au-delà de la fonction de la pièce, et plus précisément du verset qui est destiné à un
soliste, le rapprochement avec certains éléments morphologiques de la teneur du Petre
est possible : comme. l’intonation du verset, l’usage fréquent de la corde de
récitation, mais également du Ré, note suivant le Do Corde de récitation, autant
d’éléments qui installent une couleur proche du ton psalmodique. Un autre élément
nous rappelle la flexe du mode, c’est la troisième section très singulière du verset,
fondée sur un passage Ré-Do-Sol grave qui se situe généralement après les notes
Chapitre X : L’agencement musical des voix
18
Fig. 5
Structure du Verset Non est inventus.
(Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, Ms 2801 Folio 131r)
(Cf, Annexe 2)
Fig. 6
D’après Richard HOPPIN, 1991, La musique au Moyen-Âge, Tome I,
Liège, Mardaga, p. 103.
Intonation 2 Éléments suspensifs
Développement mélismatique
Développement mélismatique
Développement
mélismatique
Fin Cadence type mode fa authente
Chapitre X : L’agencement musical des voix
19
répétées de la corde de récitation. Mais ici s’arrête la ressemblance. Les différences
sont également là. La suite de la pièce se prolonge par des mélismes virtuoses sur le
« us » de inventus. La cadence terminale est typique du mode de Fa, elle ne s’achève
pas sur la troisième note du mode (La) pour conclure. Nous sommes bel et bien dans
un verset.
Analysons maintenant la voix de ténor du Petre Clemens d’après le codex Ivrea MS115 .
Etude du Color du Tenor « Non est inventus ».
Tropation de la teneur depuis la source grégorienne
du « Non est inventus ».
Reprenons l’agencement en Talea du Ténor du Petre, avec l’introduction (A), les sept
occurrences successives (B) et pour finir la courte conclusion (C). La pièce se
découpe ainsi (Fig. 25).
Fig. 7
Tenor du Petre Clemens dans le manuscrit d’Ivrea.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
20
Prenons comme base le verset grégorien « Non est inventus similis illi », et recherchons,
en repartant les essais de Clark, comment elle pourrait se trouver intégrée dans le
Ténor du Petre (Fig.26).
Cette formule, écrite en mode de Fa authente (cinquième ton), est composée de 22
notes.
L’Introduction (AI) est composée sur une échelle de sons constituée de 2 x 6 notes :
(fa-sol-la-ut-la-sol) // (fa-ut-fa-la-ut-fa) (Fig.27).
Un lien existe entre ces deux formules. En s’appuyant sur le premier Fa de la
seconde, la première est parfaitement rétrograde :
Prenons comme base le verset grégorien « Non est inventus similis illi », et recherchons,
en repartant les essais de Clark, comment elle pourrait se trouver intégrée dans le Ténor
du Petre.
FIG. 8
Verset « Non est inventus » du graduel grégorien Ecce sacerdos
Cette formule, écrite en mode de Fa authente (cinquième ton), est composée de 22
notes.
L’Introduction (AI) est composée sur une échelle de sons constituée de 2 x 6 notes :
(fa-sol-la-ut-la-sol) // (fa-ut-fa-la-ut-fa)
Chapitre X : L’agencement musical des voix
21
Fig. 9
Un lien existe entre ces deux formules. En s’appuyant sur le premier Fa de la
seconde, la première est parfaitement rétrograde :
[ fa-sol-la-ut-la-sol// fa-ut-fa-la-ut-fa ].
Une première signature de Clément VI apparaît. Le chiffre six représente avant tout
une certaine forme de perfection (justifiée par l’arithmétique, car six est le premier
chiffre « parfait »),24 et il symbolise également le pouvoir. Le chiffre sept fait
référence au sacré. Par jeu sémantique hautement symbolique, l’allusion semble
s’adresser aux détracteurs du pontife fort nombreux au moment de son élection. De
24 Vincent F HOPPER, 1995, La symbolique médiévale des nombres, édition Gérard Montfort, Paris. P. 73-74.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
3
3
Chapitre X : L’agencement musical des voix
22
plus par un jeu subtil de la phrase rétrograde, Vitry l’implique dans une relation,
hautement symbolique elle aussi, avec le chiffre sept. Il serait fastidieux de rentrer
dans une description complète du jeu des nombres dans le Ténor. Soulignons à ce
sujet, deux propositions de Clark. Correspondant aux sept longues de l’Introduction,
le chiffre sept pourrait faire penser aux sept vices et aux sept vertus. Cette
thématique se retrouve déjà dans le motet Ave Regina Celorum en référence aux sept
allégories de Vertus ou aux sept de Vices, peintes à fresque par Giotto dans la
chapelle des Scrovegni.25 Mais il correspondrait aussi aux sept lettres de « Clemens »,
et participeraient ainsi de la signature Clément VI. Par ailleurs, cette conjonction du
six et du sept, que nous avons déjà aperçue dans la composition du Ténor, se
retrouve déjà dans un motet comme l’Ave regina celorum (composition des distiques du
poème du Duplum en un vers de 7 syllabes et un vers de 6, ou dans un conduit
politique comme le Novus miles sequitur, qui renferme lui aussi le même genre de
métrique avec des vers de 13 syllabes qui se séparent, par la rime à la césure, en deux
moitiés inégales, dont la première est toujours de 7 syllabes et la seconde de 6.
Cette Introduction s’agence au moyen d’une séparation entre les valeurs courtes et les
valeurs longues de la séquence :
Séquence A (valeurs courtes) Séquence B (valeurs longues)
créant, dans cette Introduction, une organisation successive bipartite du Ténor qui
s’articule tout particulièrement avec les entrées successives en caccia des voix
supérieures. La première séquence correspond à l’entrée du Triplum, la seconde à
l’entrée du Duplum. À chaque entrée correspond une séquence de six notes. Et là
aussi la durée de chacune des deux sections est respectivement de 3 et de 5 longues :
3 avant l’entrée du Duplum, et 5 avant l’entrée de la première énonciation de la Talea
(BII). On remarque aussi l’affectation des nombre à chacune des voix, et partant la
signification du discours de chacune au regard de sa fonction : 3 pour le Triplum, et 5
pour le Duplum.
25 Bernard VECCHIONE, 2006, « Entre herméneutique et poétique… », op. cit.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
23
À la fin de cette introduction commence le Développement isorythmique du Ténor en
Talea. La première section isorythmique du Petre, (BII), est délimitée par la première
énonciation de la Talea.
Color I. Section BII, première énonciation de la Talea.
Cette première énonciation possède un Color particulièrement fidèle au Ecce sacerdos.
Nous retrouvons clairement citée l’intonation (fa-la-sol-do). Puis au milieu de notes
étrangères se dégage la corde de récitation Do. Par la suite nous retrouvons, assez
distinctement, les éléments suspensifs, côte à côte, qui terminent cette première
occurrence.
Color II. Section BIII, deuxième énonciation de la Talea.
Pour la deuxième occurrence du Color, on retrouve les principales notes du verset
grégorien. L’intonation, la corde Do et le Ré, limite de notre ambitus. La séquence
s’achève sur un Sol. On ne retrouve pas cependant la répétition de l’élément
suspensif (B). Beaucoup de notes sont répétées dans un ensemble évoluant peu du
point de vue des hauteurs (Fa à La).
A B
A
B
Chapitre X : L’agencement musical des voix
24
.
Color III. Section BIV, troisième énonciation de la Talea.
En BIV, on retrouve le Color dans sa quasi totalité, sans la répétition de l’élément
(B). Le début expose une intonation sommaire du verset qui est repris dans la
deuxième partie de manière plus fidèle. Il n’y a pas de note répétée de la corde de
récitation Do.
Color IV. Section BV, quatrième énonciation de la Talea.
Dans la quatrième énonciation l’essentiel des notes est présent. On ne trouve pas de
note répétée de la corde Do. Mais nous retrouvons la citation des éléments (A) et (B).
Chapitre X : L’agencement musical des voix
25
Color V. Section BVI, cinquième énonciation de la Talea.
La cinquième énonciation est la seule qui ne présente pas le verset dans sa version
d’origine. Toutes les notes de l’échelle sont présentes. Elle débute par le Ré, puis
expose les notes dans le désordre.
Color VI. Section BVII, sixième énonciation de la Talea.
La sixième énonciation est pratiquement citée dans l’intégralité de sa version
originelle. Il ne nous manque que le Ré aigu. Les éléments A et B sont présents
aussi.
Ré?
Chapitre X : L’agencement musical des voix
26
Color VII. Section BVIII, quatrième énonciation de la Talea.
La dernière énonciation nous expose les notes principales du verset grégorien dès la
quatrième note. Il ne nous manque que le Do après le Ré aigu, ainsi que l’élément B,
pour avoir la séquence complète.
Conclusion (C)
La conclusion, sommaire, permet de faire sonner la note finale du mode, de
redescendre, après une longue pédale de Sol, sur le Fa.
À la suite de cette première lecture, il apparaît clairement que la teneur du Petre est
bien issue du verset du graduel Ecce sacerdos. Nous pouvons ainsi pousser notre
compréhension de l’emprunt plus loin que les suppositions de Clark. Vitry n’a pas
choisi cette pièce grégorienne de manière fortuite. Le poids théologique de cette
Elément
B? Do?
Chapitre X : L’agencement musical des voix
27
pièce est particulièrement significatif de la circonstance pour laquelle, très
vraisemblablement, le motet a été composé. Nous avons vu que, même si dans
certaines occurrences du Color nous n’avons pas l’intégralité de la séquence, cela
n’affecte en rien l’implication particulièrement de ce verset dans notre motet. D’un
point de vue technique, la modalité est là, et c’est ce qui compte dans l’établissement
d’une teneur. D’un point de vue sémantique, dans un monde où l’art de la mémoire
est particulièrement présent, le simple fait d’évoquer une chose, même partiellement,
est suffisant pour tisser tout un réseau de références26. Le lien, même ténu, du Petre
avec l’Ecce sacerdos, nous permet de voir à quelle sphère de signification le motet de
Vitry se rattache, depuis quoi, et surtout sur quoi, il vise à argumenter. Clark a été
freinée dans sa démarche par le fait de rechercher des correspondances entre l’Ecce et
le Petre, sur la base d’une méthode comparative voulant à tout prix retrouver dans le
motet la musique du verset grégorien dans son intégralité. L’occurrence du Color
simplement liée à la citation de l’échelle modale de la pièce grégorienne d’origine est
un point essentiel pour comprendre le processus de composition d’un motet. À partir
du moment où l’œuvre repose sur les notes pivots essentielles au mode d’origine,
celles, dans le fond, qui s’entendent le plus, la citation est effective ou plus
précisément elle acquiert fonction de référenciation.27 Ceci demeure valable lorsque
le teneur intègre l’occurrence de manière désordonnée, ou même disséminée parmi
d’autres notes étrangères à la source d’origine. La difficulté est réelle pour le teneur
de motet composée par centonisation, où plusieurs sources d’origine sont utilisées,
mixées, pour une inventio.28 Mais dans l’ensemble des cas les ressemblances sont
suffisamment perceptibles pour que l’on retrouve, sous la teneur, la pièce liturgique
qui en a suscité la composition.29 Le Petre est un bon exemple de ces motets qui
26 Anna Maria BUSSE BERGER, op. cit., p. 16-17.
27 Dans le fond, cette manière d’évoquer « en filigrane » la pièce liturgique originelle pourrait ressembler à cet autre présence « en filigrane » du nom de Joseph en acrorime initiale du poème du Triplum dans le motet Ave Regina celorum de Marchetto da Padova (Vecchione, 2008, op. cit., 2014, op.cit.). Le matériau rimique de ce poème en effet comporte en voyelles accentuées les lettres <O.E.> du nom de <(J) O(s) E (ph)>. Comme Joseph, qui est présent, mais en retrait de la scène d’Annonciation qu’évoquent les acrostiches de ce poème, le verset de l’Ecce sacerdos peut être présent dans ce motet, mais en filigrane, et donc à la fois en fond et en retrait. On voit bien alors que l’Ecce sacerdos est présent dans le discours que tient ce motet de Vitry, mais que ce discours « en sort », à la fois parce qu’il en provient et parce qu’il s’en détache.
28 Bien entendu tout ceci n’est valable qu’à partir du moment où l’on trouve suffisamment de preuves qui justifient l’utilisation d’une pièce liturgique pour la construction d’un ténor.
29 Pour Vecchione le problème a trop été limité à la question de l’identité, voire de la ressemblance seule, alors que dans l’inventio, comme dans tout type de tropatio, la question est, pour lui, plutôt celle de la dialectique entre la ressemblance et la différence, i.e. en termes de philosophie et de théologie médiévales, entre la similitudo et la dissimilitudo constitutives de tout mouvement de dérivation (réécrture, évocation…). Il renvoie à ce sujet à ce que dit de la « régio de dissemblances » (regio dissimilitudinis), Georges Didi-Hubermann dans son Fra Angelico. Dissemblance et figuration, Paris,
Chapitre X : L’agencement musical des voix
28
s’éloignent des « cas musicologiques d’école » appliquant automatiquement une
conception de l’« isorythmie » dans laquelle le Color est très exactement dupliqué et
très clairement conjoint à la Talea. Toute sorte de cas de figure se rencontrent entre
ces deux extrêmes que sont la duplication exacte et la dérivation lointaine par des
procédés de tropation très sophistiqués, permettant d’opérer tout une gradation dans
le traitement des évocations et des dissemblances. La question est alors de savoir que
signifie très exactement les techniques de tropations employées. Quel sens peut avoir
l’acte d’écrire depuis une source liturgique dont on ne veut pas qu’elle apparaisse
clairement ? Vitry semble, en tout cas, atteindre le sommet de son art par la maîtrise
technique de la forme, ainsi que par l’art de réemployer en les tropant les éléments
issus d’une tradition liturgique déjà signifiante. La distance entre source et tropation,
l’Ecce sacerdos grégorien et le Ténor du Petre, tel justement que réécrit, « inventé », par
Vitry, est précisément le problème. Pour l’herméneutique du motet médiéval
proposée par Bernard Vecchione, par sa configuration en dérivation, en trope
justement, le réemploi d’une source grégorienne et sa réécriture, sa glose, en vue d’un
nouvel ajout, d’actualité, à la liturgie (comme c’est le cas, entre autres, du motet)
produit d’elle-même signification. La réécriture participe activement du message
formé par l’œuvre et transmis à des destinataires pour les persuader ; tout comme la
présence ostensiblement affichée ou plus ou moins dissimulée, mise plus ou moins
en retrait d’une référence évoquée de façon plus ou moins biaise. D’après Clark, il
semblerait que le Petre posséderait en sous-entendu ce précepte essentiel qui
correspond à l’ambiance politique de l’élection de Clément VI et de ses conflits
d’alors avec Louis de Bavière.
Nous voyons en tout cas que le programme littéraire implique très fortement le pape
Clément et son rattachement explicite de la lignée de Pierre, ce qui d’un point de vue
théologique ne fait que démontrer légitimation de Clément par la constance de
l’action pontificale dans un profond respect de la tradition romaine, mais est surtout
l’indice de ce problème que Clément VI pouvait rencontrer face à ses détracteurs qui
le considéraient comme non légitime car hors de Rome et loin par conséquent de la
chaire de Pierre.
Flammarion, 1995, notamment dans ces deux paragraphes, p.98-118, où il traite de « La dialectique du dissemblable » et de « Memoria, ou l’implicite des figures ».
Chapitre X : L’agencement musical des voix
29
La « compositio » des voix supérieures
Tessitures et fonction des voix
Le Petre est un motet à trois voix. Si son Ténor (écrit en UT3) est instrumental, les
deux autres voix, écrites au-dessus de lui en tessiture, sont deux voix chantées. Ces
voix, qui sont écrites dans la même tessiture (clefs d’UT1), coopèrent étroitement
dans la pièce, alternant à la fois l'imitation, la complémentarité, mais également
l'opposition. Cette disposition polyphonique est assez fréquente dans les motets
français du XIVe siècle. La mensuration du motet est en tempus imperfectum prolatio
maior. Les textes des voix chantées, on l’a vu, sont distincts du point de vue de leur
construction poétique autant que de leur signification. Pourtant, comme c’est en
général le cas dans les motets, de par les dispositifs d’écriture musicale au moyen
desquels Vitry fait chanter leurs textes, leurs fonctions respectives, dans le discours
qu’elles tiennent de concert, semblent en étroite interdépendance.
Tout d’abord, elles possèdent toutes deux une dédicace à Clément VI :
Au Triplum, dès le premier vers : « Petre Clemens, tam re quam nomine » (Pierre,
clément tant par les actes que par le nom).
Au Duplum, par l’expression « Clemens sextus sanctus divinitus », énoncée au
sixième vers du poème (mise en exergue du chiffre 6, par le sens à produire, par la
place où on le produit, mais illustration parfaite ici de ce qu’est la symbolique du
chiffre 10 quant à l’écriture, rapportée ici à Clément, des vers décasyllabes de la
pièce).
Au Ténor, qui, par son origine liturgique et sa structure isorythmique que
suivent les deux autres voix, exprime symboliquement le nom et la personne du pape.
Dans l’Introduction (AI), les voix dialogues entre-elles. Les deux premiers vers de
l’une et de l’autre y sont utilisés.
Le texte de la voix de Triplum semble être inspiré par la pièce grégorienne Bone pastor,
Clemens accipe. Le Duplum est la voix qui dédicace directement le motet à Clément VI.
C’est une voix originale, qui est étroitement liée au Ténor par la reprise de son incipit
textuel, à la toute fin du texte, sous la forme : « Cui non est inventus tuus similis ».
Citation qui diffère légèrement d’un point de vue grammatical du « Non est inventus
similis illi » liturgique, mais dans laquelle, comme nous l’avons dit, le pronom
personnel <ILLI> change de forme tout en migrant de l’extrême fin du texte vers
une position initiale de pronom relatif <CUI>, mais aussi où l’adjectif possessif
Chapitre X : L’agencement musical des voix
30
<TUUS> renverse transforme le participe passé <INVENTUS> en substantif. On
pourrait imaginer que Vitry transforme la phrase en y adjoignant le tutoiement du
<TUUS>, mais ceci ne serait recevable que si l’on considérait que le narrateur en
fiction du motet ne pourrait être que son compositeur même, ce que conteste
sévèrement Vecchione à l’occasion de son analyse narratologique de l’Ave regina
celorum de Marchetto da Padova, étendue plus tard à divers autres motets30.
L’adaptation du <ILLI> en <CUI> ne change pas sur le fond le sens de ce fragment
de texte, mais à regarder de près, comme on l’a dit, en adapte localement le sens au
contexte du motet dans lequel, comme conclusion, résolution, aboutissement il
apparaît.
Un problème intéressant est celui du rôle des voix dans le discours qu’émet la
polyphonie. Comme l’a montré Bernard Vecchione,31 à l’image de l’élévation
30 Dans sa narratologie des motets Vecchione établit nettement la différence entre le narrateur réel qu’est le compositeur et le narrateur fictif auquel dans sa pièce il délègue parole. C’est en général ce dernier qui parle en première personne et non forcément toujours le compositeur. Dans ce Petre de Vitry la question est de savoir qui parle en employant le tutoiement. Si l’on imagine que c’est Philippe de Vitry lui-même, il est clair alors qu’une proximité, voire une familiarité, entre le pape et le compositeur sont à suggérer. Mais si le narrateur du motet est le narrateur fictif que Vitry met en scène dans sa pièce, alors il n’en est rien. Pour le Plange de Machaut, Vecchione par exemple a montré que ce n’était pas le compositeur qui s’adressait au Duc Charles de Normandie en le tutoyant, mais la Vierge Marie à qui Machaut dédie cette pièce afin qu’elle convainque Charles, en ces débuts de guerre de Cent Ans, pendant la captivité londonienne de son père, le roi Jean II, de ne pas craindre de prendre les armes contre les Anglais et leurs alliés, car le Ciel lui viendra en aide sur le champ de bataille le moment venu. Or, si le nom d’Enrico Scrovegni est clairement mentionné dans le motet de Marchetto, celui de la Vierge n’est jamais mentionné dans celui de Machaut. Se référant à la narratologie littéraire de Gérard Genette, Vecchione considère alors qu’il y a deux types de motets : les « homodiégétiques » (où le compositeur parle en première personne) et les hétérodiégétiques (où le compositeur délègue parole à un narrateur fictif qui parle ou non dans le motet en première personne). Il considère aussi que dans ce dernier cas deux autres possibilités se rencontrent : celle des narrateurs fictifs présents en énoncé, et celle des narrateurs fictifs hors cadre de l’énoncé (comme c’est le cas du Plange de Machaut, et vraisemblablement de ce motet Petre de Vitry). Comme exemple de ce second type, Vecchione propose aussi la scène d’Annonciation décrite dans l’Ave Regina Celorum de Marchetto da Padova, où les paroles prononcées par l’Archange Gabriel sont seules présentes en acrostrophe initiale du poème de la voix de Triplum, alors que le nom de l’Archange Gabriel qui les prononce n’est jamais énoncé en motet. L’Archange reste hors cadre, mais le discours du motet ne commence qu’avec les paroles de l’Ange. Tout dépend, dit Vecchione alors, du « cadrage du discours », englobant le narrateur fictif ou le laissant hors cadre de l’énoncé. De la sorte, si, en accord avec la narratologie littéraire de Gérard Genette il oppose l’extradiégèse à l’intradiégèse (i.e. le compositeur, son commanditaire et la circonstance précise de composition, de destination du motet, au discours fictif du motet), au-delà de Genette il distingue deux types d’intradiégèse : celle en énoncé, et celle en hors-cadre de l’énoncé, impliquée par l’énoncé (par exemple l’Archange Gabriel du motet de Marchetto, la Vierge Marie du Plange de Machaut), mais qu’on ne peut confondre avec les éléments factuels (compositeur, commanditaire, circonstance…) de l’extradiégèse.
31 Sur le motet à trois voix Ave Regina celorum/ Mater innocencie/ [Ite missa est] de Marchetto da Padova (2008, 2014, op. cit.), composé pour la cérémonie de consécration de la chapelle des Scrovegni, le 25 mars 1305, et le motet à quatre voix Ave corpus sanctum/ Protomartyris / Gloriosi Stefani, composé très vraisemblablement pour la célébration des reliques de saint Étienne dans l’Abbaye de l’Isola San Giorgio, à Venise, le 26 décembre 1329 en présence du doge de Venise Francesco Dandolo nouvellement élu (Vecchione 2009, op. cit.).
Chapitre X : L’agencement musical des voix
31
intérieure des édifices gothiques, dans le dispositif polyphonique « à l’italienne » des
motets des débuts du Trecento, la répartition en tessiture des voix est
particulièrement signifiante sur le plan symbolique, renvoyant à l’agencement de la
Création entre mondes de la Terre (voix grave de Duplum), monde des
intermédiaires, pasteurs de peuples religieux ou civils (partie médiane de Ténor), et
monde du Ciel (voix aiguë de Triplum). Dans les motets composés en Italie au début
du XIVe siècle, et même si le nombre de ceux qui ont subsisté en archives est très
réduit, le Triplum est un lieu équivalent à celui des grandes verrières dans
l’architecture des cathédrales gothiques du Nord. Il est le lieu où s’exprime une
parole venue du Ciel et destinée à la Terre. Le Ténor, et même le Contreténor, sont
en voix intermédiaires, comme on le voit dans l’Ave regina celorum ou l’anonyme
vénitien Ave corpus sanctum en l’honneur des reliques de saint Etienne.32 La voix
chantée de Duplum est en voix grave et exprime une parole venue de la Terre et
destinée à la Terre ou au Ciel. La tessiture des voix, dans ces motets, dit leur fonction
discursive, tout comme le lieu depuis lequel le discours que tient chacune est
prononcé. En France, et dans l’Europe du Nord, le système d’élévation des voix est
légèrement différent, notamment pour l’emplacement de la voix de Ténor. Le Ténor
est la voix la plus grave : elle est en soubassement de l’édifice polyphonique ; c’est elle
qui soutient tout l'édifice, et qui semblerait symboliser dans cette forme d’écriture
l’importance accordée l’Église comme fondement de la société gothique, tant
française qu’anglaise, vis-à-vis de l’exercice du pouvoir royal, et notamment de son
caractère sacré par l’Eglise. Si en Europe du Nord la royauté fait allégeance à l’Eglise,
en Italie il semblerait que le fondement de la société soit tout autre : dévolu à la
Grande Bourgeoisie d’affaires et à ses représentants élus (les doges de Venise, etc.).
32 À propos de cette pièce, Bernard Vecchione écrit (2009, ibidem, p. 280) : « La voix la plus grave est celle de Duplum (UT4) ; la plus aiguë celle de Triplum (UT2) ; entre les deux s’échelonnent les parties de Contreténor et de Ténor, le Contreténor (UT4) étant plus grave que le Ténor (UT2). D’où l’ordre des voix : du grave à l’aigu, Duplum, Contreténor, Ténor et Triplum. Le dispositif est “à l’italienne”, le Ténor et le Contreténor instrumentaux étant ici intercalés en tessiture entre le Duplum et le Triplum chantés. On remarque par ailleurs la même clef (UT4) pour les parties de Duplum et de Contreténor ; et la même clef aussi (UT2) pour les parties de Ténor et de Triplum. Ce qui laisse supposer que la fonction discursive de la partie de Contreténor est liée à celle de la voix de Duplum ; et que la fonction discursive de la partie de Ténor est liée à celle de la voix de Triplum. Or le nom du doge, Francesco Dandolo (strophe 2, vers 2), est cité dans le texte de la voix de Triplum ; tandis que celui de l’Abbé de l’Isola San Giorgio l’est dans le texte de la voix de Duplum. Les fonctions des voix et des parties instrumentales sont reliées deux à deux : le Duplum, la voix qui, depuis la Terre, parle de questions politiques et de pouvoir temporel, est liée à la partie de Contreténor ; le Triplum, la voix qui parle, depuis le Ciel, en général de doctrine et de pouvoir spirituel, est liée à la partie (isorythmique ici) de Ténor. Par les tessitures, se détectent les lieux depuis lesquels des paroles sont émises, et des points de vue, des topoï discursifs avec leurs thèmes, la manière dont singulièrement ces topoi sont envisagés. Mais ici les reliques d’Étienne sont possession du doge et non de l’abbé à qui il les a confiées. Cette messe de célébration des reliques d’Étienne était l’occasion pour le doge de réaffirmer sa suprématie à Venise sur l’Église. D’où le retournement : au Triplum le pouvoir sacré du doge, ce pouvoir que le doge à Venise détient directement des reliques d’Étienne ; au Duplum le pouvoir subalterne de l’abbé de Saint-Georges, au service matériel du pouvoir doganal ».
Chapitre X : L’agencement musical des voix
32
Pour ce qui est des voix chantées, leur fonction discursive semble ne pas différer de
celles des dispositifs polyphoniques « à l’italienne ». On voit bien dans ce Petre Clemens
de Vitry que, si c’est à la voix de Triplum que s’effectue l’adresse à Clément comme
réel successeur de Pierre, <PETRE CLEMENS> (m.1), c’est à la voix de Duplum en
revanche que s’effectue son apostrophe comme <CLEMENS SEXTUS> (m.22).
Dans le Petre, les deux voix chantées sont écrites en clef d’UT 1, dans la même
tessiture, ce qui favorise une conception à la fois unitaire et dialogique du discours
qu’elles tiennent. Fusion du discours presque entre la voix dont le discours émane de
la Terre (Duplum) et celle dont le discours vient du Ciel (Triplum).
Ainsi, outre l'art musical qui offre une répartition particulière du discours par la
polyphonie, les textes littéraires, par leur sens, permettent de singulariser chaque voix,
et de les mettre en dialogue pour produire un discours cohérent. Mais on remarquera
que ce n’est pas tant les paroles qui en elles-mêmes sont signifiées par l’élévation
polyphonique du motet que les modalités de leur mise en perspective : point de vue
de l’énoncé, depuis la Terre ou le Ciel, depuis son émetteur ou son récepteur.33
Comment le Petre Clemens utilise-t-il ce précepte ? Comment comprendre le sens du
discours émis par chacune des voix ? Comment comprendre que de la musique
organise, de par sa constitution polyphonique, l’unité des trois discours distincts mais
simultanés.
Dispositifs d’écriture
Chaque voix a une fonction bien spécifique dans l’énonciation du discours que tient
le motet.
Le Ténor en est le fondement : de par son enracinement en liturgie (le verset grégorien
« Non est inventus » du commun d’un confesseur « Ecce sacerdos ») ; mais aussi de par sa
disposition en tessiture grave ; et son organisation isorythmique depuis un Color
emprunté (même réécrit peu importe) et une Talea. Il forme en quelque sorte le fond
(ou la source) du propos. Il rappelle, de façon symbolique par le jeu des allusions, que
le pape est le prêtre (sacerdos), le Bon Pasteur (Bone pastor), le représentant du Christ
33 Vecchione par exemple (2014, op. cit., p.94-95) remarque que le chiffre 15, si important dans l’Ave Regina celorum de Marchetto da Padova, dit en fait, dans la scène d’Annonciation dépeinte à la voix de Triplum, les paroles de l’Ange <AVE MARIA GRACIA PLENA etc.), non émises par lui cependant, mais reçues par la Vierge, avec cet infléchissement du discours sur le mystère de l’Incarnation. Les paroles de l’Ange sont au nombre de 15, le Ténor de Marchetto a un Color de 15 notes, le Panneau de la Vierge de l’Annonciation peinte par Giotto dans la chapelle des Scrovegni dont le motet de Marchetto est le motet de dédicace, est le 15ème du cycle des Vies. Le seul vers hypercatalecte du poème du Triplum qui met en scène en « acrostrophe » initiale l’Annonciation est celui qui commence par la parole de l’Ange <PLENA>.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
33
sur Terre, et qu’il est le seul à connaître, à conserver et faire s’appliquer les lois du
Ciel sur Terre. Enfin, qu’il est le seul à décider du lien de son obédience. Là où il se
trouve le pape se trouve Rome, et donc la Rome céleste, le Siège de saint Pierre.
Le Duplum exprime la voix qui s’élève depuis la Terre. C’est la seule dont le texte
énonce clairement, au vers 6 (m.22-23), le nom et la qualité du pontife : <CLEMENS
SEXTUS SANCTUS DIVINITUS>. Clément est le sixième pape qui porte le nom
de Clément. Le texte le dit au sixième vers. C’est une voix de louange, dont la fin du
texte proclame que Clément n’a pas d’égal sur Terre, et qu’il est donc la personne
qu’il faut, le seul pape légitime. Le texte du Duplum, qui s’écarte depuis le début de
l’exergue oubliée ou peut-être intentionnellement tue du Ténor, le rejoint finalement
en chantant explicitement des termes similaires : <CUI NON EST INVENTUS
TUUS SIMILIS>. Le rôle du Ténor est de conjoindre. Dissimuler le texte, puis
l’inventer, le mettre au jour, le faire très explicitement, par le chant, paraître mais au
bout d’un parcours, opère cette conjonction. Au début de l’œuvre, les discours
diffèrent, ils sont séparés ; à la fin de l’œuvre, ils fusionnent. Tout le trajet discursif
du motet est dans cette opération. Rôle de la distance, puis de sa résorption. Un lien
entre Ténor et Duplum apparaît, pour affirmer, et légitimer, les thèses de l’obédience
avignonnaise.
Le Triplum, quant à lui, nous oriente vers une voie d’interprétation. Il nous rappelle
l’hymne Iam bone pastor Petre clemens, destinée à l’office de la chaire de Pierre. Ainsi les
premiers mots de son texte, Petre Clemens, seraient directement tirés de cette hymne,
tout en en dérivant la signification vers le double sens de <CLEMENS> (Tu es
Clemens et clemens dixeris). C’est ce tissage de textes, à l’égal du tissage des sources
musicales liturgiques, qui est remarquable dans la production des motets. Vitry
intègre cette expression en lui donnant plusieurs interprétations possibles. De plus, le
fait d’intégrer, par synecdoque de la partie pour le tout, un rappel de cet office suffit
à appuyer l’idée qu’Avignon est le siège légitime de Pierre, celui du pape, son Bon
Pasteur. Même si la chaire romaine matérielle de Pierre n’est pas présente, le symbole
qu’elle est pour l’Église est là et se suffit à lui-même. Il ne s’agit plus alors de débattre
sur la présence réelle de la chaire matérielle de Pierre, sa présence à Rome et son
absence en Avignon ; mais de sa chaire spirituelle, celle depuis laquelle est émis
l’enseignement de l’Eglise. Et celle-ci se trouve là où se trouve l’Eglise : non plus à
Rome, celle-ci, mais en Avignon.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
34
Un motet de célébration de la chaire de Pierre
Les deux poèmes du Petre ont finalement une thématique commune : rendre
hommage à Clément VI, pape fraîchement élu, affirmer sa légitimité, tout comme la
validité de ses thèses théocratiques. Sa qualité de « nouveau Cephas » sur la Terre, et
sa clémence, sont affirmées, « tant par ses actes que par son nom ». En recherchant
des éléments sur l’origine grégorienne du Ténor nous avons formulé une hypothèse
sur son lien avec la chaire de Pierre. Nous avons remarqué que l’hymne en l’honneur
de la chaire de Pierre, « Iam bone pastor Petre Clemens accipe » (voir Annexe 3),
renfermait justement l’expression « Petre Clemens », premiers mots du Triplum du mot,
clairement exposés, seuls, par une courte entrée en caccia. Sans son brouillage donc
par le texte de la voix de Duplum, dès ce début de motet l’expression est alors
clairement audible. Seulement accompagnés d’une tenue instrumentale de Fa au
Ténor, en l’absence de Duplum, ces mots d’introduction résonnent comme le thème
sur lequel porte le motet : « Petre Clemens », « Iam bone pastor ». Or, l’expression ne se
retrouve dans aucune autre pièce de la liturgie. Quelle signification la référence peut-
elle avoir ? Vitry ou le gardien du dogme auraient-il glissé un sens tout particulier en
reprenant, en exergue, cette expression ?
Fig. 10
Hymne Iam bone pasto Petre clemens accipe34
La réponse à la question peut se trouver dans la place de cette hymne dans le
calendrier liturgique. Le résultat est particulièrement saisissant. Le choix de Vitry
s’éclaire. L’expression Petre Clemens serait un rappel d’une pièce grégorienne qui, par sa
place dans le calendrier liturgique, se destine à la célébration de la chaire de saint
Pierre. C’est une hymne utilisée à deux reprises, durant les vêpres du 18 janvier et
celle du 22 février. L’Église a toujours célébré la Chaire de l’Apôtre Pierre, premier
pape et fondateur de l’Église romaine. Jusqu’à la réforme Vatican II du Pape Jean
XXIII, on distinguait en fait deux fêtes de la Chaire de Pierre dans l’année liturgique :
34 D’après le site de l’Université de Latrobe, http://www.lib.latrobe.edu.au/MMDB /
MusicDBDB/single.php?FN=M5468&REPNO=
Chapitre X : L’agencement musical des voix
35
celle du 18 janvier, où l’on célébrait la chaire de saint Pierre à Rome ; et celle du 22
février, où l’on célébrait la chaire de saint Pierre à Antioche. La première de ces deux
fêtes a été supprimée, ou plutôt on l’a adjointe à la seconde, en retrouvant en cela la
pratique ancienne de la seule fête du 22 février. Nous savons en effet qu’au Moyen-
Âge à Rome les deux fêtes n’étaient pas distinctes. Certains auteurs soutiennent
même qu’en réalité elles concernaient toutes deux la « Ville éternelle » : celle du 18
janvier se rapportant à la chaire du cimetière d’Ostie où Saint-Pierre eut ses premiers
néophytes ; celle du 22 février concernant la chaire Vaticane. Il est en tout cas certain
que la coutume de célébrer la chaire du Premier des Apôtres à Rome remonte à la
plus haute Antiquité. Les plus anciens sacramentaires, le gélasien et le grégorien pour
citer les plus fameux, attestent en ce jour de l’existence d’une fête appelée « Natale
Petri de cathedra », fête qui s’est maintenue à Rome, à l’exclusion de celle du 18 janvier,
jusqu’au XVIe siècle. La fête du 18 janvier semble être d’origine gallicane. Les Églises
de Gaule avaient bien reçu de Rome le Natale Petri de cathedra, mais elles voyaient
comme un inconvénient d’en faire la célébration durant les jours du Carême. Aussi
en avancèrent-elles la date au 18 janvier. La fête de février fut bien conservée en
Gaule, mais on la réserva à la chaire d’Antioche, ce qui explique l’origine commune
des deux fêtes. Il est d’ailleurs à noter que dans le missel ces deux fêtes ont la même
messe. Rome adopta plus tardivement l’usage gallican. En 1557, le Pape Paul V mit
en effet, à Rome, la célébration de la Ville en possession de la Chaire de saint Pierre,
précisément au jour du 18 janvier. Chaque année ensuite, à cette même date, la chaire
était portée en procession par des prélats, et ce, jusqu’à Alexandre VII, qui la fit
mettre dans une splendide châsse sise au fond de l’abside de la basilique vaticane.
Lors de ces deux occasions, la célébration de la chaire de Pierre marque le rappel de
l’autorité absolue du pape et de sa « cathedra », représentant son magistère suprême.
C’est le symbole de l’autorité du pape, par la célébration du premier de la lignée
(« Petrus primus ») qui doit être vénéré, transmis et préservé. Lorsqu’un pape prend ses
fonctions, et possession de son pouvoir, il reçoit ses vêtements, la crosse et la tiare,
symbole spirituel pour l’un, temporel pour l’autre de la ville de Rome. De ce siège, il
guidera, en tant que « bon pasteur », les fidèles.
Ainsi, le fait que le motet de Vitry commence par chanter d’une façon clairement
audible les mots Petre Clemens, à la fois sonne comme un rappel et dit toute
l’implication de Pierre Roger, fraîchement élu pape sous le nom de Clément VI, tout
son attachement à la chaire de Pierre, ce qui, de fait, affirme totalement sa légitimité,
aux yeux de tous, ainsi que d’un point de vue purement canonique.
Il est troublant de retrouver l’unique citation possible de l’expression Petre Clemens
dans une pièce grégorienne destinée à la célébration de la chaire du premier pontife.
C’est cette référence qui est une des motivations qui ont suscité la composition du
Chapitre X : L’agencement musical des voix
36
motet : la légitimité de la papauté avignonnaise expatriée de la cité éternelle. Cette
volonté de Clément VI, comme nous avons pu le voir dans sa biographie, l’amènera
à faire construire un édifice en l’honneur de l’apôtre qui deviendra également le
symbole fort d’une légitimité tant décriée.
Pour conforter cette analyse, on peut voir que Vitry semble respecter la mise en
rythme de ce passage, en relation avec l’accentuation latine de la pièce liturgique
d’origine. Dans l’hymne grégorienne du Iam bone pastor, le mot <PETRE> est chanté
syllabiquement, tandis que la première syllabe de <CLE-MENS> bénéficie d’une
brève ornementation ligaturée :
Fig.28
Musique des mots Petre Clemens dans l’hymne grégorienne Iam bone pastor
(State Library of Victoria, Ms *096.1 R66A: The Poissy Antiphona, Folio 409v)
Le mot Petre est chanté au moyen de deux brèves de valeurs inégales. Le mot est
chanté dans une durée ternaire, la première note ayant la valeur d’une Brevis recta et la
seconde d’une Brevis altera, doublée en durée. Tandis que la ligature correspond à
l’accentuation de la première syllabe du mot <CLE-MENS>, le mot est chanté au
moyen de trois notes, deux pour la première syllabe, <CLE->, une pour la seconde,
<-MENS> ; et de telle façon que l’ensemble ait une durée ternaire, la première
syllabe valant deux Breves rectae, et que la deuxième syllabe vaille aussi une Brevis recta.
Dans le Codex d’Ivrea, on retrouve exactement la même configuration rythmique. Le
mot Petre est chanté avec une durée ternaire, la première syllabe étant courte et la
seconde allongée ; et le mot Clemens est chanté avec son mélisme sur la syllabe
<CLE-> et une valeur courte sur la syllabe <–MENS>.
Chapitre X : L’agencement musical des voix
37
Fig. 11
Mise en musique des mots « Petre Clemens » dans le manuscrit d’Ivrea.
Nous retrouvons bien la mise en rythme des mots Petre Clemens du Iam bone pastor.
Certes la ressemblance n'est pas totale. D'un point de vue mélodique notamment,
aucune note ne correspond. Il n'empêche que le système d’ensemble est le même et
que la dérivation se perçoit nettement.
Un lien avec les événements politiques du moment
Cette évocation de la chaire de saint Pierre est directement liée au contexte
géopolitique tant troublé et difficile qui entoure la prise de fonction de Clément VI et
justifie peut-être la composition par Vitry du Petre Clemens. N’oublions pas que dans
le livre de sermon de Clément VI, à côté des poèmes complets du motet, se trouvent
des écrits plus politiques comme le Aperi labia mea, qui dicte les règles du pouvoir
pontifical selon Clément VI, et le texte de Clément Ubi Roma ibi papa.
L’œuvre prend alors sa pleine dimension discursive, une dimension qui confine à la
rhétorique au sens fort d’un discours de type argumentatif. Par la double évocation,
du Ecce sacerdos et du Iam bone pastor, on fait référence à un symbole théocratique fort,
le siège du premier pontife, et on argumente pour légitimer la résidence même du
pape en Avignon, et donc pour le légitimer, comme pape, lui-même. La chaire
matérielle de Pierre fait défaut dans la cité provençale. Par la référence à l’office du
Natale Petri de cathedra, l’œuvre déplace le problème vers l’héritage de la spiritualité
cette fois de la chaire de Pierre et permet de légitimer le pouvoir papal en Avignon.
C’est l’effet de cet « art de la mémoire » dont parle Anna Maria Busse Berger. « Art
de la mémoire » utilisé ici à des fins de discours rhétorique, d’argumentation. Et plus
précisément d’ancrage dans une tradition pour asseoir un argumentaire, accentuer la
force persuasive des arguments déployés.
Qui plus est, on remarque que la musique de l’hymne grégorienne Iam bone pastor est
elle-même tirée de la pièce Aurea luce, destinée à la célébration de la personne même
des apôtres Pierre et Paul.
Ainsi le Petre Clemens s’organise autour de la personne même du pape, à la fois
comme pontife, successeur de Pierre, et garant de la fidélité à l’esprit de
l’enseignement en « cathèdre » de Pierre. C’est du haut de sa chaire que Pierre
enseigne les préceptes de l’Église ; c’est du haut de sa chaire pontificale en Avignon
que Pierre Roger Clément les légitime pour les transmettre avec fidélité et légitimité.
Toutes proportions gardées, on pourrait rapporter cette œuvre à une sorte de
discours argumentatif quasi biographique, un discours que Vecchione, pour les
Chapitre X : L’agencement musical des voix
38
motets similaires qu’il a étudiés, rattache à cette branche de la rhétorique qui relève
du genre « épidictique de louange ». Nous y découvrons ses sources d’inspiration, ses
affiliations, et tout un discours d’actualité qui se fonde dans les préceptes et les
traditions de l’Église pour argumenter sur les dangers qui menacent la papauté
avignonnaise dans l’Europe du moment.
L’expression Petre Clemens est redéployée dans sa signification par Vitry qui en étend
le sens, sorte de « condensé littéraire » impliquant une multiplicité de lectures, selon
les préceptes de l’exégèse médiévale : une seule énonciation mais pour dire,
simultanément, plusieurs choses. Dispositif fréquent finalement à cette époque, et qui
semble prendre de l’ampleur au XIVe siècle et s’adapter parfaitement au genre du
motet. Polyphonie, pluritextualité, multiplicité des lectures simultanées des données,
tant littéraires que liturgiques et musicales de l’œuvre. D’où, par le jeu de mot sur le
nom de Clément, les relations emblématiques : « Pierre, tu es Clément », « Clément,
tu es Pierre », « Pierre, tu es Roger », « Roger, tu es Clément », et « Clément, tu es
Pierre » ; et de plus, comme Pierre, « Clément, tu es clément ». La vers décasyllabe
qui sert d’ouverture au motet, <PETRE CLEMENS TAN RE QUAM NOMINE>,
se révèle être dans le fond plus qu’un subtil jeu de mot entre son nom de baptême,
« Pierre », pour Pierre Roger d’Egletons, son nom de pontife, Clément, et sacerdoce
comme successeur digne et légitime de Pierre. Comme elle fait référence à son
pouvoir régalien de justice aussi : « tam re quam nomine », par tes actes comme par
ton nom, en tant que pape, tu te montres clément en matière de jugement envers tes
propres adversaires. Plus qu’un simple jeu de mot, elle s’avère être un jeu sur la
pensée des relations multiples et complexes entre les choses (tam re) et leur
expression, leur dénomination (quam nomine). Ce jeu littéraire préfigure parfaitement
le très haut niveau intellectuel dans lequel a été suscité et conçu ce motet. Ce début
du motet, clairement audible dans son texte quand il est chanté, est l’unique fois où
est cité le prénom de baptême du pape. Et il l’est, de plus, en exergue du motet, dès
son ouverture, comme une lettrine enluminée, qui sera supprimée de la reprise
tronquée (b) de la seconde entrée en caccia de cette Introduction, m.5 (Triplum) et
m.6 (Duplum), comme (m.22-23) de la section <SACRARUM DIGNITAS>
(Triplum) / <CLEMENS SEXTUS SANCTUS DIVINITUS> (Duplum) où la
phrase mélodique initiale (a) (m.1-3), évidée de sa tête (<PETRE>) se scinde
(m.22) en deux propositions superposées : (x) (Triplum) et (y) (Duplum). Ce jeu de
signatures multiples est déjà largement présent dans le motet Ave regina celorum, et
sous de multiples formes, comme l’a montré Bernard Vecchione. Il le sera encore
largement dans le motet Nuper rosarum flores, comme il l’a aussi montré, associé alors à
des formes purement musicales de signature, par équivalence entre les initiales du
nom du pape Eugène IV, G(abriele) C(ondulmer), et les notes que ces lettres
Chapitre X : L’agencement musical des voix
39
représentent, Sol (G)-Do (C), dès le début du motet et dans nombre de ses passages
stratégiques ultérieurs.35
35 Les deux premières notes, chantées en valeurs longues, dans le Nuper rosarum flores de Guillaume Dufay, sont à la voix de Motetus Sol (G) et Do (C) et à celle de Triplum Sol(G) et Ré (D). Une double signature de G(abriele) C(ondulmer) associé à G(uillaume) D(ufay). Le double système se reproduit plus loin pour chanter le mot <TIBI> (m.8-9) ou encore dans le très long mélisme sur le petit motet <ORA->, début du <ORATIONE TUA> (vers 22, m.57-84) (Bernard Vecchione, 1998, « Entre rhétorique et pragmatique… », op. cit., p. 372-73). À un autre moment de la pièce, dès que, après une longue introduction sans Ténor ni Second Ténor, quand ceux-ci apparaissent et que commence la première section isorythmique (Ib), l’enjambement du texte, <G(randis templum machinæ) / COND(ecorarunt perpetim)>, laisse apparaître la mise en exergue du nom du pontife Eugène IV, mais comme personne privée, G(abriele) COND(ulmer), de même que la signature <G.CONDULMER> apparaît en tropation tout le long de la section de texte réservée à cette première section avec Ténors (Ib). La chose se reproduit à d’autres moments de la pièce, par exemple (à partir de la m.29), sur le début de la deuxième section sans Ténors de la pièce (IIa), avec l’enjambement du dernier vers de la strophe 2, <CON(secrare) D(ignat)U(s est)…>. D’autres signatures aussi se lisent dans la pièce, comme celle de du pape sous son nom de pontife <EUGENIUS> (m.22) associé à la signature de Cosimo de’ Medici (m.24), mais à rebours du texte celle-ci, <HOC IDEM> [MEDICO H(oc)], dans l’expression d’une politique commune à Florence d’exercice du pouvoir : <EUGENIUS HOC IDEM> → <MEDICO H(oc) [fructus] SUI NEG(otii) U(rbe) E(uropaque) [facere] [permiserunt]>. Nombreux sont les exemples de ce type dans les motets isorythmiques de circonstance du XIVe et du XVe siècle, comme aussi d’ailleurs dans la peinture à laquelle il arrive souvent aussi à cette époque-là de comporter des mots (voir Vecchione, 2009, op. cit., particulièrement p.269-85).
Related Documents