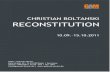1 Date de remise : 31/08/2009 La reconstitution virtuelle du patrimoine perdu : le Projet Inventaires Hamilton. Celia Curnow Chef de projet, Projet Inventaires Hamilton Edimbourg, Ecosse, Royaume-Uni Professeur Bruce Royan Directeur, Groupe Palais Hamilton Virtuel Edimbourg, Ecosse, Royaume Uni Traduction : Pierre Tribhou Bibliothèque Inguimbertine Carpentras, France Meeting : 201. Art Library WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 75TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL 23-27 August 2009, Milan, Italy http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/index.htm Résumé Cet exposé décrit un projet innovant consistant à reconstituer, à partir des ressources des bibliothèques, archives et musées du monde entier, une des plus belles collections privées jamais constituées en Europe. Le Groupe Palais Hamilton Virtuel a été fondé pour recréer sur la Toile un palais ducal qui a été perdu et ses collections spectaculaires de beaux-arts et arts décoratifs qui ont été éparpillés de par le monde. Le prototype de ce projet est décrit et illustré. Il a récemment été soumis à une évaluation détaillée et cet exposé examine pourquoi et comment cela a été mis en œuvre et quelles conclusions en ont été tirées.

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Date de remise : 31/08/2009
La reconstitution virtuelle du patrimoine perdu : le Projet Inventaires Hamilton. Celia Curnow Chef de projet, Projet Inventaires Hamilton Edimbourg, Ecosse, Royaume-Uni Professeur Bruce Royan Directeur, Groupe Palais Hamilton Virtuel Edimbourg, Ecosse, Royaume Uni
Traduction : Pierre Tribhou
Bibliothèque InguimbertineCarpentras, France
Meeting : 201. Art Library
WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 75TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL 23-27 August 2009, Milan, Italy
http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/index.htm
Résumé
Cet exposé décrit un projet innovant consistant à reconstituer, à partir des ressources des bibliothèques, archives et musées du monde entier, une des plus belles collections privées jamais constituées en Europe. Le Groupe Palais Hamilton Virtuel a été fondé pour recréer sur la Toile un palais ducal qui a été perdu et ses collections spectaculaires de beaux-arts et arts décoratifs qui ont été éparpillés de par le monde.
Le prototype de ce projet est décrit et illustré. Il a récemment été soumis à une évaluation détaillée et cet exposé examine pourquoi et comment cela a été mis en œuvre et quelles conclusions en ont été tirées.
2
Les collections Hamilton Les ducs d’Hamilton furent de remarquables collectionneurs de beaux-arts et arts décoratifs pendant près de quatre siècles (Figure 1). La majeure partie de la collection a été dispersée à travers une série de ventes depuis la fin du dix-neuvième siècle et le palais Hamilton lui-même a été détruit à la fin des années 1920. Les localisations actuelles de nombreuses belles pièces ne sont pas connues. Mais il existe, dans les papiers de famille, à la bibliothèque publique locale et ailleurs, une série complète d’inventaires et de catalogues de ventes, remontant au dix-septième siècle.
Le Groupe Palais Hamilton Virtuel Le Groupe Palais Hamilton Virtuel (VHPT)1 a été fondé pour reconstituer le palais et ses collections à travers une série de projets de recherches utilisant les nouvelles technologies. Le groupe est présidé par le célèbre historien et biographe Dr Rosalind K. Marshall2, et ses directeurs comprennent le Dr Godfrey H. Evans, Conservateur principal des arts appliqués d’Europe aux Musées nationaux d’Ecosse, George P. Mackenzie, Directeur des archives nationales d’Ecosse ; et Fraser Niven, Directeur exécutif de Lennoxlove – demeure de l’actuel duc de Hamilton.
Le partenaire technologique du VHPT est le Réseau d’accès aux ressources culturelles d’Ecosse (SCRAN)3. Avec la collaboration de la Commission royale sur les monuments anciens et historiques d’Ecosse (RCAHMS), VHPT a produit un site pilote4 pour montrer ce qui pourrait être fait, notamment des reconstitutions virtuelles en trois dimensions du palais disparu, basées sur des dessins originaux des architectes (dont ceux de William Adam autour de 1730), des plans des années 1920 et des photographies depuis le 19e siècle. (Figure 2).
3
Le Projet Inventaires Hamilton Le groupe a maintenant commencé à rendre accessibles en ligne des versions numériques de chacun des inventaires historiques Hamilton, avec liens hypertextes (sur une base ligne par ligne) vers des transcriptions littérales et versions modernisées de la description de chaque item identifié. Chaque notice d’objet renvoie à son tour aux autres inventaires pertinents, de telle sorte que les chercheurs peuvent retracer la provenance de l’objet, ses changements de localisation à travers les ans, et éventuellement ce qui lui est arrivé une fois qu’il a quitté la famille. A chaque étape du système, il y a une sorte d’espace « wiki modéré », afin que les chercheurs puissent identifier de nouveaux objets, ajouter des informations supplémentaires, corriger des erreurs, etc. (Figure 3).
Un exemple Il est certain que la première chose qu’un utilisateur est susceptible de vouloir faire est une recherche de type Google sur tout ce qui a jusqu’à présent été chargé sur le site, en tapant ce qu’il veut dans la boîte de recherche du coin supérieur droit de la page. Par exemple « Jacobite » appellerait entre autres choses une vue (attribuée à Giuseppe Valeriani) du Palazzo Muti, avec le Prince James Edward Stewart accueillant son plus jeune fils, le Prince Henry, qui venait d’être fait Cardinal. Puisque
4
cette vue a été conservée dans la collection privée du duc de Hamilton jusqu’à une date aussi récente que 2001, elle n’aurait pas été visible si l’utilisateur avait restreint sa recherche aux inventaires historiques et catalogues de vente. Cliquer sur une des vignettes présentées (Figure 4) donne accès à plus d’informations concernant l’objet qu’elle représente (Figure 5).
Pour avoir une idée du mécanisme du Projet Inventaires, cliquez à présent sur « Digitised Inventories » dans la colonne de gauche. Apparaîtront par ordre de date des vignettes d’inventaires sur lesquels nous travaillons actuellement. Choisissez un inventaire qui vous intéresse et vous verrez une liste des pages de cet inventaire qui ont été scannées/transcrites. A long terme, nous espérons avoir des images et des descriptions de chaque objet inscrit dans chaque inventaire ; pour le moment, nous dressons la liste des objets que nous avons déjà chargés, avec le numéro de page correspondant.
5
Une bonne introduction au système serait peut-être de suivre cette démonstration :
Cliquez sur « 1643c. Paintings (M4/21) ». Sélectionnez la page 10. Trouvez la troisième ligne en partant du bas et cliquez dessus. Une boîte de texte s’ouvrira en haut de l’écran, offrant à la fois une transcription littérale et modernisée de l’inscription, à savoir « A litle pece w[i]th Lott [&] his 3 daughters » (Figure 6).
Cliquez sur « View Object » pour afficher l’objet peint (Figure 7).
6
Si vous voulez, vous pouvez ensuite descendre pour lire une rapide description et une liste des autres mentions dans les inventaires (Figure 8).
Vous pouvez cliquer sur certains d’entre eux pour afficher la page scannée correspondante. Ou alors, si vous descendez jusqu’à la section « Who: » de la notice (Figure 9) et si vous cliquez sur « James 3rd Marquis and 1st Duke of Hamilton (Owner) » vous obtiendrez 5 autres peintures de sa collection (Figure 10).
En outre, la notice contient une référence bibliographique à un livre qui traite de la collection Arnott, et en cliquant sur « Title » à côté de cette référence vous pouvez chercher à la Bibliothèque nationale d’Ecosse la cote de l’exemplaire dont ils disposent (Figure 11).
7
Nous avons choisi d’inclure dans ce prototype un éventail de différentes sortes d’inventaires, comprenant lettres, reçus, catalogues de vente, et même la peinture de la galerie de l’archiduc Léopold Wilhelm autour de 1651 (Figure 12).
Si vous la sélectionnez puis cliquez sur la peinture située en haut à gauche du mur de la galerie, vous accèderez aux détails des « Trois philosophes » de Giorgione (Figure 13), qui se trouve aussi dans 4 autres inventaires. Et ainsi de suite…
8
L’Evaluation Depuis la publication en 1988 du livre majeur de Don Norman, Psychology of Everyday Things5, il est reconnu que toute conception de système gagne à suivre une conception centrée sur l’utilisateur, avec pour noyau une évaluation des usages. Autour des années 1990, des idées semblables ont été appliquées à la conception de bases de données culturelles6 et aux sites web de musées7. De nos jours, les auteurs en informatique culturel insistent toujours sur le fait que de bonnes pratiques d’évaluation devraient faire partie du processus de conception numérique à chaque étape, y compris la maintenance perdurant bien après le développement du projet initial8. De plus, une meilleure pratique de l’évaluation commence à apparaître dans le secteur culturel numérique9. En Ecosse en 2005 le Conseil des musées écossais a publié une évaluation de l’impact sur les usagers des projets numériques dans les musées écossais10. Le but de cette évaluation - mieux connaître les utilisateurs des ressources culturelles électroniques - était une partie de la stratégie affichée du Conseil des musées écossais11. Le rapport a identifié les meilleures pratiques en matière de numérisation des collections et a mis en lumière la façon dont les publics considéraient les services offerts. Comme on pouvait s’y attendre, se recommandation principale rappelait l’importance de tester, contrôler et évaluer correctement un projet
9
numérique muséal de façon répétée, à chaque étape et ce dès l’origine. Un autre impératif qui en ressortait était de définir clairement des groupes d’utilisateurs et leurs objectifs probables. C’est sur fond de ces publications et de leurs conclusions que l’évaluation a été considérée par le bureau des directeurs du Groupe Hamilton Virtuel comme partie intégrante du cycle de développement du Projet Inventaires, avec un rôle central à jouer.
Le prototype et ses évaluateurs Le prototype a été développé ces deux dernières années. Une version plus petite qui comprenait sept inventaires matériaux relatifs en a été dévoilée en août 2006 dans le cadre de l’exposition Trésors de Lennoxlove12, qui s’est tenue à la maison de vente Lyon et Turnbull à Edimbourg. Depuis, six autres items ont été ajoutés aux sept inventaires d’origine : factures, inventaires, photographies et lettres.
Treize utilisateurs potentiels ont participé à cette évaluation. Cependant, deux utilisateurs ont effectué l’évaluation ensemble, et ont été comptés comme un seul utilisateur car leur réponses étaient pour la plupart similaires. Il était important d’avoir un équilibre parmi les participants entre ceux qui venaient du monde du commerce, ceux du monde universitaire et ceux du monde des galeries d’art et des musées. Les utilisateurs sélectionnés comprenaient 2 marchands d’art, 3 conservateurs, 5 universitaires, un bibliothécaire, un chef de projet numérique et un historien de l’architecture.
On a considéré qu’ils étaient représentatifs d’un éventail d’utilisateurs potentiels typiques travaillant dans des communautés de recherche et, surtout, rompus à l’utilisation de cette sorte d’archives. Ils ont été interrogés et enregistrés numériquement sur les ordinateurs personnels et portables de leur lieu de travail. On les assura au début de l’entretien que c’étaient eux qui testaient le système et pas l’inverse. L’entretien était semi-directif. A la fin de l’entretien des questions directives ont été posées par questionnaire, pour obtenir des informations sur les interviewés et leur utilisation des archives d’Hamilton et d’autres. Chaque interviewé a suivi les mêmes instructions données dans le même ordre.
Méthodologie et buts de l’évaluation Le but général du Projet Inventaires est de mettre en relation des utilisateurs via les inventaires historiques, la correspondance et les factures dans les archives Hamilton, de façon à suivre la trace des objets qui faisaient anciennement partie des collections Hamilton. Nombre de ces objets se trouvent à présent dans les collections de grands musées et galeries à travers le monde. Il semblait donc logique d’élaborer
10
l’évaluation en usant de critères semblables à ceux utilisés dans l’évaluation de projets numériques muséaux. En tant qu’évaluation qualitative et formatrice d’une ressource numérique interactive, il était important qu’elle puisse prendre place à l’étape de la conception et dès le premier développement du cycle du projet13. Son but général était avant tout d’identifier les besoins des utilisateurs, confirmer les niveaux auxquels ils voudraient interagir avec le site et par là assurer son avenir comme ressource planifiée. En tant que méthode de base de l’étude de marché, l’évaluation a interrogé des individus représentatifs de certains groupes d’usagers potentiels et a analysé leurs réponses. En tant que test de base d’utilisabilité, l’évaluation a identifié dans quelle mesure les utilisateurs étaient capables d’utiliser leurs ressources efficacement et correctement, révélant des erreurs de développement, soulevant des problèmes de programmation et de design/navigation.
Bien que les exigences et besoins de base aient déjà été établis au début du projet de développement, cette évaluation qualitative a étudié le comportement des utilisateurs et visait à obtenir une compréhension plus précise des usagers. On attendait de l’évaluation qu’à son tour elle influe sur les développements à venir de la ressource et fournisse une mise au point fine sur les exigences des utilisateurs.
L’évaluation a été accomplie en observant et en enregistrant numériquement les réactions de chaque usager pendant qu’on lui demandait d’accomplir un certain nombre de tâches ou qu’on le guidait pour cela, faisant l’expérience des principales fonctions et caractéristiques du site. C’était une évaluation d’utilisabilité à coopération minimale ; coopération parce que les utilisateurs n’étaient pas passifs mais œuvraient comme co-évaluateurs. Cette technique d’évaluation est considérée comme fiable et économique14 p.280.
Il aurait sans doute été plus logique de conduire l’évaluation plus tôt dans le cycle de développement, mais ce fut impossible par manque de temps et d’argent. Quelles sortes de méthodes d’évaluation aurait-on pu utiliser plus tôt ? Idéalement les méthodes d’évaluation devraient être composées à la fois de tests par des utilisateurs finaux et d’évaluations par des experts14 p.270. Si une équipe de webdesigners comprend des utilisateurs experts, un éventail de méthodes d’examen peut être utilisé. Une des formes les plus répandues d’évaluation par des experts implique qu’ils vérifient que l’application obéit bien à une liste de règles ou principes du design (visibilité, cohérence, familiarité, affordance, navigabilité, et retour d’information). On y fait parfois référence sous l’expression d’«heuristique de l’utilisabilité ». A partir des écrits de Jacob Nielson15, Don Norman5 et d’autres, Benyon avec d’autres encore ont établi une liste de tels principes de design, choisis pour vérifier si un site est « apprenable, efficace et ouvert »14 pp.65-66. Les évaluations utilisant ce type de méthode sont rapides, peu coûteuses et utiles à l’étape formatrice d’un projet tel que celui-ci. En fait, de nombreux problèmes relevés par les utilisateurs au cours de l’évaluation auraient pu être identifiés par ce type de test
11
initial, ce qui aurait donné une « liste consolidée de problèmes priorisés liés à l’heuristique et aux solutions suggérées »14 p.273.
D’autres problèmes qui ont émergés auraient pu aussi être relevés plus tôt par un autre type d’évaluation experte : l’inspection cognitive. Cette dernière demande à l’évaluateur expert d’examiner rigoureusement les interfaces clés et de poser les questions clés :
L’utilisateur saura-t-il quoi faire sur chaque page ? Verra-t-il comment le faire ? S’il est sur la bonne voie, le saura-t-il ?14 p.537, 13 p. 421
Plusieurs problèmes basiques de navigation relevés par les utilisateurs lors de cette évaluation formatrice auraient pu être relevés plus tôt si une évaluation heuristique et une inspection cognitive avaient été opérées par des utilisateurs experts au début de la construction du prototype. Cependant, une approche alternative a été choisie : construire rapidement un prototype construit à partir de la solution toute faite « SCRAN-in-a-Box ». Cette solution a été créée pour se conformer aux standards de l’accessibilité de base validés par le World Wide Web Consortium16. De plus, la recherche en évaluation de projets numériques interactifs soutient le point de vue que le retour d’information des utilisateurs peut et devrait être utilisé par des designers et développeurs à n’importe quel moment du cycle de développement, idéalement à l’étape du prototype avant la plus grosse partie de la construction du site17.
Le processus d’évaluation Les auteurs ont élaboré un scénario d’utilisation d’après la première carte de navigation du site. Dans ce scénario un utilisateur souhaitait voir une entrée liée à une peinture via un inventaire. Ayant lu les deux pages introductives principales, chaque utilisateur trouvait une peinture – dans ce cas l’entrée décrite comme 85: James, 3rd Marquis of Hamilton by Daniel Mytens à la page 6 de l’inventaire des peintures en 1638 (M4/20). On y accédait par les index qui listaient tous les inventaires inclus dans le projet, et par conséquent par l’index qui liste toutes les pages et items trouvés dans un inventaire particulier. A partir de cette image de la page d’inventaire, l’utilisateur accédait à des transcriptions littérales et modernisées des entrées sur la page. Si l’objet n’avait jamais été localisé, on demandait à l’utilisateur d’aider à identifier la pièce et de suggérer ses localisations. Il créait alors directement un lien vers l’objet s’il existait, ou accédait à une page de transcription. Sur la page de transcription, il pouvait examiner la page et la vignette avec la fonction zoom et accéder à un objet. Ayant visualisé la notice ou la peinture d’un objet, l’utilisateur pouvait ensuite revenir pour lier à un autre inventaire la notice donnée en bas de la page consacrée à l’objet enregistré. On montrait alors à l’utilisateur le système de recherche sélective sur cette page de transcription et finalement un guide avec des informations sur un inventaire unique ou un ensemble d’inventaires. Une étape finale était l’accession aux références bibliographiques sur
12
une page de transcription d’inventaire contenant des liens directs vers les cotes de la Bibliothèque nationale d’Ecosse et la British Library.
Les évaluateurs remplissaient ensuite un questionnaire sur eux-mêmes, leur relation au Hamilton Palace, leur usage des collections Hamilton et des Archives nationales d’Ecosse. On leur demandait d’exposer les raisons pour lesquelles ils pourraient utiliser cette ressource et les façons dont ils pourraient utiliser le site web dans son ensemble, y compris le site web pilote précédent4. Ils étaient invités à prendre en compte l’utilisabilité générale du prototype d’inventaire, sa navigation, ses systèmes de retour d’information, à se demander si les usages qu’on pourrait vouloir en faire étaient clairs, et si on choisirait de l’utiliser pour des tâches réelles. Pour finir, ils étaient invités à donner leur impression générale sur l’ensemble de la ressource et à suggérer des améliorations.
Résultats Les enregistrements numériques de chaque session d’évaluation on été transcrits et à partir des transcriptions une liste de recommandations et/ou de solutions envisageables (17 au total) a été dressée. Il était important de noter les réactions positives au site tout autant que les négatives afin que les aspects positifs de l’expérience d’utilisation ne soient pas perdus lors d’un réaménagement du site. Plusieurs problèmes relevaient des principes de bases ou de l’heuristique de l’utilisabilité et du design14 p.272 :
• apprenabilité (navigation, contrôle, cohérence, retour d’information), • efficacité (familiarité, visibilité) • ouverture (convivialité, souplesse, et par-dessus tout style)
Des parties du questionnaire ont parfois obtenu des réponses similaires mais grâce à sa nature semi-directive il poussait souvent les utilisateurs à réfléchir plus profondément au site et à son potentiel. Par exemple, on a demandé aux utilisateurs s’ils paieraient pour regarder d’autres matériaux d’archive présentés de la même façon, reliant des inventaires archivés à des objets localisés. Les réponses étaient très positives avec une large suggestion d’archives et de collections qui pourraient être traitées de la même façon. Il était intéressant de voir les variations au sujet de ce que les utilisateurs considéraient comme les atouts et les défauts du site. Les défauts les plus graves qui ont été pointés étaient l’absence de page d’aide opérationnelle, et (à certains endroits) le manque d’orientation logique à travers le site (les utilisateurs ne savaient pas quoi faire). En revanche, l’engagement initial des Archives nationales d’Ecosse de scanner les archives Hamilton, la fidélité et la haute résolution des scans et le design global ont été appréciés.
Les utilisateurs ont montré du plaisir, de l’intérêt et de la fascination pour la profondeur et l’étendue des inventaires, factures et photographies utilisés pour le prototype, ainsi que pour les liens qui avaient été et seraient faits aux peintures et meubles maintenant pour la plupart éparpillés en diverses collections. Ils ont salué
13
l’opportunité offerte à chaque utilisateur de s’engager dans des transcriptions et éventuellement de les contester et étaient conscients qu’ils pouvaient contribuer de façon significative au projet de recherche en identifiant et en établissant des liens avec des peintures et meubles non localisés jusqu’ici. Ils ont réalisé la nature collaborative de cette recherche, qui s’accorde à l’approche Web 2.0 : « Le web est à tout le monde ! ».
Sur tous ces aspects l’évaluation a montré à quel point le projet est à la pointe. Elle a confirmé qu’à l’ère numérique de nouveaux modes d’apprentissage et de compréhension apparaissent continuellement, comme en Europe au 15e siècle à la suite de l’invention de l’impression à caractères mobiles. Les évaluateurs ont pris conscience que le VHPT fournit un accès aux archives à un niveau sans doute plus profond que tout autre projet actuel de numérisation en recherche historique universitaire et en histoire de l’art. Ils ont compris qu’à son état achevé le Projet Inventaires prolongeait les valeureux efforts pour localiser les collections Hamilton dans leur ensemble, en résolvant des questions cruciales de provenance qui avaient embarrassé au moins trois générations d’historiens et d’historiens de l’art. Ainsi que l’a déclaré avec enthousiasme un évaluateur à la fin de l’entretien :
« C’est une visite virtuelle de ce qui fut la plus importante demeure en Ecosse… Vous poussez loin vos recherches. Même dans les plus belles demeures du pays nous n’atteindrions jamais ce niveau de connaissance dans un guide… Tout est à portée de main… Si nous étions à la Bibliothèque d’Hamilton nous aurions environ 58 documents ouverts… avec nos doigts en guise de marque-pages... Le Victoria & Albert Museum, la National Gallery et même le Met[ropolitan Museum de New York]… Je pense qu’aucun d’eux n’a jamais pu faire de liens entre les inventaires à un tel niveau… Je suis étonné et ravi que vous ayez pu aller si loin. »
Prochaines étapes.L’évaluation a identifié les besoins des utilisateurs, a fait des recommandations, et le travail est en cours pour en réaliser un grand nombre. Le cycle de développement du projet inclura d’autres évaluations centrées utilisateur, et avant cela on espère entreprendre d’autres études expertes telles qu’une inspection cognitive. En outre, même s’il y a encore beaucoup à faire pour compléter les inventaires et lettres du dix-septième siècle, nous pensons déjà à notre prochaine et importante initiative de création de contenu.
La demande des universitaires, conservateurs, marchands, commissaires-priseurs et autres, est grande pour obtenir des informations sur des items particuliers qui ont fait partie de la collection Hamilton Palace à laquelle ils s’intéressent. Cela prend en général la forme de demandes de précisions concernant des descriptions et des attributions, dans quelle demeure et pièce les items se trouvaient, qui les a acquis ou possédés, quelles relations ils entretiennent avec d’autres choses.
Le catalogue Christie’s de 1882 consacré au Hamilton Palace contient 2213 lots de beaux-arts et arts décoratifs qui furent vendus cette année-là mais n’est pas un
14
enregistrement complet de la collection Hamilton. Des centaines d’items avaient été conservés par la famille du 12e duc, ses fidéicommissaires et héritiers. Certains se trouvent toujours à Lennoxlove. Beaucoup d’autres ont été vendus plus tard, notamment lors d’une autre série de ventes Christie’s en 1919, mais aussi lors de douzaines d’autres ventes et dispersions entre 1882 et aujourd’hui. De plus, certains items de la vente de 1882 (par exemple la célèbre peinture par Rubens de Daniel dans la fosse aux lions) ont été rachetés par la famille Hamilton et vendus une deuxième fois plus tard.
Ainsi, rien que la simple publication et annotation du catalogue de vente de 1882 nous permettrait déjà de raconter une partie d’une histoire complexe et fascinante. Une meilleure approche, plus détaillée, serait de choisir l’inventaire du palais Hamilton en 1876, qui comprend la plupart des items de la vente de 1882 et aussi beaucoup de ceux de la vente de 1919 et d’autres ventes/dispersions. En utilisant le catalogue de vente de 1876, qui contient les entrées les plus complètes de tous les inventaires antérieurs à 1882, nous pouvons établir l’existence dans la collection de la plupart des items importants et leur localisation dans le palais. De plus, l’inventaire de 1876 enregistre le palais à son apogée victorienne quand il n’était pas seulement la concentration de pouvoir et de richesses créée par le 10e duc, mais était empli de nombreuses œuvres déplacées depuis les deux propriétés de William Beckford à Bath, les deux maisons de ville des Hamilton à Londres (la maison des 10e duc et duchesse à Portman Square et la maison des 11e duc et duchesse à Arlington Street) et Easton Park dans le Suffolk (dont le 10e duc avait hérité du comte de Rochford en 1830 et qu’il avait utilisé pour abriter beaucoup des items de Beckford à la fin des années 1840 et au début des années 1850).
Nous serions donc capables d’enrichir la base de données de 1876 de toutes les informations pertinentes des inventaires et ressources précédentes, notamment les ressources du dix-septième siècle, les inventaires Holyroodhouse and Kinneil, les inventaires du palais Hamilton en 1759 et 1793, l’inventaire « duc d’Hamilton » relatif aux peintures possédées par le 9e duc d’Hamilton, les inventaires du palais Hamilton en 1811, 1835-40 et 1852/53 enregistrant le développement de la collection par le 10e duc, l’inventaire de la collection Beckford à Bath après sa mort en 1844, les listes relatives à Easton Park et Portman Square et l’inventaire des biens d’Arlington Street rassemblés par le 11e duc, soit à partir de l’accumulation de richesses par Beckford, soit par sa propre activité de collectionneur. A la même époque, nous pourrions ajouter les informations des catalogues de ventes de 1882 et 1919 et d’autres cessions et ainsi rassembler et relier les éléments pour rendre compte de la façon la plus complète possible de la collection du palais Hamilton.
Pour conclure Le prototype a montré dans quelle mesure l’approche VHPT pouvait être employée pour trouver et faire des liens entre des peintures et du mobilier dont le parcours n’avait jusqu’à présent pas été retracé. L’utilisateur final obtient des informations assez complexes, d’une façon intuitive et fascinante sans diminuer leur valeur
15
académique. En cette époque d’accès numérique, l’utilisateur non spécialiste peut interagir de façon originale avec l’information qui était auparavant le domaine réservé des universitaires. Ce projet ouvert à la révision et à la participation est conçu pour permettre de découvrir, sélectionner et recueillir de façon continue des ressources sur la collection Hamilton, et les disséminer vers de nouveaux publics.
L’histoire des ducs de Hamilton et de leurs collections a partie liée avec les grands mouvements et événements du développement de l’Ecosse moderne, et avec certaines des plus belles œuvres de l’art occidental. Le VHPT a déjà suscité l’intérêt de savants à travers l’Ecosse et au-delà, et ce projet est susceptible de devenir l’une des entreprises de recherche artistique, sociologique et historique les plus importantes jamais tentées en Ecosse.
16
Références 1 The Virtual Hamilton Palace Trust [Website] http://www.vhpt.org/
2 Marshall, RK. The days of Duchess Anne: life in the household of the Duchess of Hamilton, 1656-1716. Collins, 1973 3 Royan B. “Cross-domain access to digitised cultural resources: the SCRAN project.” IFLA Journal, 25:2, May 1999 http://www.ifla.org/IV/ifla64/pdf/039-109e.pdf 4 Hamilton Palace: a Virtual Reconstruction [Website] http://sites.scran.ac.uk/vhp/index.html
5 Norman DA. The Psychology of Everyday Things. Basic Books, 1988
6 Royan B. “Towards Database Design Criteria.” In: Proceedings of the UKOLUG State of the Art conference. Learned Information, 1992
7 Hertzum M. “A review of museum web sites: in search of user-centered design.” In: Archives and Museum Informatics 12, 1998
8 Cunliffe D, Kritou E, Tudhope D. “Usability Evaluation for Museum Web Sites.” In: Museum Management and Curatorship 9(3), 2002
9 Dawson D, Grant A, Miller P, Perkins J. “User Evaluation: Sharing Expertise To Build Shared Values.” In: Proceedings of the Museums and the Web Conference, 2004 http://www.archimuse.com/mw2004/papers/dawson/dawson.html
10 Scottish Museums Council. Museums, Galleries and Digitisation - Current best practice and recommendations on measuring impact. November 2005 http://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/publications/publication/44/
11 Scottish Museums Council. A National ICT Strategy for Scotland’s Museums. June 2004 http://www.museumsgalleriesscotland.org.uk/publications/publication/67/
12 [Sibbald J.] Treasures from Lennoxlove: home of the Duke of Hamilton. [Catalogue of an exhibition at Lyon & Turnbull, Edinburgh, 1-18 August 2006]. [Lennoxlove House Ltd], 2006 http://www.vhpt.org/news/news_images/Lennoxlove_cat.pdf?PHPSESSID=48u41fo24tjrnvcscbubs9cs03
13 Preece J, Rogers Y, Sharp H. Interaction Design - beyond human-computer interaction. John Wiley & Sons, 2002
17
14 Benyon D, Turner P, Turner S. Designing Interactive Systems: People, Activities, Context, Technologies. Pearson Education, 2005
15 Nielsen J. Usability Engineering. Academic Press, 1993
16 Web Accessibility Initiative (WAI) [Website]. World Wide Web Consortium http://www.w3.org/WAI/
17 Jones L, Greene SL. “MoMA and the three legged stool: Fostering creative insight in interaction system design.” In: Proceedings of the conference on designing interactive systems: processes, practices, methods and techniques. ACM Press, 2002 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=347660
A propos des auteurs Celia Curnow. Chef de projet, Projet inventaires Hamilton. [email protected] Ancienne conservatrice aux Glasgow Museums and Art Galleries, récemment diplômée d’un master en design des systèmes interactifs et multimédia, Celia dirige actuellement le Projet Inventaires Hamilton et vient d’achever une évaluation du prototype.
Professeur Bruce Royan. Directeur, Groupe Palais Hamilton Virtuel. (Orateur). Directeur exécutif de la société de conseil en informatique culturel Concurrent Computing Limited, Bruce a géré les collections d’art de deux universités, préparé la stratégie ICT des Musées d’Ecosse et a achevé une étude sur l’avenir de l’information pour les Tate Galleries. Il préside le Conseil de coordination des associations d’archives audiovisuelles.
Related Documents