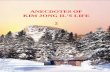Faculté des Sciences sociales et politiques Département de Science politique COMM-B-535: Analyse des discours politiques et médiatiques – 5 ects La langue de bois nord-coréenne Existe-il une différence de rhétorique entre Kim Jong-il et Kim Jong-un à l’égard des Etats-Unis ? Travail présenté par : ABSIL Louis CUFFOLO Maximilien Titulaires : CALABRESE Laura, GOBIN Corinne Année d’étude : POLI4P Année académique : 2012-2013

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Faculté des Sciences sociales et politiques Département de Science politique
COMM-B-535: Analyse des discours politiques et médiatiques – 5 ects
La langue de bois nord-coréenne
Existe-il une différence de rhétorique entre Kim Jong-il et Kim Jong-un à l’égard des Etats-Unis ?
Travail présenté par : ABSIL Louis
CUFFOLO Maximilien
Titulaires : CALABRESE Laura, GOBIN Corinne Année d’étude : POLI4P Année académique : 2012-2013
Table des matières 1. Introduction .................................................................................................................................... 1
2. Corée du Nord ................................................................................................................................ 2 2.1. Politique interne ................................................................................................................................... 2
2.1.1. Caractéristiques principales de la Corée du Nord ............................................................................... 2 2.1.2. La dynastie des Kim ...................................................................................................................................... 3
2.2. Politique externe .................................................................................................................................. 3 2.2.1. La politique étrangère nord-coréenne ...................................................................................................... 3 2.2.2. Les relations américano-coréennes ........................................................................................................... 6
3. Méthode ........................................................................................................................................... 8 3.1. Analyse lexicométrique ....................................................................................................................... 8 3.2. Approches théoriques retenues ......................................................................................................... 9 3.3. Korean Central News Agency ......................................................................................................... 10
4. Analyse lexicométrique ............................................................................................................. 12 4.1. Principales caractéristiques lexicométriques par périodes ...................................................... 12 4.2. Analyse factorielle des correspondances ............................................................................... 14 4.2.1. Kim Jong-‐il et Kim Jong-‐un .................................................................................................................... 14 4.2.2. Spécificités par parties Kim Jong-‐il .................................................................................................... 16 4.2.3. Spécificités par parties Kim Jong-‐un ................................................................................................. 20
4.3. Comparaison ..................................................................................................................................... 23 5. Conclusion .................................................................................................................................... 26
6. Bibliographie ............................................................................................................................... 28 6.1. Ouvrages ............................................................................................................................................ 28 6.2. Articles scientifiques ..................................................................................................................... 28 6.3. Sites Internet .................................................................................................................................... 29
7. Annexes ......................................................................................................................................... 29
1
1. Introduction
Notre travail portera sur une analyse des discours nord-coréens émis au travers de
l’agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA), cette dernière agissant
comme organe de communication à la fois du Parti des travailleurs nord-coréens et du
gouvernement national. Ceci nous amenant dès lors à une imbrication entre discours politique
et médiatique ancrée dans une logique totalitaire propre à l’idéologie Juche et au régime
fondé par Kim Il-sung.
Pour limiter temporellement notre étude, nous nous appesantirons sur un événement
militaire annuel touchant les Etats-Unis et la Corée dans son ensemble, séparée depuis la fin
de la seconde guerre mondiale entre le Nord et le Sud, la frontière définitive ayant été fixée au
travers du 38ème parallèle à la suite de la guerre de Corée. Cet événement, dénommé le Foal
Eagle, consiste en une série d’exercices militaires conjoints menés depuis 1997 entre les fores
armées étatsuniennes et sud-coréennes. Si ces manœuvres sont l’occasion pour les deux alliés
historiques de marquer leur coopération au travers d’une démonstration de leur puissance,
cela représente pour la Corée du Nord une manifestation d’un certain impérialisme et une
perception directe de menace quant à l’intégrité de ses frontières et de son territoire. À cet
égard, il nous apparaît légitime de nous interroger sur d’éventuels changements de discours
émis par le pouvoir communiste, ce que nous ferons au travers d’une analyse à la fois
diachronique et comparative. Respectivement, cela consistera en une étude de changements
rhétoriques que l'on pourrait attribuer au Foal Eagle, ainsi qu’en une comparaison entre les
deux leaders que sont Kim Jong-il et Kim Jong-un, lors de leur première année en tant que
dirigeants « suprêmes » à la fois du parti et du gouvernement.
Eu égard aux éléments décrits ci-dessus, nous partirons ainsi de deux hypothèses
principales, volontairement larges pour permettre à l'analyse de s'exprimer sans biais, de faire
émerger les éléments constitutifs des discours sans restrictions préalables si ce n'est la
sélection du corpus. Notre première hypothèse est qu’il existe une divergence de rhétorique
entre Kim Jong-il et Kim Jong-un concernant les Etats-Unis et leur influence politique, la
deuxième étant qu’il y a un durcissement discursif lors des opérations militaires conjointes
menées lors des événements du Foal Eagle entre les Etats-Unis et la Corée du Sud. Dans un
premier temps, nous aborderons au sein de ce travail certains aspects propres au régime nord-
coréen en lui-même. Dans un second temps, nous relaterons certaines particularités de la
2
politique étrangère nord-coréenne. Ceci étant, nous tenterons, de manière globale, d’exposer
divers éléments conjoncturels et structurels caractéristiques des relations entre la péninsule
coréenne et les Etats-Unis. Nous utiliserons ensuite la méthode lexicométrique d’analyse de
discours avec l'outil informatique Lexico3 pour dégager les éléments qui, combinés au travail
préalable de contextualisation, permettront de conclure ce travail en vérifiant les hypothèses
tout en soulevant toute autre observation s'avérant pertinente.
2. Corée du Nord
2.1. Politique interne
2.1.1. Caractéristiques principales de la Corée du Nord
Le régime nord-coréen, généralement désigné comme totalitaire1, s’est affirmé lors de
la partition de la péninsule coréenne en 1948 alors qu’entre 1910 et 1945 cette dernière se
trouvait sous le régime colonial japonais. L’une des bases principales du régime se situe en
son idéologie, le Juche, marquée entre-autres par un centrisme politique, un paternalisme
idéologique, un collectivisme économique, un racisme ethnique, un isolationnisme
diplomatique ou encore un nationalisme culturel. Le Juche se pose ainsi à la fois comme un
système de pensée politique et philosophique. Ainsi, le nationalisme affirmé au sein du Juche
se répercute notamment en terme d’isolationnisme, voire d’hostilité, à l’égard du monde
extérieur. De plus, cette doctrine sert également à renforcer le culte de personnalité autour de
la « dynastie » des Kim, qu'il s'agisse du fondateur de la nation Kim Il-sung ou de son fils et
successeur Kim Jong-il, ou plus récemment Kim Jong-un, actuel dirigeant de la Corée du
Nord2. En dehors de ces éléments, le régime nord-coréen est également marqué par un parti
unique, le Parti des travailleurs de Corée, dont le poste de secrétaire général est
habituellement occupé par le dirigeant du régime lui-même, en l’occurrence, Kim Jong-un
depuis le 11 avril 2012.
1 Pour plus de détails, voir la définition fournie notamment par Hannah Arendt 2 PARK Han S. (ed.), North Korea. Ideology, Politics, Economy, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1996, pp.2-‐3
3
2.1.2. La dynastie des Kim
Nous intéressant plus particulièrement aux différences communicationnelles entre
Kim Jong-il et Kim Jong-un, et postulant qu’il existe une rhétorique plus apaisée de la part de
ce dernier à l’égard des Etats-Unis, il nous apparaît intéressant de revenir ici brièvement sur
leur parcours respectif depuis la mort du « grand Leader » Kim Il-Sung en juillet 1994. À
l’instar de CHEONG Seong Chang, nous réfutons ici l’image généralement véhiculée au
travers d’ouvrages et d’articles de presse, présentant tantôt les dirigeants nord-coréens comme
des grands politiciens affectueux à l’égard du peuple, tantôt comme des tyrans fous. Kim
Jong-il, né le 16 février 1942 en Union Soviétique, a d'abord fréquenté l’école de Namsan à
Pyongyang avant de suivre les cours à l’Université militaire Kim Il-sung, certaines sources
indiquant qu’entre 1958 et 1960, il aurait étudié à l’Académie militaire de l’air est-allemande.
Ainsi, Kim Jong-il a-t-il été éduqué avant tout dans un but de direction, ce dernier ayant selon
sa biographie abrégée publiée en 1987 pris des fonctions importantes au sein du régime dès
avril 1964, alors qu’il devint « chef suprême » du pays en 19943. Quant à Kim Jong-un, qui
serait né en janvier 1983 ou 1984, il semble avoir joui d’un parcours davantage « ouvert ». Ce
dernier, qui a effectué son éducation primaire en Corée du Nord, a effectué dès 1992 un
voyage en Chine et au Japon, alors qu’en 1994, il se rendait en voyage en Europe. De 1996 à
2001, il étudia en Suisse, à l’Ecole internationale de Berne notamment. Lors de son retour en
Corée du Nord, en 2001, Kim Jong-un savait ainsi parler anglais, français et allemand, en
dehors du coréen. Ceci étant, de 2002 à 2007, il étudia lui aussi à l’Université militaire de
Kim Il-sung, où lui fut inculquée l’idéologie du Juche. Après cela, il fût petit à petit incorporé
à des postes clefs du régime, jusqu’à la succession de son père à la tête du pays suite au décès
de celui-ci en décembre 20114.
2.2. Politique externe
2.2.1. La politique étrangère nord-coréenne
La politique étrangère de la Corée du Nord se base historiquement sur plusieurs
objectifs, certains étant manifestes, d’autres latents. Alors que les premiers font référence aux
positions officielles du régime, les seconds sont quant à eux sous-jacents à l’attitude
observable de l’État coréen, indique Byung Chul KOH. Aussi, plus un État apparaît comme 3 CHEONG Seong Chang, Idéologie et Système en Corée du Nord. De KIM Il-‐Sông à KIM Chông-‐Il, Paris, Editions L’Harmattan, 1997, pp.-‐307-‐311 4 North Korea Leadership Watch, http://nkleadershipwatch.wordpress.com/kim-‐jong-‐un/
4
fermé, plus la probabilité que ses objectifs latents s’éloignent de ses revendications manifestes
est grande. Trois objectifs manifestes peuvent être ainsi relevés selon l'auteur, à savoir
« l’indépendance », « la paix » ou encore « l’amitié », ceci s’inscrivant notamment dans une
certaine continuité historique de la politique étrangère nord-coréenne. Le premier but à
atteindre, prioritaire, fait référence à la recherche d’autonomie de l’Etat sur la scène
internationale et la volonté de construire un nouvel ordre mondial, ainsi que la volonté de voir
la réunification des deux Corée(s) aboutir au travers l’engagement de négociations avec les
Etats-Unis et la signature d’un traité de paix avec ces derniers ; ceci s’imbriquant entre autres
dans la volonté de Pyongyang de voir le retrait des forces étasunienne du territoire sud-
coréen. Il est à noter que la promotion de cette volonté d’indépendance sert également de
moyen interne de propagande pour le régime. Le deuxième objectif s’insère lui aussi dans la
volonté de voir le retrait des forces étasuniennes de Corée du Sud, tandis que le troisième
objectif s’insère dans la recherche de soutien extérieur dans la lutte contre les Etats
impérialistes et plus particulièrement contre « l’impérialisme étasunien ». Les objectifs latents
de la politique étrangère nord-coréenne se regroupent quant à eux autour de la recherche de
« légitimité », de « sécurité » et de « développement », ceux-ci étant également poursuivis par
la Corée du Sud. Le premier but s’insère ainsi dans la nécessité pour l’État de se présenter et
de se faire reconnaître comme le seul représentant légitime de la Corée, face à la république
sud-coréenne, et ce depuis la division de la péninsule en 1945. La recherche de sécurité se
marque quant à elle notamment par la course à l’armement et la volonté de voir le retrait des
forces et armes américaines de Corée du Sud, cette présence étant perçue non seulement
comme une entrave à la réunification mais également comme une menace pour la sécurité de
la Corée du Nord. Enfin, le développement du pays, qui constitue l’un des objectifs
principaux d'une grande majorité des pays du tiers-monde, s’insère ici également comme
nécessité en lien avec la recherche de légitimité et de sécurité par le régime5.
Kim Yongho dépeint quant à lui la politique étrangère nord-coréenne en terme de
perception de la menace, analysée à partir de deux variables, l’une faisant référence à la
perception de la menace externe, à savoir le dilemme de sécurité, et l’autre, à la perception de
la menace interne, à savoir la question de la succession. Ici, l’environnement international et
interne de la Corée du Nord est ainsi vu comme une cause, alors que l’attitude provocante du
régime est vue comme un effet et ce au travers de la question du dilemme de sécurité et de la 5 KOH Byung Chul, « Foreign Policy Goals, Constraints, And Prospects », in, PARK, Han S. (ed.), North Korea. Ideology, Politics, Economy, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1996, pp.175-‐184
5
question de la succession6. Ainsi, l’attitude provocante de la Corée du Nord en matière de
politique étrangère peut être ici vue comme un moyen diplomatique permettant au régime
d’influencer les Etats-Unis et la perception que ces derniers entretiennent à l’égard du régime
nord-coréen. L’auteur met également en avant la manière dont le terrorisme, orienté vers la
Corée du Sud et vu ici comme « l’usage illégitime de la force, motivé politiquement et dirigé
vers les civils » a pu servir de moyen pour Pyongyang d’exprimer sa réprobation à l’égard de
la politique étasunienne tout autant que de moyen d’avertissement à l’égard de la Corée du
Sud et des Etats-Unis. Ceci étant, un lien peut-être fait entre la résurgence d’actes terroristes
et d’attitudes provocantes de la part de la Corée du Nord et la manière dont cette dernière
perçoit l’environnement international en terme de menace. De plus, l’agenda politique interne
de la Corée participe également au développement d’attitudes provocantes, le terrorisme et la
violation du traité d’armistice servant alors ici de moyen à la fois de renforcer la cohérence du
régime ainsi que de solidifier et réaffirmer la position de leader du « chef suprême » à la tête
du pays. Enfin, l’attitude belligérante du régime nord-coréen s’est également exprimée
corrélativement et parallèlement lors de périodes d’instabilité politique en Corée du Sud7.
Une dernière particularité, d'ordre plus idéologique rend également compte de la
militarisation de la politique nord-coréenne, la National Defence Comission étant devenu un
organe primordial de l'autorité politique et de l'administration étatique. Afin de comprendre le
bellicisme ressenti de la politique nord-coréenne, un dernier élément idéologique, ayant pris
une grande importance depuis 1998, se doit d'être mis en lumière. En effet, l'idéologie du
Juche (voir supra) est depuis 1998 assortie d'une doctrine plus pratique dans la gestion des
affaires de l'État. Cette politique est définie par les officiels coréens comme présente depuis le
règne de Kim Il-sung et découlant de l'histoire mythifiée du leader jurant de restaurer le pays
(entendu ici en termes de Corée unifiée) par les armes alors qu'il recevait de son père deux
pistolets en héritage. Pourtant, sa mise en pratique totale ne retentit que lorsque Kim Jong-il
en décida ainsi en 1998, selon les informations récoltées sur la page web officielle du
gouvernement nord-coréen. Plus particulièrement, la politique de Songun, qui se situe dans le
prolongement du Juche, est une doctrine donnant la priorité à l'armée et, de manière plus
globale, au domaine militaire : « Songun politics is rooted in the military-priority ideology
6 YONGHO, Kim, North Korea Foreign Policy. Security Dilemma and Succession, Lanham, Lexington Books, 2011, p.3 7 YONGHO Kim, op.cit., pp.101-‐106
6
that embodies the Juche idea. »8. Il est important d'opérer cette distinction car comme le
soulignait Alexander Vorontsov, même si le service militaire obligatoire est de dix ans, la
plupart des activités menées par le personnel militaire recruté se situe dans un cadre socio-
économique.9 De ce fait, la politique de Songun est en fait plus qu'un projet purement
militaire, car il s'agit, dans l'esprit du régime, de consolider la société civile et de protéger la
révolution, d'un point de vue domestique comme international.10 Le concept de Songun vient
donc donner à l'armée un rôle moteur au sein de la société, à l'instar des plus traditionnels
acteurs de la révolution que sont le parti et le prolétariat. Aussi, cette politique se répercute-t-
elle dans les chiffres, la Corée du Nord étant le pays le plus militarisé au monde
proportionnellement à sa population.
2.2.2. Les relations américano-coréennes
Les relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis n’ont cessé d’évoluer en matière
de perception de la menace ressentie par le régime de Pyongyang à l’égard du deuxième.
Différents éléments, tels que la guerre du Vietnam menée par les Etats Unis ou encore la
coopération sécuritaire conjointe développée par Ronald Reagan au début des années 1980
entre les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon, ont ainsi été marqués par l’amplification de
la perception de menace du régime de Pyongang à l’égard des Etats-Unis, cette évolution
pouvant mener à des actes de terrorisme ou violations du traité d’armistice par Pyongyang. Il
est ainsi intéressant de noter que la fin de la guerre froide et plus particulièrement la victoire
des Etats-Unis sur l’Irak lors de la guerre du Koweït ont marqué un pic dans le sentiment de
menace ressenti par la Corée du Nord, les Etats-Unis s’imposant alors comme l’unique
superpuissance mondiale11. Ceci étant, des relations diplomatiques s’établirent à Pékin dès
1988 entre les USA et la DPRK alors que l’année 1993 marquera l’ouverture de négociations
de haut niveau au travers de la problématique nucléaire12. En effet, la défaite irakienne en
1991 poussa la Corée du Nord à développer son programme d’armes nucléaires face à la
puissance étasunienne et ce en réponse à une situation internationale perçue comme une
8 « Songun politics », in Politics, DPR of Korea, KOREA Official webpage of the DPR of Korea, www.korea-‐dpr.com/songun.html, consulté le 29 avril 2013 9 VORONTSOV Alexander, « North Korea's Military-‐First Policy: A Curse or a Blessing? », in, Brookings Institution, 26 May 2006, http://www.brookings.edu/views/oped/fellows/vorontsov20060526.htm, consulté le 28 avril 2013 10 HABIB Benjamin, « North Korea's nuclear weapons programme and the maintenance of the Songun system », in The Pacific Review, 24: 1, 2011, pp.43-‐64 11 YONGHO Kim, op. cit., pp.104-‐107 12 KOH Byung Chul, op. cit., p.184
7
source de menace à son égard. La volonté de la Corée du Nord s’inscrivait alors dans une
double volonté, à savoir diminuer la menace militaire américaine et améliorer les relations
entre les deux pays. En effet, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce programme nucléaire
permit un réchauffement des relations entre Pyongyang et Washington. Ainsi, alors que sous
Bill Clinton, la ligne de conduite étasunienne à l’égard du programme nucléaire nord-coréen
consistait en la volonté de voir l’arrêt du développement nucléaire par Pyongyang, l’arrivée à
la présidence de Georges W.Bush marqua une rupture dans cette politique pacificatrice et
cette volonté de rapprochement entre les deux pays. En effet, le nouveau président favorisait
quant à lui une ligne de conduite davantage rigide, en réclamant l’abandon total du
programme nucléaire nord-coréen au risque de se retrouver face à un conflit armé. Les
attentats du 11 septembre 2001 menèrent en effet l’administration Bush à durcir la position
américaine face à la Corée du Nord, cette dernière ayant été définie par le président américain
comme un membre à part entière de l’ « Axe du mal » au même titre que l’Irak et l’Iran, alors
qu’en 2003, Georges W. Bush désignait la Corée du Nord comme un régime hors-la-loi13.
Ainsi, le dilemme de sécurité poussa notamment la Corée du Nord à révéler en 2002 son
programme nucléaire clandestin, ceci menant à une deuxième crise nucléaire entre les Etats-
Unis et la Corée du Nord. L’administration Obama s’est quant à elle prononcée dès ses débuts
en faveur d’une politique dite de « patience stratégique ». Cette approche se caractérise ainsi
par une attitude attentiste dans la volonté de voir la Corée du Nord revenir d'elle-même à la
table des négociations, et ce tout en maintenant des pressions à l’égard de Pyongyang. Aussi,
cette politique implique-t-elle la volonté de voir la Corée du Nord faire un pas vers le
démantèlement nucléaire ainsi que de voir cela aboutir à une normalisation de ses relations
avec la Corée du Sud dans le but de réintégrer les « pourparlers à six » réunissant les deux
Corée(s), la Chine, les Etats-Unis, la Russie et le Japon. La Corée du Nord s'était en effet
retirée du traité de non-prolifération nucléaire en 2003. Enfin, cela implique l’application par
les États-Unis de différentes sanctions à l’égard de la Corée du Nord, ainsi que la volonté de
convaincre la Chine de durcir ses positions à l’égard de Pyongyang. Il est à noter que cette
politique est coordonnée avec la Corée du Sud, différents exercices militaires à grande échelle
étant conjointement mis en place par Seoul et Washington. Ceci étant, certaines critiques
mettent en avant le fait que cette politique mise en place par l’administration Obama a permis
13 YONGHO Kim, op. cit., pp.106-‐109
8
à la Corée du Nord de prendre la situation à son compte et de notamment poursuivre le
développement de son programme nucléaire14.
3. Méthode
3.1. Analyse lexicométrique
La méthode analytique que nous emploierons au cours de ce travail est une analyse
statistique automatisée du discours, appelée lexicométrie. Nous utiliserons un outil
informatique logiciel dénommé Lexico, conçu et développé par André Salem et les équipes du
Laboratoire de Saint-Cloud et de l'Université Paris 3. Cette méthode permet d'appréhender des
corpus de grande taille et d'en analyser les récurrences comme les spécificités. De ce
traitement automatisé pourront ressortir les différents emplois de chaque forme graphique et
de leur contexte respectif au sein des discours, afin d'en dégager du sens. Les données
recueillies par ce type de processus qui semble de prime abord axé sur le quantitatif nous
rendront, au contraire, à même de pousser l'analyse qualitative au cœur des enjeux dont il est
question par d'incessantes contextualisations. Différents outils sont mis à disposition du
chercheur : « L’index alphabétique permet de vérifier la saisie du texte, de rapprocher les
utilisations du singulier et du pluriel d’un même substantif, les différentes flexions d’un
verbe, etc. L’index hiérarchique, dans lequel les formes sont classées par fréquence
décroissante, permet d’examiner les formes les plus utilisées. Les concordances permettent,
pour chaque forme, de rassembler l’ensemble des contextes dans lesquels la forme apparaît.
Les inventaires de segments répétés permettent de repérer les séquences de formes qui
apparaissent à plusieurs endroits du texte. Le calcul des spécificités permet de dégager les
formes et les segments qui se trouvent être particulièrement employés (ou, au contraire
particulièrement sous-employés) par chacune des parties du corpus (LAFON, 1984)»15
La lexicométrie est donc, plus qu'une méthode, un outil de sciences sociales
permettant l'analyse qualitative de corpus massifs en redirigeant constamment le chercheur
suivant des schémas lexicaux permettant de déconstruire le discours tout en n'omettant pas de
14 CHANLETT-‐AVERY Emma, E. RINEHART Ian, « North Korea : U.S. Relations, Nuclear Diplomacy and Internal Situation », in Congressional Research Service, 2013, http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41259.pdf, pp.6-‐7 15 LEIMDORFER François, SALEM André, « Usages de la lexicométrie en analyse de discours », in cahier des Sciences humaines 31, 1995, p.131.
9
situer ce dernier parmi d'autres éléments du corpus. On notera qu'une perspective critique
imprégnera ce cadre d'étude au sens ou, comme l'ont explicité de nombreux chercheurs
(principalement en Critical Discourse Analysis), l'analyse du discours part du principe
suivant : « On peut théoriser les textes comme des instanciations du discours, et le discours
lui-même comme une action sociale médiatisée textuellement opérant un travail idéologique
en « représentant et construisant la société ».16 Le discours a donc un effet sur le réel autant
que la réalité conditionne ce même discours, et c'est précisément cela qui rend toute analyse
du discours pertinente dès lors qu'il s'agit d'établir une analyse politique.
3.2. Approches théoriques retenues
En premier lieu, Christian Delporte définit la langue de bois comme « un ensemble de
procédés, qui par les artifices déployés, visent à dissimuler la pensée de celui qui y recourt
pour mieux influencer et contrôler celle des autres ». Ainsi, le discours de la langue de bois se
marque entre autres par l’utilisation et la répétition de mêmes mots et d’énoncés stéréotypés,
des mêmes lieux communs et mêmes termes vagues17. L’auteur distingue deux aspects de la
langue de bois, l’un totalitaire, l’autre démocratique, tous deux ayant comme objectif
principal de cacher la vérité. Dans le premier cas qui nous intéresse ici, eu égard à la nature du
régime nord-coréen, la langue de bois devient un « instrument de contrôle de la pensée et un
levier au service de l’hégémonie du groupe dominant » où « les mots sont là pour cacher les
réalités, conditionner les esprits, interdire toute réflexion autonome, réduire la raison à une
croyance collective préfabriquée » et ce au sein d’un espace où la liberté d’expression est
muselée et où le discours politique se veut absolu18. Dans ce qu’il définit comme la
« sovietlangue », l’auteur met ainsi brièvement en avant la manière dont la langue de bois,
liée au culte de la personnalité, s’est perpétuée depuis la mort de Kim Il-sung et la prise du
pouvoir par son fils Kim Jong-il en 199419.
Dans la même optique, Maurice Tournier développe pour sa part une théorie
statistique de la sloganisation, dans une étude du texte propagandiste, prenant appui sur un
définition de la propagande basée sur l’idée que « Dire, c’est faire faire sans faire réfléchir. ».
16KOLLER Veronika, « Analyser une identité collective en discours : acteurs sociaux et contextes », Semen [En ligne], 27 | 2009, mis en ligne le 10 décembre 2010, consulté le 29 mars 2013 17 DELPORTE, Christan, Une histoire de la langue de bois, Paris, Flammarion, 2011, pp.10 18 Ibid., pp.14-‐15 19 Ibid., pp.93-‐94
10
Il postule au sujet de la mémoire qu’elle est formée par un système de graphes préexistants et
correspondant à des souvenirs sur lesquels se superposent les percepts nouveaux afin de
dégager du sens et d’activer des phénomènes de reconnaissance. Ces graphes communiquant
entre eux et ayant parfois trait à des idées communes participent selon l’auteur de la formation
d’une sorte d’ultrastructure de la mémoire composée d’associations idéelles indirectes. Selon
l’auteur, la structure d’un discours peut s’appréhender similairement via des « interliaisons
connotatives » et phénomènes de téléstéréotypie entre concepts et répertoires lexicaux, formés
par la fréquence de leurs associations. Cette correspondance pourrait dès lors permettre à un
percept nouveau de passer outre l’activité combinatoire volontaire et d’agir en tout premier
lieu sur ces sous-graphes ayant trait à l’archimémoire. Ce phénomène de sloganisation
analyse donc la répétition d’associations de mots en tant qu’elle permet de stimuler chez
l’individu un réflexe mental précédant la réflexion critique. « La fréquence, cette sœur ainée
des sommaires de la mémoire.»20
3.3. Korean Central News Agency
Le corpus analysé pour la réalisation de ce travail est tiré de l'agence de presse nord-
coréenne, Korean Central News Agency (KCNA) fondée le 5 décembre 1946. Elle est un
organe gouvernemental de transmission des informations aux médias nationaux d'une part, et
internationaux de l'autre, par le biais de traductions en anglais, en russe, et en espagnol, ainsi
que par de « friendly and cooperative relations with foreign news agencies »21. Elle se veut,
selon ses propres termes, haut-parleur du Parti du Travail de Corée et du gouvernement de la
République Populaire Démocratique de Corée (DPRK). L'agence KCNA étant la seule active
en Corée du Nord, elle participe d'une diffusion uniforme22 de l'information à tous les
journaux, qu'ils soient radiophoniques, télévisés ou écrits. Au sein d'un régime tel que celui
que le pays connaît, elle est donc un formidable outil de propagande et de consolidation de
l'idéologie Juche. Parmi les thèmes les plus abordés, il n'est donc pas étonnant de constater un
grand nombre d'articles dédiés à la grandeur de Kim Il-sung, le fondateur de la nation nord-
coréenne ainsi que celle des dirigeants lui ayant succédé. Ainsi, Byung-chul Koh démontrait
par une analyse statistique menée lors du mois de juin 1969 que 40% de la surface
rédactionnelle du quotidien Rodong Sinmun - Journal des Travailleurs, organe officiel du Parti
20 TOURNIER, Maurice, « Texte « propagandiste » et cooccurrences. Hypothèses et méthodes pour l’étude de la sloganisation », in, Mots n°11, octobre 1985, p.184 21 Korean Central News Agency, « Introduction to KCNA », kcna.co.jp, consulté le 27 avril 2013 22 Selon les termes de KCNA : « uniform delivery of news »
11
du travail de Corée et quotidien le plus lu du pays - était dédiée à la vénération du « leader
respecté et bien aimé ».23 Au sein d'un système s'apparentant à un culte de la personnalité du
leader (quel qu'il soit), l'agence de presse jouit donc d'une fonction particulière en tant
qu'unique source d'information pour les médias nationaux. En effet, en offrant sur un ton
neutre une somme d'informations dites objectives, et en diffusant largement ces informations
à travers un large réseau de journaux, radios, etc., l'appareil de presse nord-coréen diffère la
censure, en pouvant paradoxalement se targuer d'un large éventail de médias écrits, Alain
Brillouet faisant déjà état pour l'année 1960 de quelques 26 journaux tirés en 252 397 milliers
d'exemplaires24. Cette grande diversité reste cependant factice, le CPJ (Comittee to Protect
Journalists) ayant en 2012 établi une liste sur laquelle figurent les dix pays les plus touchés
par la censure, suivant dix-sept indicateurs, parmi lesquels la Corée du Nord occupe la
deuxième position25.
Nous avons décidé pour la composition de corpus de nous attarder sur un événement
particulier de la politique extrême-orientale asiatique, à savoir le Foal Eagle, série d'exercices
militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis d'Amérique organisé chaque année
depuis 1997. Ces manœuvres militaires communes sont perçues comme un temps fort de la
coopération entre les deux pays, alliés depuis l'embrasement de la guerre de Corée. S'il est
symbole de coopération pour ceux qui la mènent, il est néanmoins perçu de manière bien
différente par le gouvernement de la Corée du Nord, qui y voit là une menace pour sa
sécurité. Cette menace pressentie amène donc généralement, c'est un de nos postulats, les
agences officielles à tenir un discours plus prononcé quant à leurs positions en terme de
politique internationale. On constate une importante dénonciation de ces exercices au regard
du droit international ainsi qu'une constante recherche d'alliés dans cette indignation, dans la
courte période qui précède ainsi que pendant la durée des exercices. Afin de rendre fidèlement
compte de cette fluctuation et d'établir une comparaison qui soit la moins biaisée, le corpus
tiendra compte du mois précédent Foal Eagle, de la durée des exercices, et du mois suivant la
fin de ces derniers. Aussi avons-nous plus précisément sélectionné notre corpus en fonction
des titres et/ou articles évoquant directement les Etats-Unis. Ainsi, alors que le premier Foal
Eagle sous Kim-Jong-il, et historiquement le premier événement de cette série, s’est tenu
23 KOH Byung-‐chul, op. cit., pp. 655-‐674, 24 BRILLOUET Alain, « Quelques données sur les moyens d'information en Corée du Nord » in Revue d’études comparatives Est-‐Ouest, Volume 11, N°1, 1980, pp. 113-‐126, 25CPJ, « 10 Most censored countries », in Special Reports, New York, 2 mai 2012, http://www.cpj.org/reports/2012/05/10-‐most-‐censored-‐countries.php
12
entre le 17 octobre et le 6 novembre 1997, le premier sous le pouvoir de Kim-Jong-un en tant
que Secrétaire général du Parti du travail de Corée et Chef Suprême de la DPRK, s’est quant à
lui tenu entre le 28 février et le 9 mars 2012.
4. Analyse lexicométrique
4.1. Principales caractéristiques lexicométriques par périodes
D’après les éléments repris ci-dessus, nous constatons que la forme « the » est la plus
usitée que ce soit par Kim Jong-il ou Kim Jong-un avec 7663 occurrences sur tout le corpus.
À première vue, l’usage fréquent de cette locution pourrait témoigner d’un certain recul pris
par l’agence de presse. En s’exprimant de la sorte, KCNA expose l’action d’agents,
principalement politiques, en tant que groupes, faisant rarement usage de noms propres. Ainsi,
par exemple, les présidents étasuniens, ne sont jamais évoqués directement, tandis que
l’inventaire distributionnel nous montre un fort usage de termes génériques tels que
« troops », « forces », « military », associés à « unitedstates », comme nous le verrons de
manière plus détaillée infra. Les deuxième et troisième formes, toujours des mots outils, les
plus fréquentes sont respectivement « of » et « and » avec respectivement 3176 et 2484
occurrences. Le premier mot plein que l’on retrouve le plus fréquemment, est sans surprise
« unitedstates » avec 1826 occurrences. La liste des segments répétés nous permet de voir
associé la forme « the » à « unitedstates » à 1280 reprises dans les deux corpus, elle est donc
l’association la plus fréquente, ce qui rend compte d’une mise en avant des Etats-Unis comme
un acteur à part entière, une entité. Egalement la présence du segment répété « in the »,
montre, comme nous le verrons plus en détail ci-après, l’inscription géographique et directe
de la volonté impérialiste des Etats-Unis, au travers des différentes actions qu’elle entreprend.
Ceci étant, les Etats-Unis sont associés 462 fois à la forme « and », ce qui indique qu’ils
interagissent avec d'autres acteurs. Nous verrons plus bas que ces-derniers sont fréquemment
évoqués au travers de leur partenariat avec la Corée du Sud, particulièrement pour la période
13
dirigée par Kim Jong-il, ou au travers de leurs implications internationales, particulièrement
pour la période dirigée par Kim Jong-Un.
Spécificités positives et négatives du « unitedstates », « southkorea », « dprk » et « northkorea »
« On appelle spécificités positives les effectifs qui dépassent largement ce que le
modèle laissait prévoir et spécificités négatives les effectifs qui se révèlent nettement
inférieurs à ce que ce même modèle permettait d’espérer »26. Ainsi, comme nous le montre
très clairement ce graphique de ventilation par personnalité exprimé ici en valeurs relatives, la
nomination des Etats-Unis (pour ce schéma, les termes unitedstates et american ont été
groupés), est très positivement spécifique à Kim Jong-Un totalisant 1269 occurrences contre
557 pour Kim Jong-il en valeurs absolues. En dépit de cette sous-utilisation relative de la
forme « unitedstates » (au sein de laquelle nous avons associé « United-States » aux autres
dénominations officielles telles « U.S » et « USA ») par rapport à son successeur, il demeure
intéressant de relever sa fréquente association avec la Corée du Sud qui elle, est
spécifiquement liée à cette période du corpus. Cette apparente sous-utilisation pourrait
également nous ramener ainsi aux éléments vus supra quant aux relations bilatérales
respectives entre Etats-Unis et Corée du Nord, les relations entre Kim-Jong-il et Bill Clinton 26 SALEM André, Tutoriels pour l’analyse textométrique, p.20, http://lexicometrica.univ-‐
paris3.fr/numspeciaux/special8/tutoriel1.pdf
14
étant alors considérées comme un moment de détente relative entre les deux nations, tandis
que les relations entre Barack Obama et Kim-Jong-Un marquent une certaine rupture dans les
relations entre les deux pays. Il n’apparaît dès lors pas illogique que l’agence de presse
KCNA se réfère moins aux Etats-Unis en 1997 qu’en 2012.
En revanche, les lemmes Southkorea et Northkorea apparaissent spécifiques aux
discours de Kim Jong-il. La forme DPRK quant à elle connaît la même proportion d’usages
chez les deux leaders. Cette forme de désignation du pays par le régime qui y règle la vie en
société est caractéristique des États non-démocratiques en quête de légitimité. Ainsi,
l'appellation Democratic People's Republic of Korea marque-t-elle en premier lieu le lien
d'affiliation entre la nation, la République, le système, et les populations y résidant. Ces
derniers ne sont dès lors plus de simples habitants d'un pays, ils sont rhétoriquement insérés
dans le processus de définition de l'État. Par la répétition de cette forme d'appellation de la
Corée du Nord, le gouvernement s'assure donc une assise populaire, qu'il institutionnalise par
là-même. Aussi, aucune précision n'étant établie quant à la situation septentrionale de la
Corée dont il est question, il est souligné que la Corée du Nord soit la seule à être une
République populaire démocratique. A fortiori, le gouvernement nord-coréen entend par là
affirmer sa seule légitimité sur tout le territoire de la Corée, incluant la partie au sud du 38ème
parallèle, tout en affirmant le caractère usurpateur des dirigeants Sud-coréens, à qui la
légitimité est refusée, sur ce territoire.
4.2. Analyse factorielle des correspondances
4.2.1. Kim Jong-‐il et Kim Jong-‐un
15
L’analyse factorielle des correspondances représentée par le graphique ci-joint nous
montre une segmentation entre les deux leaders, la plupart des dépêches sous l’autorité de
Kim Jong-il se retrouvant du côté gauche du graphique, tandis que celles prononcées en 2012
sous Kim Jong-un se situent du côté droit. Ceci indique une différence globale entre les deux
corpus, qui nous tenterons d’analyser plus tard. Aussi, au travers de ce graphique, peu de
textes semblent se démarquer, à l’exception de ceux du 22 septembre, des 10 – 11 – 13 - 24
octobre, et des 13 et 20 novembre 1997, ainsi que ceux du 17 février, des 5, 13, 15 et 22 mars,
et des 2 et 4 avril 2012. Dans le but d'identifier une première polarisation, nous avons
recherché les spécificités relatives aux deux groupes textuels émanant des dates reprises ci-
dessus par rapport au corpus pris dans son entièreté. Concernant les discours particuliers
situés sur la gauche, formulés sous la gouvernance de Kim Jong-Il, de très fortes spécificités
se sont affirmées : 30 pour « il » assortis de 21 pour « kim » et 20 pour « jong » (la différence
entre les trois formes est due au fait que les mots Kim et Jong peuvent également être utilisés
pour désigner son successeur, ce qui les rend moins spécifiques) affichent un très présent
phénomène d'autodésignation que nous développerons davantage ci-après. Nous constatons
également un indice 18 pour la forme « leader » qui participe du même phénomène et
contribue à la personnification du régime politique. Suivent ensuite avec un indice de
spécificité supérieur à 5 une multitude de formes faisant partie du champ interne (« army »,
« nation », « socialist », « party », « secretary », « general », « comrade », etc.) qui
démontrent que cette section semble relater principalement des éléments de politique
intérieure. Nous constatons donc une série de formes lexicales relevant du système et de la
propagande nord-coréenne, avec la présence conjointe des parties formant son tout : l'armée,
le parti, le peuple, ses leaders. Quant au groupe de textes se rapportant à la période dirigée par
Kim Jong-un, de moins intenses spécificités ont été relevées. Les formes se démarquant le
plus, avec un indice supérieur à 10, sont « soldier » avec 17, le premier, « killing » qui a un
indice de 14, « exhibition » et « civilians » qui correspondent tout deux à un indice de
spécificité de 11. La présence de termes se raccordant à des pays tiers est également à
souligner, avec les formes désignant l'Afghanistan et le Sri Lanka comportant chacun un
indice supérieur à 5.
Pour aller plus loin, nous avons ensuite procédé à l'identification de parties semblant
représenter les plus fortes polarisations suggérées par le graphique produit par l'AFC, et
celles-ci coïncident avec la division globale entre les deux leaders. La différence lexicale étant
16
établie suivant cette sélection, nous avons poursuivi la démarche en recherchant les
spécificités de ces parties du corpus. Celles-ci se sont avérées correspondre globalement à
celles que nous venions d'observer quant aux textes les plus éloignés du centre du graphique
dessiné par l'analyse factorielle des correspondances. La pertinence de cette sélection ne s'en
trouvant que confirmée, nous commencerons donc par analyser ces spécificités séparément,
afin de dégager le sens global véhiculé par chacun des leaders, pour pouvoir ensuite les
comparer efficacement. Nous avons décidé de relever celles qui correspondraient à un indice
de spécificité supérieur ou égal à 3.
4.2.2. Spécificités par parties Kim Jong-‐il
Ces tableaux nous montrent les spécificités des textes les plus représentatifs de la
polarisation à gauche sur l'axe 1 révélée par l'analyse factorielle des correspondances, à savoir
ceux qui furent écrits par l'agence KCNA aux 24 et 27 septembre, 27 et 28 du mois d'octobre,
et aux 4 et 6 novembre de l'année 1997.
Dans ce cas-ci, la forme « must », qui détient la plus grande spécificité, indique une
injonction émanant de la part du régime nord-coréen principalement à l’égard des Etats-Unis
et de ses alliés : « (..)unitedstates and japan must stop adventurous military game ». Ces injonctions passent ainsi
par la volonté de voir les Etats-Unis, le Japon et la Corée du Sud cesser leurs opérations
militaires et plus particulièrement que Washington cesse d’adopter une attitude belligérante à
17
l’égard de la Corée du Nord, l’objectif étant pour cette dernière de parvenir notamment à la
réunification des deux Corées. En effet, isolée totalement sur la scène internationale à la suite
de la chute de l’URSS, l’appel à la réunification de la Corée devint un élément récurent de la
politique extérieure de la Corée du Nord, en mal d’alliés. Plusieurs éléments méritent d’être
soulignés ici. Dans un premier temps, il est intéressant de noter la dichotomie existant d’une
part entre l’attitude décrite comme belligérante des Etats-Unis et celle de la DPRK, juste, en
elle-même, l’attitude de cette dernière dépendant essentiellement de celle des Etats-Unis. Un
changement de la politique et de l’attitude étasunienne, mènerait ainsi à un apaisement de la
situation, dans une relation où s’oppose un « arbitraire » américain face à un « bon-vouloir »
(will) nord-coréen quant à la volonté de voir les relations entre les pays s’améliorer : « (…)the dprk is ready to put an end to the hostile relations and improve its ties with the unitedstates with leniency and good will. if the dprk-‐
unitedstates ties are to be improved, the unitedstates must dispel the outdated conception of the cold war era and refrain from
approaching the korean issue from the position of strength. ». Ceci indique notamment que la position et la
politique nord-coréenne, ferme, est légitime et ne doit finalement pas être modifiée voire
même remise en question, cette dernière étant avant tout victime d’une situation arbitraire
créée par ses agresseurs. Dans un second-temps, il est intéressant de noter le fait qu’alors que
les Etats-Unis semblent former un bloc monolithique, le nom du président Bill Clinton n’étant
jamais évoqué, a contrario, le nom du président sud-coréen de l’époque, Kim Young Sam, est
nommé à plusieurs reprises et associé directement au régime coréen (Kim Young Sam
regime , group); les formes « young » et « sam » détenant par ailleurs toutes deux une
spécificité de 5 : « the kim young sam group must renounce the wild ambition to extricate themselves from the crisis by igniting a
new war and must give up the war maneuvers against the north at once. »
Comme déjà vu supra, l’idée de réunification des deux Corées, séparées depuis 1948,
et qui se sont engagées dans la guerre fratricide de Corée de 1950 à 1953 constituait après la
guerre froide un élément important de politique étrangère d’une Corée du Nord isolée sur le
plan international et dont la perception de la menace était alors élevée. Il est ainsi intéressant
de noter que c’est sous Kim-Jong-il, que fut signée la Déclaration conjointe Nord-Sud du 15
juin 2000 avec le président sud-coréen Kim-Dae Jung, les deux dirigeants s’engageant alors à
œuvrer pour la réunification de la péninsule coréenne, alors que le 13 décembre 1991 fut
signé un accord de réconciliation, de non-agression d’échanges et de coopération entre les
deux pays27. A certains moments, l’agence de presse se réfère ainsi à des acteurs extérieurs
soutenant présupposément la réunification des deux Corées, ceci venant renforcer la position 27 Site web du monde diplomatique, dossier Corée, http://www.monde-‐diplomatique.fr/dossiers/coree/A/coree91.html
18
de la Corée du Nord, qui ne se retrouve alors pas esseulée dans sa volonté de voir aboutir ce
projet de réunification nationale : « (…)we fully support the korean people's just struggle for independent and peaceful
reunification of the country. ». D’une manière globale, l’idée de la réunification des deux Corées
renvoie à une image positive, à une cause nationale que se doit d’être menée à bien et de
manière pacifique : « (…)glory and blessings to the hopeful kim jong il era which will bring about the reunification and prosperity
of the nation and adorn the 21st century! ». Aussi, bien souvent, des pays comme les Etats-Unis ou encore
le Japon, sont accusés d’entraver les efforts de réconciliation entre la Corée du Nord et la
Corée du Sud : « (…)if the bellicose elements within and without ignite an adventurous war, in spite of the unanimous denunciation
and rejection by the korean nation and the world peace-‐loving people, the korean workers and entire people will annihilate all of the
aggressors, provokers and achieve the cause of national reunification(…) »
La spécificité « great », se réfère presque exclusivement à la personne de Kim-Il-sung
et plus particulièrement à Kim Jong-il, ceci nous renvoyant à l’idéologie du Juche et au culte
de la personnalité, constituant l’une des bases de légitimation du régime auprès des masses
populaires : « (…)kuwol and looking round woljong temple and the three ponds. under the banner titles "to defend great comrade
kim jong il is firm faith of revolutionary armed forces" and "absolute trust in and worship for great general kim jong il"(…) »
Cet adjectif est également généralement joint au mot camarade (comrade), ceci ramenant à la
nature communiste du régime. Aussi, cette forme fait-elle également référence à la nature du
peuple coréen, du parti unique ou du projet de réunification nationale : « (…)the korean people are a great heroic people who defeated the unitedstates which boasted of being the "strongest" in the world ; (…)this is the unshakable faith and
will of our army and people led by the great party. » « great » est ainsi à prendre dans le sens de la grandeur et
de la magnificence, il en appelle ainsi aux sentiments et au nationalisme coréen au travers du
mythe de Kim Jong-il qui serait, selon l’historiographie nationale, né au Mont Paektu, point
culminant de la Corée du Nord.
La forme « war » obtient la quatrième plus grande spécificité. Ainsi, cette forme ne
décrit-il pas une situation de guerre de fait, mais davantage une situation ressentie comme
telle par la Corée. En effet, « war » est toujours associée et suivie par des formes telles que
« manœuvres », « game », « scenario », « provocation » « racket » ou encore « exercises »
L’association « war exercises » ou « war manoeuvers » faisant généralement directement
référence aux opérations du Foal Eagle : « (…)the 36th foal eagle war game, involving the unprecedented-‐in-‐scale
armed forces and military hardware enough to wage a war, is an out-‐and-‐out war drill intended to make a preemptive attack on the
northern half, and it is driving the inter-‐korean confrontation to the brink of war »
Ceci nous indique bien que l’on se retrouve davantage dans une dialectique de guerre froide
que de guerre réelle prenant directement place sur le territoire nord-coréen. Souvent, ce mot
19
est également associé aux formes« maniacs » ou « mongers », lorsque celui-ci n’est pas
directement attaché à ces dernières « warmongers », « warmaniacs ». Ils se réfèrent aussi
toujours à l’entité des Etats-Unis, et marque un espèce de penchant naturel pour ces derniers à
faire la guerre. « (…)if the unitedstates war maniacs finally unleash war in defiance of our good faith and tolerance, the korean
people and people's army will mercilessly annihilate the enemy and accomplish the historic cause of national reunification »
De même « puppets » se réfère exclusivement à la Corée du Sud, ce qui définit une situation
de sujétion à l’égard des Etats-Unis : « (…)the unitedstates war maniacs must not only talk about "peace" and "detente"
but also abandon the anachronistic "policy of strength" against the dprk and stop goading the southkorean puppets on to war
provocation » Aussi, est-il souvent précédé par « unleash », « fratricidal » ou « new ». Le
« unleash » décrit généralement l’action des Etats-Unis, tandis que le « fratricidal » fait
référence à la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Par rapport au Foal Eagle
est-il intéressant de souligner que cette opération est davantage évoquée par Kim Jong-il que
Kim Jong-un, ceci pouvant s’interpréter par le fait qu’en 1997, cette opération était organisée
pour la première fois. Les années passant, on pourrait s’imaginer que le régime a ainsi
considéré cette opération militaire comme un rituel ne méritant même plus d’être appréhendé
et ne constituant plus une menace en soi.
« Our » obtient une spécificité de 7, ce qui est relativement conséquent. Ceci est très
intéressant en ce sens où cela marque un lien important entre l’organe officiel du parti et la
population nord-coréenne. Ce mot lien permet ainsi entre autres de créer à côté d’une
communauté de valeurs, une véritable cohésion nationale dans la lutte contre les Etats
belligérants, ou encore dans la lutte pour la réunification. La presse, le parti, le gouvernement,
le peuple, l’armée et le leader suprême ne font ainsi plus qu’un, ne formant plus qu’un corps
uni dans un même dessein : « (…) we will strengthen our armed forces in every way so that we can smash any provocation of
the enemy at one stroke at any time and in any place. we never beg provokers for peace. in order to defend the security of the country and
the people, we will not rule out sacred war against the aggressors. this is the unshakable faith and will of our army and people led by the
great party. »Ceci confirme d’une certaine manière le caractère totalisant et englobant du régime.
On se retrouve ainsi une fois de plus face à un manichéisme, d’autant lorsqu’on retrouve
« our » associé à « force », « tolerance » ou encore « will », ce qui souligne la puissance et la
bonté du peuple nord-coréen : (…)if the unitedstates war maniacs finally unleash war in defiance of our good faith and
tolerance(…) . Ceci peut ainsi nous faire penser à l’une des fonctions du fait-divers dans bons
nombres de journaux d’informations occidentaux, et à son rôle d’agrégation tribale, où un
« nous » s’oppose à un « vous ». Dans ce cas-ci, cette fonction se veut cachée et indirecte.
Dans le cas d’un régime totalitaire, cette fonction est limpide, le destin du régime étant
directement mis en liaison à celui du peuple face à d’autres grands ensembles directement
20
désignés. Ainsi, dans le même ordre d’idée retrouvons-nous à de nombreuses reprises la
forme « we » associée à « will », ce qui indique une action dirigée dans le futur et ceci
renforçant l’idée d’un projet commun liant la société nord-coréenne dans son ensemble, cette
dernière étant décrite à la fois comme prête à répondre aux attaques et insoumise face à ses
adversaires : (…)we will answer the reckless war provocation moves of the unitedstates and japan with corresponding self-‐defensive
measures ». Aussi, même si cette dernière souhaite la paix, elle n’est néanmoins pas prête à se
soumettre pour l’obtenir « we love peace but never beg for it. »
4.2.3. Spécificités par parties Kim Jong-‐un
Les tableaux repris ci-dessous, issus du logiciel Lexico3, montrent l'emploi du
vocabulaire spécifique aux dépêches de la Korean Central News Agency lors des journées du
12 février et des 13 et 14 mars de l'an 2012, ces dates ayant été considérées via l'analyse des
facteurs comme fortement représentatives de la polarisation à droite sur le graphique fourni
par l'AFC. C'est en outre sur cette partie droite que se situent une écrasante majorité des
discours tenus par l'agence de presse lors du règne de Kim Jong-un.
Il est très intéressant de noter que les formes semblant les plus spécifiques à ces
parties du corpus, relevant de la polarisation marquée entre les deux leaders par l'AFC, sont
celles qui désignent des régions, des pays étrangers. Plus encore, ces pays étrangers ne sont ni
la Corée du Sud, qui se trouve sous-représentée dans cette section, ni les États-Unis, qui avec
un indice de spécificité de 3 ne se dénote pas considérablement, compte tenu des modalités de
sélection du corpus explicitées précédemment. « lanka » arrive en première position, suivie de
21
peu par la forme « sri », qui, ayant la même fréquence d'utilisation, confirme bien qu'il s'agit
d'une utilisation conjointe se référant au pays qu'est le Sri Lanka. Aussi la forme « asia »
semble-t-elle très prégnante. On notera également l'usage fréquent des termes « afghan » et
« afghanistan » ainsi que celui de « pacific ». Relativement rare dans le reste du corpus,
l'utilisation de ces termes marquent l'inscription de perspectives plus mondiales dans les
discours officiels nord-coréens. En effet, ici, l'intuition du chercheur à la vue des mots pleins,
spécifiques à ces parties, irait rapidement dans le sens d'une parenté avec les spécificités du
champ lexical martial – lui aussi très présent –, telle « soldier » ou « drone » « killing »
« civilians » « in » « asia ». Il est cependant important dans le cadre d'une étude
lexicométrique de passer outre les raccourcis intuitifs ; vérifions donc les contextes, ainsi que
le sens donné à chacune de ces formes lexicales au sein des articles. Aussi est-il surprenant de
trouver un mot comme « development » parmi la concentration de vocabulaire martial, nous
nous attacherons donc également à en dégager le sens. Le seul mot-outil qu'il convient de
souligner parmi ces spécificités est l'adverbe « in » qui avec un indice de 6 est très important à
cerner. Il s'insère au premier regard dans le schéma dénonçant l'implication des USA au sein
de diverses parties du monde et marque par son contexte les opérations militaires américaines.
Les verbes les plus présents de cette section sont « killing » et « killed » ayant
respectivement des indices de spécificité de 9 et 4, suivis par « condemns » et « condemned ».
Sujets du premier, objets du second, les États-Unis sont intrinsèquement liés à ces deux
verbes. Utilisé à quinze reprises, le verbe « to kill », l'action de tuer est une entreprise
exclusivement réservée aux États-Unis. De plus, utilisé huit fois avec pour objet « civilians »,
c'est le caractère immoral de l'action militaire américaine qui est ici décriée, étant bien
entendu qu'il est mal de tuer des civils : “at least 16 civilians, including women and children, were reportedly killed by
the unitedstates soldier”, “the killing of afghan civilians by a unitedstates soldier”, “at least 12 people were killed and three others injured
in a unitedstates drone strike launched friday in pakistan's northwest tribal area”. C’est en outre dan ce schéma de la
dénonciation que se retrouvent imbriquées les multiples formes du verbe « condemn »,
condamner, qui pour sa part est uniquement le fait de nations tiers.
C'est donc dans ce contexte que nous retrouvons les acteurs internationaux identifiés
plus haut, qui semblaient spécifiques de cette partie du corpus : “russia on monday condemned the recent killing of afghan civilians”,“expressed the stand of his country rejecting the unitedstates and
west's sanctions against iran.”,“india will not join the unitedstates and west in applying the sanctions against iran, he
stressed.”,“afghanistan condemns killing of 16 civilians by unitedstates soldier”, “pakistan condemns unitedstates house bill on
balochistan ». Ils sont, comme nous le suggèrent les extraits cités, mentionnés selon deux options :
22
ils sont soit les victimes des forces armées américaines (s'agissant principalement de
l'Afghanistan), soit ils condamnent les États-Unis pour leur politique internationale ou leur
implication dans la mort d'innocents de par le monde. On assiste donc à une dichotomie
internationale sur base du champ lexical guerrier. L'opposition à caractère manichéen est
marquée entre d'une part les États-Unis qui veulent imposer leur ordre par la force à la région
Asie-Pacifique (et leur implantation en Corée du Sud comme à Okinawa, préfecture japonaise
qui n'est mentionnée qu'au travers des troupes américaines y stationnant), et d'autre part la
Corée du Nord ainsi que les autres pays condamnant l'action des premiers. « top commercial banks in
sri lanka have joined protests against a unitedstates » , « president of bolivia evo morales on friday slashed the unitedstates interfering
policy », « unitedstates stretches out its tentacles into asia-‐pacific region. the unitedstates is stretching out tentacles of domination into
the asia-‐pacific region to realize its wild ambition for world domination. », ”the unitedstates has invented various absurd pretexts for
years to justify its military presence in southkorea and military domination over northeast asia ». C'est d'ailleurs également
dans cette optique d'internationalisation que nous retrouvons l'utilisation, qui nous avait parue
étonnante, du mot “development”. Si celui-ci se réfère une fois au programme de recherche
nucléaire nord-coréen, c'est surtout dans son sens premier qu'il est utilisé, se liant par trois fois
au développement du Sri Lanka, qui est empêché par les USA, et deux fois à la Bolivie pour
dénoncer l'espionnage camouflé par l'agence américaine de développement USAid : “bolivian president evo morales on thursday accused the united states of spying on his and other latin american countries. the bolivian president said
the spying is done under the cover of the unitedstates agency for international development.”, ”speech presented to the congress described the dprk as "forces of threat". he claimed the dprk's development of nuclear weapons and ballistic missiles makes it more urgent
for the unitedstates to establish a ballistic missile defence system and that the dprk is threatening”
La Corée du Sud, dans cet équilibre, endosse un rôle ambivalent, à la fois complice et
victime. Si elle peut apparaître comme hôte privilégiée pour les soldats américains, de par leur
alliance militaire, c'est toujours dans une relation inégale de quasi-subordination. En effet, la
Corée du Sud n'est que passive : elle accueille la coopération militaire sans que sa population
ne la cautionne à coup sûr. Mention est d'ailleurs faite d'un mécontentement interne qui,
véridique ou non, témoigne d'une perception par les leaders nord-coréens, de la position
équivoque du peuple et de l'éventualité d'une discordance entre la politique menée par le
gouvernement (considéré d'ailleurs illégitime, comme nous l'avons souligné à de multiples
reprises) et le peuple sud-coréen. “its military presence in southkorea and military
domination over northeast asia”. Il est clair que les États-Unis sont mentionnés en terme de
menace perçue. Le champ lexical qui s'y rapporte dans cette section du corpus est
essentiellement stratégique/martial. La Corée du Nord annonce par le biais de ses organes de
presse que ces derniers visent la domination de tout le continent : “it is the strategic goal of the unitedstates to put the whole of the korean peninsula under its control with southkorea as its base and, furthermore, establish its military domination
23
over northeast asia and the rest of the asia-‐pacific region.” Ce faisant, le gouvernement nord-coréen se place en
pacifiste, ou en résistant. Il est en tout cas le légitime défenseur de la péninsule coréenne
contre l'invasion américaine, il maintient le dernier bastion d'anti-impérialisme ; et c'est ce
rôle qui confère sa légitimité au régime ainsi que la nécessité de sa militarisation au travers
notamment de la politique du Songun qui justifie les recherches en armement.
Nous retrouvons donc au travers de cette analyse des spécificités les objectifs
manifestes comme latents, identifiés dans la première partie de ce travail. L'indépendance,
l'amitié, et la paix sont prônés autour du rejet de l'impérialisme américain dans le monde
émergent (Asie, Pacifique, Amérique Latine sont mentionnées) tandis que la légitimité, la
sécurité et le développement découlent de manière moins affichée de la position du
gouvernement nord-coréen sur cet échiquier mondialisé. La légitimité est acquise au
détriment de la Corée du Sud, et au travers de l'opposition ferme des leaders nord-coréens.
Quant aux États-Unis, le besoin de sécurité est affirmé par la perception de la menace
extérieure, et le développement s'opère, conformément aux principes du Juche et de Songun,
par le biais de l'armée, dont l'importance est à nouveau légitimée en regard aux menaces
externes.
4.3. Comparaison
De la comparaison émerge un certain nombre d'oppositions comme un certain nombre
de similarités. La première observation qu'il est intéressant de noter est la plus grande
concentration du vocabulaire de Kim Jong-il au sein duquel on retrouve l'usage de mots qui,
tels « must » ou « puppets », ne reviennent pour ainsi dire jamais dans les discours de Kim
Jong-un. De plus grands indices de spécificités caractérisent les discours du premier, tandis
que le second semble avoir un vocabulaire plus élargi, varié. Aussi avons-nous mis en lumière
le fait que les discours médiatiques sous Kim Jong-il sont très ancrés dans la région
géographique coréenne, avec l'implication des États-Unis fortement corrélée à celle de la
Corée du Sud lorsque celle-ci n'est pas mentionnée dans une optique de réunification. Les
informations y sont relativement autocentrées, avec un fort usage des prépositions identifiant
le « Nous ». À l'inverse, ceux de la période de gouvernance de Kim Jong-un sont empreints
d'une internationalisation des enjeux, mettant en scène le monde dans la confrontation. Le
vocabulaire se rapportant à la géographie internationale – les références asia, pacific, region,
afghanistan, iran et cetera – est à envisager sur deux plans : les acteurs internationaux sont
24
mentionnés soit en opposition aux États-Unis (dans une logique passive ou dans une logique
active, selon qu'ils sont victimes de la guerre ou qu'ils manifestent leur mécontentement) soit,
dans une moindre mesure, en lien positif avec la Corée du Nord (au travers de coopération, de
diplomatie ou d'affinités dues à l'ennemi commun). Le « nous » constitué au sein des discours
de 2012 est donc un « nous » plural, auquel s'attache une communauté de nations qui se
définit essentiellement par opposition à l'impérialisme. Dans une démarche différente, les
discours de 1997, formulés sous le gouvernement de Kim Jong-il, s'attachent à la définition
d'un « nous » nord-coréen, auquel se rapportent les valeurs idéologiques et les agents du
régime : le parti, l'armée, le peuple, que l'on affuble de qualités. L'ennemi ultime, en revanche,
est relativement concordant : il s'agit inexorablement des États-Unis. Concernant ces derniers,
comme nous avons pu nous en rendre compte supra, ils sont, lors de la période de Kim Jong-
il, généralement associés directement aux formes « warmaniacs » (25 occurrences),
« warmongers » (14 occurrences) ou encore « imperialists », ce qui va sans dire, rend compte
d’une vision belliciste des Etats-Unis émanant de l’agence de presse nord-coréenne à cette
époque. A contrario, lors de la période Kim Jong-un, les Etats-Unis sont essentiellement
associés à des formes telles que « forces » (64 occurrences), ce qui indique le fait que les
Etats-Unis agissent uniquement au travers de leur armée. Dans le même ordre d’idée, la forme
« United-States » est jointe aux formes « marines », « army », « military », « troops » et dans
une moindre mesure « imperialists ». Ceci indique dès lors que l’action des Etats-Unis sur la
scène internationale est uniquement militarisée, ces derniers, n’étant pas à l’instar de la
période sous Kim Jong-il, décrits au travers d’adjectifs. En effet, c’est par l’action et non par
le caractère, présupposé intrinsèque à l’entité américaine, qu’est mis en avant l’impérialisme
belliciste dont font preuve ces derniers. Concernant l’appel à la réunification des deux Corées,
ce qui constitue comme nous l’avons vu l’un des objectifs manifestes de la politique étrangère
nord-coréenne, nous avons vu que si chez Kim Jong-il, on retrouvait une occurrence élevée de
la forme « réunification » (58 occurrences), lors de la période de Kim Jong-un, l’idée de
réunification, bien qu’évoquée, était alors moins spécifique. Ainsi, il apparaît que sous Kim
Jong-il, la volonté de réunification de la part des sud-coréens ne soit que peu questionnée, et il
s’agit dès lors pour lui d’établir les conditions de cette réunification pacifique, à savoir
principalement la rupture du lien qu’ils entretiennent avec les Etats-Unis (établie par la forte
cooccurrence des formes « southkorean » et « puppets »). Généralement, sous Kim Jong-un,
la réunification devient un prétexte à la polarisation. En effet, sous le gouvernement de Kim
Jong-un, cette volonté est interrogée, et n’est toujours que partielle, si bien que l’incertitude
25
de cet engagement, permet de discréditer le gouvernement sud-coréen et de poser ainsi les
leaders nords-coréens en tant que légitimes représentants de la Corée réunifiée.
Les spécificités de la période Foal Eagle au sein du corpus séparé Kim Jong-il
Les spécificités de la période Foal Eagle au sein du corpus séparé Kim Jong-un
Notre hypothèse concernant le durcissement de la rhétorique militaire lors des
événements du Foal Eagle ne s'avère que partiellement correcte. En effet, la prégnance du
mot « war », qui obtient une fréquence de 183 sur la période s'étalant du 17 octobre au 6
novembre 1997 – parmi les 303 utilisations comptabilisées sur une période totale étudiée,
allant du 17 septembre au 6 décembre – confirme une nouvelle fois que la menace d'une
guerre semble peser sur la Corée du Nord, du moins selon son interprétation des exercices
conjoints. Le vocabulaire militaire en est renforcé, et les exercices du Foal Eagle sont
mentionnés un bon nombre de fois, suffisamment pour être considérés spécifiquement liés à
cette section du corpus. En revanche, la sur-utilisation du mot « drills », qui dénote
directement par sa traduction du caractère d'entraînement inhérent au Foal Eagle, semble être
un terme moins fort, moins guerrier. La menace est donc peut-être, comme nous l'avions
présupposé plus haut, plus légèrement perçue, en tant qu'il s'agit déjà de la quinzième
manœuvre de ce type. Par contre, ce qui est bel et bien tangible pour Kim Jong-un, c'est
l'impérialisme qui est exacerbé dans cet exercice militaire. Le Foal Eagle est donc davantage
perçu comme une démonstration de puissance impérialiste que comme une menace réelle.
26
5. Conclusion Notre objectif initial visait à interroger l’éventualité d’une différence de rhétorique
émanant de la part de l’agence de presse KCNA entre le règne de Kim Jong-il et celui de Kim
Jong-un par rapport aux Etats-Unis. Afin de répondre à notre interrogation, nous avons décidé
de nous intéresser aux premières années où les deux leaders dirigeaient officiellement le pays
à la fois en tant que Chef suprême de la DPRK et Secrétaire du Parti du travail de Corée. Plus
spécifiquement, nous nous sommes intéressé à l’événement du Foal Eagle, et ce afin
notamment de délimiter notre corpus. Notre première hypothèse était qu’il existe une
divergence de rhétorique entre Kim Jong-il et Kim Jong-un eu égard à la personnalité ddeux
leaders, alors que notre deuxième hypothèse postulait un durcissement discursif lors des
opérations militaires conjointes menées lors des événements du Foal Eagle entre les Etats-
Unis et la Corée du Sud.
Ainsi, d’un point de vue global, nous estimons pouvoir ici confirmer notre première
hypothèse, et ce, bien sûr, dans les limites relatives au choix de notre corpus. En effet, il nous
est apparu au travers cette analyse comparative qu’il existe une différence de rhétorique entre
Kim Jong-il et Kim Jong-un, et ce malgré une prégnance évidente de la langue de bois entre
les deux périodes. La langue de bois se retrouve notamment par la formulation de segments
répétés dont le plus marquant reste « independant and peaceful reunification » lorsqu’il est
fait mention de la Corée dans son ensemble. Sous Kim Jong-il, ressortait en effet davantage
une vision agressive, monolithique, des Etats-Unis, dont la relation avec la Corée du Sud se
définissait en tant que relation de sujétion des seconds par rapport aux premiers. Aussi, la
relation entre la Corée du Nord et les Etats-Unis semblait se résumer à la formulation
d’injonctions de Pyongyang à l’égard de Washington. Ceci pourrait s’expliquer non-
seulement par l’isolement de la Corée du Nord sur la scène internationale à cette époque, mais
également par la personnalité de Kim Jong-il en elle-même. Ceci nous renvoie également aux
objectifs manifestes et latents de la Corée du Nord (voir supra). Kim Jong-un quant à lui
s’inscrit dans une perspective plus mondialisée et entreprend au travers de la description des
actions militaires américaines (principalement dans la région Asie-Pacifique comme nous
l’avons développé plus haut) d’établir non seulement leur caractère impérialiste, mais encore
d’identifier les victimes de cet impérialisme ainsi que ceux qui s’y opposent. Cette démarche
traduit donc d’une part une volonté de dénonciation plus formelle des méthodes américaines
(notamment l’utilisation de drones ou le caractère civil des victimes de leurs attaques) autant
27
qu’elle démontre la recherche d’alliés partageant les « condamnation » que ces derniers
émettent à leur égard.
Concernant notre deuxième hypothèse, elle est, comme nous l’avons vu, partiellement
correcte, au sens où Kim Jong-un voit dans cette opération une occasion de réaffirmer le
caractère impérialiste des Etats-Unis. Quant à son prédécesseur, cette opération militaire
semble davantage représenter une menace directe pour l’intégrité du pays, eu égard, à la forte
fréquence de la forme graphique, « war », qui associe de fait l’exercice au champ lexical
martial.
Pour conclure, nous avons pu nous rendre compte, malgré certaines différences de
langage, de la persistance de la langue de bois au sein des dépêches KCNA entre la période
Kim Jong-il et Kim Jong-un. Il pourrait aussi être intéressant, en parallèle au travail effectué
ici, d’inverser la comparaison, en tentant de cerner cette fois l’évolution de la rhétorique
américaine à l’égard de Pyongyang. Notre corpus étant ici limité, il serait intéressant de
travailler sur un corpus plus conséquent, afin de confirmer ou infirmer nos hypothèses pour de
bon. L’analyse lexicométrique s’est avérée ici un bon outil permettant de répondre
partiellement à nos hypothèses par l’identification d’une structure inhérente au texte ainsi que
d’associations répétées de formes, qui s’imbriquant, permettent au chercheur de révéler le
sens caché du discours, assimilé au concept d’architexte développé par Maurice Tournier.
Différents phénomènes de téléstéréotypie, peuvent ainsi être décelés. Dès lors, il serait
également intéressant, dans une recherche future, d’interroger la réception de ces
téléstéréotypes par le public.
28
6. Bibliographie
6.1. Ouvrages - CHEONG, Seong Chang, Idéologie et Système en Corée du Nord. De KIM Il-Sông à KIM
Chông-Il, Paris, Editions L’Harmattan, 1997
- DELPORTE, Christan, Une histoire de la langue de bois, Paris, Flammarion, 2011
- PARK, Han S. (ed.), North Korea. Ideology, Politics, Economy, Englewood Cliffs, Prentice
Hall, 1996
- YONGHO, Kim, North Korea Foreign Policy. Security Dilemma and Succession, Lanham,
Lexington Books, 2011
6.2. Articles scientifiques - BRILLOUET Alain, « Quelques données sur les moyens d'information en Corée du Nord »,
in, Revue d’études comparatives Est-Ouest, Volume 11, N°1, 1980
- CHANLETT-AVERY, Emma, E.RINEHART, Ian, « North Korea : U.S. Relations, Nuclear
Diplomacy and Internal Situation », Congressional Research Service, 2013,
http://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R41259.pdf
- CPJ, « 10 Most censored countries », in New York, Special Reports, 2 mai 2012,
http://www.cpj.org/reports/2012/05/10-most-censored-countries.php
- HABIB Benjamin, « North Korea's nuclear weapons programme and the maintenance of the
Songun system », The Pacific Review, 24: 1, 2011, pp.43-64
- KOH Byung-chul, « Ideology and political control in North Korea » , in, Cambridge
University Press , The Journal of Politics Vol. 32, No. 3, 1970
- KOLLER Veronika, « Analyser une identité collective en discours : acteurs sociaux et
contextes », Semen [En ligne], 27 | 2009
- LEIMDORFER François, SALEM André, « Usages de la lexicométrie en analyse de
discours », in cahier des Sciences humaines 31, 1995
-‐ SALEM, André, « Tutoriels pour l’analyse textométrique », http://lexicometrica.univ-‐
paris3.fr/numspeciaux/special8/tutoriel1.pdf
- TOURNIER, Maurice, « Texte « propagandiste » et cooccurrences. Hypothèses et méthodes
pour l’étude de la sloganisation », in, Mots n°11, octobre 1985
29
- VORONTSOV Alexander, « North Korea's Military-First Policy: A Curse or a Blessing?,
Brookings Institution », 26 May 2006,
http://www.brookings.edu/views/oped/fellows/vorontsov20060526.htm
6.3. Sites Internet - North Korea Leadership Watch, http://nkleadershipwatch.wordpress.com/kim-jong-un/
- Site officiel de la République populaire démocratique de Corée, www.korea-dpr.com/
- Korean Central News Agency, kcna.co.jp
- Le Monde Diplomatique, http://www.monde-diplomatique.fr
7. Annexes
Related Documents