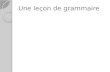1 UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 La grammaire et le microprocesseur Une étude de la poétique de Dantec in La Sirène rouge, Les Racines du mal et Babylon Babies Elie MAUCOURANT Dossier de Master dirigé par Yannick CHEVALIER Maître de conférence à l’université Lyon 2 Mai 2012

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
La grammaire et le
microprocesseur
Une étude de la poétique de Dantec
in
La Sirène rouge, Les Racines du mal et Babylon
Babies
Elie MAUCOURANT Dossier de Master dirigé par
Yannick CHEVALIER
Maître de conférence à l’université Lyon 2
Mai 2012
2
Sommaire
INTRODUCTION 4
I) Une approche morphologique de la poétique de Dantec 6
1) Des compositions 7
A) Des mots composés avec un espace 8
1- Une composition formée à partir deux mots 8
2 - Une composition formée avec adjonction de deux majuscules 8
B) Des mots séparés par un trait d’union 10
1- Une composition formée à partir de mots entiers 10
2- Une composition formée avec adjonction d’une majuscule 12
3- Une composition formée avec adjonction de deux majuscules 12
4- Une composition formée avec un morphème préfixal 13
5- Une composition formée avec un morphème préfixal et adjonction de deux majuscules 13
C) Un cas unique : une composition séparée par une barre. 14
2) La dérivation par le préfixe. 15
A) Une dérivation par le préfixe standard 16
B) Une dérivation par le préfixe avec adjonction d’une majuscule 17
C) Une dérivation par le préfixe avec adjonction de deux majuscules 18
3) Des cas spécifiques 19
A) Des mots-valises /composés bien particuliers. 20
B) Des emprunts ou des codes switchings ?
1- En mélangeant les langues 22
a) Le français l’anglais 22
b) L’italien et l’anglais 23
2- Des anglicismes 23
3- De l’onomastique faisant écho aux anglicismes de Dantec 24
4- L’ enclosure et l’ anglicisme : quelques cas 25
C) Quelques cas d’enclosure 26
D) Une morphologie en rapport avec un domaine bien spécifique 27
II) Trois patrons syntaxiques et leur étude sémantique 30
1) Constructions syntaxiques et analyses sémantiques avec l’adjectif 31
A) L’utilisation de l’adjectif qualificatif 32
1- Des qualificatifs de couleur 32
2- Des qualificatifs de sensation 35
3- Des qualificatifs technologiques. 37
3
B) L’utilisation de l’adjectif relationnel 39
2) La construction syntaxique avec le substantif: La clef de voûte de la
métaphore. 43
A) L’utilisation de deux substantif en apposition. 43
1- Syntaxe et sémantique des figures de styles 45
2- Des tensions sémantiques dans la construction syntaxique 48
3) Des cas isolés et ambigus. 51
A) Une occurrence unique aux limites du français 51
B) Des ambivalences sémantiques 52
C) Une occurrence résolument unique dans l’étude syntaxique 54
III) L’imaginaire de Dantec 58
1) Un imaginaire aux thèmes récurrents 58
A) Alice 58
B) Le feu 60
C) Le tube à essai et le chargeur de fusil 61
1- Sciences dures et industries 61
2- Guerre et pensée philosophique 62
2) Un intertexte particulier 63
A) Louis Ferdinand Céline 65
B) André Breton 64
C) Henri Miller 63
3) Des références à la littérature anglophone de science-fiction. 65
A) Le Cyberpunk 66
1- Wiliam Gibson 66
2- Philip K.Dick. 67
B) Dan Simmons 67
C) Breat Easton Ellis 68
CONCLUSION 70
Bibliographie et Webographie 73
4
INTRODUCTION
La science-fiction n’est pas un genre uniforme, loin de là. Ce genre littéraire
est une véritable mosaïque de sous genres qui possèdent chacun leurs codes d’écriture, leurs
références culturelles, littéraires et leurs thèmes de prédilection, chacun des sous-genres
s’inscrivant en général dans une époque bien particulière. Ainsi la science-fiction américaine
des années 60 et 70 se focalise largement quant aux tensions politiques entre les USA et
l’URSS, c’est-à-dire la possibilité de voir le monde éradiqué dans un conflit nucléaire d’ordre
mondial. A l’inverse, la préoccupation majeure du XXIe siècle se situe entre terrorisme
islamiste, poussées d’extrême droite et questions écologiques. La science-fiction est le miroir
des peurs occidentales, son outil de catharsis et de transcendance. Bien que rien ne soit
clairement tranché, nous pouvons délimiter deux grandes famille de science-fiction. Comme
son nom l’indique, la science-fiction entretient un rapport privilégié avec le domaine
scientifique. La morphologie de « science-fiction » se caractérise comme un mot composé des
termes « science » et « fiction », témoignage morphologique de cette tension et de ce rapport
étroit entre création littéraire et sciences. Mais comme il existe des sciences dites “molles“ et
des sciences dites “dures“, il existe des sciences-fictions très attachées à écrire de la fiction en
rapport avec les sciences physiques, spatiales, informatiques, neurologiques, (etc...) (dite aussi
“Hard ficion“) et à leur évolution, tout comme il existe des sciences-fictions, soeurs de
l’anticipation, consacrée aux disciplines des “sciences molles“, c’est-à-dire la sociologie,
l’anthropologie (etc...). La “science molle fiction“ a ses origines dans l’utopie, bien avant la
“science dure fiction“ et l’avènement de la science moderne au XIXe siècle, trouvant ses
racines chez Thomas More. La “science dure fiction“, « forme presque achevée chez Jules
Vernes et H.G Wells »1 s’inscrit dans un registre littéraire corollaire aux découvertes
scientifiques majeures du XIXe, XXe XXIe siècle, qu’il s’agisse de problèmes
astrophysiques, de découverte de l’informatique ou d’androïdes. Mais les genres ne sont pas
imperméables, bien au contraire. S’il est vrai qu’un Kim Stanley Robinson va s’attacher à
travailler avec la NASA durant des années pour écrire au plus près de la réalité scientifique la
possible terraformation de Mars dans la Trilogie de Mars234, il est tout aussi vrai que
concevoir le progrès scientifique appelle des question d’ordre éthique (songeons aux Trois
1 Frederic Jameson, Penser avec la science-fiction, Paris, Max Milo, l’Inconnu, 2008, page 12.2 Kim Stanley Robinson, Mars la rouge, Paris, Presse de la Cité,1992.3 Kim Stanley Robinson, Mars la verte, Paris, Presse de la Cité, 1993.4 Kim Stanley Robinson, Mars la bleue, Paris, Presse de la Cité, 1996.
5
lois de la robotique d’Asimov »5). Ainsi si l’on peut distinguer des grandes familles de
science fiction, l’on peut concevoir des passerelles entre elles. Mais comment alors se
caractérise le fait d’écrire de la science-fiction dans la forme ? Pour le comprendre, il faudrait
étudier l’écriture même, sous ses aspect morphologique, syntaxique, sémantique et ses
références intertextuelles qui la caractérisent. Le style et la morphologie, la syntaxe et la
sémantique seront toutefois radicalement différents si l’on écrit une science fiction proche de
la science dure ou de la science sociale. Plus exactement, dans la forme, la “science dure
fiction“ se caractérise par l’utilisation exacerbée, d’un point de vue morphologique,
syntaxique et sémantique de termes en rapport avec les sciences dures.
Dans quelle mouvance s’inscrit donc Dantec ? Que signifie donc exactement écrire de la
science-fiction chez Dantec ? Comme cela se caractérise-t-il dans la forme ? Il sera intéressant
d’y répondre, par le biais d’une approche morphologique, syntaxique, sémantiques et
intertextuelle et dans les trois oeuvres que sont La Sirène rouge, Les Racines du mal et
Babylon Babies. L’étude est illustrée au travers de nombreux exemples, relevés remarquables
quant à notre approche et qui structurent la réflexion autour de cette problématique bien
précise de grammaire. En ce sens, devrons-nous dans un premier temps nous consacrer à
l’étude morphologique de Dantec. A savoir se concentrer sur l’étude des néologismes, les
classer en fonction de leur type, puis analyser les cas spécifiques témoignant de l’utilisation
de plusieurs langues par métissage- notamment l’anglais. Dans un second temps, sera-t-il
plus qu’important d’étudier conjointement syntaxe et sémantique. Nous verrons donc ainsi à
travers l’étude de plusieurs patrons syntaxique comment se construit et s’exprime la poétique
de Dantec, comment ils témoignent également de plusieurs figures de style- dont la
métaphore. Nous étudierons en premier lieu le patron du nom et l’adjectif- qu’il soit
qualificatif ou relationnel, nous verrons également comment s’exprime le patron du nom et du
complément du nom, voie royale de la métaphore. Enfin, nous étudierons ces cas particuliers,
isolés et ambigus, mais néanmoins témoin de l’élaboration de la poétique de Dantec dans le
texte. Dans un dernier temps, faudra-t-il s’attacher à étudier l’imaginaire de Dantec, définit
par les thèmes récurrents dans les oeuvres, les intertextualité, et enfin- brièvement, les
références aux oeuvres anglophones de science-fiction.
5 Issac Azimov, Les Robots et l’Empire, Paris, J’ai Lu, 1986.
6
I) Une approche morphologique de la poétique de
Dantec.
L’analyse stricto sensu de la poétique de Dantec ne saurait se justifier sans une
analyse stylistique de ses oeuvres. Pourtant, étudier une poétique en particulier ne se limite
pas seulement à cerner la poétique d’un auteur. Outre une approche sémantique et syntaxique,
il parait plus que judicieux de se pencher sur une étude morphologique. En effet, l’analyse
morphologique d’occurrences bien précises en rapport avec le sujet donné et la problématique
soulevée permet de mettre en lumière des points phares utiles à l’interprétation et la
compréhension de la poétique l’auteur. Ainsi, l’étude minutieuse de la construction des mots ,
entre autres les néologisme dans les trois oeuvres étudiées, montrera des récurrences et des
faits de langages et d’écriture propres à l’auteur et donc propices à la compréhension de sa
poétique. L’on en viendra également à étudier les emprunts aux langues étrangères et leur
utilisation métissée avec la langue française.
La science-fiction, comme nous l’avons dit précédemment est un genre littéraire qui utilise
bien souvent le néologisme et l’emprunt à d’autres langues. Que ce soit de la science “dure“
fiction ou de la science “molle“ fiction, le néologisme est pour sa part un outil important,
dirons-nous, un vecteur de science-fiction, genre par excellence perméable aux nouveaux
mots. Il est un outil fondamental parmi d’autres qui ensemble définissent une écriture dite
relevant du genre de la science-fiction. Que l’on parle du « déchronologue »6, ou d’un
« Schizo-Processeur »7, le néologisme occupe toujours une grande place et une place de choix
dans la littérature de la science-fiction, tout comme l’emprunt et le métissage lorsqu’on
parlera, par exemple, de « NeuroNext »8. Or s’agira-t-il de se saisir en cette étude comment la
construction morphologique ouvre des perspectives d’analyse poétique. Il conviendra
toutefois de définir notre méthode avant de rentrer dans l’analyse en tant que telle.
Ainsi, nous avons relevé dans les trois oeuvres de Dantec des occurrences pertinentes quant à
notre étude : c’est à dires des néologismes, des emprunts et des cas spécifiques. Nous les
avons classés puis commentés. Notre classement de cette étude morphologique repose sur
trois grands critères majeurs. En premier lieu avons-nous étudiés les compositions. Dans un
second temps nous nous sommes penchés sur les mots dérivés s’avérant être des néologismes
6 Stéphane Beauverger, Le Déchronologue, Paris, La Volte, 2009, page 13.7 Maurice G. Dantec, Les Racines du mal, Paris, Gallimard, (Folio SF), 1995, page 269.8 Maurice G. Dantec, Les Racines du mal, Paris, Gallimard, (Folio SF), 1995, page 269.
7
formés à partir de la dérivation préfixale. Enfin, dans un troisième temps, nous nous sommes
attardés sur des cas spécifiques- dont les emprunts font partie. Nous justifions ce classement
par le rapport entre les mots ou les morphèmes composants les néologismes. En ce sens, notre
classement suit la progression morphologique des néologismes, c’est-à-dire le rapprochement
morphologique des mots le constituant : de deux mots séparés par un espace et constituant
une lexie, nous étudierons tour à tour et par la suite deux mots séparés par un trait d’union, et
enfin, les compositions constituées d’un morphème préfixal. Notre classement situe
également les occurrences témoignant de l’adjonction d’une ou de deux majuscules.
1) Des compositions
La composition est un outil crucial pour la formation des néologismes. Crucial car
particulièrement utile. Par exemple l’occurrence « casse-noisette » constituée respectivement
des termes « casse » et « noisette » est une lexie parfaitement intégrée à la langue française
qui peut servir de modèle pour la composition de néologismes. Nous définirons la
composition en ce sens :
Son fonctionnement est fondamentalement le même que celui de fleur ou de porte.Lorsque les bases peuvent exister à l’état libre, le critère de composition estqu’aucun des éléments du composé ne peut –être déterminé séparément. Ceséléments ne peuvent pas non plus être remplacés par un autre terme ordinairementéquivalent paradigmatiquement ni subir des opérations syntaxiques telles que lamise en relief. Les mots de ce type présentent ou non un trait d’union. C’est unecaractéristique exclusivement graphique, en partie incohérente au regard du mode deformation et qui ne doit en aucun cas être considéré comme la preuve de lacomposition. Ce qui compte, c’est que dans tous les cas on a affaire à des syntagmeslexicalisés, à des lexies.9
Il est en effet important de saisir le mot composé dans sa globalité, de le
comprendre comme étant une lexie. Ce qui est néanmoins particulièrement notable est le fait
que Maurice G. Dantec, à partir de deux mots, va constituer une lexie totalement nouvelle,
vecteur d’un imaginaire nouveau.
9 Joëlle Garde Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, Paris, Armand Colin,(Cursus) 2011, page 89.
8
A) Des mots composés avec un espace
Même si comme l’explique Joëlle Gardes Tamines, « les mots de ce type
présentent ou non un trait d’union. C’est une caractéristique exclusivement graphique, en
partie incohérente au regard du mode de formation et qui ne doit en aucun cas être considéré
comme la preuve de la composition »10, il nous a paru bon de commencer notre classement
par les occurrences composées avec un espace. Comme la définition le met en lumière, il est
bien évidement notable de constater que nos occurrences sont des lexies à part, bien qu’elles
soit composées de deux « mots-formes »11. Il s’agit donc toujours bel et bien de néologismes
incarnés en la forme de mots composés.
1- Une composition formée à partir deux mots
Une occurrence illustre bien le patron de composition formé de deux mots avec
un espace. Page 684 des Racines du mal nous trouvons ceci :
« Ainsi, on pouvait perdre des heures à se balader dans l’univers artefact. »
L’on pourrait considérer cette occurrence comme un patron syntaxique nom et adjectif. Ainsi
« artefact » ne serait qu’un adjectif qualificatif au même titre que « bleu » ou « méchant ». Or
nous avons décidé de le classer dans les compositions. Il s’agit en effet d’une composition
sans trait d’union, d’une lexie à part entière. « L’univers » n’est pas un « univers » au sens le
plus simple, c’est un univers « réalisé par l'homme, {un} produit artificiel »12, dont le sens
« artefact » est « probablement emprunté à l’anglais »13. Cette composition sans trait d’union
dont l’un des terme est emprunté à l’anglaise montre déjà que l’étude morphologique révèle
un tic d’écriture particulier : celui de créer des néologismes proches, dans leurs structures, de
l’anglais.
2 – Une composition formée avec adjonction de deux majuscules
10 Joëlle Garde Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, op.cit, page 89.11 Alain Polguère, Notions de base en lexicologie, Montréal (Québec), Observatoire de Linguistique Sens-Texte(OLST), 2002, page 41.12 TLFI13 Ibid
9
C’est à la page 645 des Racines du mal que nous relevons cette occurrence bien
particulière :
« La chimie unique des lumières de néon et du Coca était tout à fait adapté à l’atmosphère du
lieu. N’importe où, la planète Nulle Part. »
« Nulle Part » bien que constitué de deux « mots formes »14, une lexie exprimée sous sa forme
de locution nominale. Mais c’est également, avec « planète », une composition dont il est
intéressant de relever que « Nulle » et « Part » portent chacun une majuscule à leur première
lettre. Il s’agit d’un moyen d’insister sur le rapport entre planète et « Nulle Part », un moyen
de mettre en exergue leur relation de proximité. « planète Nulle Part » est donc une
composition “nom propre“.
De plus, « Nulle Part » ne saurait être considéré comme un simple adjectif qualificatif, car
« planète Nulle Part » se définit finalement comme une lexie à elle toute seule et dans sa
globalité. C’est une unité de sens : une désignation de lieu au même titre que « Paris ». Les
protagonistes arrivent à « planète Nulle Part », et non pas sur la planète de quelque chose.
L’étude morphologique montre donc que Dantec forme ses néologismes en ce cas sur le
modèle de la langue française en y insérant toutefois une contradiction sémantique : ce lieu
nommé désigne un “non lieu“.
Notre étude morphologique a permis de mettre en lumière plusieurs
caractéristiques quant aux mots composés avec un espace. Certaines occurrences présentaient
l’adjonction de majuscules, d’autres se présentaient sous la forme morphème préfixal +
espace + mot. Ces néologismes répondaient pour la plupart à un besoin précis : la création
d’un imaginaire spécifique. De plus, nous relevions ces éléments particuliers : l’ambivalence
de la nature grammaticale de certaines occurrences : « artefact » pour « univers artefact »,
avec des rapprochements dans la construction morphologique avec la langue anglaise et une
contradiction sémantique soulevée par l’étude morphologique de « planète Nulle Part ».
Il est, par ailleurs, finalement intéressant de constater que les compositions séparées par un
espace ne sont pas si nombreuses. Nous verrons que les néologismes séparés par un trait
d’union sont beaucoup plus nombreux. Même si la séparation par un espace ou un trait
d’union ne s’agit que d’une marque graphique, il semblait bon de rappeler ce phénomène
constaté durant l’étude.
14 Alain Polguère, Notions de base en lexicologie, op.cit, page 41.
10
L’étude morphologique des néologismes se poursuit donc avec l’étude des occurrences
séparées par un trait d’union.
B) Des mots séparés par un trait d’union
Les compositions ne se limitent donc, bien évidement pas, aux seules
compositions faites à partir de deux mot séparés par un espace. Celles qui sont séparées par un
trait d’union sont, de plus, majoritaires dans les trois oeuvres de Dantec.
1- Une composition formée à partir de mots entiers
L’on trouvera aisément plusieurs exemples de composition formées à partir de
deux mots entiers. Des néologismes, bien sûr, dont la morphologie ouvre les portes d’un
imaginaire particulier. Ainsi la page 684 des Racines du mal témoigne bien de ce
phénomène :
« Un véritable univers-leurre, un simulacre parfait de celui qu’il était chargé de protéger de
toute intrusion. »
« univers-leurre », une lexie crée à partir des deux « mots formes »15 « univers » et leurre »
rappelle fortement la composition « univers artefact » (page 6 de notre dossier), étudié
précédemment dans la partie consacrée aux compositions faite à partir de deux mots séparés
par un espace. Leur construction morphologique et leur fonctionnement syntaxique est
relativement similaire, à la différence que les deux mots de la composition sont ici séparés par
un trait d’union. Ce qui est toutefois notable est la récurrence de l’utilisation du terme
« univers » dans la formation de néologismes.
Nous notons également le recours récurrent au néologisme fait à partir d’une
composition quand il s’agira de décrire des sensations précises. Ainsi les pages 486 des
Racines du mal et la page 292 de Babylon Babies illustrent ce phénomène.
« Le plus étrange, c’est qu’il su ce qu’il était advenu d’elle sans avoir pu accéder à aucune
information digne de ce nom en provenance du monde extérieur. La cartographie conscience-
sensation était formelle. » et « Maître Nicolas Kravczech, alias docteur Newton, s’en
délectait, comme la promesse d’une nouvelle liqueur extatique, qui ne tarderait pas à charrier
15 Alain Polguère, Notions de base en lexicologie, op.cit, page 41.
11
ses veines et ses artères, plongeant son cerveau dans une piscine bonheur-souffrance lave
incandescente bain d’acide feu purifiant du fouet lames de rasoir courant sous la peau en
nervures de verre coupantes et saintes. »
« conscience-sensation » et « bonheur-souffrance » sont deux néologismes issus de la
composition. Ces néologismes témoignent d’un fait bien précis : leur création relève de
l’enclosure, une enclosure destinée à expliquer un fait incompréhensible. En effet, la
« conscience » et la « sensation » sont fort différents, voire antinomiques. Ils relèvent
respectivement pour l’un de la métaphysique et pour l’autre de l’empirique. Il en va de même
pour « bonheur » et « souffrance » qui sont pour leur part des antonymes. Joindre ces termes
pour en faire une composition, un néologisme, témoigne d’une volonté de décrire un
phénomène justement difficilement descriptible puisque contradictoire. Le néologisme était la
bonne solution. La séparation des deux mots par un tiret permet de souligner leur rapport
paradoxal. Le néologisme et son sens s’en trouvent donc renforcés d’un point de vue
morphologique. Pas sûr, donc, que l’absence de trait d’union et le trait d’union soit
exclusivement une marque graphique comme l’explique Joëlle Garde Tamine.
Dantec use à nouveau de ce type de néologisme page 289 de Babylon Babies :
« Le jeune arabe lui avait offert le sourire-cimeterre du bourreau de Bagdad. »
« sourire-cimeterre » est une composition des termes « sourire » et de « cimeterre ».
« Cimeterre » aurait pu s’apparenter à un adjectif, ce qui aurait fait de l’occurrence « sourire
cimeterre » une occurrence proche de « sourire triste » ou « sourire jaune ». Or « sourire-
cimeterre » est une lexie, un néologisme dans sa forme. Sa morphologie est unique. Il est donc
différent, d’un point de vue morphologique de « sourire kabyle » ou « sourire de l’ange ».
Dans la mesure où la morphologie est différente, le sens de cette lexie est bien particulier.
Certains y verront une périphrase d’un sourire assassin, une métaphore du sourire kabyle ou
encore une métaphore du sourire de l’ange. La poétique de Dantec et son analyse commence
donc au niveau de la morphologie. Que nous indique cette occurrence formée de deux termes
séparés par un trait d’union ? Ce néologisme appelle donc bien des interprétations et remplit
son rôle: l’ouverture des portes d’un imaginaire et d’une poétique sombre.
Une dernière occurrence, enfin, se situe à mi-chemin entre le néologisme et le
mot attesté. En effet, « pseudo-minoen » mot composé avec la base nominale « minoen» et
l’élément formant « pseudo », tiré du grec et signifiant : « faux trompeur » et qui en français
12
moderne signifie « qui est faussement...qui passe pour »16 met en lumière un phénomène
intéressant. En effet l’utilisation du mot formant « pseudo » avec un trait d’union ne témoigne
pas de la création d’un néologisme puisque son utilisation est attestée. En revanche, « pseudo-
minoen » est une entrée plutôt rare dans les dictionnaires. Si l’utilisation de ce mot composé
est juste, il n’en est pas moins vrai qu’elle est très rare.
2- Une composition formée avec adjonction d’une majuscule
Comme c’est le cas pour « planète Nulle Part » (page 7 de notre dossier),
l’occurrence suivante est la dénomination d’un lieu. Ainsi, page 645 des Racines du Mal :
« Espace purement objectal, robotisé, démocratique, international, technique. Autoroute-ville.
Kilomètre sept cent cinquante. »
Cette composition des termes « autoroute » et « ville » est une lexie et syntaxiquement parlant
une phrase averbale. À la différence de « planète Nulle Part », l’on ne trouve qu’une seule
majuscule et un trait d’union entre les deux termes de la composition. « Autoroute-ville » est
une lexie qui désigne un endroit bien précis. Ce néologisme permet donc de se différencier
d’une proposition telles que “une ville d’autoroute“. Ici, « Autoroute-ville » est tout
simplement un nom de ville au même tire que Clichy-sous-Bois. Ce mode de formation, au
regard des noms composé avec « ville », présent dans la langue française, n’est donc
nullement surprenant.
3- Une composition formée avec adjonction de deux majuscules
Le procédé est relativement le même au regard de cette occurrence qui tient de
lieu de nom de chapitre dans l’oeuvre Babylon Babies. Page 149 :
« Maman-Machine »
« Maman-Machine » est une composition des termes « Maman » et de « Machine ». Il ne
s’agit pas de d’une “mère poule“, mais d’une maman mécanique. L’adjonction d’une
majuscule au terme composant « machine » renforce le côté symbiose acier/chair. En effet,
cette majuscule permet de placer sur un pied d’égalité le terme « Maman » et le terme
« Machine ».
16 TLFI.
13
4- Une composition formée avec un morphème préfixal
Nous constatons également, une utilisation de termes composés avec un
morphème préfixal. Ainsi, page 645 des Racines du mal :
« La vie en orbite ressemblerait à la vie dans les banlieues interurbaines. Des zones en friche
apparaîtraient peu à peu aux abords des centres cosmo-industriels »
Et page 290 de Babylon Babies :
« {...} une néo-protéine qui permet la modulation infinie de chaque impression de douleur et
la création d’icône mentales sado-masochistes avec une déconcertante virtuosité. »
Ces deux composition mélangeant morphème préfixal et mot, séparés par un trait d’union,
sont remarquablement similaires dans leur morphologie.
Ils sont pourtant différents sur un point.
« cosmo-industriel » suit le patron de la langue française bien efficace du morphème préfixal
terminé par la voyelle « o »- originellement un mot devenu morphème par abréviation, c’est à
dire par l’abrasion de sa dernière syllabe et adjonction de la voyelle « o »-, patron que l’on
retrouve dans des occurrences attestées telles que « franco-français » ou « sado-
masochiste ».« cosmo-industriel » est donc mot composé et dérivé avec le morphème préfixal
« cosmo », issu du grec « kosmos », qui signifie monde, univers17. « Cosmo » industriel n’est
donc rien d’autre le centre industriel déplacé dans l’espace.
« néo-protéine » est quelque peu différent. C’est un mot composé et dérivé avec le morphème
préfixal « néo », tiré du grec et signifiant « nouveau » avec le mot « protéine ». Le morphème
« Néo » est différent de « cosmo » puisqu’il n’est l’abréviation de rien dans la langue
française, mais un mot grec signifiant « nouveau. »
Quoi qu’il en soit, ces néologismes sont intéressants puisqu’ils témoignent d’une variété de
mode de création.
5- Une composition formée avec un morphème préfixal et adjonction de deux
majuscules
17 Emmaunuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la languefrançaise, op.cit, 1996, page 204.
14
Penchons nous un instant sur cette occurrence, page 269 des Racines du mal :
« Parallèlement, j’ai commencé à transformer mon Schizo-Processeur. »
« Schizo-Processeur » est mot dérivé avec le mot « processeur » et le morphème préfixal
« schizo ». Schizo- signifie littéralement : « élément tiré du grec skhhizein « fendre » et
entrant dans la construction de termes savants où le deuxième élément désigne ce qui est
divisé ou présente une fente comme schizophrène, schizophrénie, schizoïde. » 18. Le « Schizo-
Processeur » donc littéralement un « processeur divisé ». Et cette occurrence suit le schéma
de « cosmo-industriel », bien que l’auteur ai jugé bon de rajouter deux majuscules. Les
majuscules annonces déjà l’émergence d’un nom propre, ce qui prend tout son sens en
contexte : le « Schizo-Processeur » possède une conscience schizophrène.
Les mots séparés par un trait d’union présentent donc des similitudes avec ceux
séparés par un espace, en particulier lorsqu’il s’agit de nommer un lieu. Mais nous constations
à l’issue de cette étude que la composition avec le trait d’union est relevée plus de fois en
comparaison des compositions séparées par un espace. Il apparaît que ce mode de
composition est celui privilégié par Dantec. Nous supputons qu’il s’agit là d’une manoeuvre
dans le but d’être transparent. En effet, lorsque Dantec use du néologisme–songeons à
l’occurrence « conscience-sensation », le rapport de tension entre les deux terme et soulevée
par la lexie « conscience-sensation » elle-même semble plus net avec une trait d’union. Les
termes semblent plus proches d’un point de vue grammatical.
C) Un cas unique : une composition séparée par une barre.
Il s’agit là de la seule occurrence présente dans les trois oeuvres se présentant
sous cette forme. Page 644 des Racines du mal :
« Schizzo /Schaltzmann était d’accord avec moi, il m’a présenté une carte où un calque
lumineux recouvrait la zone la plus probable de leur lieu de rendez-vous. »
Ce néologisme n’est pas non surprenant dans sa forme. Il met en tension deux noms propres,
(« Doctor Schizzo » et « Andreas Schaltzmann ») sous la forme d’une composition avec
18 Emmaunuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la languefrançaise, op.cit, page 719.
15
lesdits noms propres séparés par une barre oblique. C’est un cas unique qui s’explique par le
contexte. En effet, les deux noms propres cohabitent morphologiquement dans la composition
dans la mesure où le « Schizo-Processeur » passe par des phases de transes schizophréniques
où « Doctor Schizzo » est également « Andreas Schaltzmann ».
Par ailleurs, l’oeil averti aura remarqué la graphie italienne de « Schizzo » et de « Doctor
Schizzo » évoqué. Nous y reviendrons plus loin.
Cette occurrence rare n’est pas significative d’un patron syntaxique récurrent
quant au néologisme. Elle méritait pourtant d’être étudiée puisqu’elle montre et rappelle dans
sa forme, bien que ce soit une barre oblique et non un trait d’union ou un espace, que Dantec
affectionne les néologismes sous la forme de compositions.
Les compositions, nous l’avons donc vu, ont une place de choix parmi
néologismes de Dantec. Que leur graphie soit sans trait d’union, avec, avec une ou deux
majuscules ou encore avec un morphème préfixal, ils participent activement à la peinture de
l’imaginaire de Dantec. Leur forme reste pourtant classique. Dantec ne coupe pas les mots de
manière hasardeuse ; il n’y a encore moins la création de nouveaux mots dans l’absolu. La
nouveauté vient du métissage de deux termes attesté. Cette réalité du néologisme chez Dantec
se trouve une fois de plus avérée lorsqu’il s’agit de l’autre mode de formation des
néologismes dans ses oeuvres. Il s’agit de la dérivation par le préfixe.
2) La dérivation par le préfixe.
La dérivation par le préfixe est l’autre mode par excellence de formation des
néologismes chez Dantec. Nous ne nous attarderons pas sur la dérivation par le suffixe dans la
simple mesure où il n’y a pas de néologisme dérivé par le suffixe dans les trois oeuvres de
Dantec. Il est ensuite important de savoir que « la question de la distinction entre composition
et dérivation est complexe et n’a pas toujours été tranchée de la même façon »19. C’est une
réalité qu’il faut prendre en compte. Nous avons fait le choix de séparer dérivation et
composition, et de placer l’étude de la dérivation en second lieu. Pour bien saisir la différence
19 Joëlle Garde Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, op.cit, page 88.
16
entre la composition et la dérivation, nous prendrons comme modèle la définition de la
dérivation énoncé par Joëlle garde Tamine :
La dérivation est processus morphologique défini en synchronie dans le système etconcerne la formation des mots ; il consiste dans la création de nouvelles unitéslexicales par l’adjonction à une base d’un affixe : chant-eur. Rappelons qu’enfrançais il n’existe pas d’affixe inséré dans la base et que les affixes la précèdent oula suivent. Selon la place de l’affixe dérivationnel et le mode de combinaison et lemode de combinaison avec la base, on distingue trois type de dérivations enfrançais, la préfixation, la suffixation et le mode de formation parasynthétique.20
Les occurrences qui seront étudiées et classées comme occurrences dérivées suivront cette
définition. Nous rappelons à titre indicatif que nous avons constaté précédemment des
compositions qui présentaient des dérivations. Elles étaient surtout et avant tout des
compositions dans la mesure où la graphie de la lexie montrait un mot et un morphème
séparés distinctement par un trait d’union ou un espace. Les occurrences étudiées par la suite
ne sont pas des compositions mais des unités lexicales soudées. Avant d’aller plus loin, il est
important de définir ce qu’est la dérivation par le préfixe. Nous citerons également Joëlle
Garde Tamine pour ce point :
La préfixation : l’affixe est alors placé à gauche de la base et il n’entraîne jamais lacréation d’un nouveau mot dont la classe morphosyntaxique différerait de celle de labase. {...} Ils (les préfixes) n’ont pas de fonction grammaticale et se bornent àintroduire un changement de sens : leur fonction est exclusivement sémantique.21
A) Une dérivation par le préfixe standard
Qui dit néologisme ne dit pas forcément nouveau mode de création. Comme
nous l’avions constaté précédemment, les modes de création de néologisme suivent les règles
du français standard. Il n’y a rien de farfelu ou d’extrême. Ainsi, page 398 des Racines du
mal :
« La neuromatrice gronde, grogne, crisse, feule, rugit, halète, dans une symphonie digitale,
polyphonie hybride, aux voix se brouillant les unes aux autres, indistinctes, nuages verbaux
délités dès qu’apparus par un chaos sonore électrique »
« neuromatrice » : est mot dérivé avec la base « matrice» et le morphème préfixal « neuro »
qui est « un premier élément de mots savants, comme neurologie, du grec neuron, « nerf » ».
20 Joëlle Garde Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, op.cit, page 82.21 Ibid.
17
« Matrice » va désigner, au-delà du terme anatomique et dans un sens figuré : « milieu où
quelque chose prend naissance. »22 Ce mode de formation combinatoire est récurrent. Il se
calque grandement sur le schéma de « biomécanique » et de « bioprocesseur »
Ainsi page 486 et 286 de Babylon Babies :
« On l’avait amputé de la main droite, au moins en partie. Et on avait remplacé la partie
manquante par une sorte de greffon biomécanique. » et...
« À ses côtés, en travers du double siège arrière, Marie dormait d’un sommeil paisible. Le
bioprocesseur était en train de se dissoudre dans son estomac. »
Le mode de formation des néologismes de Dantec, en ce cas pour « neuromatrice » suit
volontiers le mode de formation des mots scientifiques attestés tels que « biomécanique » ou
« biprocesseur ». Y aurait-t-il une volonté, de par la morphologie, de donner crédit et autorité
à ses néologisme ?
La dérivation par le préfixe est donc un mode de formation des néologismes
que Dantec n’hésite pas à utiliser. De plus, la formation de ces néologismes calqués sur le
mode de formation des mots attesté en français renforce la crédibilité desdits néologismes. Ce
n’est pas une surprise. La science-fiction de Dantec se rapproche de l’anticipation et l’étude
morphologique de ses néologismes prouve qu’il cherche à donner crédit à ses créations
lexicales.
B) Une dérivation par le préfixe avec adjonction d’une majuscule
Plus loin dans la création de néologisme par la dérivation préfixale, l’on notera
ceux dont avec adjonction d’une majuscule. Ainsi, page 286 des Racines du mal :
« Un prototype de Biosphère 2000 a été monté au centre d’un immense hangar, dans lequel
s’affairaient jour et nuit des grappes de troglodytes humains, aux yeux brillants comme des
lucioles. »
« Biosphère 2000 » est un mot dérivé de le radical « sphère » et le morphème préfixal
« bio », signifiant en grec « vie », et que l’on retrouve comme morphème préfixal dans des
mots savants comme « biologique », ou « biologie ». « Biosphère » n’est pas un néologisme
22 Emmaunuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la languefrançaise, op.cit, page 484.
18
en tant que tel. C’est l’ajout de la majuscule et du nombre « 2000 » qui en fait une lexie
nouvelle. Il est intéressant par ailleurs de relever la majuscule qui témoigne de la formation
d’un néologisme à la valeur de nom propre.Le rajout de 2000 renforce l’effet de nom
d’entreprise, d’aspect très “ marketing ”, que l’on retrouve aussi banalement dans des
occurrences telles que “Optique 2000“, etc...
Mais la dérivation par le préfixe avec adjonction d’une majuscule n’est pas le
seul type de dérivation que l’on retrouve dans les oeuvres quant aux néologismes.
C) Une dérivation par le préfixe avec adjonction de deux majuscules
En effet, l’on retrouvera deux cas de dérivation par le préfixe avec adjonction
de deux majuscules, respectivement page 286 et 575 des Racines du mal :
« Ce que nous savions tous, c’est que NeuroSphère nous permettrait de poursuivre les
travaux » et
« Le TechnoCodex est consultable sur le serveur. N’hésitez pas à le consulter »
« NeuroSphère » est un mot dérivé avec la base nominale « Sphère » et le morphème préfixal
« neuro » qui est « un premier élément de mots savants, comme neurologie, du grec neuron,
« nerf ». Force est de constater que le morphème préfixal « neuro » est récurrent. Souvenons-
nous qu’il est déjà utilisé dans le néologisme « neuromatrice ». « Sphère », pour sa part est
également utilisé dans le néologisme « Biosphère 2000 ». Au vu de cette étude
morphologique, nous constations une certaine récurrence lexicale.
Le « TechnoCodex est un peu différent. « TechnoCodex » est un mot dérivé avec le terme
« codex » et le morphème préfixal « Techno ». « Codex » est attesté dès le XVIIe en français,
dans le sens de « recueil »23. Le « TechnoCodex » n’est autre qu’un registre « consultable sur
le serveur ». L’adjonction des deux majuscules met en lumière une volonté d’emphase quant à
ce néologisme archaïsant. Nous rajouterons que ce « TechnoCodex » est un mélange des
lexiques propres à la science-fiction («Techno », pour “technologie, techique“) et de la
Fantasy- le « Codex » étant bien souvent un livre de magicien (Le Codex de Merlin24).
23 Emmaunuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la languefrançaise, op.cit, page 178.24 Robert Holdstock, Le Codex de Merlin, Paris, Le Pré aux Clercs, 2011.
19
La préfixation avec deux majuscules montre une fois de plus des récurrences
des les constructions des néologismes, mais aussi des récurrences lexicales (« neuromatrice »
de la partie précédente faisant écho à la « NeuroSphère » dans cette partie,
« Biosphère2000 », L’étude morphologique montre également l’intervention du néologisme
propre au milieu de la publicité et du “marketing“ (« Biosphère 2000 »)
A l’issue de cette étude en rapport avec la dérivation préfixale, nous constatons
une importante utilisation de termes « processeur », « mécanique », « Sphère » ainsi que des
morphèmes préfixaux « neuro » et « bio », » sur l’ensemble des occurrences en rapport avec
la dérivation préfixale. Voilà des termes et des morphèmes qui renvoient à des champs
lexicaux bien précis : ceux de la science-fiction. La morphologie des néologismes chez
Dantec est donc bien l’une des clefs de la compréhension de sa poétique ?
3) Des cas spécifiques
La composition et la dérivation par le préfixe sont, comme nous l’avons
constatés précédemment, les deux principales grandes instances utilisées par Dantec pour
créer ses nouveaux mots. Force est de constater que l’on relève des occurrences qui ne
relèvent ni de la composition ni de la dérivation par le préfixe stricto sensu. Ce sont des cas
spécifiques qui méritent toute notre attention. Eux aussi, bien qu’ils ne relèvent d’aucune
catégorie traditionnelle de création de mots apportent, supportent et définissent à leur façon la
poétique de Dantec. L’étude de leur morphologie apportera peut-être quelques lumières sur le
concept d’écrire de la science-fiction. Ces “néo-néologismes“ parfois quelque peu farfelus
vont également de pair avec un autre fait d’écriture remarquable : Il s’agit des mélanges de
langues, d’emprunt ou de code switchings. Ce sont parfois de simples emprunts ou des termes
utilisés pour la création de nouveaux mots. L’emprunt et le métissage des langues est aussi un
trait important de l’écriture de Dantec. Et nous verrons que l’anglais n’est pas la seule langue
concernée. Ce trait d’écriture est également et particulièrement frappant au regard de la
morphologie de néologismes bien spécifiques : les noms propres. Les enclosures ont
également une part importante dans le lexique de Dantec, tout comme c’est le cas de ces
termes spécifiques à une culture particulière.
20
L’étude de la morphologie de la poétique de Dantec et de ses néologismes amène donc à
l’étude des cas bien spécifiques quant à la formation de néologismes, mais aussi à l’utilisation
des langues étrangères, à leur métissage dans la création de nouveaux mots avec la langue
française, et à l’utilisation d’un vocable propre à une culture particulière.
A) Des mots-valises /composés bien particuliers.
Ces espèces de compositions hors normes que nous allons étudier, s’approchent
le plus des créations standard de néologisme évoquées dans les partie précédentes. C’est pour
cette raison que nous les situons en premier lieu de notre étude. Cette partie est avant tout
consacrée à l’étude des mots-valises, des mots composés présentant des particularités. En
effet, ils relèvent difficilement à proprement parler de la composition, mais ils s’y
rapprochent.
La page 290 de Babylon Babies présente une occurrence rare dans sa forme,
mais pertinente quant à notre énoncé :
« Néguentropine Sacher-Dolorosa, avait dit le jeune dealer, une néo-protéine qui permet la
modulation infinie de chaque impression de douleur et la création d’icônes mentales sado-
masochistes avec une déconcertantes virtuosité. »
« Néguentropine Sacher-Dolorosa » est une composition, un emprunt et une dérivation par le
suffixe avec adjonction d’une majuscule. La dérivation du concept physique de néguentropie
avec le morphème suffixal « ne » est succédé l’utilisation d’un nom propre « Sacher » pour
« Chevalier Léopold de Sacher-Masoch », qui est lié par un trait d’union lexie avec l’emprunt
au latin « Dolorosa. » Les majuscules se justifient par le fait que ce néologisme est le nom
commercial de la molécule.
A l’inverse, d’autres occurrences ne s’étalent pas sur trois mots la composant,
mais raccourcissent. Deux exemple illustrent ce fait. Tout d’abord, penchons nous sur la page
61 de Babylon Babies :
Il avait observé la face blafarde, lunaire, cette peau d’albinos grêlée de tachesbrunes comme des cratères laissés à la surface d’un astre mort, puis les stéréoptiquesde pointe qui donnaient redonnaient vie à des yeux détruits par la guerre des annéesauparavant, et enfin les lèvres pâles et fines comme des lames de ciseauxchirurgicaux se retroussant sur une dentition de céramique d’un blanc publicitaire,sertissant l’éclat jaune d’une vieille canine coulée dans l’or pur. Une espèce de fauvedont les veines charriaient de la glace. L’ours blanc des terres froides.
21
« stéréoptiques » est un néologisme vraiment particulier. C’est une espèce de composition
utilisant le terme « optique » et le terme « stéréo ». Si les deux mots avaient été logiquement
assemblés, le mot ainsi créé aurait du être être stéréo-optique, ou stéréooptique. Il est rare de
trouver deux mêmes voyelles l’une à côté de l’autre en français. L’auteur a simplement
mélangé les deux termes et supprimé un hypothétique trait d’union et un « o » de trop. C’est
un mode de formation du néologisme vraiment surprenant. C’est par ailleurs un tour de force
qui ne désigne rien d’autre que des yeux artificiels. En effet, « optique » désigne le support
ces yeux artificiels. « stéréo » est un élément formant au sens de « volume, objet dans sa
spatialité »25 et « relief »26. « Stéréo » est donc le principe de vue en relief de ces yeux, leur
mécanique, leur fonctionnement. Ainsi le néologisme « stéréoptiques » désigne des yeux
artificiels qui de facto ont besoin d’une vision en relief pour palier l’oeil humain. Gardons
également à l’esprit que ce type de formation du néologisme est très rare dans les trois
oeuvres étudiées.
Une autre occurrence suit ce mode de formation. Ainsi, page 286 des Babylon Babies :
La douleur avait jailli en flux délicats tout d’abord, tendant de fines nervuresbarbelées sous son derme ruisselant de désir. Elle s’était incrustée en fins tendonsdurs comme l’acier et brûlants comme des braises aux endroits les plus sensibles, etil en avait gémi de douleur plaisir. Ce masociel était une pure merveille, pensa-t-il àplusieurs reprises alors que les frémissements électriques explosaient en cascade surses zones les plus intimes comme des filament de métal portés au rouge.
« masociel » est une formation hors norme adjoignant simultanément le terme« masochiste »
le terme « logiciel ». Le mot se forme ainsi : “maso{chiste}/{logi}ciel“. C’est très surprenant
et proche de l’inintelligible. Les mots formants sont transformés en espèce de base ou de
morphème jamais rencontrés dans la langue française. Cet exemple, et c’est important, est
absolument unique dans les trois livres étudiés. En effet, Dantec invente ses néologismes en
s’appuyant sur des principes attesté dans la langue française, que ce soit la composition ou la
dérivation par le préfixe. Ce cas est donc unique.
Ces espèces de compositions hors normes sont absolument rarissimes dans les
oeuvres de Dantec. Ils méritaient pourtant toute notre attention avant de se livrer à l’étude de
cas beaucoup plus courant dans la poétique de Dantec. L’étude morphologique de ses oeuvres
25 TLFI26 Ibid.
22
révèle une récurrence, un fait d’écriture très marquant. L’importante utilisation des langues
étrangère, en particulier l’anglais.
B) Des emprunts ou des codes switchings ?
Les linguistes ont fait un effort notable quant à tracer la différence entre
l’emprunt lexical et le code switching. En règle générale l’emprunt lexical n’existe que dans
le lexique alors que « le code switching se manifeste aussi bien dans le lexique qu’au niveau
syntaxique ou au niveau de la construction énonciative. »27. Le code switching est donc une
alternance profonde du code linguistique. Nous préfèrerons parler d’emprunt ou de métissage.
1- En mélangeant les langues
a) Le français l’anglais
D’ailleurs, le métissage des langues est la première approche quant à l’apport
d’une langue étrangère chez Dantec. C’est un fait d’écriture finalement peu courant dans
l’écriture de Dantec mais qui manifeste toutefois cette importance de l’apport alien dans son
écriture. La page 269 des Racine du mal s’en fait l’écho :
« Parallèlement, j’ai commencé à transformer mon Schizo-Processeur, en fonction des percées
de NeuroNext. »
« NeuroNext » est un néologisme utilisant le terme anglais « Next » (« suivant, après »), avec
le morphème préfixal français « Neuro ». « NeuroNext » est donc un cas remarquable dans
l’étude morphologique des néologismes puisqu’il est la symbiose de deux langues, un
métissage avec un morphème préfixal et un terme attesté en anglais. L’utilisation des deux
majuscules n’est guère surprenant. Tout comme « NeuroSphère »28, il témoigne de
l’utilisation de ce néologisme comme nom propre de marque, de groupe de recherche. L’on
retrouve aussi des métissages de langue assez courant dans la phraséologie du français
standard. Ainsi page 439 de la Sirène rouge :
27Rakesh M. Bhatt, Code-switching and the functional head constraint, New York, Modern Languages andLinguistics, 1995, page 12.28 Maurice G. Dantec, Les Racines du mal, op.cit, page 575.
23
« Le visage ambivalent du yuppie cannibale et humanitaire {...} Femme d’affaire branchée
dans les milieux de la mode, de la pub et du vidéoclip le jour, elle réalisait des films interdits
la nuit. Torture et assassinat en direct live, sur de la bande magnétique. »
« direct live » est l’expression de ce mélange des langues finalement assez courant.
Un nom propre métisse les langues. Regardons cette occurrence page 684 des
Racines du mal :
« De la 3-D complexe, qui témoignait de la virtuosité de son concepteur, Shade-La-Machine,
Minox, le minotaure du cybermonde. »
« Shade-La-Machine » est un nom propre composé à partir « shade », « l’ombre », du
déterminant « la » et du substantif « Machine ».
b) L’italien et l’anglais
Chose surprenante est en revanche l’utilisation de l’italien. Regardons les
pages 644 et 684 des Racines du mal :
« Schizzo /Schaltzmann était d’accord avec moi, il m’a présenté une carte où un calque
lumineux recouvrait la zone la plus probable de leur lieu de rendez-vous. » et...
« Comme me l’expliqua le Doctor Schizzo, quiconque tentait d’ouvrir la Porte 999 de manière
illégale entrait en fait dans un dédale aux dimensions infinies, et complètement factice. »
Nous ne revenons pas sur la forme « Schizzo/Schaltzmann », c’est à dire la composition de ce
terme avec une barre oblique, puisque nous nous y sommes déjà penché précédemment. En
revanche, nous nous intéressons cette fois ci sur la graphie de « Schizzo » et de « Doctor
Schizzo ». C’est une graphie qui rappelle fortement l’italien. Ce sont les deux consonnes « z »
qui rappellent l’italien. Encore plus surprenant est le mélange avec le terme anglais
« Doctor ». Ce métissage avec l’italien est très rare. C’est un cas isolé.
2- Des anglicismes
Outre le métissage des langues, il y a bien sûr des emprunts à la langue
anglaise. C’est un fait d’écriture important chez Dantec. Tout d’abord, penchons un instant
sur cet emprunt incontournable. Le titre même d’une des trois oeuvres étudiées : Babylon
Babies.
24
« Babylon Babies » est un emprunt crucial dans la mesure où il est le titre même de l’oeuvre.
Le titre n’est pas en français, c’est un signe prouvant que la poétique de Dantec, sa syntaxe,
sa sémantique et inévitablement, sa morphologie auront un lien avec la langue anglaise. La
traduction littérale de « Babylon » est « Babylone » qui n’est autre dans la Bible29 que « dans
l'écriture, se dit pour signifier, un lieu de désordre et de crimes. »30. Ainsi Babylon Babies,
(«Babies » pour enfant » ou « bébé » en français) désignerait pas extension les « enfants du
désordre et des crimes ».
L’on retrouvera d’autres emprunts tels que page 291 de Babylon Babies :
« -Le tout en échange des mémoires résiduelles des biochips de Marie Zorn. Et de ce que je
sais de l’histoire. »
Des « biochips », de la biomécanique. L’anglais fait partie de la morphologie de l’écriture de
Dantec. Nous ne pouvons nous y soustraire.
3- De l’onomastique faisant écho aux anglicismes de Dantec
Si l’anglais est présent dans l’écriture de Dantec, il y est particulièrement
représenté dans la morphologie de certains noms propres. Page 291 de Babylon Babies C’est
tout simplement un mot anglais usuel « Shadow » (ombre) qui est transformé ici en
pseudonyme :
« La voix de Shadow était douce comme le miel. »
Et page 515 de Babylon Babies, c’est tout simplement deux prénoms, l’un masculin, l’autre
fémnin, à la consonance très anglophone qui sont composés pour faire un nouveau prénom.
« Joe-Jane a trouvé ça sur le réseau, c’est tout frais de ce matin. »
Mais Dantec ne se contente pas seulement de faire des substantifs usuels en
anglais des noms propres. Il s’amuse avec les mots. Ainsi, page 644 des Racines du mal :
« Je pense que SunSet vit près de la frontière orientale de l’Italie, vers l’Autriche et la
Slovénie... {...} Minox vient probablement de la frontière germano-suisse. »
« SunSet » est un emprunt mais aussi un nom propre composé, « Sun » et « Set » étant
séparés par une majuscule, mais les deux réunions signifiant couché du soeil, et enfin un jeu
de mot puisque que « Seth » est une divinité égyptienne
29 La Bible, Gallimard, Paris, (FolioPlus Classique), 2005.30 TLFI.
25
« Minox » est un nom propre (Minotaure) abrégé par le suffixe « x », largement utilisé dans la
terminologie du marketing : » « xerox », « xanax ». Mais c’est surtout le jeu de mot avec
« ox » (boeuf) en anglais qui est frappant. Le min-ox- est donc doublement un bovin.
Nouveau jeu de mot page 347 de Babylon Babies :
« ShellC éclata d’un rire sonore en le prenant par l’épaule ».
«ShellC » est un néologisme amusant dans la mesure ou « Shell » signifie « coquillage » en
anglais, et l’utilisation de la lettre « C » en capitale qui fait écho à « sea », la mer. ShellC est
un coquillage de la mer ? A noter par ailleurs la similitude phonétique entre le néologisme
« ShellC » et le prénom anglais « Chelsea ».
En dernier lieu, constaterons-nous ce surnom intéressant puisque transformé du
français à l’anglais et abrégé au passage. Page 184 des Racines du mal :
« -Oh, Boje Moï, Darquandier, ne me ressortez pas vos théories sur le chaos et les mass
médias je vous prie. » « Darquandier » devient :
« -Non, Dark, pas vraiment, eux, ils font plutôt dans le genre dix-neuvième. »
« Dark » est une occurrence remarquable dans la mesure où ledit prénom est à la fois une
abréviation, un diminutif du nom « Darquandier » (souvenons nous que l’abréviation, en autre
le diminutif lorsqu’il s’agit d’une abréviation sur un nom propre, « se produit dans l’immense
majorité des cas par la finale du mot ».31) et surtout un emprunt- la letre « k » marque aussi
l’appartenance de ce diminutif à la langue anglo-saxonne- dans la mesure où « Dark » n’est
autre qu’un adjectif anglais signifiant « sombre ».
4- L’ enclosure et l’ anglicisme : quelques cas
L’utilisation de l’anglais combiné au système de l’enclosure est rare. Il n’est
relevé qu’une fois dans l’étude, page 286 des Racines du mal :
« Il nous confectionnait des smartdrinks et des trucs comme du crystal, ou le “ SearchLight“,
de sa propre confection, qui envoyait un sacré coup de turbo dans nos propres “circuits
neuroniques“, vous pouvez me croire. »
L’utilisation, tout d’abord, de l’italique est surprenante. Dantec n’hésitant pas à utiliser
l’anglais dans l’écriture, nous sommes surpris devant cette volonté de stigmatiser le terme
anglais par rapport à la proposition française. Cette italique fait donc office d’enclosure, tout 31 Joëlle Garde Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, op.cit, page 89.
26
comme ce néologisme anglais, «“SearchLight“ ». Son statut de néologisme explique pourquoi
il n’est pas en italique, mais encadré par deux guillemets. « “SearchLight“ », une drogue qui
“mène à la lumière“ est bien étrange dans sa morphologie puisque Dantec n’hésite pas à créer
dans mots avec l’anglais sans s’alourdir de guillemets. Pensons à « NeuroNext ».32
Les langues étrangères, et tout particulièrement l’anglais tiennent une place de
choix dans l’écriture de Dantec. Nous l’avons vu, l’auteur mélange les langues, le français et
l’anglais et, plus surprenant, l’italien et l’anglais. Puis il truffe de termes anglais son texte,
jusqu’à s’en servir pour créer des néologismes à la nature de noms propres. Certes l’anglais
est utilisé avec l’enclosure, mais cela reste un fait rare...Tout comme l’enclosure en français
reste un fait d’écriture rare chez Dantec.
C) Quelques cas d’enclosure
Certes l’enclosure est un fait d’écriture rare chez Dantec. Mais dans le cadre
d’une étude morphologique, il convient de s’y arrêter un instant. Regardons cette occurrence
page 286 des Racines du mal :
« qui envoyait un sacré coup de turbo dans nos propres “circuits neuroniques“, vous pouvez
me croire. »
Il est surprenant que Dantec utilise les guillemets pour l’occurrence “circuits neuroniques“.
Certes il s’agit d’une périphrase, d’une métaphore pour désigner les neurones, le terme
technique de circuit apportant une touche mécanique au syntagme. Mais ce genre de procédé
est courant dans l’écriture de Dantec et l’on se demande réellement pourquoi utilise-t-il des
guillemets. C’est véritablement la seule fois où Dantec use de ces guillemets en pareil cas.
Notons cette autre enclosure, tout aussi surprenante, page 684 des Racines du mal :
« alors que le “véritable“ cybermonde, dans lequel ils communiquaient, restait hors
d’atteinte. ».
Ici l’enclosure témoigne du paradoxe entre le terme « cybermonde » et le terme « véritable ».
Il s’agit d’un acte de pudeur plutôt surprenant de la part d’un auteur qui parle de « Schizo-
Processeur ». Nous retrouvons une dernière enclosure, toujours page 684 des Racines du mal :
32 Maurice G. Dantec, Les Racines du mal, op.cit, page 269.
27
« Très jolie architecture, susurra la machine, une sorte d’hypercube fractal. On croit briser ses
défenses et on s’enfonce de plus en plus dans le trou ».
En ce cas, l’occurrence pourrait éventuellement justifier l’enclosure dans la mesure où la
représentation d’un « hypercube fractal » est assez difficile à concevoir.
Les enclosures représentent un fait d’écriture minoritaire chez Dantec. Elles
sont été étudiées parce qu’elles sont rares, non pas parce qu’elles sont représentatives d’un fait
global de la poétique de l’auteur. Ces enclosures sont surprenantes, et leur utilisation est
parfois déroutante. L’auteur aime les néologismes et les emprunts, par exemple. Il est étrange
qu’en ces occurrences il eût été amené à utiliser les enclosures.
D) Une morphologie en rapport avec un domaine bien spécifique
Il semble intéressant, par ailleurs, de se pencher sur la morphologie
d’occurrences bien spécifiques. En effet, les termes étudiés sont en rapport avec une culture,
un courant culturel, ou un domaine bien particulier. Leur morphologie à priori surprenante
s’explique en réalité par le courant culturel ou leur domaine spécifique. Il s’agit de termes
existants, réutilisé dans un contexte bien différent par Dantec, et dont la fonction est
différente. D’une marque déposée, l’on passera ainsi à un nom propre. Il ne s’agit pas tout à
fait de néologisme mais de réappropriation. Le procédé semblait toutefois suffisamment
remarquable à étudier quant à notre étude, surtout que le domaine bien spécifique est tout à
fait en lien avec la science-fiction.
Ainsi, les deux occurrences suivantes témoignent de ce fait. Tout d’abord, celle page 515 de
Babylon Babies :
« Unix et Lotus étaient restés dans leur loft ».
Nous ne nous attarderons pas quant à l’adjonction de la majuscule sur le terme « Lotus »,
mais plus sur le terme « Unix ». Sa morphologie bien particulière appartient au monde de
l’informatique. En effet « Unix » est un nom propre mais aussi un système d’exploitation
créé en 1969
Il est va de même page 532 de Babylon Babies :
« Le dénommé Vax passait des heures enfermé dans son atelier ».
28
« Vax » présente une morphologie particulière. A l’instar d’ « Unix », c’est un néologisme
conçu pour les besoins de l’informatique, plus loin, pour les besoins de sa commercialisation.
En effet « Vax » est un nom propre mais également une famille d’ordinateur conçu au sein de
la société Digital Equipement Corporation. Ce qui est intéressant en ces cas est que la
morphologie initiale des termes a été conservée pour devenir des noms propres. Dantec s’est
contenté de reprendre un nom de système d’exploitation et un nom d’ordinateur pour en faire
des noms propres- certainement des pseudonymes.
Il reste une dernière occurrence, tout à fait cruciale quant à la poétique de
Dantec. Page 173 de la Sirène rouge :
« Urbanisme cyberpunk, déjà, fin de vingtième siècle, tout simplement... »
« cyberpunk » est un mot composé avec « cyber », -premier élément formant de mots
techniques en rapport avec la science informatique et le virtuel (« cybernétiques »,
« cybercafé », « cyberespace », « cybertexe » « cyberpunk »)- et punk, anglicisme tombé
dans le domaine courant de la langue française, courant musical et culturel. C’est un terme
très important quant à le poétique de Dantec. Le terme n’est pas un néologisme, mais est un
mot attesté et utilisé. Faisant référence à un courant culturel, il occupe une partie importante
de l’imaginaire de Dantec que nous étudierons plus loin. Ainsi, avant d’aller plus loin, dans la
sémantique, la syntaxe, l’imaginaire et l’intertexte, nous nous devions de nous arrêter un
instant sur cette occurrence et de l’analyser dans sa morphologie.
Ces quelques termes étudiés montrent à quel point la morphologie peut être
l’écho, l’illustration même d’un univers particulier, d’un imaginaire, d’une poétique.
Plus globalement, l’étude de ces cas particuliers a révélé des points
fondamentaux quant à l’analyse de la poétique de Dantec. En effet, l’étude scrupuleuse de la
morphologie a révélé des compositions ou mots-valises réellement surprenants, des emprunts
à l’anglais, à l’italien et des métissages de langues dans la morphologie même des
néologismes. Nous avons également étudié les cas d’enclosure ainsi que les mots présentant
une morphologie propre à un univers, un domaine ou une culture bien précise. Ce dernier
point sur les cas spécifiques vient donc terminer l’étude morphologique initiée par l’analyse
des mots composés et complétés par celles concernant les mots issus de la dérivation par le
préfixe. A l’issue de cette étude, nous tirons plusieurs conclusions quant à la morphologie du
mot nouveau (ses emprunts, également), de l’écriture de Dantec.
29
Et il conviendra tout d’abord de retenir certaines récurrences dans la
construction du mot. Certains mots ou préfixes utilisés dans la création de mots composés
sont en rapport avec le lexique de l’espace : « cosmo-industriel », « planète Nulle Part »,
« univers artefact », « univers-leurre ». L’on retrouve, par ailleurs, des morphèmes préfixaux
ayant trait aux sciences dures : « neuro », « bio », « neo » et « cyber », ce qui donne en
contexte des néologismes en rapport avec la biologie supposée novatrice (« néo-protéine »), à
la biomécanique et à l’informatique,(« Schizo-Processeur », « Maman-Machine ») ainsi
qu’aux sciences neurologiques (« NeuroSphère », « NeuroNext », « neuronique »
« Neuromatrice »). Ces néologismes sont tout autant de noms, d’adjectifs, que de noms
propres rappelant fortement le lexique des entreprises (« Biosphère 2000 »). Force est de
constater, par ailleurs, que l’anglais tient une place de choix, tant dans le néologisme que dans
l’emprunt. Ce sont des néologismes lorsque l’auteur mélange les langues, les métisse pour en
faire des termes uniques et nouveaux (« NeuroNext »), ou lorsqu’il s’agit de créer de
nouveaux noms ou pseudos (« ShellC », « Minox », « Dark ») ce sont aussi des emprunts qui
viennent colorer l’écriture de Dantec par leur morphologie surprenante en français
(«biochips»). C’est encore sans compter les deux cas de graphie italienne qui viennent
ponctuer le tout (« Doctor Schizzo », « Schizzo/Schaltzmann »). Enfin, l’on relève quelques
néologismes à la morphologie quelque peu déroutante en français (« masociel »,
« stéréoptiques », « Néguentropine Sacher-Dolorosa »). Mais dans l’ensemble, il est
indiscutable de constater que les néologismes de Dantec se construisent sur des schémas
attestés en français, des patrons reconnus et avec des mots ayant très largement trait à la
science. Le lecteur ne trouvera aucun exemple de néologismes dont la création morphologique
est fondés sur des critères totalement imaginaires, à l’instar de « Khazad-dûm »33 chez
Tolkien, par exemple. La construction du mot nouveau dans la poétique Dantec n’est autre,
donc, que l’infiltration d’un vocable ayant trait à la science dure dans la morphologie du
terme et ce, sur des critères de formations attestés et reconnus en français moderne. C’est ainsi
que se définit le néologisme du style relevant de la science-fiction chez Dantec. Les
néologismes le définissant se construisent avec des mots formants ou affixes appartenant alors
au lexique de la science-fiction- donc de la science tout court, puisque comme nous le voyons,
le genre littéraire et la discipline d’étude sont étroitement liés.
33 JRR, Tolkien, Le Seigneur des anneaux (1) Paris, Gallimard (Folio), 2000, page 411.
30
Par ailleurs, noterons-nous le pauvre apport en occurrences quant au néologisme ou aux
emprunt dans l’oeuvre La Sirène rouge. Est-ce parce que ce roman est le premier roman de
Dantec ? Parce qu’il est le moins “science-fiction“ et qu’il s’apparente plus au genre du polar
ou du thriller ? Parce que le style, et donc la poétique de l’auteur n’est pas encore tout à fait
affirmée ? Est-il toujours révélateur quant à la question de savoir, qu’est-ce qu’écrire de la
science-fiction chez Dantec ? L’approche sémantique et syntaxique nous apportera-t-elle des
éléments de réponse quant à cette question ?
C’est ce que nous allons voir à l’instant.
II) Trois patrons syntaxiques et leur étude sémantique.
S’attacher à étudier le néologisme est une chose particulièrement importante,
cruciale, quant à une étude sur la poétique d’un auteur, en ce cas précis, Dantec. Il conviendra
toutefois d’étudier les constructions syntaxiques et la sémantique des termes et des
propositions. En effet, le néologisme ne définit pas à lui seul la stylistique d’un auteur. Même
s’il est vrai qu’il est une marque du genre de la science-fiction, il n’est pas moins vrai que la
sémantique et la syntaxique sont révélateurs quant à la définition d’une écriture dite relevant
justement de la science-fiction. Cette étude s’axe en priorité sur l’analyse de trois patrons
syntaxiques bien précis : la construction syntaxique de l’adjectif et de la métaphore, la
construction syntaxique avec le nom propre comme clef de voûte de la métaphore, et enfin
les cas isolés et ambigus. Cette analyse plutôt large des patrons syntaxique a néanmoins le
mérite de couvrir toutes les occurrences les plus remarquables et les plus pertinentes quant à
notre étude. En effet, nous nous trouverons confrontés à des occurrences, des propositions
voire des syntagmes présentant une particularité, un fait d’écriture notable. C’est parfois une
métaphore, parfois une périphrase ou une tout autre figure de style. Quoi qu’il advienne, c’est
ainsi que nous tenterons de comprendre, grâce à ces éléments, comment la plume de Dantec
est en définitive une écriture science-fiction. Il va également de soi que l’étude syntaxique se
verra couplée à une analyse sémantique. Nous ne séparons pas les deux approches, car nous
considérons qu’elles apportent conjointement des lumières sur les questions soulevées par le
sujet.
31
1) Constructions syntaxiques et analyses sémantiques avec
l’adjectif.
Il conviendra tout d’abord d’étudier les occurrences en rapport avec l’adjectif,
que nous définirons ainsi : « Les adjectifs constituent la deuxième catégorie d’éléments qui
accompagnent le nom. Ils ne servent pas à actualiser une référence ni à quantifier le nombre
d’éléments visés, mais expriment des propriétés de ces éléments. Ils ne déterminent donc pas,
ils caractérisent. Ils sont compatibles avec les déterminants et ne peuvent à eux seuls
permettre à un substantif de fonctionner comme un sujet »34. Point de néologismes, donc,
dans cette étude, si ce n’est l’utilisation particulière des mots dans un but bien précis : bâtir
une écriture du futur. L’adjectif est un de ces outils à la disposition de l’auteur, et il en use
comme il se doit dans la construction de ses syntagmes et de ses propositions. Mais il faudra
distinguer deux types d’utilisation de l’adjectif. Premièrement faudra-t-il se pencher sur
l’étude de l’adjectif qualificatif, puis dans un deuxième temps, sur l’utilisation de l’adjectif
relationnel. Nous verrons ainsi au gré de l’étude des occurrences leur rôle crucial dans la
construction de périphrases ou de métaphores, leur rôle crucial quant à l’élaboration d’un
style bien précis, d’une poétique futuriste. Même si, nous le verrons par la suite, la
construction avec le nom et le complément du nom est la voie royale de création de
métaphore, il conviendra de garder à l’esprit que l’adjectif a un rôle à jouer quant à la
métaphore et donc bien sûr dans le processus d’élaboration de la poétique style science-fiction
de Dantec en général. Notons toutefois que notre analyse ne va pas s’attarder sur les
« marquages stylistiques »35 provoquées par la seule variation de place de l’adjectif. Ainsi, le
fait que l’adjectif antéposé « prendra volontiers une valeurs subjective »36 tel “un excellent
repas“, ou encore « la figure rhétorique de l’épithète de nature » : “la blanche colombe“ sont
tout autant de faits de langue que nous n’étudierons pas. Nous nous concentrerons sur les
occurrences remarquables quant à notre étude, c’est à dire étude de la stylistique de Dantec et
de son écriture dite relevant de la science-fiction. Nous éviterons ainsi les relevés de
stylistique standards.
34 Joëlle Gardes-Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, op.cit, page 162.35 TLFI.36 Ibid.
32
A) L’utilisation de l’adjectif qualificatif
L’adjectif qualificatif se définit de cette manière : « {...} Sur la base de critères
sémantiques et syntaxiques, on peut distinguer différentes catégories d’adjectifs. Les premiers
sont les adjectifs qui expriment une propriété intrinsèque, comme la couleur, la forme, etc. Ils
constituent la majorité des adjectifs. »37 Il peut être épithète, épithète détachée et attribut
lorsqu’il est inséré dans le groupe verbal.
1- Des qualificatifs de couleur
L’utilisation de l’adjectif exprimant une « propriété intrinsèque »38 comme la
couleur est très fréquente. Or la stylistique de Dantec s’en empare de manière
particulièrement intéressante. En effet, la « Sirène rouge », titre de l’une des trois oeuvres, et
le « gaz azur » sont des propositions plus qu’anodines. Ainsi le syntagme « La Sirène rouge »
révèle des points intéressants à étudier quant à une approche sémantique. Penchons nous tout
d’abord sur cette partie du syntagme : « sirène », « sous la forme sereine au XIe, emprunté au
latin tardif sirena, venu du latin classique siren »39. La « Sirène » est un « être fabuleux, dont
le haut du corps est celui d'une femme et le bas à partir de la taille est celui d'un poisson, qui
selon les légendes attirait les marins par son chant mélodieux, les retenait prisonniers ou les
faisait périr sur les écueils. » 40. Mais « sirène » peut également faire à écho au sens vieilli de
« sirène » soit : « Personne qui par un discours habile, charme, séduit ou endoctrine
quelqu'un », et « Femme ayant un très grand pouvoir de séduction ». 41. Enfin, la « sirène »
est aussi par analogie un « appareil servant à produire un signal sonore très puissant le plussouvent au moyen d'air comprimé, de vapeur ou par l'électricité, utilisé comme moyen d'appelou d'alerte ».42
Quant au terme « rouge », épithète de « sirène » en contexte, il est un adjectif, une « couleurqui parmi les couleurs fondamentales se situe à l'extrémité du spectre, et rappelle notammentla couleur du coquelicot, du rubis, du sang ». Le rouge est donc la couleur du sang, mais aussi
37 Joëlle Gardes-Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, Paris, Armand Colin,(Cursus) 2011 page 162.38 Ibid.39 Emmanuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la langue française,op.cit, page 739.40 TLFI.41 Ibid.42 Ibid.
33
le signal de « l’alerte rouge » puisque le rouge est « La couleur qui par son intensité, sert àmettre en relief, à attirer l'attention »43 et qui « connote le danger ou l'interdit »44.
A présent, penchons nous sur le syntagme entier « La Sirène rouge ».
Le fait que la « sirène » soit « rouge » est intéressant. Si l’on considère la « sirène » comme« un signal d’alarme » et le rouge comme une « couleur d’alerte », il ne s’agit plus alors dedésigner des sirènes de police, mais bien des sirènes d’urgence, de danger grave. C’est« l’alerte rouge ». Celle qui rappelle le danger et le sang. C’est accessoirement une métaphoredu communisme.
Dans un deuxième temps, si l’on considère que « sirène » n’est pas un signal d’alerte mais
« être fabuleux, dont le haut du corps est celui d'une femme et le bas à partir de la taille est
celui d'un poisson, qui selon les légendes attirait les marins par son chant mélodieux, les
retenait prisonniers ou les faisait périr sur les écueils » et une « femme ayant un très grand
pouvoir de séduction », la « sirène rouge » devient alors une périphrase pour désigner une
espèce de « dame de coeur »-si l’on prend comme référentiel Alice aux pays des merveilles45
ou de vampire, de nouvelle comtesse de Bathory46 qui ne désigne personne d’autre que l’un
des personnages du roman, à savoir la mère d’Alice. En effet, Eva grande tueuse, est obsédée
par le sang, qui est à ses yeux (p.512) est cette « drogue rouge et chaud comme la vie. »
La « Sirène rouge » est donc un syntagme qui joue sur la pluralité de ses teneurs sémantiques.
Notons enfin les axiologies dégagées par cette étude sémantique qui sont celles du danger, du
sang, de l’alerte, de la mort et du monstre.
Point de connotation considérée comme de la science-fiction, donc, dans la
mesure où l’on ne relève pas de terme issus de la science dure dans la construction de cette
proposition. Or il en va tout différemment de l’occurrence qui suit (page 671 des Racines du
mal) :
« De hauts nuages majestueux, blancs et moutonneux, s’élevaient dans le gaz azur, comme
des champignons atomiques. »
L’ « azur » , épithète de gaz en contexte de « gaz », est en littérature et par analogie au « Nom
donné anciennement au lapis-lazuli appelé aussi quelquefois pierre d'azur »47, et une « couleur
d'un bleu intense. »48, donc aussi une « référence à la couleur du ciel et de la mer par beau
43 TLFI.44 Ibid.45 Lewis Carroll, Alice aux pays des merveilles, Paris, Gallimard (Folio Classique) 1994, page1.46 Eric Hickey, Encyclopeadia of Murder and Violent crime, Sage publication, 2003, page 44.47 TLFI.48 TLFI
34
temps, le ciel ou l'air, plus rarement la mer »49, et, au figuré un « symbole de l'idéal, de
l'infini, de l'absolu ».50, quant au « gaz », il est une désignation du « ciel », puisque ce sont
« De hauts nuages majestueux, blancs et moutonneux » qui s’y élèvent et que le ciel est
composé... de gaz. Les « gaz » expriment le ciel dans le lexique scientifique, puisque ce sont
les gaz qui composent le ciel. Ce qui est intéressant, c’est que la construction littéraire
standard entend ciel pour et azur pour « ciel d’azur », ou « d’azur de cieux »51. Or notre
syntagme en cette occurrence est « gaz azur ». « gaz azur » est donc un mixte de deux
lexiques : celle de la littérature traditionnelle, avec l’utilisation de « l’azur » et celle de la
science avec « gaz ». Cette métaphore du ciel est donc à la fois une élévation du terme ciel
d’une manière très littéraire avec l’utilisation du terme azur et à la fois une chute dans
l’univers scientifique avec le terme « gaz »- la définition la plus réaliste du ciel, de la manière
la plus technique qui soit. Les métaphores de Dantec sont donc le résultat d’une symbiose de
lexiques. En ce sens, la sémantique de Dantec ouvre donc les portes d’une analyse de sa
poétique et de sa stylistique : c’est un mélange de lexiques, exactement de deux lexiques :
littéraire et scientifique.
L’occurrence suivante vient enfin confirmer cette affirmation. Page 173 de la
Sirène rouge :
« La nuit, dôme noir et parfait, carbonique. »
La construction syntaxique est intéressante. Point de doute que « noir » soit l’épithète de
« dôme ». Mais que penser de « carbonique » ? Est-ce l’épithète de « nuit » ou de « dôme »
qui est « parfait » ? De plus, « La nuit, dôme noir et parfait, carbonique. » est une proposition
averbale qui assimile la nuit à un « dôme noir » et alors que la phrase type préférera « la nuit
noire ». Ici, la nuit est un « dôme noir » qui de surcroît est « carbonique ». « Carbonique » est
particulièrement remarquable quant à une approche sémantique. En effet, le carbone est
l’élément le plus répandu dans l’univers et la nuit est propice à l’observation de l’espace. La
nuit carbonique, c’est donc la nuit de la matière en son absolu, des étoiles et du vide spatial.
Dans un deuxième temps, le carbone peut se manifester sous différents états. Il peut être noir,
et c’est donc du charbon. Ainsi, par analogie, le carbone, désigne le noir de la « nuit ». Enfin,
le carbone, ou plus précisément le charbon après un certain temps se mue en diamant. Le
diamant par analogie désigne les étoiles (qui brillent comme). Ainsi et en ce sens une
« nuit{...} carbonique est une nuit étoilée. » Cette étude répond donc à la question syntaxique 49 Ibid.50 Ibid.51 Ibid.
35
suivante : « carbonique » est- il l’épithète de « dôme » ou de « nuit » ? Il l’est donc
probablement de « nuit », répondra la sémantique. L’on pourra enfin répliquer que les virgule
autour de « ,dôme noir et parfait, » isolent le syntagme et prouvent que « Nuit,{...} » et
« ,carbonique » sont liés. Pourtant une légère ambiguïté subsiste : le débat est ouvert. Quoi
qu’il advienne « dôme noir » et « carbonique » sont un syntagme métaphorique et
anaphorique de la « nuit ».
La page 173 de la Sirène rouge possède un exemple, également, d’utilisation intéressante
d’adjectif :
« Le tableau de bord, pure radiation. Compte tours et tachymètre, comme des codex fluos. ».
« Codex fluos », ou le terme isolé du syntagme « codex », dont « fluo » est l’épithète, se
définit ainsi : « manuscrit consistant en un assemblage de feuilles de parchemin, de forme
semblable à nos livres actuels, par opposition au rouleau de papyrus »52. Le « fluo » est une
abréviation de fluorescent (dans la mesure où « L’abréviation se produit dans l’immense
majorité des cas par la finale du mot »53) signifiant qui « transforme les radiations lumineuses
reçues en radiations de plus grande longueur d'onde; en particulier, qui transforme les rayons
ultra-violets et les rayons X en rayons visibles. »54. Ainsi la proposition subordonnée
comparative « comme des codex fluos » fait référence aux « compte-tours et tachymètre ».
Ainsi, l’on remarquera que l’étude sémantique et syntaxique révèle le mixte de deux usages
pour une même désignation. Autour d’une construction syntaxique adjectivale dont le patron
est celui de l’adjectif qualificatif avec son épithète, l’on constate un usage d’un terme désuet
« codex », et d’un terme référant à une technologie moderne « fluo. ». Et par extension, « les
comptes tours et les tachymètres deviennent d’antiques manuscrits fluorescents. » La poétique
de Dantec s’appuie aussi donc sur une tension entre termes vieillis et termes modernes.
Cette étude prouve donc une chose : l’insertion du lexique scientifique dans la construction
stylistique de Dantec. Grâce à l’insertion du lexique scientifique dans la proposition, la phrase
type propre au lexique de la littérature : « Nuit...noire » devient une “nuit carbonique“.
2- Des qualificatifs de sensation
Quelques utilisations d’adjectif représentant la sensation sont représentatifs de
52 TLFI.53 Joëlle Garde Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, op.cit, page 89.54 Ibid.
36
notre étude quant à la compréhension de l’écriture de la science-fiction. Observons cette
occurrence page 103 des Racines du mal :
« Au-dessus d’elle le ciel était moucheté d’astres aux radiations violement visibles. Au delà
de l’autoroute, au-dessus d’une lande noire et sans forme, rien que des vagues nuances de
ténèbres, le disque pâle de la lune se levait. »
« radiations violement visibles » révèle, dont « visibles » est épithète de « radiations » est une
occurrence qui présente une tension sémantique. En effet la « radiation » est une « émission et
propagation d'énergie dans l'espace ou dans la matière sous forme d'ondes électromagnétiques
ou de particules »55. La radiation, dans sa définition même est un phénomène physique
synonyme de rayonnement. La « radiation », ou plutôt donc en physique le « rayonnement »,
peut éventuellement se caractériser comme étant l’ensemble des ondes électromagnétiques
visibles par l’oeil humain, soit celles entre 380nm et 789 nm et donc, en un mot, se définir
comme étant la lumière...Ce qui s’illustre en contexte comme étant la lumière des « astres ».
Ainsi les « radiations violement visibles » n’est qu’un syntagme métaphorique pour désigner
la lumière des étoiles. Cette fois ci, c’est les « astres » qui sont exprimés comme était des
« radiations violement visible ». La poétique traditionnelle prend donc un coup ; elle est
sublimée par une utilisation de manière rigoureusement scientifique. Ainsi se définit
également la poétique de Dantec. Plus qu’un mixte de lexiques traditionnels de la littérature
avec des termes de sciences dures, les dénominations du sujet se font de manière très
scientifique tout simplement. C’est un des visages de la poétique de Dantec.
En revanche, un coup d’oeil quant aux occurrences de la Sirène rouge vient nous confirmer
que cette oeuvre présente bien peu de constructions syntaxiques, (une seule, page 173) de
relevés sémantiques quant à l’écriture relevant du genre de la science-fiction. L’utilisation de
qualificatifs le prouvent : ils sont tout à fait différent de le leur utilisation faite dans Babylon
Babies ou dans les Racines du mal. Ainsi, l’on retrouve plus généralement des occurrences
telles que celles-ci :
« Toute cette sérénité lumineuse des éléments, des arbres, des pierres et des oiseaux de mer
qui planaient en jacassant au-dessus des flots ». « Lumineuse » est l’épithète de « sérénité »,
et témoigne d’une figure de style relevant de la synesthésie, c’est-à-dire d’une association de
sens divers. Mais c’est là bien tout.
55 TLFI.
37
3- Des qualificatifs technologiques.
L’on trouve également des adjectifs qualificatifs appartenant au lexique de la
technologie en général. Ils sont pour certains des métaphores. La page 324 de Babylon Babies
s’en fait l’écho :
« Ca gueulait, ça gémissait, contrepoint horriblement humain à la symphonie mécanique qui
pilonnait l’univers entier ».
« symphonie mécanique » met en évidence la nature de « mécanique » comme étant un
adjectif qualificatif épithète de « symphonie. ». En effet, « mécanique » entretien un rapport
très étroit avec le substantif « symphonie ». Mais au delà de l’aspect syntaxique, étudions la
sémantique de ce syntagme« symphonie mécanique qui pilonnait » : « symphonie » se définit
ainsi : « composition musicale, généralement de grande dimension, composée de trois ou
quatre mouvements, pour certains de forme sonate, dont l'instrumentation, qui réunit toutes
les familles d'instruments de l'orchestre, s'est modifiée au cours des siècles, dans sa richesse et
sa variété »56 mais aussi, et en par analogie « Ensemble de sons, de bruits formant une
harmonie »57, ou encore « Ensemble de couleurs, de parfums, ou autre, qui produisent sur les
sens une forte impression d'harmonie, un grand effet d'équilibre »58, voire « Ensemble de
choses organisées qui figurent dans un ensemble donné. »59. En contexte, hormis la première,
« symphonie » se définira par toutes les définitions données. Une « symphonie mécanique »,
c’est donc, à l’instar de l’occurrence « gaz azur », une utilisation de deux lexiques : la
musique et le techniques. Notons le verbe « pilonner » qui se définit ainsi : « Frapper à coups
de pilon pour écraser, fouler, tasser »60 ou encore « Écraser les positions adverses sous un
bombardement intensif »61. Ainsi une « symphonie mécanique » est un syntagme qui devient
une métaphore du bombardement grâce à l’ajout du verbe « pilonner » : « symphonie
mécanique qui pilonnait » est donc une métaphore du bombardement.
Mais le patron syntaxique de l’adjectif qualificatif en rapport avec le lexique de
la technologie ne révèle pas seulement des figures de style telle la métaphore. Il peut
56 TLFI57 Ibid.58 Ibid.59 Ibid.60 Ibid.61 Ibid.
38
également être utilisé pour décrire des phénomènes techniques complexes, un peu comme
l’occurrence « hypercube fractal »62. En effet, penchons nous les occurrences page 687 des
Racines du mal :
« En une microseconde, la créature solaire a envahi leur système. Leur univers pseudo-
minoen a subi l’assaut fulgurant d’une jungle proliférante, un réseau de métastases
biomécaniques qui s’est emparé des piliers et des coupoles, recouvrant tout, et y compris leurs
propres clones virtuels. ».
« métastases biomécaniques », « clones virtuels », ne sont pas adjectifs qualificatifs
témoignant d’une métaphore. Mais ils participent à la création de la poétique de Dantec, dans
la mesure où l’on retrouve ce mélange de lexiques à nouveau. Cette fois ci, il ne s’agit pas
d’un mixte avec la littérature et la science, mais de deux lexiques scientifiques. « Métastases
biomécanique », dont « biomécanique » est l’épithète de « métastases » est un patron
syntaxique qui témoigne du mixte entre le lexique de la science de l’ingénierie médicale
(« biomécanique ») et de la médecine « métastase ». Il en va de même pour « clone virtuels »
qui associe le mot « clone », appartenant au lexique de la science dure avec le mot « virtuel »,
appartenant aux sciences de l’informatique.
Enfin, et ce n’est pas des moindres, arrêtons nous un instant sur ceci, page 173
de la Sirène rouge :
« Urbanisme cyberpunk, déjà, fin de vingtième siècle, tout simplement...Rodéo luminescent et
métallique de voitures, comme des créatures sauvages lancées sur les pistes de béton,
territoires noir et jaune, à la signification mystérieuse. Lettres blanches frappées de plein fouet
par les phares. »
« urbanisme cyberpunk » est un syntagme dont « urbanisme » est le sujet et
« cyberpunk » sont épithète. Cette occurrence témoigne d’un phénomène sémantique
intéressant. En effet, « l’urbanisme », soit l’ « ensemble des sciences, des techniques et des
arts relatifs à l'organisation et à l'aménagement des espaces urbains, en vue d'assurer le bien-
être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement »63 est lié
syntaxiquement avec « cyberpunk », courant culturel largement initié par Wiliam Gibson avec
le Neuromancien64 et annoncé par Philip K. Dick dans plusieurs de ses ouvrages, notamment
62 Maurice G. Dantec, Les Racines du mal, op.cit, page 684.63 TLFI.64 Wiliam Gibson, Le Neuromancien, Paris, J’ai lu, 2001
39
Blade Runner65.Le « cyberpunk » est un courant culturel de révolte (d’où la référence au
courant socio-musical « punk ») dans un futur proche dominé par la technologie, (d’où le
terme de « cyber »), les corporation et où le hacker survit dans un monde où le complot est
monnaie courante ». Le « cyberpunk» est avant tout un courant littéraire, graphique,
cinématographique, qui a trait aux mangas et à l’animé, ainsi qu’au jeu vidéo. Sa mise en
relation d’un point de vue sémantique n’est pas évidente. Ainsi, dire qu’un « urbanisme » est
« cyberpunk », les lier de manière syntaxique par la relation nom et adjectif épithète lié, et
donc le lier de manière sémantique, c’est élargir leur champ d’acceptions. C’est utiliser et
leur donner une nouvelle définition à chacun des termes par leur association surprenante.
L’étude des adjectifs qualificatifs a permis de mettre en lumière des
phénomènes sémantiques et syntaxiques intéressants. De prime abord, nous avons constaté
qu’en effet, l’adjectif qualificatif pouvait être utilisé dans la construction de métaphores.
Songeons à « gaz azur » ou « symphonie mécanique ». Dans un deuxième temps, avons-nous
constaté que la poétique de Dantec, notamment avec ses métaphore, se caractérise par une
construction syntaxique avec deux termes dont l’étude sémantique prouve qu’ils
appartiennent à deux lexiques différents. Nous avons remarqué qu’il s’agit un mixte entre la
littérature et la science. Il arrive parfois que la métaphore se caractérise aussi par une
métaphore dont la sémantique a une teneur seulement scientifique, telle l’occurrence
« radiation violement visible ». Enfin, en dernier lieu, avons-nous constaté que la poétique de
Dantec s’incarne également avec des patrons syntaxiques construits avec des termes
appartenant, non pas cette fois-ci aux science et à la littérature, mais à deux sciences dures
différentes, telle « métastases biomécaniques », qui se rejoignent dans la construction
syntaxique en un mixte sémantique de deux lexiques. Tout ceci concernait l’adjectif
qualificatif. Mais en va-t-il de même pour l’adjectif relationnel ?
B) L’utilisation de l’adjectif relationnel
L’adjectif qualificatif et l’adjectif de relation sont différent. En effet :
Les {...} adjectifs relationnels {...} expriment non pas une propriété intrinsèque maisune propriété définie relativement à un autre élément et peuvent être paraphrasé parun complément prépositionnel.
65 Philipe K. Dick Blade Runner, Paris, J’ai lu, 2001
40
Il convient d’opposer ces deux types d’adjectifs, dont le fonctionnement est trèsdifférent. Les adjectifs de relation, parfois appelés pseudo adjectifs, ont en effet laparticularité de ne pas pouvoir répondre à toutes les propriétés habituellementreconnues aux adjectifs qualificatifs. L’adjectif de relation {...} possède laparticularité de se souder avec le nom pour former une nouvelle appellation, à lalimite du nom composé. Tandis que l’adjectif qualificatif exprime une propriétéintrinsèque du nom qu’il précise, l’adjectif de relation met en rapport deux notionsdistinctes. L’adjectif de relation constitue donc une classe à part. S’il conserve lamorphologie d’adjectif (il est soumis à l’accord), il en perd certaines propriétéssyntaxiques, ce que marquent les traits suivants qui l’opposent aux adjectifs : il nepeut être ni attribut ni épithète détachée, il ne peut-être que postposé au nom aveclequel il constitue un ensemble soudé ; aucun adjectif ne peut venir s’y intercaler, iln’est pas modifiable en degré et n’étant pas sur le même plan logique que l’adjectifqualificatif, il ne peut lui être coordonné. 66
Le patron syntaxique formé à partir de l’adjectif relationnel est finalement peu
présent dans les trois oeuvres étudiées. Il peut, toutefois et dans certains cas, témoigner de
métaphores puissantes, propres au style de Dantec, et incarner sa poétique frappée du sceau de
la science-fiction et du lexique de la science dure. Observons la page 398 des Racines du
mal :
« La neuromatrice gronde, grogne, crisse, feule, rugit, halète, dans une symphonie digitale,
polyphonie hybride, aux voix se brouillant les unes aux autres, indistinctes, nuages verbaux
délités dès qu’apparus par un chaos sonore électrique ».
« nuages verbaux » met en évidence la nature de « verbaux » comme étant un adjectif
relationnel. Il présente toutes les qualités inhérentes à cette nature grammaticale. En effet,
« verbaux » entretien un rapport très étroit avec le substantif « nuages ». Il ne peut être ni
attribut ni épithète détachée, il ne peut-être que postposé au nom avec lequel il constitue un
ensemble soudé ; aucun adjectif ne peut venir s’y intercaler, il n’est pas modifiable en degré et
n’étant pas sur le même plan logique que l’adjectif qualificatif, il ne peut lui être coordonné.
« nuages verbaux » est un syntagme dont « nuage » utilisé par analogie dans la langue
français en « ce qui forme un amas comparable à l'aspect et à la couleur des nuages. »67,
comme par exemple le lexique mathématique qui traite de « Nuage de points »68. L’étude
sémantique de cette occurrence démontre donc que « nuages verbaux » est tout comme un
« nuage de point » sur une abscisse et une ordonnée. Mais c’est aussi un mélange de « voix »
qui donc se « brouillent », et qui par analogie va former un amas « comparable à l’aspect des
nuages ». Proche de l’utilisation métaphorique du « brouillard, » ces « nuages verbaux » sont
66 D. Denis et A. Sancier-Chateau, Grammaire du français, Paris, le livre de poche, 1994, page 3.67 TLFI.68 Ibid.
41
« indistincts ». C’est une apparition chaotique, éphémère, une métaphore désignant des voix
brouillées par l’électronique et ses aléas.
Autre occurrence remarquable quant à cette étude sur les adjectifs de relation,
page 668 des Racines du mal :
« {...}Mais un événement plus puissant encore que mon orage cérébral{...} »
« orage cérébral » met en évidence la nature de « cérébral » comme étant un adjectif
relationnel, tout comme l’occurrence précédente. Mais le syntagme « orage cérébral »
témoigne de plusieurs choses est le vecteur d’un phénomène sémantique notable. En premier
lieu, les deux termes sont proches syntaxiquement. En effet, l’ « orage », phénomène
météorologique et de nature électrique se définit ainsi : « Perturbation atmosphérique
caractérisée par des phénomènes électriques (tonnerre, éclairs, foudre) et généralement
accompagnés de fortes précipitations (pluie, grêle) ainsi que de rafales de vent. »69, qui par
analogie va être « synonyme de tempête »70 ou encore des « trouble, agitation d'origine
diverse affectant une ou plusieurs personnes, une collectivité. »71 En troisième lieu, quant au
cerveau, à l’aspect « cérébral » :
Le cerveau repose sur des courants électriques qui permettent de coder puisvéhiculer l’information {...} Le cerveau est constitué de cellules {...} elle mêmestraversées par un courant électrique, c’est l’influx nerveux. Il va se propager le longdes prolongements cellulaires, comme le long d’un fil électrique, et être transmis àd’autres cellules, grâce à une jonction particulière la synapse. C’est une zoned’interface entre deux neurones à la surface desquels la membrane est poreusepermettant des échanges d’ions, sodium, potassium, chlore par exemple. Des régionsentières de notre cerveau se mettent à produire ces courants électriques, génèrent despotentiels d’action, c’est-à-dire des impulsions électriques qui se propagent etpermettent de lire, écrire, parler etc... des modifications électriques sont donc à labase même du fonctionnement de toutes nos activités cérébrales, couplées à desmodifications chimiques, humorales ou hormonales. »72
Certains phénomènes cérébraux sont donc par nature électriques. Il y a donc, premièrement un
lien entre les deux termes via leur nature. Se crée donc ensuite une analogie entre « cérébral »
et « orage ». En ce sens, comment ne pas penser à l’emprunt « Brainstorming » (tempête du
cerveau) ? La ressemblance lexicale avec « orage cérébral » est frappante. Ainsi le syntagme
« orage cérébral » est une construction lexicale faisant appel au lexique médical et
scientifique, un syntagme proche de l’anglais “brainstorming“ et une métaphore illustrant le
69 Ibid.70 Ibid.71 Ibid.72 Yehezkel Ben Ari, Philippe Coubes, L’électricité : son implication dans le fonctionnement du cerveau et dansles soins, Paris, Neurodon, 2002, page 1.
42
bouillonnement de la pensée. Le syntagme page 7 de Babylon Babies est un exemple de ce
type : « métal salvateur ».
« métal » se définit ainsi : « Corps simple, bon conducteur de la chaleur et de l'électricité,
libérant des cations et donnant des oxydes généralement basiques par combinaison avec
l'oxygène et doué d'un éclat souvent brillant »73, et ainsi l’on tentera de comprendre en quoi,
au vu de la définition stricto sensu, ce « métal » peut-être salvateur, si ce n’est là une
métaphore de la balle. Nous verrons l’occurrence le « métal de la douleur » qui renvoie à ceci.
Une fois de plus la poétique de Dantec se caractérise par une utilisation spécifique dans la
syntaxe et la sémantique, en l’occurrence, une tension sémantique et une utilisation récurrente
du lexique de la science dure et de l’industrie pour métaphoriser un phénomène bien précis.
Bien que minoritaire dans le relevé, l’adjectif relationnel est un acteur
important de la poétique de Dantec. Le lien créé entre les deux termes, un lien syntaxique
puissant, permet la création de métaphores dont le lexique appartient aux sciences dures. La
conclusion est donc sans appel. Grâce au lexique des sciences dures, Dantec utilise les outils
grammaticaux du français tout en s’inspirant des patrons syntaxiques de la langue anglaise
afin de créer sa poétique très science-fiction incarnée par ces métaphores si particulières.
L’adjectif, qu’il soit relationnel ou qualificatif a donc un rôle crucial dans la
stylistique et la poétique de l’auteur. Il est un outil de création métaphorique et un acteur
important de la notion d’écriture dite relevant du genre de la science-fiction. Plus encore,
l’étude des partons syntaxique de l’adjectif a permis de comprendre comment la valeur
littéraire de la science-fiction est créée. Il aura fallu se pencher sur des occurrences montrant
que Dantec mélange les lexiques pour faire sa poétique. Trois schémas se distinguent : celui
de la littérature et de la science dure, celui de la science dure avec un autre domaine de
science dure et celui de la métaphore par le biais d’un seul lexique de la science dure. C’est
autour de ces schémas que le patron syntaxique de l’adjectif permet l’élaboration de
métaphores et de dénominations propres à Dantec. A présent, après avoir étudié les
phénomènes syntaxiques et sémantiques inhérent à l’adjectif qualificatif et relationnel,
observons ce qu’il en est avec le patron syntaxique phare de la métaphore : la construction
syntaxique avec le substantif.
73 TLFI.
43
2) La construction syntaxique avec le substantif: La clef de voûte
de la métaphore.
Si l’adjectif avait son rôle à jouer dans la stylistique Dantec, il ne fait pas
oublier que la métaphore, en français se manifeste souvent dans au travers du patron
syntaxique type : celui avec le nom. Il y a plusieurs patrons de ce genre. Le premier est un
patron fondé sur l’utilisation de deux substantifs en apposition ; le second, très classique
quant à la métaphore, est l’utilisation d’un substantif et d’un complément du nom ; en un
troisième temps, il se sera enfin nécessaire d’étudier quelques cas bien précis et bien à part.
La construction autour du substantif est donc cruciale afin de bien cerner comment dans la
syntaxe et la sémantique se créer la poétique de Dantec, poétique relevant du genre de la
science-fiction. Les néologismes ne sont pas au programme, il s’agira de comprendre et
d’étudier des relevés bien précis : ceux qui témoignent de la stylistique de la science-fiction,
et donc de l’auteur. Il s’agira donc de comprendre aussi comment Dantec s’approprie le genre
de la science-fiction pour créer une poétique relevant dudit genre, mais également propre à
lui-même, et enfin de cerner comment cela s’organise à l’échelle syntaxique et sémantique.
A) L’utilisation de deux substantif en apposition.
Nous avions précisé que Dantec utilisait parfois deux substantif en apposition.
C’est une réalité syntaxique que nous retrouvons page 99 de Babylon Babies :
« La pluie tombait par conteneur, dans une succession de flashes polaroïds géants, et sous la
canonnade du tonnerre. »
« flashes polaroïds » est l’association syntaxique et sémantique du terme « flashes » et du
nom propre « polaroïd ». « Flash » est un « Éclair d'origine chimique ou électronique destiné
à illuminer vivement un sujet que l'on veut photographier en l'absence d'une lumière naturelle
suffisant »74 et Polaroïd est une marque d’appareil photo. L’on pourrait donc supposer que la
phrase désigne le flash d’un Polaroïd. Mais l’utilisation du terme au pluriel pour la marque
« polaroïds » et le fait qu’il n’y ait plus de majuscule montre une volonté de transformer ce
74 TLFI.
44
terme en nom commun. Les « flashes » ne sont, au regard du contexte et de la transformation
de « polaroïds » nom commun, bien évidemment pas des flashes d’appareil photo. C’est une
métaphore désignant des éclairs. Il est intéressant de noter que même un phénomène naturel
est métaphorisé par le biais d’un outil humain et totalement artificiel. La stylistique de
Dantec, dans cette construction syntaxique et au regard de l’étude sémantique, prouve qu’au
delà de l’insertion du lexique scientifique dans la construction stylistique de la phrase, l’on
découvre que la métaphore est construite autour de termes propres à l’industrie, propres à
l’homme. La nature au sens de ce qui est naturel et donc non artificiel est masqué et
métaphorisé par ce qui est artificiel et humain.
Le patron syntaxique formé autour de deux substantif en apposition n’est donc,
au regard du relevé des occurrences, pas si fréquent. Il est pourtant vecteur d’un fait d’écriture
récurrent chez Dantec : la création d’une poétique à partir de la métaphorisation du naturel par
le technique, l’artificiel. A présent, étudions ce qu’il advient avec le patron nom et
complément du nom.
B) L’utilisation du nom et du complément du nom
La métaphore, figure de style très classique dans la littérature est caractérisée
en syntaxe par le patron syntaxique du nom et du complément du nom. Nous définirons les
compléments en ce sens :
« A la différence de certains compléments du verbe, les compléments du nom sont
facultatifs- même si leur suppression entraîne parfois dans changements de sens dans
l’énoncé. Leur rôle est de modifier le nom, en délimitant leur extension, c’est à dire en
spécifiant son domaine d’application. »75 Au-delà de cet aspect purement syntaxique, gardons
à l’esprit que nous allons étudier comment, grâce au patron syntaxique du nom et du
complément du nom, propre entre autre à la métaphore, Dantec crée sa poétique au style
relevant du genre de la science-fiction. Comment la notion d’écriture de science-fiction va-t-
elle se caractériser dans ce patron ; exactement, comment l’écriture de Dantec va s’approprier
les critères du genre pour devenir une poétique novatrice. En ce sens, la sémantique sera un
75 D. Denis et A. Sancier-Chateau, Grammaire du français, op.cit, page 355.
45
outil précieux pour éclairer cette étude. En parlant de réappropriation, d’ailleurs, penchons
nous sur le titre de l’un des oeuvres :
« Les Racines du mal » est un patron syntaxique formé avec le substantif « racines » ainsi que
son déterminant pluriel défini « les » dont le complément du nom « mal » à valeur de
possession est introduit par la préposition « du ».
« Les Racines du mal » est une proposition qui soulève des points intéressant quant à une
approche sémantique. En effet, « les racines » de quelque chose est une tournure idiomatique
qui se définit ainsi au singulier : « Origine, principe »76, « Avoir sa racine dans »77, « Avoir
son origine dans »78, « Être à la racine de »79, « être à l'origine de »80, mais au pluriel sont
également une « attache, lien profond »81. L’étude de la proposition « les Racines du mal »
démontre que ce syntagme est en réalité une reprise de l’expression type « purger le mal à sa
racine », il s’agit donc de traiter de l’origine du mal. De plus, Les Racines du mal fait bien
évidemment écho aux Fleurs du mal. Comme nous le voyons, remplacer le
substantif « fleur » par « racines » a le double avantage de faire écho à l’oeuvre de Baudelaire
tout en détournant l’expression figée. C’est donc le nom, et non le complément du nom qui est
ici changé pour aboutir cette réappropriation littéraire. Le complément du nom reste le même
et sert de pivot. Ce phénomène est particulièrement intéressant, mais il conviendra de noter
que, bien qu’il soit notable d’un point de vue syntaxique, sémantique et stylistique, ne relève
finalement pas de notre étude. En effet, gardons à l’esprit qu’il s’agit pour nous de pister ce
que signifie écrire de la science-fiction chez Dantec. Or nous le voyons clairement dans cette
introduction, il ne faudra pas s’arrêter à toutes les métaphores construites autour du patron
nom et complément du nom. Commençons donc l’étude des relevés pertinents quant à notre
approche avec le page 99 des Babylon Babies :
1- Syntaxe et sémantique des figures de styles
« La pluie tombait par conteneur, dans une succession de flashes polaroïds
géants, et sous la canonnade du tonnerre. »
76 TLFI.77 Ibid.78 Ibid.79 Ibid.80 Ibid.81 Ibid.
46
« canonnade du tonnerre » est un patron syntaxique formé avec le substantif « canonnade »
dont le complément du nom à valeur de possession « tonnerre » est introduit par la préposition
« du ». Il est clair que cette métaphore de l’orage se fait l’écho d’un fait d’écriture intéressant
chez Dantec, de surcroît récurrent. La métaphorisation du monde naturel, de ce qui ne relève
pas de l’homme, ici l’orage, se fait par l’insertion d’un lexique propre à l’homme, artificiel et
en cette occurrence, le feu du canon, la « canonnades ». La poétique de Dantec s’illustre donc
par la métaphorisation de la nature par l’artificiel et l’insertion du vocabulaire de la guerre.
Nous avions précédemment constaté l’importante présence du vocable scientifique et des
sciences dures ainsi que de la technique, nous constatons à présent la présence du lexique de
la guerre. Et quelle désolation ! Observons la page 327 de Babylon Babies :
Le matin venu, Toorop s’était levé avec un drôle de goût dans la bouche. Un goût derouille et de cendre, déposé sur sa langue comme le sédiment d’un fleuve ayantprécédemment érodé les ruines d’une vile détruite. Il s’était avalé d’un trait unecanette de Coca-Cola glacé. Le liquide froid, gazeux et acide avait fait pétiller unmillion de papilles encroûtées dans la gangue d’un rêve obscur, à l’odeur dedésolation.
« odeur de désolation » est un patron syntaxique formé avec le substantif « désolation » dont
le complément du nom à valeur de propriété « tonnerre » est introduit par la préposition
« de ». C’est une figure de style intéressant dans la mesure où ce n’est pas une métaphore.
L’association de « désolation » et de « odeur » d’un point de vue syntaxique ne pose pas de
problèmes. Il est néanmoins presque juste d’un point de vue sémantique. Ces deux termes
s’associent étrangement. La poétique de Dantec naît et s’illustre dans cette légère tension
sémantique entre un sens, « l’odeur », et un état de fait, la « désolation ». La science-fiction se
caractérise certes par l’introduction de termes de la science et de la technique autant d’un
point de vue morphologique que syntaxique et sémantique. Mais parce qu’elle incarne le futur
et que les visions poétiques de l’auteur s’expriment ici par la « désolation » dans la syntaxe, il
convient d’intégrer le lexique de la destruction comme un lexique de la science-fiction. Il
suffit d’ailleurs de songer à Matheson82 pour penser la désolation comme un état de fait ce
genre littéraire.
Quelques exemples viennent aussi illustrer l’idée que le patron syntaxique de
nom et complément du nom puisse être l’outil cette fois-ci plus précisément du feu.
Regardons la page 726 des Racines du mal :
82 Richard Matheson, Je suis une légende, Paris, Gallimard, collection « Folio SF », 2001.
47
« La vague fut atrocement réelle. Je l’ai perçue comme un dragon de feu, à l’odeur toxique et
épouvantable, une créature tchernobylienne qui me dominait et me donna la force d’agir ».
« dragon de feu » est un patron syntaxiques formé avec le substantif « dragon », dont le
complément du nom à valeur qualificative « feu » est introduit par la préposition « de ».
« Dragon de feu » illustre un phénomène sémantique intéressant. « Dragon » est dans le
lexique mythique et légendaire, un « Monstre fabuleux qu'on représente généralement avec
des griffes de lion, des ailes d'aigle et une queue de saurien. »83. Ici, le syntagme « Dragon de
feu » est composé d’un substantif « Dragon » suivit de son complément du nom à valeur
qualificative « feu » et introduit par la préposition « de ». Or c’est inattendu, dans la mesure
où le dragon crache du feu, mais n’est pas « de feu ». La construction syntaxique se fait donc
l’écho d’un paradoxe sémantique.
De plus, si l’on suppute que « l’odeur toxique et épouvantable », est une périphrase du
souffre, force est de constater que ce fait rappelle la guerre, car le soufre était « autrefois,
utilisé comme moyen de défense »84, et le monde de l’industrie- donc des fourneaux et la
chimie : « Métalloïde solide (symbole « S », numéro atomique 16) friable, de couleur jaune,
sans saveur ni odeur, qui fond facilement, brûle avec une flamme bleue en exhalant des
vapeurs suffocantes (gaz sulfureux) »85 et au lexique du feu infernal de la Bible86 : «où le
soufre, en tant que matière inflammable, intervient dans le châtiment des impies ». 87 Enfin,
ces hypothèses quant à la compréhension sémantique de cette proposition trouvent écho dans
le syntagme « créature tchernobylienne ». La catastrophe de Tchernobyl, des ses radiations et
de ses morts par radiation nucléaire est une référence évidente au reste de la proposition. Le
terme de « créature » doit enfin être compris comme « Être engendré par l'homme »88, dans la
mesure où la catastrophe de Tchernobyl est d’origine humaine.
L’étude sémantique de cette proposition révèle donc des lexiques infernaux, nucléaire,
mythiques, bibliques et chimique. Mais le plus important est la notion de métaphorisation du
naturel par l’artificiel. Les pages 173 et 555/556 de la Sirène rouge illustrent ceci :
« La musique semblait faite pour l’univers de l’autoroute, ici dans la Ruhr »
83 TLFI.84 Ibid.85 Ibid.86 La Bible, Gallimard, (FolioPlus Classique), 2005,(Genèse, 19, 24.).87 TLFI.88 Ibid.
48
« L’univers de l’autoroute » est un syntagme qui s’exprime sémantiquement en le sens
d’ « environnement naturel, milieu physique »89 et de « système, ensemble d'objets abstraits
formant un tout harmonieusement organisé. »90, dans la mesure où le contexte se fait l’écho
d’un « milieu » d’autoroute et d’un « système » « abstrait » et « harmonieux ». L’autoroute
est devenu le référent physique.
« Sa colonne vertébrale devenait plus rigide qu’une barre d’acier trempé.{…}Que rien ne
pourrait plus arrêter la séquence qui se profilait à l’horizon de toutes prochaines secondes{...}
Il sentit ses derniers composants de sécurité fondre, comme du silicium sous la flamme{…} ».
Le syntagme « composants de sécurité » appartient au lexique de l’industrie, de la mécanique
et de l’informatique. La référence au « silicium », (« métalloïde du groupe du carbone, très
répandu dans la nature en combinaison, cristallisant en aiguilles brillantes, octaédriques, d'un
gris foncé, ou bien se présentant sous un état amorphe en une poudre brune brillante »91),
appartenant au lexique de la chimie, vient appuyer cette idée que l’industrie, la mécanique et
l’informatique sont des lexiques utilisé dans la poétique de Dantec A noter que le silicium est
un composant essentiel des ordinateurs. Ainsi, la phrase type, « je sens mes résistances
céder » est détournée grâce à la métaphore mécanique et industrielle, chimique et
informatique pour devenir : « Il sentit ses derniers composants de sécurité fondre ». Une fois
de plus l’auteur conserve la valeur sémantique du syntagme, mais change le lexique utilisé
pour le remplacer par celui des sciences dures et de l’industrie. Ainsi se construit, entre autres,
les figures de style chez Dantec.
2- Des tensions sémantiques dans la construction syntaxique
Il apparaît également qu’il puisse naître une tension dans les schémas
syntaxico-sémantique. Le page 18 de Babylon Babies en témoigne :
« Un beau visage mandchou vingt ans, pas plus, les yeux vitreux s’interrogant pour toujours
sur la fragilité de l’existence face au métal de la douleur. »
« métal de la douleur » est un patron syntaxique formé avec le substantif « métal » dont le
complément du nom à valeur de propriété « douleur » est introduit par la préposition « de » et
le déterminant féminin « la ». « Métal » se définit ainsi : « Corps simple, bon conducteur de
89 TLFI.90 Ibid.91 Ibid.
49
la chaleur et de l'électricité, libérant des cations et donnant des oxydes généralement basiques
par combinaison avec l'oxygène et doué d'un éclat souvent brillant ». D’un point de vue
sémantique, il est vrai que la phrase type préfère « douleur du métal », l’on peut donc
raisonnablement supputer que ce syntagme est aussi une métaphore pour qualifier la balle
d’une arme à feu. Ce retournement syntaxique est toutefois intéressant. Le syntagme montre
donc que, au regard de la phrase type qui serait “la douleur du métal“, le complément du nom
et le nom ont inversé leur place. Cette astuce syntaxique a donc des conséquences
sémantiques et donc stylistique. Le « métal » passé en position de nom prend de la puissance
au détriment de « douleur » renvoyé au statut de complément du nom. Le « métal », l’artificiel
a donc une place plus importante dans la syntaxe, dans la sémantique et donc la stylistique de
cette phrase. Cette étude montre donc une fois de plus la prééminence de l’artificiel sur le
naturel dans la construction syntaxique même. Le contexte, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une
balle, prouve aussi que la métaphore est en étroite relation avec le lexique de la guerre, de la
souffrance et de la désolation. D’autres tensions sont remarquables quant à notre approche.
Regardons la page 173 de Babylon Babies :
La musique semblait faite pour l’univers de l’autoroute, ici dans la Ruhr. Le tableaude bord, pure radiation. Compte tours et tachymètre, comme des codex fluos. Lestours de verre derrière la nuée orange du sodium, alors que les échangeurs sesuccédaient, vers Bohn et Cologne. La nuit, dôme noir et parfait, carbonique.Métronome de réverbères. Urbanisme cyberpunk, déjà, fin de vingtième siècle, toutsimplement...Rodéo luminescent et métallique de voitures, comme des créaturessauvages lancées sur les pistes de béton, territoires noir et jaune, à la significationmystérieuse. Lettres blanches frappées de plein fouet par les phares.
« Métronome de réverbères est un patron syntaxique formé avec le substantif
« métronome», dont le complément du nom à valeur partitive « réverbère » est introduit par la
préposition « de ». A noter que le terme « métronome » associé à un complément du nom à
valeur partitive, comme c’est le cas dans cette occurrence, n’est pas une formation sémantique
correcte. Le terme « Métronome » ne peut être employé par un complément du nom à valeur
partitive. Le « métronome » est un « petit instrument d'étude, à pendule, réglable, servant à
marquer la mesure, afin que le morceau de musique ou le passage étudié soit exécuté en
rythme et à la vitesse voulue. »92 et ne saurait tolérer un complément du nom à valeur
partitive, comme nous l’avons vu. Or «réverbères » et sa préposition « de » se comportent
comme tel. Le terme de « métronome » et sa fonction grammaticale sont utilisés de manière
plus large, et les « réverbères », qui est une « Colonne métallique supportant une lampe 92 TLFI.
50
servant à l'éclairage des rues »93 comme unité de comptage. Il y a donc un véritable sabotage
poétique des codes syntaxiques et de l’organisation sémantique de la phrase. C’est peut-être,
au même titre que les formations de différentes mixtes de lexique étudiés précédemment,
l’une des clefs de la compréhension de la poétique de Dantec.
Il en va de même page 61 de Babylon Babies :
Il avait observé la face blafarde, lunaire, cette peau d’albinos grêlée de taches brunescomme des cratères laissés à la surface d’un astre mort, puis les stéréoptiques depointe qui donnaient redonnaient vie à des yeux détruits par la guerre des annéesauparavant, et enfin les lèvres pâles et fines comme des lames de ciseauxchirurgicaux se retroussant sur une dentition de céramique d’un blanc publicitaire,sertissant l’éclat jaune d’une vieille canine coulée dans l’or pur. Une espèce de fauvedont les veines charriaient de la glace. L’ours blanc des terres froides.
« dentition de céramique » est un patron syntaxique formé avec le substantif « dentition »
dont le complément du nom à valeur qualificative « céramique » est introduit par la
préposition « de » . « dentition de céramique d’un blanc publicitaire, sertissant l’éclat jaune
d’une vieille canine coulée dans l’or pur » : ce syntagme est intéressant et reflète une tension
sémantique puisque le verbe « sertir » se définit ainsi : « Fixer une pierre précieuse dans un
chaton ou une monture dont on rabat le rebord autour de la pierre »94. C’est donc
normalement la « vieille canine coulée dans l’or pur » qui devrait sertir la « dentition de
céramique d’un blanc publicitaire », et non l’inverse. Il y a donc une valorisation d’un point
de vue sémantique de la « dentition de céramique d’un blanc publicitaire ». La poétique de
Dantec se caractérise donc par une réappropriation des codes syntaxiques et sémantiques du
français, notamment lorsqu’il s’agit de créer des effets littéraires.
Le patron syntaxique du nom et de son complément sont donc des outils
indispensables quant à la création de figure de style telles la métaphore. La science-fiction n’y
échappant pas, nous avons observé comment la poétique de Dantec s’en emparait. Nous avons
donc relevé des métaphores en rapport avec la guerre et l’industrie et moins, contrairement
aux néologismes de références aux sciences dure. La partie syntaxique et stylistique se
concentrant finalement plus sur l’industrie et le chargeur de fusil. Nous observons également
que le naturel est fortement métaphorisé par l’artificiel, que c’est “l’homo industrium“ qui
principalement mise en scène. Enfin, il aura été plus qu’important d’étudier ces étranges
93 TLFI.94 Ibid.
51
constructions en tension avec la syntaxe et la sémantique, constructions qui inversent nom et
complément du nom (« métal de la douleur»). Ces cas spécifiques apportent leur lumière
quant cerner le style poétique de l’auteur. En parlant de cas spécifiques, il est à présent temps
de se concentrer sur les cas isolés et ambigus soulevé par l’étude.
3) Des cas isolés et ambigus.
Il existe des occurrences qui entretiennent une certaine ambiguïté
syntaxique ou sémantique. Nous l’avons vu, certains cas se faisaient l’illustration d’une
tension syntaxique (« Métronome de réverbères »), ce qui entraînait des interrogations quant à
l’approche sémantique du syntagme. Mais aucune de ces occurrences ne présentait une
interrogation dans le terme même, c’est-à-dire à savoir quelle est la nature même du terme et
donc quelle interprétation grammaticale faudra-t-il, en conséquence, suivre. L’on retrouvera
également des occurrences tout à fait ambivalentes quant à leur interprétation sémantique,
d’autres la limite du français. Ces cas isolés et ambigus pourraient être accusé de ne pas être
révélateur d’un fait d’écriture global. C’est une erreur. Nous avons vu durant notre étude que
quelques occurrences, bien que minoritaires, venaient apporter leur pierre à l’édifice de la
stylistique de Dantec tout en appuyant certain faits syntaxique, sémantiques, et
morphologiques déjà repérés et analysés comme étant remarquables quant à notre étude, ou en
se caractérisant comme étant tout à fait unique. Ces éléments, dans leur originalité, doivent
être pris en compte. En effet, c’est leur unicité et leur caractère très spécifique qui leur interdit
d’être une norme courante de la poétique de l’auteur. Or ils sont bien, néanmoins, un vecteur
d’écriture de la science-fiction façon Dantec.
A) Une occurrence unique aux limites du français
La page 751 des Racines du mal témoigne d’une occurrence unique dans la
construction du syntagme. Elle est franchement à la limite du français.
« Il devint cette lumière chaleur sensation et il comprit qu’il était là pour embraser le
monde. »
En effet, l’absence de tirer démontre que cette occurrence n’est pas un mots valise ni un mot
composé. Mais nous avons vu que les tirets n’étaient pas les marqueurs suffisants pour
52
déterminer un mot composé. Pourtant, l’accumulation des trois termes (trois !), prouve qu’il
ne s’agit nullement d’une composition. Ce n’est pas une enclosure, puisqu’il n’y a ni
guillemet ni annonciateurs tels que « une sorte de » ou « comme une ». D’un point de vue
syntaxique et sémantique, c’est une véritable étrangeté. Quel est le rapport entre « lumière » et
« chaleur », par exemple. Est-ce que « lumière » est le substantif auquel « chaleur » serait
l’épithète rattachée ? Dans ce cas-là, que faire de « sensation » ? S’agit-il de deux noms
apposés ? Cet étrange syntagme énumératif de plusieurs termes indépendants, et nous le
comprendrons sous cet angle, vient appuyer cette hypothèse. L’écriture de Dantec, comme
nous l’avons constaté quelques fois, fait écho à la construction grammaticale anglaise. En
effet, la langue anglaise, particulièrement synthétique, ne souffre pas d’un manque de
déterminant ou d’autres liants syntaxiques entre les termes, manquant ici cruellement. Cette
occurrence apparaît donc comme une espèce de syntagme anglicisé.
Cette occurrence, unique en son genre, fait pourtant écho aux aspects
anglicisant précédemment repérée et analysés dans les parties précédentes. Il devient donc de
plus en plus certains et indéniable que la poétique de Dantec repose sur une syntaxe et une
sémantique parfois très proche de la construction grammaticale anglaise.
Ce n’est bien évidemment pas toujours le cas. Loin de là, nous observons en les occurrences
suivantes, de véritables ambivalences sémantiques.
B) Des ambivalences sémantiques
Nous retrouvons donc plusieurs occurrences relevées qui témoignent
d’ambivalences sémantiques, ce qui les classe nécessairement dans les cas ambigus et isolés
puisqu’ils ne sont pas des phénomènes systématiques de l’écriture de Dantec, mais bien des
cas minoritaires. Observons la page 651 des Racines du mal :
« J’ai tracé comme une bête de course, une machine »
« machine », lié avec « bête de course » pour définir les faits du personnage narrateur est
intéressant. « Machine (XIVes) emprunt au latin machina « invention, machination », « engin
de guerre » et aussi « structure de l’univers » et « ouvrage composé avec art », emprunté au
grec dorien makhana, « moyen (en général) », d’où « machine » est d’abord attesté dans le
53
syntagme machine corporelle, « ensemble d’éléments ayant la complexité d’une machine ».95
« machine » est en son sens premier « Objet fabriqué complexe capable de transformer une
forme d'énergie en une autre et, ou d'utiliser cette transformation pour produire un effet
donné, pour agir directement sur l'objet de travail afin de le modifier selon un but fixé »96,
mais en notre occurrence « machine » se définit comme « Personne considérée comme ayant
pour fonction essentielle d'effectuer, de produire quelque chose »97. En ce sens, sa « fonction
essentielle » est de tracer comme une bête de course. « Bête » peut également en son sens et
par analogie faire écho avec la « machine », tel « Un train, une locomotive »98. Par exemple :
« quand, après avoir dit adieu à nos deux amis Fritz et Luigi, nous sommes montés dans notre
wagon; on a fermé la portière, la bête de fer a renâclé comme un cheval qui piaffe, et nous
sommes partis. »99 écrivait Flaubert. Notons enfin que le syntagme « de course » vient
souligner ce sens direct avec « machine ». En ce sens, l’assimilation du “je“ narrateur à une
bête de course, puis, de surcroît, à une machine, vient appuyer l’hypothèse précédemment
émise comme quoi le naturel est remplacé de manière métaphorisé par l’artificiel. Petite
nuance, donc, ici en en cette occurrence, c’est le naturel et l’artificiel qui métaphorisent
ensemble les faits du “je“ narrateur. Nous voyons donc comment certains cas à part viennent
appuyer et nuancer les faits d’écriture récurrents chez l’auteur.
Une deuxième occurrence vient jouer l’ambivalence sémantique. Page 231 de la Sirène
rouge :
« La solution se cristallisa d’un seul coup. Une taupe. Un agent dormant »
« La solution se cristallisa d’un seul coup » est une proposition remarquable d’un point de vue
sémantique dans la mesure où « cristalliser », terme appartenant au lexique de la chimie,
désigne « Amener à l'état cristallin, transformer en cristaux », et que « solution », terme
appartenant également au lexique de la chimie, désigne une « action de dissoudre un corps,
une substance dans un solvant; processus par lequel s'élabore cette action »100. L’emploi
pronominal de « cristalliser » avec « se » est bien possible, mais pas dans le domaine de la
chimie. Il est juste dans le domaine littéraire « au figuré : se fixer, se concrétiser, devenir
95 Emmanuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la langue française,op.cit, page 462.96 TLFI.97 Ibid.98 Ibid.99 Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves, Paris, Pocket, 2002, p. 163.100 TLFI.
54
cohérent, sensible. »101. Ainsi Dantec opère, une fois de plus, un parfait mixte avec la phrase
type et le lexique des sciences dures. La « solution », terme ambivalent sémantiquement
puisqu’il désigne en contexte la solution à un problème, mais aussi la solution chimique, est
couplé au terme « cristallisé » qui possède donc deux sens, chimiques et littéraires, également,
donc, ambivalent sémantique. C’est la syntaxe qui trace la limite entre les deux lexiques
puisque l’emploi « se cristalliser » n’est pas possible en chimie. Cette occurrence est
remarquable puisque les termes sont véritablement à double face dans les lexiques de la
chimie et de la phrase type en français. Il ne s’agit pas exactement comme d’habitude
d’apposer des termes appartenant à des lexiques différents, mais bien cette fois ci, de jouer sur
les résonances sémantiques ambivalentes de ceux-ci. L’insertion du vocable scientifique,
rappelons le, est propre à la science-fiction.
L’étude de ces deux cas à la teneur sémantique ambivalente a permis de mettre
en lumière et de rappeler certains phénomènes d’écriture typiques de la poétique de Dantec.
Ils les rappellent lesdits phénomènes, de mixte de lexiques et d’insertion de l’artificiel dans le
naturel, mais les nuancent. Cette fois-ci il s’agit d’enchérir avec le naturel avec l’artificiel
(« une bête de course, une machine ») ou de jouer sur l’ambivalence des termes qui peuvent
appartenir à la fois au lexique scientifique et littéraire (« la solution se cristallisa d’un seul
coup ».). Mais au-delà de l’ambivalence sémantique, attachons nous cette fois-ci à étudier
une occurrence qui puisse être étudié de plusieurs manières selon la nature grammaticale
variable de ses termes.
C) Une occurrence résolument unique dans l’étude syntaxique.
C’est à la page 7 de Babylon Babies, l’incipt du roman, une vaste proposition
que l’on trouve syntagme paradoxal quant à une approche syntaxique.
Vivre était donc une expérience incroyable, où le plus beau jour de votre existencepouvait s’avérer le dernier, où coucher avec la mort vous garantissait de voir lematin suivant, et où quelques règles d’or s’imposaient avec constance : ne jamaismarcher dans le sens du vent, ne jamais tourner le dos à une fenêtre, ne jamaisdormir deux fois de suite au même endroit, rester toujours dans l’axe du soleil,
101 TLFI.
55
n’avoir confiance en rien ni personne, suspendre son souffle avec la perfection dumort vivant à l’instant de libérer le métal salvateur.
« mort vivant » est un patron syntaxique qui peut-être considéré de deux
manières. Premièrement « mort vivant » peut-être considéré comme un patron syntaxique
substantif avec adjectif. En effet, « mort » peut-être analysé comme un substantif dont
« vivant » serait l’adjectif qualificatif. Dans un second temps, pourrions-nous envisager la
perspective de ladite occurrence « mort vivant » non pas comme deux termes distinct, mais
comme une composition. En effet, « les mots de ce type présentent ou non un trait d’union.
C’est une caractéristique exclusivement graphique, en partie incohérente au regard du mode
de formation et qui ne doit en aucun cas être considéré comme la preuve de la composition.
Ce qui compte, c’est que dans tous les cas on a affaire à des syntagmes lexicalisés, à des
lexies102 », et donc « mort vivant » pourrait être une composition de « mort » et de « vivant »
dans la mesure où la mise en relief de ses éléments est impossible et qu’aucun de ses
composés ne peut-être déterminés séparément.
« mort vivant » est un cas ambigu est donc un cas ambigu d’un point de vue syntaxique. Or
cette tension syntaxique entraîne nécessairement une tension sémantique. D’un point de vue
sémantique, si le terme « mort vivant » est considéré, non pas comme deux termes distinct,
mais comme une composition, il se définit ainsi : « Personne qui paraît mort(e) ou semble sur
le point de mourir »103 ou comme un synonyme de « zombie ». Mais si le terme, par la
syntaxe, est défini comme un substantif et son adjectif, alors il s’agit là d’une relation
antithétique dans d’un point de vue sémantique dans la simple mesure où la « mort » est la
« cessation de la vie. »104 et où donc le substantif « mort » ne saurait être lié sémantiquement
à l’adjectif « vivant » sans être un paradoxe sémantique. A l’inverse, nous pourrions
également considérer que le « mort » était « vivant » au moment de « libérer le métal
salvateur ». Nous voyons donc combien l’ambiguïté syntaxique et donc sémantique pose des
questions d’ordre stylistique.
Ainsi, cette occurrence, bien qu’unique, révèle que la stylistique de Dantec
repos donc bien sur des jeu de tensions syntaxiques et sémantiques, de jeu de tensions
littéraire qui s’illustrent aussi bien par une syntaxe et une sémantique ambivalente, parfois
102 Joëlle Garde Tamines, La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1, op.cit, page 89.103 TLFI.104 Ibid.
56
paradoxales. Ces ambivalences et tensions reflètent donc une stylistique propre à Dantec, et
propre à la science-fiction, puisque ces constructions révèlent des faits de langues
précédemment étudiés typique du genre. L’on voit donc, au travers de l’étude syntaxique et
sémantique, comment l’auteur se réapproprie le genre.
Ces cas isolés et ambigus ont donc eu le mérite de réaffirmer certains faits
d’écriture de l’auteur tout en les nuançant. Songeons au fait que la poétique de Dantec repose
sur une syntaxe et une sémantique parfois très proche de la construction grammaticale
anglaise, ou bien encore les mixte de lexiques et d’insertion de l’artificiel dans le naturel,
même s’il s’agit d’enchérir avec le naturel avec l’artificiel, ou de jouer sur l’ambivalence des
termes qui peuvent appartenir à la fois au lexique scientifique et littéraire. La dernière étude
d’occurrence révèle, pour sa part, comment « mort vivant » peut-être compris de différente
manière. Ces cas isolés et ambigus sont donc des révélateurs, des objets de réaffirmation de
style, mais aussi des outils nuançant des faits d’écriture avérés. Ils sont des points de couleur
unique sur la peinture stylistique et poétique de l’écriture de Dantec, des moyens de mise en
valeur et de nuance.
L’étude de la syntaxe et de la sémantique a donc été d’une redoutable efficacité
quant à cerner ce qu’est l’écriture de Dantec, écriture s’inscrivant donc tant par son unicité et
sa ressemblance avec la science-fiction. Gardons donc en tête quelques éléments clefs
soulevés par la double analyse syntaxique et sémantique. L’étude de l’adjectif, qualificatif et
relationnel a démontré son importance dans le processus de création métaphorique et de
fondation de sa poétique. Trois schémas syntaxiques et sémantiques avaient été remarqués.
Trois schémas de mélange des lexiques que nous rappelons ici : mélange des lexiques de la
littérature et de la science dure, mélange de lexiques de différents domaines de la science dure
et métaphorisation d’un objet par le lexique d’un seul domaine de la science dure. Quoi qu’il
advienne, les métaphores de Dantec sont donc le résultat d’une symbiose de lexiques. En ce
sens, la sémantique de Dantec ouvre donc les portes d’une analyse de sa poétique et de sa
stylistique : c’est un mélange de lexiques, exactement de deux lexiques : littéraire et
scientifique. Le patron syntaxique du nom et du complément du nom, sous toutes ses formes,
avait révélé la prééminence du lexique de l’industrie, ainsi que la métaphorisation du naturel
par l’artificiel. Des lexiques du feu et de la guerre ont été également remarqués et analysés.
Quelques cas complexes et spécifiques permettent de mieux comprendre la création de cette
57
poétique qui joue avec la syntaxe, aussi bien en inversant complément du nom et nom
(« métal de la douleur »), mais qui joue aussi avec la sémantique. Certaines occurrences,
durant l’étude de cas uniques et ambigus, soulignent des traits récurrents d’écriture de Dantec
tout en les nuançant. Les mixtes de lexiques et la métaphorisation du naturel par l’artificiel, le
jeu lexical et sémantique avec la phrase type, tous ces procédés, y compris la proximité dans
la syntaxe et pour quelques occurrences avec l’anglais ont été soulignés et réitérés. Quelques
nuances ont pu toutefois être avancées. Pour une fois, l’on ne mélangeait pas, l’on
surenchérissait dans le rapport entre naturel et artificiel, pour une fois l’auteur ne
métaphorisait pas seulement, mais jouait sur l’ambivalence sémantique quant à la phrase type
et l’insertion du lexique scientifique.
Ainsi, si nous reprenions tout ce qui a été relevé et analysé quant à la compréhension de la
poétique de Dantec d’un point de vue morphologique, syntaxique et sémantique pourrions-
nous conclure qu’elle se caractérise en ce sens.
La poétique de Dantec est riche en néologismes, en étroit rapport avec les sciences
dures (espace, biologie, sciences neurologiques), le domaine du commerce et des entreprises ;
néologismes qui se caractérisent par leur métissage linguistique et leur proximité avec
l’anglais. La construction du mot nouveau dans la poétique Dantec n’est autre, donc, que
l’infiltration d’un vocable ayant trait à la science dure dans la morphologie du terme et ces,
sur des critères de formations attestés et reconnus en français moderne.
D’un point de vue syntaxique et sémantique, l’on remarque l’indiscutable insertion du lexique
des sciences dures et de l’industrie et plus périodiquement de la guerre et du feu. Par ailleurs,
nous notons un trait d’écriture absolument récurrent : la reprise de la phrase type avec des
termes issus du lexique propre aux sciences dures. De plus, il convient de garder à l’esprit cet
autre trait frappant : la métaphorisation du naturel par l’artificiel. Tout ceci est couplé avec
des jeux de tension quant la syntaxe, comme par exemple l’inversion du nom et du
complément du nom, et d’un important travail avec la sémantique, tant par des effets
d’ambivalence et de double sens que part des effet de tensions. Enfin, la syntaxe s’est révélée,
en certaines occasions, proche de l’anglais.
Ces éléments sont des faits avérés, des indices quant à la volonté de cerner la poétique de
l’auteur. Il manque toutefois une pièce dans cette analyse. En effet, comment envisager de
comprendre une poétique sans distinguer l’imaginaire révélé par l’étude morphologique,
syntaxique et sémantique ?
58
III) L’imaginaire de Dantec
Force est de le constater. Même durant les premiers pas de l’analyse, c’est-à-
dire durant l’analyse morphologique, nous avions été contraint de nous arrêter un instant sur
l’étude d’une morphologie en rapport avec une culture bien spécifique. La poétique doit
également se définir par la compréhension d’un imaginaire. Son imaginaire est en lien avec la
morphologie, la syntaxe et la sémantique puisqu’il est dégagé par ces aspects. Alors, comment
caractériser cet imaginaire ? Comme le définir ou le classer ? Il apparaît judicieux de diviser
cette étude en trois parties. Premièrement, attacherons-nous à comprendre que l’imaginaire de
Dantec est illustré par des thèmes tout à fait récurrents : Alice aux pays des Merveilles,105 vu
par Carroll ou Deleuze, le feu, et la science, la guerre et l’industries. Dans un deuxième
temps, nous nous pencherons sur l’intertexte mis en évidence par Dantec, en passant par
Breton, Miller ou Céline. Dans un dernier et troisième temps, sera-t-il très important, bien que
cette étude ne soit pas un dossier consacré à la littérature comparée, de se pencher brièvement
sur les références à la littérature anglophone de science-fiction.
1) Un imaginaire aux thèmes récurrents
L’imaginaire de Dantec est la somme de thèmes récurrents mis en évidence,
entres autres, par l’analyse morphosyntaxique ainsi que par l’analyse sémantique
d’occurrences remarquables. Ces grands thèmes récurrents se sont exprimés par le biais de
phénomènes morphologiques, syntaxiques et sémantiques que nous avons étudiés
précédemment. Ces phénomènes forment ensemble la poétique de Dantec, poétique qui est
exprimée au travers trois grands thèmes qui sont Alice, le feu et la suprématie de la science
dure couplée à un symbolisme tant philosophique et guerrier qu’industriel.
A) Alice
105 Lewis Carroll, Alice aux pays des merveilles, Paris, Gallimard (Folio Classique), 1994.
59
La poétique de Dantec se fait l’écho de l’élaboration d’un mythe ; de la mise en
valeur, de la création et de l’avènement de « surhommes »106, nietzschéens et rankiens, des
« archétypes »107 jungiens, comme Philip K Dick le concevait : « Dick voyait dans ses
personnages fantastiques autant d’archétypes jungiens »s108. Ainsi, Marie Zorn est la génitrice
d’une nouvelle espèce d’humains. A noter l’éradication de ceux qui tentent malheureusement
de s’élever (Eva Kirstensen) ou la sublimation de ceux qui l’atteignent, par le
suicide (Andreas Schaltzmann). En plus de cette conception psychanalytique, pourrions-nous
réfléchir un instant à la symbolique philosophique de la Sirène rouge, parabole du mythe
d’Alice au pays des Merveilles109, conte des plus importants aux yeux de Deleuze. En effet,
sans ambiguïté, nous pouvons avancer le fait que la protagoniste, Alice, porte son nom en
référence à Alice au pays de merveilles, de Lewis Carroll. Tout comme l’héroïne du conte,
Alice de la Sirène Rouge, est propulsée, seule dans un monde qui la dépasse et qui la fascine.
Un monde presque sous terrain puisque ignoble et chtonien en certains points (les assassinats
en série...). Enfin, c’est un monde où elle rencontre des monstres (sa mère/la dame de coeur),
ou des aides précieuses ( Toorop/ Le chapelier)...page 103 de la Sirène rouge
« Elle marchait déjà vers la caisse et la grande cafétéria, dans un travelling decinéma. Ses sens lui paraissaient décuplés. Elle pouvait percevoir la radiationultraviolette du béton, la vibration si particulière du néon jaune de la cafétéria, lescomposantes subtiles de la lumière, et aussi l’éventail neuf des sonorités quis’ouvrait dans ses oreilles.{...}Elle leva la tête et aperçut le visage d’Hugo à lapériphérie de sa vision, sa peau blanche comme celle d’un poisson des profondeur. Ilmarchait à ses côtés. Au-dessus d’elle le ciel était moucheté d’astres aux radiationsviolement visibles. Au-delà de l’autoroute, au-dessus d’une lande noire et sansforme, rien que des vagues nuances de ténèbres, le disque pâle de la lune se levait. »
Le monde dépeint, est urbain, propre au style de Dantec et la description des « radiations »
n’est pas sans rappeler les « super sens » de Marie Zorn dans Babylon Babies. Mais toutes ces
choses, à la frontière du surnaturel, dans un récit policier pourraient êtres aussi justifiés par le
fait qu’Alice entame un grand voyage initiatique inspiré de l’oeuvre de Carroll. En ce sens,
tout comme Alice n’est pas surprise de voir un lapin pressé et regarder sa montre à gousset,
Alice de la Sirène Rouge n’est pas surprise de ressentir « la radiation ultraviolette du béton ».
Enfin, ceci est justifié du fait que le monde de ce voyage, celui de la Sirène Rouge est
chtonien : « des profondeurs », « vagues nuances de ténèbres » tout comme l’univers d’Alice
106 Otto Rank, Le Mythe de la naissance du héros, Paris, Payot, 1983, page 30107 C-J, Jung, Psychologie de l’inconscient, Chêne- Bourg/Genève, Georg Editeur, 1993, page 161.108 Lawrence Sutin, Invasions divines, Philip K. Dick, une vie, Paris, Folio S-F, 1995, page 180.109 Lewis Carroll, Alice aux pays des merveilles, op. cit.
60
au Pays des Merveilles est sous terre. Mais bien au-delà de cet aspect purement formel, l’on
retrouve des références très claires à Deleuze. Ainsi la treizième série de la Logique du sens110
traite du « schizophrène et de la petite fille », thèmes très chers à Dantec :
On s’aperçoit qu’on a changé d’éléments, qu’on est entré dans une tempête. Oncroyait être parmi les petites filles et les enfants, on est déjà dans la folieirréversible. On croyait être à la pointe des recherches littéraires, dans la plus hauteinvention des langages et des mots ; on est déjà dans les débats d’une vie convulsive,dans la nuit d’une création pathologique concernant les corps111
Alice et le langage, la folie et la littérature, autant de thèmes Deleuziens repris
par Dantec. Sa poétique illustrée par la morphologie, la syntaxe et la sémantique permet cette
rémanence des thèmes philosophiques dans la mesure où « chaque moment du récit tend à
projeter un nouveau cadre générique, qui lui est propre selon un procès de restructuration {...}
où chaque segment de phrase ouvre sur une gamme de possibilités et d’incertitudes qui se
trouve ensuite réorientée en fonction du prochain choix à faire. »112. Notons enfin qu’Alice
aux pays des merveilles est un thème prisé du courant littéraire et culturel du cyberpunk :
« Knock knock Neo...Wake up Neo...The Matrix has you...Follow the white rabbit... »113
B) Le feu
Le feu est un thème crucial. Nous l’avons vu, le terme est très présent dans le
relevé des occurrences. C’est le feu sous toutes ses formes : comme phénomène physique,
nucléaire, solaire, électrique, comme feu bibliques et mythiques. C’est aussi le feu de la
guerre, celui de l’arme à feu, celui du bombardement, celui du feu grégeois. Mais c’est aussi
le feu des corps. Ainsi, page 668 des Racines du mal : « L’amour ressemble à s’y méprendre
au mécanisme des bombes atomiques, deux morceaux de matière fissile rassemblée
brusquement pour atteindre la masse critique ». Le feu du corps, le feu sexuel est donc aussi
une véritable clef de la compréhension de l’imaginaire de Dantec. Gaston Bachelard va en ce
sens en expliquant que : « {...} La conquête du feu est primitivement une conquête sexuelle,
on ne devra pas s’étonner que le feu soit resté si longtemps et si fortement sexualisé. »114.
L’imaginaire de Dantec rentre donc en résonance avec cette perception sous jacente,
110 Gilles Deleuze, Logique du sens, Paris, Les Editions de Minuit, 1969.111 Ibid., page 101.112 Frederic Jameson, Penser avec la science-fiction, Paris, Max Milo, l’Inconnu, 2008, page 137.113 Andy et Larry Wachowski, Matrix (The Matrix), 1999.114 Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, (Folio essais), 1949, page 81.
61
inconsciente et primitive du feu. Le feu, chez Dantec, nous l’avons dit, est celui du feu
purificateur. Du feu biblique et mythique, page 687, des Racines du mal « En une
microseconde, la créature solaire a envahi leur système. Leur univers pseudo-minoen a subi
l’assaut fulgurant d’une jungle proliférante, un réseau de métastase bio mécanique qui s’est
emparé des piliers et des coupoles, recouvrant tout, et y compris leurs propres clones
virtuels. ». C’est le feu du dieu ; page 749 des Racines du mal : « Nos rêves sont des livres de
feu », d’un dieu et de son Livre et d’un dieu qui châtie les impurs sous la forme d’une bête :
page 726 des Racines du mal : « La vague fut atrocement réelle. Je l’ai perçue comme un
dragon de feu, à l’odeur toxique et épouvantable, une créature tchernobylienne qui me
dominait et me donnait la force d’agir. ».... C’est à quelque chose près le feu du Dieu de
l’Ancien Testament, celui qui anéantit Sodome et Gomorrhe.115 Mais ce feu qui châtie peut
aussi châtier grâce à la technologie, page 291 de Babylon Babies : « souffrance lave
incandescente bain d’acide feu purifiant du fouet », ou n’être qu’un composant d’un
imaginaire technique, page 556 de la Sirène rouge : « Il sentit ses derniers composants de
sécurité fondre, comme du silicium sous la flamme{…} ». Enfin, n’oublions pas que
Schalztmann est un pyromane et que, ce n’est pas des moindres, la couverte des Racines des
mal116 n’est autre qu’une allumette enflammée.
C) Le tube à essai et le chargeur de fusil
1- Sciences dures et industries
Nous l’avons vu durant l’étude morphologique, notamment, la récurrence des
morphèmes préfixaux tels que : « neuro », « bio », « neo », « cosmo », et « cyber », a permis
de constater que la poétique de Dantec corrélait en grande partie avec la suprématie de la
science dure dans son lexique. La science dure qui s’exprime dans la morphologie, c’est-à-
dire par son lexique dans l’élaboration de néologisme, et dans la syntaxe et le sens de la
phrase. C’est une donnée intrinsèque de la poétique de Dantec. Elle en est une constituante
fondamentale. En effet, si Dantec construisait son imaginaire à partir de sciences dite
“molles“ , il aurait été plus que probable de retrouver des morphèmes préfixaux tels que
« anthropo », « socio », ou « philosophico... » or ce n’est pas le cas. L’imaginaire de Dantec
115 La Bible, op. cit, chapitre 18 et 19.116 Maurice G. Dantec, Les Racines du mal, op. cit, première de couverture.
62
se structure autour d’un lexique très précis, et donc d’un univers précis : celui de la science
dure. Même les quelques références anthropologiques citées par l’auteur restent étroitement
liées au domaine des sciences dures. Nous songeons à la référence à Jeremy Narby117, page
552 de Babylon Babies « Que connaissez vous du serpent cosmique, monsieur Toroop ? ». En
effet les études de Jeremy Narby, anthropologue, se focalisent sur l’ADN. De plus, l’on
retrouvera, notamment dans le patron syntaxique nom et complément du nom, une récurrence
du lexique industriel comme le syntagme, « composant de sécurité fondre », qui renvoyait au
« silicium sous la flamme ». Important également est le métaphorisation du naturel par
l’artificiel. L’industrie s’oppose radicalement au naturel.
Mais la puissance de Dantec est incarnée dans le « métal de la douleur »...donc aussi dans la
guerre, le symbolisme philosophique et guerrier.
2- Guerre et pensée philosophique
Arrêtons nous donc un instant sur la guerre, l’importance du sujet de la guerre
et des armes dans les trois oeuvres : page 324 de Babylon Babies : « Ca gueulait, ça
gémissait, contrepoint horriblement humain à la symphonie mécanique qui pilonnait l’univers
entier », ou encore, page 17 de la même oeuvre :
Vivre était donc une expérience incroyable, où le plus beau jour de votre existencepouvait s’avérer le dernier, où coucher avec la mort vous garantissait de voir lematin suivant, et où quelques règles d’or s’imposaient avec constance : ne jamaismarcher dans le sens du vent, ne jamais tourner le dos à une fenêtre, ne jamaisdormir deux fois de suite au même endroit, rester toujours dans l’axe du soleil,n’avoir confiance en rien ni personne, suspendre son souffle avec la perfection dumort vivant à l’instant de libérer le métal salvateur
Songeons donc à Sun Tzu cité page 16 de Babylon Babies, célèbre pour son traité sur L’Art
de la Guerre118. L’imaginaire guerrier de Dantec pourrait alors bien faire écho au Bushido que
Mishima a particulièrement analysé dans son Le Japon Moderne et l’Ethique du Samouraï.
Ainsi « Méditer quotidiennement sur la mort, c’est se concentrer quotidiennement sur la
vie. »119 La Psychanalyse du Guerrier de Claude Barrois explique que le soldat se bat
puisqu’il a « accepté l’idée de mourir »120. Tous ces éléments viennent corroborer la poétique
117 Jeremy Narby, Le Serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir, Paris, Terra Magna, 1995.118 Sun Tzu, L’Art de la guerre, Paris, Flammarion, (Champs) 1999.119 Yukio Mishima, Le Japon moderne et l’éthique du samouraï, Paris, Gallimard, Arcades, 198, page 66.120 Claude Barrois, Psychanalyse du guerrier, Paris, Hachette (Pluriel Intervention), 1993.
63
de Dantec qui métaphorise ces thèses avec le fait de « coucher avec la mort ». Si Dantec n’est
pas un historien, si sa démarche est une démarche littéraire poétique de la guerre et non une
démarche littéraire historique de la guerre, comme c’est le cas pour W.B Marsh et Bruce
Carrick121, force est de constater que l’auteur, à l’image des anciens Grecs, envisage « surtout
de composer un oeuvre remarquable pour ses qualités esthétiques et littéraires qui priment
pour eux sur l’exactitude, la précision ou la fidélité »122. Force est donc de constater la guerre
historique chez Dantec, notamment par la création de personnages fictifs guerriers, à mi
chemin entre l’archange et le soldat de Black Water («Toorop »).
L’imaginaire de Dantec est donc bel bien caractérisé par des thèmes récurrents,
que ce soit Alice, le feu, la science, l’industrie, la guerre, la philosophie guerrière. Ces traits
viennent appuyer l’étude morphologique, syntaxique et sémantique qui mettent en lumière des
traits d’écritures remarquables. Ces études combinées l’une à l’autre permettent de mieux
comprendre ce que signifie écrire de la science-fiction chez Dantec.
2) Un intertexte particulier
Mais il est aussi largement important de saisir l’intertexte dégagé par l’étude de
la morphologie, de la syntaxe et de la sémantique. L’imaginaire de Dantec doit également être
cerné grâce à l’intertexte, en sus des thèmes récurrents. Nous verrons les intertextes dégagés
suivants : ceux en liens avec l’écriture de Louis Ferdinand Céline, ceux de André Breton ou
encore de Miller.
A) Louis Ferdinand Céline
Nous pouvons donc appeler l’intertexte avec Louis Ferdinand Céline, il est
vrai. Le texte s’approche quelque peu de la stylistique de Barbusse, mais garde toutefois une
grande proximité avec Voyage au bout de la nuit123. En effet :
121 W-B, Marsh, Bruce Carrick, Tales of War, Nottingham, Icon Books, 2010122 Pierre Ducrey, Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Fribourg, Hachette (Pluriel), 1999, page 62.123 Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, 1952.
64
« Ici, à l’hôpital, tout comme dans la nuit de Flandres la mort nous tracassait ; seulement ici,
elle nous menaçait de plus loin la mort irrévocable tout comme là-bas, c’est vrai, une fois
lancée sur votre tremblante carcasse par les soins de l’Administration. »124 qui fait écho à
page 327 de Babylon Babies : « Toorop s’était finalement endormi devant les images d’un
Français d’origine croate qu’il avait bien connu dans la 108e, Jérôme Kosvic, atteint par un
projectile de M-16 en plein thorax, et qui mourrait sous les yeux impuissant de ses camarades,
de l’infirmier ukrainien de la section, et de la caméra impassible. » Le lexique de la mort, de
la guerre est tout à fait similaire. C’est une écriture aux propositions longues, très ponctuée,
décidée et descriptive. Mais Dantec n’utilise pas de termes appelant l’émotion. Là où Céline
parle de « tremblante carcasse », Dantec préfère « caméra impassible ».
B) André Breton
Nous pourrions aussi appeler l’intertexte avec André Breton. Regardons cet
extrait, page 61 de Babylon Babies...
Il avait observé la face blafarde, lunaire, cette peau d’albinos grêlée de taches brunescomme des cratères laissés à la surface d’un astre mort, puis les stéréoptiques depointe qui donnaient redonnaient vie à des yeux détruits par la guerre des annéesauparavant, et enfin les lèvres pâles et fines comme des lames de ciseauxchirurgicaux se retroussant sur une dentition de céramique d’un blanc publicitaire,sertissant l’éclat jaune d’une vieille canine coulée dans l’or pur. Une espèce de fauvedont les veines charriaient de la glace. L’ours blanc des terres froides.
...qui résonne avec ce texte d’André Breton : « Ma femme à la chevelure de feu
de bois/Aux pensées d'éclairs de chaleur/À la taille de sablier/ Ma femme à la taille de loutre
entre les dents du tigre »125. En effet, l’étude sémantique de cette occurrence avait permis de
soulever le fait que c’est normalement la « vieille canine coulée dans l’or pur » qui devrait
sertir la « dentition de céramique d’un blanc publicitaire », et non l’inverse. Cette association
libre de termes et de leur sémantique, cette union libre n’est pas sans rappeler les unions libres
de L’Union libre de Breton que François Rastier explique en ce sens : « La cohésion et la
discohésion sémantique ne dépendent pas ou pas seulement du système linguistique, mais de
124 Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, ibid, page 87.125 André Breton, Clair de terre, (L’Union Libre) Paris, Gallimard, (nrf poésie), 1966, page 90.
65
normes propres au discours littéraire. »126. Dantec, dans la syntaxe et la sémantique
s’approche donc de Breton.
C) Henri Miller
Songeons un instant aux références antiques telle celle page 687 des Racines
du mal :« En une microseconde, la créature solaire a envahi leur système. Leur univers
pseudo-minoen a subi l’assaut fulgurant d’une jungle proliférante, un réseau de métastase bio
mécanique qui s’est emparé des piliers et des coupoles, recouvrant tout, et y compris leurs
propres clones virtuels. » Ceci pourrait être un écho à des oeuvres telles que celle d’Henry
Miller : « seul, Agamemnon est là. Le corps est tombé en morceaux quand on a ôté du visage
le masque. Mais il est là, qui emplit le silence immobile de la ruche, se répand à l’air libre,
inonde les champs, soulève un peu plus haut le ciel. »127
Notons enfin ce fait : Henri Miller est un auteur anglophone, mais il ne relève pas du genre de
la science-fiction. Pour cette dernière et ultime partie, sera-t-il, quand même, intéressant de se
pencher rapidement sur les référence à la littérature anglophone de science-fiction soulevée
par l’étude morphologique, syntaxique, sémantique et stylistique.
Ces intertextes sont en lien avec la poétique de Dantec. Ils soulignent des
phénomènes stylistiques et poétiques de l’auteur. Il paraissait important d’étudier ces
intertextes, puisque la matière textuelle de Dantec s’y référait. Ils sont du reste assez loin de la
notion de science-fiction qui nous est si chère et de ses références intertextuelles... fussent-
elles traduites de l’anglais.
3) Des références à la littérature anglophone de science-fiction.
Il aurait été bien difficile de passer à côté de cette partie. Certes, notre étude
n’est pas une étude de littérature comparée, à plus forte raison elle se concentre sur l’analyse
morphologique, syntaxique, sémantique et stylistique de la poétique de Dantec. L’on pourrait 126 François Rastier, Sémantique et rhétorique, Toulouse : Editions universitaires du sud, 1998, p. 33-57127 Henry Miller, Le Colosse de Maroussi, Paris, Le Livre de Poche, 1958, page 127.
66
alors avancer que traiter de références à la littérature anglophone de science-fiction est délicat
dans la mesure où la langue est différente et où donc, l’on se concentre sur l’analyse en
française strico sensu.
Or, l’étude morphologique et syntaxique a révélé ceci : Dantec métisse les langues, l’anglais
et le français pour créer des néologismes. De plus, sa syntaxe se calque parfois sur la syntaxe
anglaise. Enfin, l’étude minutieuse de certains néologismes démontrait que leur morphologie
était justifiée par leur appartenance et leur référence à une culture bien spécifique : une culture
anglo-saxonne de la science-fiction. En ce sens l’étude sémantique et stylistique qui a révélé
des références claires et précises quant à ces courants culturels, révèle donc aussi des
références intertextuelles à des auteurs de science-fiction de langue anglaise.
Ainsi, comment ne pas se concentrer un instant, même brièvement, sur ces références ?
A) Le Cyberpunk
Nous rappelons la définition du cyberpunk : Le « cyberpunk » est un courant
culturel de révolte (d’où la référence au courant socio-musical « punk ») dans un futur proche
dominé par la technologie, (d’où le terme de « cyber »), les corporation et où le hacker survit
dans un monde où le complot est monnaie courante ». Le « cyberpunk» est avant tout un
courant littéraire, graphique, cinématographique, qui a trait aux mangas et à l’animé, ainsi
qu’au jeu vidéo. Un auteur en est l’un des principaux créateurs... :
1- Wiliam Gibson
Le cyberpunk est un courant culturel largement initié par Wiliam Gibson avec
le Neuromancien128, ouvrage qui inspire aux frères Wachowski leur film Matrix129(The
Matrix). Dantec ne cesse de faire allusion au cyberpunk, le terme est utilisé plusieurs fois dans
les oeuvres, en particulier Babylon Babies et La Sirène rouge. La métaphorisation du naturel
par l’artificiel, l’importance de la technique, de l’informatique, l’existence de mondes virtuels,
la notion de complots, le cadre situé dans un futur très proche, illustré par des héros à contre-
128 Wiliam Gibson, Le Neuromancien, op. cit, 2001129 Andy et Larry Wachowski, Matrix (The Matrix), 1999.
67
courants, libertaires et rebelles, font que les trois oeuvres s’apparentent aux cyberpunks, et
sont donc des références à Wiliam Gibson.
2- Philip K.Dick.
Le cyberpunk est annoncé par Philip K. Dick dans plusieurs de ses ouvrages,
notamment Blade Runner130. C’est l’un de ses précurseurs. Ce n’est pas un hasard, donc si
Dantec cite Philip K. Dick dans ses remerciements au début de Babylon Babies. La puissance
de la biomécanique, des héros tout à fait hors circuits, électrons libre dans un monde écrasant,
sont tout autant de thèmes que l’on retrouve chez les deux auteurs. Philip.K Dick a été un
auteur de référence en science-fiction, et une source d’inspiration majeure pour beaucoup
d’auteurs. Dantec ne fait pas exception. Que ce soit en référence à Ubik131, Le Maître du haut
château132 ou encore Blade Runner133, l’on retrouve beaucoup de corrélation entre Dantec et
K. Dick dans l’économie du roman, la trame ou encore certains éléments poétiques et
culturels.
Le cyberpunk a donc une place importante, que ce soit par le biais des lignes de
Gibson, ou des rêveries androïdes de K. Dick. Ce n’est néanmoins pas la seule référence que
l’on peut situer chez Dantec quant à notre approche et qui est soulevée par la morphologie, la
syntaxe, la sémantique et la stylistique.
B) Dan Simmons
Une autre référence semble apparaître chez Dantec. Il s’agit d’un des grands
maîtres de l’horreur et de la science-fiction anglophone : Dan Simmons. Le rapport s’est
établi à propos des « vampires psychiques », page 671 des Racines du mal, une assemblée
d’assassins qui n’est vraiment pas sans rappeler Dan Simmons dans L’échiquier du mal
(1,2)134 : « Ce sont des vampires psychiques ». « Des vampires psychiques », donc, un même
terme dans les deux oeuvres qui désigne chez Simmons des hommes possédant le « Talent »
130 Philipe K. Dick Blade Runner, op. cit, 2001131 Philipe K. Dick, Ubik, Paris, J’ai lu, 2001.132 Philip K. Dick, Blade Runner, Paris, J’ai lu, 2001.133 Philip K. Dick, Le Maître du haut château, Paris, J’ai lu, 2001.134 Dan Simmons, L’Echiquier du mal (1,2), Paris, Gallimard (Folio SF), 1992.
68
et manipulant les hommes comme des marionnettes en suivant les règles d’une compétition
macabre aux règles empruntées aux échecs....Tout comme dans Les Racines du mal. La trame
est exactement similaire. Enfin, chez Dantec, l’un des tueurs de la « Famille » est obsédé par
le « Gambit », soit une ouverture classique du jeux d’échec, tout comme les « vampires » de
Simmons jouent aux échecs avec des victimes sacrificielles. Les échecs et la notion
d’assassins sadiques, de jeu macabre basé sur l’échiquier, « de vampires psychiques », tout
cela sont autant de points communs entre les deux romans. Les Racines du mal ont été écrites
en 1995, et L’Echiquier du mal en 1989 : il paraît plus que plausible que Dantec se soit
inspiré de Dan Simmons pour ses Racines du mal.
C) Breat Easton Ellis
Une dernière source est en rapport avec la stylistique de Dantec. Il s’agit de
Breat Easton Ellis. En effet de la page 439 de La Sirène Rouge s’en fait l’illustration : « Le
visage ambivalent du yuppie cannibale et humanitaire{...} Femme d’affaire branchée dans les
milieux de la mode, de la pub et du vidéoclip le jour, elle réalisait des films interdis la nuit.
Torture et assassinats en direct live, sur de la bande magnétique. »
La Sirène Rouge est publié en 1993, et American Pyscho135, de Bret Easton Ellis en 1991.
Sans essayer des faire des parallèles à tout prix, ce passage à le mérite d’être parfaitement
ressemblant avec la description de Patrick Bateman, un yuppie goldenboy branché, également
assassin vampirique et accessoirement fan de Ted Bundy la nuit. Ce n’est pas une pure
coïncidence, c’est, à l’instar de l’Echiquier du Mal de Dan Simmons, une véritable source
d’inspiration de Maurice G. Dantec.
Ces références ont leur importance dans l’écriture de Dantec. Mais dans la
mesure où nous ne faisons pas de littérature comparée, et comme nous l’avons expliqué, à
plus forte raison que notre dossier est une étude grammaticale de l’écriture de Dantec, nous
nous devions d’être prudent quant au fait que ces références littéraires sont des sources de
langue anglaise. La question de la traduction et la limite imposée par le sujet nous empêche
donc de nous attarder trop longuement sur cette question. Il fallait pourtant souligner ces
135 Bret Easton Ellis, American Psycho, Paris, 10/18, 1991.
69
corrélations qui sont, qu’on le veuille ou non, des aspects littéraires en lien avec la poétique
de Dantec.
L’imaginaire de Dantec est donc bien structuré, comme nous l’avons vu, autour
de trois axes majeurs : les thèmes récurrents chers à l’auteur, l’intertexte et les références à la
littérature anglo-saxonne de science-fiction. Les thèmes récurrents n’étaient autres que la
question d’Alice, l’imaginaire du feu, et la prééminence de la science, de l’industrie et de la
guerre dans les oeuvres. L’intertexte se fait l’écho d’oeuvres traitant de la guerre, comme
celle de Céline, de références antiques comme celle de Miller, ou bien encore, dans la
construction syntaxique et sémantique, à des ouvrages de Breton. Quant à la littérature anglo-
saxonne de science-fiction, nous avons constaté l’importance du patron stylistique du
cyberpunk porté par les références à Philip K. Dick et William Gibson. Puis nous nous
sommes penchés sur les références à Dan Simmons, puis à Bret Easton Ellis. L’imaginaire de
Dantec est donc lié avec les études morphosyntaxiques, avec la sémantique et la stylistique.
Les faits littéraires dégagés par les parties précédentes ont trouvé un lien avec les références
littéraires avancées implicitement ou non par l’auteur. Souvenons nous que la morphologie a
montré des liens avec la culture cyberpunk, et que la syntaxe s’est approchée des créations
littéraires et poétique de Breton. De plus, des auteurs nous ont été utiles, rappelons le. Le feu
qui était si important dans les oeuvres, et en particulier dans Les Racines du mal, s’est vu
étudié grâce à Bachelard ; quant à Alice, c’est sous le regard de Deleuze et de Carroll que
nous nous sommes arrêtés sur ce thème récurrent, en particulier dans La Sirène rouge.
L’étude du thème de la guerre a montré pour sa part de nombreux liens avec la littérature et
l’histoire militaire : de Sun Tzu en passant par les précieuses analyse de Barrois tout en
comprenant l’archétype du héros et du surhomme grâce à Jung ou encore Rank. Cet
imaginaire, défini dans son écriture comme nous l’avons vu grâce à Jameson est donc, au
même titre que les néologismes et les patrons syntaxiques récurrents, au même titre que les
jeux de tensions sur la sémantique, un des éléments définissant la poétique de Dantec.
70
CONCLUSION
La poétique de Dantec est bien une poétique liée à la science-fiction. Nous
l’avons constaté tout au long de cette étude de grammaire qui se concentrait sur la
morphologie, la syntaxe, la sémantique, et l’intertexte. La science-fiction, donc, est
caractérisée chez Dantec d’un point de vue morphologique par une réinterprétation bien
précise. Il s’agit d’une construction morphologique axée autour de la création de nouveaux
mots à partir de mots ou de morphèmes, en rapport avec le lexique des sciences, de l’espace,
de la biologie, des sciences neurologiques, informatiques, de la biomécanique...bref des
sciences dures et des sciences du futur. L’étude a aussi montré l’importance de néologisme en
rapport avec le monde de l’entreprise et donc de l’anglais qui s’impose également dans
d’autres domaines, comme la création de nouveaux pseudos ou la réappropriation de marques
d’informatiques. Rajoutons que dans l’ensemble, il est indiscutable de constater que les
néologismes de Dantec se construisent sur des schémas attestés en français, des patrons
reconnus et avec des mots ayant très largement trait à la science. Les néologismes les
définissant se construisent avec des mots formants ou affixes appartenant au lexique de la
science-fiction- donc de la science tout court, puisque le genre littéraire et la discipline
d’étude sont étroitement liés.
D’un point de vue syntaxique et sémantique, l’on remarque l’indiscutable insertion du lexique
des sciences dures et de l’industrie et plus périodiquement de la guerre et du feu. Nous notons
un trait d’écriture absolument récurrent : la reprise de la phrase type avec des termes issus du
lexique propre aux sciences dures. Trois patrons syntaxiques et sémantiques sont
remarquables quant au mélange des lexiques : mélange des lexiques de la littérature et de la
science dure, mélange de lexiques de différents domaines de la science dure et
métaphorisation d’un objet par le lexique d’un seul domaine de la science dure. De plus, il
convient de garder à l’esprit cet autre trait frappant : la métaphorisation du naturel par
l’artificiel. Tout ceci est couplé avec des jeu de tension quant la syntaxe, comme par exemple
l’inversion du nom et du complément du nom, ainsi que d’un important travail avec la
sémantique, tant par des effets d’ambivalence et de double sens que part des effet de tensions.
Enfin, la syntaxe s’est révélée, en certaines occasions, proche de l’anglais.
L’imaginaire, dernière partie consacrée à notre étude a révélé les thèmes récurrents-, un
intertexte spécifique- Céline, Breton Miller, et bien sûr, les rapports entretenus entre la
poétique de Dantec et la littérature anglo-saxonne de science-fiction- Philip K. Dick et
71
William Gibson pour le cyberpunk, et Dan Simmons, puis Bret Easton Ellis. L’imaginaire de
Dantec est donc lié avec les études morphosyntaxiques, avec la sémantique et la stylistique
qui ont trouvé un lien avec les références littéraires avancées implicitement ou non.
Au terme de cette étude, nous constatons donc, comment Dantec, autour du néologisme, de
patrons syntaxiques précis et de références littéraires spécifiques, se réapproprie le genre de la
science-fiction. La parenté, le gène de la science-fiction s’est ainsi bien exprimé chez Dantec,
mais à sa façon, selon style. C’est l’étude de l’écriture stricto sensu qui a révélé comment
l’univers futuriste et désolé de Dantec se définit et définit ses oeuvres. Elle nous a permis
d’entrevoir ce que signifie l’appartenance à un genre tout en sauvegardant et en imposant son
unicité. Bien que l’auteur plante son décor dans un futur très proche, bien que ses récits soient
hantés par le spectre d’une fin imminente, d’une géopolitique torturée par la guerre, le
terrorisme et les conflits globaux, l’écriture, dans sa forme, fait particulièrement appel aux
sciences dures. L’écriture dans sa manifestation morphosyntaxique et sémantique est donc
une écriture de “hard fiction“ de “science dure fiction“. Pourtant, derrière cet aspect-là, l’on
ressent déjà les agitations, les remous anxieux de l’auteur quant à notre monde qu’il perçoit
comme un navire en train de chavirer dans des eaux désolées. Cette fatigue universelle, que
certains appellent matrix ou matrice, d’autres « l’autre côté{...} des fantômes organiques »136,
d’autres encore comme Dantec qui le conçoivent comme un « urbanisme cyberpunk », « déjà
fin de vingtième siècle, tout simplement », est un vecteur poétique de création de la science-
fiction. Dantec y excelle pour y peindre notre fin imminente.
La polémique violente quant à ses prises de positions radicalement à droite, nihiliste et
chrétiennes extrêmes, trouverait-elle un écho dans les fondements de son écriture ? Philip K.
Dick nous répond en deux temps :
Une des graves erreurs de la critique littéraire est de croire que les opinions del’auteur peuvent être déduites de ses oeuvres ; Freud, par exemple, a commismaintes fois cette regrettable erreur. Un écrivain digne de ce nom doit être capabled’adopter le point de vue que tous ces personnages sont tenus de posséder en proprepour pouvoir fonctionner correctement ; telle est la mesure de son art : savoir libérerson oeuvre des idées préconçues. 137
et...
136 Philipe K. Dick, Ubik, op. cit, page 282.137 Philip K. Dick, The Double Bill Symposium, Table Ronde entre auteur de S-F., 1969, in Lawrence Sutin,Invasions divines, Philip K. Dick, une vie, op. cit, page 637
72
Les gens me disent que ce qui me constitue, toutes les facettes de ma vie, mapersonnalité, mon vécu, mes rêves et mes peurs, que tout cela, donc, est apparentdans mon oeuvre, qu’à partir de l’ensemble de mes textes, on peut me reconstituerde manière précise et absolue. C’est tout à fait exact. 138
Le débat est donc ouvert.
138 Philip K. Dick, intoduction à The Golden Man, 1980, in Lawrence Sutin, Invasions divines, Philip K. Dick,une vie, op. cit, 1995.
73
BIBLIOGRAPHIE :
1 ) Oeuvres principales
-BAUDELAIRE (Charles), Les Fleurs du mal, Paris, Gallimard, (Folio Plus Classique), 2008.
-BRETON (André), Clair de terre, Paris, Gallimard, (nrf poésie), 1966.
-CELINE, (Louis Ferdinand), Voyage au bout de la nuit, Paris, Gallimard, 1952.
-CARROLL (Lewis) Alice aux pays des merveilles, Paris, Gallimard (Folio Classique),1994.
-DANTEC (Maurice G.), La Sirène rouge, Paris, Gallimard, (Folio Policier), 1993.
-DANTEC (Maurice G.), Les Racines du mal, Paris, Gallimard, (Folio SF), 1995.
-DANTEC (Maurice G.), Babylon Babies, Paris, Gallimard,(Folio SF), 1999.
-DELEUZE (Gilles), Logique du sens, Paris, Les Editions de Minuit, 1969.
-MILLER (Henry), Le Colosse de Maroussi, Paris, Le Livre de Poche, 1958.
2 ) Ouvrages critiques, essais, et manuels
-BACHELARD (Gaston), La psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, (Folio essais), 1949.
-BARROIS (Claude), Psychanalyse du guerrier, Paris, Hachette (Pluriel Intervention), 1993.
-BAUMGARTNER (Emmanuèle) et MENARD (Philippe), Dictionnaire étymologique et
historique de la langue française, Paris, Le Livre de Poche, (La Pochotèque), 1996.
-BEN ARI (Yehezkel), COUBES (Philipe), L’électricité : son implication dans le
fonctionnement du cerveau et dans les soins, Paris, Neurodon, 2002.
-BHATT (Rakesh M), Code-switching and the functional head constraint, New York,
Modern Languages and Linguistics, 1995.
-Deleuze et les Ecrivains, Littérature et Philosophie, dir. GELAS (Bruno) MICOLET
(Hervé), Nantes, Edition Cécile Defaut, 2007.
-DENIS (D.) et SANCIER-CHATEAU (A.) Grammaire du français, Paris, le livre de poche,
1994.
-DUCREY (Pierre), Guerre et guerriers dans la Grèce antique, Fribourg, Hachette (Pluriel),
1999.
-GARDES TAMINE (Joëlle), La Grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, tome 1,
Paris, Armand Colin, (Cursus) 2011.
74
-GARDES TAMINE (Joëlle), La Grammaire : syntaxe, tome 2, Paris, Armand Colin,
(Cursus), 2010.
-JUNG (C-G.) Psychologie de l’inconscient, Chêne- Bourg/Genève, Georg Editeur, 1993.
-HICKEY, Eric, Encyclopeadia of Murder and Violent crime, Sage publication, 2003.
-JAMESON (Frederic), Penser avec la science-fiction, Paris, Max Milo, l’Inconnu, 2008.
-MARSH (W.B.) CARRICK (Bruce), Tales of War, Nottingham, Icon Books, 2010
-MISHIMA (Yukio), Le Japon moderne et l’éthique du samouraï, Paris, Gallimard, Arcades,
1985.
-NARBY (Jeremy), Le Serpent cosmique, l’ADN et les origines du savoir, Paris, Terra
Magna, 1995.
-POLGUERE (Alain), Notions de base en lexicologie, Montréal (Québec), Observatoire de
Linguistique Sens-Texte (OLST), 2002.
-RANK (Otto), Le Mythe de la naissance du héros, Paris, Payot, 1983.
-RASTIER (François) Sémantique et rhétorique, Toulouse : Editions universitaires du sud,
1998, p. 33-57
-SUTIN (Lawrence), Invasions divines, Philip K. Dick, une vie, Paris, Folio S-F, 1995.
-SUN TZU, L’Art de la guerre, Paris, Flammarion, (Champs) 1999.
3) Lectures complémentaires
-ASIMOV (Isaac), Les Robots, Paris, J’ai lu, 2004.
-ASIMOV (Isaac), Les Robots et l’Empire, Paris, J’ai Lu, 1986.
-BEAUVERGER, Stéphane, Le Déchronologue, Paris, La Volte, 2009.
-DICK (Philip K.), Blade Runner, Paris, J’ai lu, 2001.
-DICK (Philip K.), Le Maître du haut château, Paris, J’ai lu, 2001.
-GIBSON (Wiliam), Le Neuromancien, Paris, J’ai lu, 2001.
-ELLIS (Bret Easton), American Psycho, Paris, 10/18, 1991.
-FLAUBERT, (Gustave) Par les champs et par les grèves, Paris, Pocket, 2002.
-HOLDSTOCK (Robert), Le Codex de Merlin, Paris, Le Pré aux Clercs, 2011.
-KING (Stephen), Ca (1,2), Paris, Le Livre de Poche, 1998.
-ROBINSON (Kim Stanley), Mars la rouge, Paris, Presse de la Cité,1992.
-ROBINSON (Kim Stanley), Mars la verte, Paris, Presse de la Cité, 1993.
75
-ROBISON (Kim Stanley), Mars la bleue, Paris, Presse de la Cité, 1996.
-TOLKIEN (J-R-R), Le Seigneur des anneaux (1,2,3), Paris, Gallimard (Folio), 2000.
-SIMMONS (Dan), L’Echiquier du mal (1,2), Paris, Gallimard (Folio SF), 1992.
-La Bible, Gallimard, Paris, (FolioPlus Classique), 2005.
WEBOGRAPHIE :- Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFI) : http://atilf.atilf.fr/
Related Documents