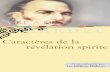1 Appla & Co. La confidence en japonais : entre secret et révélation « La parole est irréversible, telle est sa fatalité. Ce qui a été dit ne peut se reprendre. » Roland Barthes, Le bruissement du langage. Essais critiques 4, p. 99, seuil, 1984. Saisir par l’étude la confidence, c’est un peu comme saisir l’occasion de partir à l’aventure, c’est à dire ressentir en même temps l’excitation du départ et celle de l’inconnu qui s’étend loin devant. Un départ d’Ithaque, où l’on trouve le monde fini et sous contrôle, pour découvrir dès les premiers pas hors du royaume qu’il regorge de périples et d’obstacles. C’est un peu cela aussi la confidence, car vraisemblablement tout un chacun s’en fait aisément une idée assez sommaire mais rencontre quelques difficultés à en appréhender la complexité de manière stable et commune. C’est également ce que j’ai eu l’occasion de remarquer quand, lors d’entretiens avec certains amis appartenant aux universités japonaises, j’ai tenté d’expliquer la confidence. Il en est ressorti assez vite que cette confidence reste quelque chose d’assez difficile à concevoir avec raison, mais qu’elle se comprend fort bien en situation. Cette confrontation entre nos langues respectives montre assez tôt qu’un certain vécu commun et proprioceptif de la confidence lié à une pragmatique, puisse servir de point de départ à notre propos 1 . Je vais essayer ici autant que faire se peut de présenter au lecteur ce qui, dans la confidence en japonais, semble déjà dit dans le signe et son usage, avec l’espoir qu’il puisse aussi nous éclairer sur ce que ne dit pas le terme en français. 1 A titre de précision, il faut indiquer que mes investigations m’ont mené un peu partout en Europe au préalable. C’est également avec d’autres amis que je me suis entretenu sur le thème de la confidence, depuis des langues comme l’espagnol, l’italien, l’anglais, l’allemand ou même le norvégien. Or, au sortir de ces entretiens, je restais insatisfait quant aux thématiques mobilisées. Il me semblait que les similarités étaient trop flagrantes. A vrai dire, je n’y voyais aucune piste. Une infinité de pistes existe en fait, c’est même certain, mais

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Appla & Co.
La confidence en japonais : entre secret et révélation
« La parole est irréversible, telle est sa fatalité.
Ce qui a été dit ne peut se reprendre. »
Roland Barthes, Le bruissement du langage.
Essais critiques 4, p. 99, seuil, 1984.
Saisir par l’étude la confidence, c’est un peu comme saisir l’occasion de partir à l’aventure,
c’est à dire ressentir en même temps l’excitation du départ et celle de l’inconnu qui s’étend loin
devant. Un départ d’Ithaque, où l’on trouve le monde fini et sous contrôle, pour découvrir dès les
premiers pas hors du royaume qu’il regorge de périples et d’obstacles. C’est un peu cela aussi la
confidence, car vraisemblablement tout un chacun s’en fait aisément une idée assez sommaire mais
rencontre quelques difficultés à en appréhender la complexité de manière stable et commune.
C’est également ce que j’ai eu l’occasion de remarquer quand, lors d’entretiens avec certains amis
appartenant aux universités japonaises, j’ai tenté d’expliquer la confidence. Il en est ressorti assez
vite que cette confidence reste quelque chose d’assez difficile à concevoir avec raison, mais qu’elle
se comprend fort bien en situation. Cette confrontation entre nos langues respectives montre assez
tôt qu’un certain vécu commun et proprioceptif de la confidence lié à une pragmatique, puisse servir
de point de départ à notre propos1.
Je vais essayer ici autant que faire se peut de présenter au lecteur ce qui, dans la confidence en
japonais, semble déjà dit dans le signe et son usage, avec l’espoir qu’il puisse aussi nous éclairer sur
ce que ne dit pas le terme en français.
1 A titre de précision, il faut indiquer que mes investigations m’ont mené un peu partout en Europe au préalable. C’est également avec
d’autres amis que je me suis entretenu sur le thème de la confidence, depuis des langues comme l’espagnol, l’italien, l’anglais, l’allemand
ou même le norvégien. Or, au sortir de ces entretiens, je restais insatisfait quant aux thématiques mobilisées. Il me semblait que les
similarités étaient trop flagrantes. A vrai dire, je n’y voyais aucune piste. Une infinité de pistes existe en fait, c’est même certain, mais
2
La confidence : entre secret et révélation
Uchiake banashi2, ou bien Himitsu no hanashi, ou encore une ancienne forme, le Shinrai, voilà
trois termes que l’on peut prendre selon les différentes sources consultées3 comme les traductions
ou équivalences les plus proches de ce que serait la « confidence » en japonais.
1/ Voyons les distinctement : le shinrai (信頼) est littéralement ces choses affirmatives, du
sentiment ou de l’action que l’on met en jeu, qui sont « vraies » (Shin,信)4, que l’on va « confier » (Rai
頼)5 et dont on va déléguer la responsabilité à d’autres6.
2/ Le uchiake banashi (打ち明け話) est littéralement l’atteinte directe, l’appréhension
pleine, la frappe lumineuse d’une vérité transmise par le discours (Uchi 打 : frappe; Ake 明け :
lumineuse; Banashi 話 : discours, que nous préciserons par la suite). En ce sens, le terme relatif à la
lumière (Ake 明け) peut se comprendre comme un “éveil” après la “frappe”, comme celui que peut
procurer une confidence ayant valeur d’information (au sens d’in-‐formant) pour le confident.
3/ Enfin, le himitsu no hanashi (秘密の話) est quant à lui cette « partie cachée », difficile à
rendre publique, ce que l’on révèle de soi-‐même, ce que l’on risque dans la confidence, ce qui est non-‐
immédiatement com-‐préhensible (Hi 秘) et que l’on dévoile depuis la partie infime, intime (mitsu 密)
de son propre être, en un mouvement du locuteur vers l’autre, vers le confident ainsi désigné par le
mouvement même.
Ces trois versions de la confidence décrivent des aspects complémentaires pour nôtre étude : le
uchiake banashi (2) représente le point de vue du confident; le himitsu no hanashi (3) celui de
l’énonciateur. Le shinrai (1), quant à lui, concerne le tiers symbolique de ce système en tant que
signe contenant intrinsèquement tous les acteurs impliqués dans la relation qui, ailleurs avec le
2 « Banashi » est, par usage, dérivé d’un idiome sécularisé de « hanashi ». On les désigne tous deux comme des « kun-‐yomi », c’est à dire la version phonétique japonaise d’un idéogramme chinois. On l’oppose à la ou les lectures « on-‐yomi » qui sont quant à elles, retransmises selon les capacités phonétiques du syllabaire japonais, les lectures chinoises. Il peut y avoir une dizaine de lecture pour chacun des « yomi » – « kun-‐yomi » et « on-‐yomi » – ce qui rend, même pour un japonais, la prononciation de certains ensembles d’idéogrammes – appelés « mana » ou sémantèmes en français – assez difficile et, souvent, aventureuse. Dans le cas du caractère associé à « hanashi », il en existe une dizaine. Mais pour les deux versions de la confidence qui nous intéressent ici, ils s’écrivent tous deux 話, et se prononcent avec une légère différence : himitsu no hanashi et uchiake banashi, respectivement : 秘密の+話 et 打ち明け+話 . Cette différence est due, tout comme en français selon les cas, à un pratique esthétisante du langage oral permettant une fluidité accrue du discours. 3 1)日本国語大辞典、第三巻、小学館編集部、東京2006、Nihonkokugo Daijiten, Daisankan, shôgakukan henshûbu, Tôkyô, 2006 ; « Grand dictionnaire de la langue japonaise, édition shogakukan, troisième édition, Tôkyô 2006 ». 2)Tôkyô, Kôjirin, 6ème édition, éditions sanseidô, 1983, Tôkyô, kôjirin, dairokuhan, sanseidô shûshohen, 1983, 東京、広辞林、第六版、三省堂 修所変, 一九八三. 3) Tôkyô, Daijisen, shôgakkan, 1995, 東京、大辞泉、小学館、一九九五. 4 La racine du terme 信 indique qu’il s’est construit depuis les termes “être humain” et “dire”, dire l’être humain, avec comme étymologie sémantique : “ce qui a été énoncé une fois clairement et persiste dans le comportement de l’être humain”, ou encore : “le fait de saisir ( ou de contenir serait plus juste ) une volonté préconsciente et grandissante en soi”. 5 La racine du terme 頼 en revanche signifie littéralement “demander”. Le Shinrai en ce sens pourrait donc se concevoir comme la volonté de l’énonciateur de se dire depuis son être propre, de se donner, et celle du confident de connaître ce “dire vrai”, de le recevoir. 6 Le shinrai est une forme ancienne que l’on peut comprendre selon la situation comme une « confidence » et que l’on retrouve dans les textes précédents l’air moderne. De nos jours, on l’utilise beaucoup plus comme un équivalent de « confiance » en français, utilisé surtout en situation pragmatique d’énonciation.
3
uchiake banashi et le himitsu no hanashi, se trouvent chacun leur tour implicitement ou
explicitement cités.
4
Proprioception
Le secret que l’on risque au bord des lèvres : himitsu
« Ay, on the shores of darkness there is a light,
And precipices show untrodden green ;
There is a budding morrow in midnight ;
There is a triple sight in blindness keen … »°
John Keats, To Homer.
Commençons donc par le dernier terme que nous venons d’énoncer, c’est à dire le himitsu no
hanashi (秘密の話), et concentrons-‐nous sur le premier jeu d’idéogrammes, à savoir himitsu (秘密).
Le himitsu, soit le point de vue de l’énonciateur comme nous venons de le définir, se
comprend dans le discours en japonais comme une chose profonde, écho des déjà lointaines
profondeurs de la personne ; personne qui aurait trouvé la force, au prix d’un effort certain, de
donner cette chose profonde à un(e) autre. Ce don fait suite à un travail d’élaboration qui, pour
l’énonciateur, prend déjà un certain temps : il s’agit d’identifier ce qui, profondément donc, nous
anime, ce qui représente peut-‐être en illustrant le propos à l’aide des philosophies d’Heidegger et de
Simondon quoique pour des raisons différentes, comme un « déphasage » de l’étant avec l’Être,
dont la tension nécessite une résolution. Lorsque, curieux, nous questionnons le premier signe du
himitsu, soit le Hi (秘), nous y voyons là en effet cette amorce. Voyons ce que nous enseigne le Kaiji7
quant au hi-‐ de notre hi-‐mitsu : hi (秘) se compose de l’idéogramme « montrer, désigner, faire voir » (
示) et de ce qui est « certain, sûr – originellement ce qui advient quant il n’y a pas d’autre choix » (必
)8. 示+必=秘. Le kaiji donne pour l’ensemble ainsi constitué « une substance intérieure ayant
rejoint comme un mystère insoluble pour l’individu et comme poussée au bord des lèvres, ce que l’on
voudrait faire voir de soi sans trop l’oser ».
° « Oui, au bord des ténèbres il y a de la lumière, Et les précipices font voir des prairies non frayées ; Il y a dans minuit un matin qui bourgeonne ; Et dans la cécité une triple vue qui s’aiguise… » 7 Le Kaiji (解字), littéralement « comprendre le signe », est un exercice de la linguistique en japonais que nous rapprocherons difficilement de notre étymologie (car l’étymologie s’attache au sens mais non pas au signe lui-‐même) et qui a pour tâche d’analyser la signification originelle des combinaisons d’idéogrammes présentes à l’intérieur d’un idéogramme, en s’intéressant particulièrement à leur tracé. 8 Une version donne : « l’idée que, une fois réunies les possibilités X, lorsque ne reste plus de place pour se mouvoir ou même pour éviter, on ne puisse pas faire autrement que Y ».
5
Le hi de hi-‐mitsu ainsi formé se comprend alors mieux comme cet informulé en nous qui hésite à se
donner, car trop profond et complexe pour être risqué, nous le verrons, avec n’importe quel individu
mais qui, et il n’y a pas d’autre choix, doit se donner9. Le contenu importe peu, et c’est une grande
constance apparemment dans les études sur la question de la confidence, mais c’est ce que le
contenu désigne comme étant une alchimie incertaine entre risque(s) et bénéfice(s) pour soi-‐même
qui semble ici de première importance.
C’est sensiblement aux mêmes conclusions que Charles le Chevalier était arrivé dans un livre intitulé
« la confidence et la personne humaine » :
« Il semblerait, après ces analyses, que l’ouverture ne puisse plus s’éviter et que le Moi, stimulé par
ces exigences concourantes, doive s’épanouir et se dissoudre enfin, pâmé, au sein des êtres et des
choses qui l’attirent si violemment. Cela n’est point car la tendance et le goût même de se
raconter se tempèrent par le fait d’autres forces organisées, véritables digues contre le
débordement et la prostitution de soi. »10
Ces autres forces, on les trouve opportunément dans le deuxième idéogramme, le mitsu de hi-‐mitsu
qui nous raconte ces profondeurs et ces défenses « contre la prostitution de soi ».
Mitsu (密) est formé du « toit », que l’on peut interprété comme la maison, son intérieur
propre (宀) ; du « certain, sûr » vu plus haut, qui signifie ici plutôt « exactement » (必) ; et enfin de
« la montagne » (山) qui est ici une métaphore imprégnant tout le signe. Ainsi, nous avons : 宀 +必
+山=密. 宀 et 必 forment ensemble 宓11 et désignent poétiquement « la façon douce et précise
qu’un individu a de fermer la porte de sa maison ». Enfin, ce dernier signe que l’on met au-‐dessus de
la « montagne » devient notre mitsu : 宓+山=密. Le kaiji nous offre ici la beauté pudique « d’une
inatteignable montagne que l’individu enferme profondément en lui ». La montagne symbolise
autant le poids que l’importance et la force de ce qui se refuse mais, et c’est là toute la subtilité, veut
se donner. Il s’agit de cet-‐exactement-‐flagrant en nous qui, pourtant, demeure si difficile à
appréhender, vie en nous si péniblement et c’est là le paradoxe, frémit au bord des lèvres (n’oublions
pas le hi vu précédemment). Frémissement avant, pendant et après le don que l’on en fait car, « en
effet, entre l’acte qui livre et le geste qui retient, il y a la place pour « l’exquise initiative du don »12. La
double exigence de dire ou de préserver les valeurs essentielles de la personne est ici le délicat
problème qui se pose au seuil de nos initiatives et de nos intentions. Si nous imaginons deux pôles, le
dire et le préserver, alors comment dire une chose que l’on veut préserver en partie ? C’est l’équation
9 La définition japonaise du hi fait aussi mention d’une tension maximale entre « chaque côté » (両側), interprété comme les deux extrémités d’un arc que l’on tend. 10 Charles le Chevalier, « La confidence et la personne humaine », Collection Philosophie de l’esprit , Aubier, édition Montaigne, Paris, 1960, p.50. 11 Dans le langage courant, on le prononce hisoka qui veut dire « caché » (des autres) ou yasuraka qui signifie « paisible ». 12 Charles le Chevalier, op.cit., p.51.
6
la plus représentative, selon moi, de ce phénomène humain universel qu’est la confidence : « qui
saura concilier le besoin d’expression et la nécessité du mystère ? »13.
Il semble si l’on en croit l’analyse des termes vus plus haut et si l’on prend en compte les
arguments présents dans la « confidence et la personne humaine » que ce don si particulier est rendu
possible grâce à l’opération de ce que l’on nomme la pudeur. Etudions ce terme en japonais.
Le voile de la pudeur
En japonais la pudeur se dit Shou-‐chi-‐shin (羞恥心). Le premier signe, shou (羞), représente
un mouton (羊) sur un bœuf (丑). Rien de très poétique ici, cet ensemble désigne en fait l’habitude
que l’on a au Japon de couper la viande en tranches extrêmement fines. Par usage métonymique,
cela désigne également tout ce qui s’amincit en devenant presque diaphane, au sens propre comme
au figuré.
Le deuxième signe, chi (恥), représente une oreille (耳) et un cœur (心), répété par le troisième signe,
le même cœur, mais qui se prononce cette fois shin (心). Nous pourrions presque y voir le sang
monter aux oreilles de celui qui se confie et rougit pudiquement d’avoir à se découvrir, mais le kaiji
de ces kanjis14 nous donne « une oreille (une écoute?) qui s’attendrit », ou encore « un cœur qui
s’étiole, se refuse à l’écoute et se retire pour disparaître au moindre sursaut ». Il y a quelque chose
d’aérien et d’hypersensible dans la pudeur qui, loin de décrire uniquement celle du corps, prend bien
soin de choisir la main qui aura l’insigne honneur de découvrir les secrets vertigineux que la pudeur
protège si légèrement et pourtant si efficacement des regards indiscrets. Mais ici, il n’est pas
question d’un secret que tous ignoreraient, c’est un secret qui n’en est déjà plus un car il se sait
exister en chacun de nous. Et ce savoir d’un lieu pour le secret en chacun de nous est ce qui fonde en
dernière instance sa communicabilité et sa compréhensibilité sans lesquelles l’initiative du don serait
impensable. La pudeur ne veut pas préserver une pureté prétendue à l’abri de valeurs morales
abstraites fondées uniquement dans l’individu, elle est plutôt un souci de pureté que l’on peut le cas
échéant partager avec d’autres. En ce sens, elle serait plus la conscience de la responsabilité d’une
nature altérée que tous partageraient. Charles le Chevalier illustre cet aspect en précisant que « la
pudeur est un jugement qui ne semble pas venir de l’esprit pudique, mais qui a toutes les apparences
de venir d’ailleurs, qui semble traverser le pudique lequel est simplement le premier qui frissonne à
son passage »15.
Ainsi cette confidence que la pudeur délivre, si difficilement comme nous venons de le voir,
est destinée à l’écoute et choisit attentivement celui ou celle qui la recevra. Il nous est difficile de
13 ibid. 14 Mot japonais pour « idéogramme », littéralement caractère (-‐ji,字) chinois (kan-‐, 漢) : kan-‐ji (漢字). Désigne tous les caractères japonais par opposition aux utilisations et prononciations des mêmes logogrammes en Chine. 15 Charles le Chevalier, op.cit., p.62.
7
souscrire, en japonais, à la thèse qu’une confidence ne verrait dans le confident qu’un
épiphénomène dénué d’importance. Nous sommes en droit de nous demander si une confidence,
sans reconnaissance et rencontre de la sensibilité supposée de l’interlocuteur, est encore une
confidence ? Car en effet, lorsque la sensibilité du « confieur » ne rencontre pas celle du confident,
l’échange continue-‐t-‐il d’être une confidence, s’il n’est pas vécu respectivement comme tel ? Le
« substrat » de l’échange, c’est à dire son statut objectif dans la rencontre des subjectivités en
interaction, n’est peut-‐être plus vraiment un acte de confidence délivré par l’opération pudique
quand il devient une expérience unilatérale vécue différemment des deux côtés.
C’est peut-‐être que la pudeur, dans sa recherche passionnément prudente d’un interlocuteur
provoque, quand elle le trouve enfin, et parce qu’il se reconnaît, la confidence :
« C’est alors qu’apparaitra la confidence : par la nécessité de dire sans trahir et de communiquer à
celui qui écoute et sait à l’occasion « répondre », non pas le superficiel de son Moi, mais ce à quoi
se rapporte, et protège, et prépare, la pudeur, c’est à dire l’intériorité la plus active et la plus
immédiatement sensible de la personne. »16
Intéressons-‐nous à présent, plus brièvement à ce confident.
16 Ibid. p.66.
8
Le point de vue du confident
Le uchiake du souci partagé
« Mélancolique
mille soucis en mon cœur
me tourmentent
mais personne ne me fait
la grâce de s’en inquiéter. »
Murasaki Shikibu, fille de Tametoki Fujiwara, Genji monogatari17
Reprenons notre uchiake de l’introduction désignant comme nous le supposons la
confidence du point de vue du confident.
Uchiake se compose comme nous l’avons dit de uchi (打) et de ake (明け).
Voyons le kaiji du premier terme. Il se décompose lui-‐même en tei (丁) et en te (手). On a au final 手
+丁=打. Tei (丁) désigne la « tête du clou » et par extension le fait de « fixer un ou en angle droit »
deux éléments ensemble, à interpréter comme « fixer avec précision ». Le deuxième signe, te (手)
signifie simplement « la main » et donne au uchi ainsi composé son sens technique à comprendre
comme ce qui bénéficie (mais ne né pas) d’une intention procéduralisée. Ainsi, nous pouvons
préciser maintenant et avancer que le uchi que nous désignions tantôt comme « frappe » doit se
comprendre plus comme la soudaineté d’un coup qui touche juste, qui fait mouche dans la
conscience du confident.
Ake (明) quant à lui semble formé au premier abord de hi (日), le « soleil », et de tsuki (月), la « lune ».
Or, le kaiji nous enseigne que le premier terme est en fait kei (囧) dont le tracé a été réduit par usage
pour ressembler à celui du soleil mais qui signifie « petite fenêtre ». Plus précisément encore, ce
dernier terme signifie « la fenêtre à travers laquelle la lumière rassemblée pointe ». Combiné ainsi à
la lune, au tsuki (月) nous obtenons 囧+月=明. Cet ensemble est saisissant de précision pour notre
17 「思って下さるとおっしゃいますが、その真意はいかがなものでしょうか、また見たこともない方が噂だけで悩むということがあるのでしょうか」.Livre XIII, Akashi, Tome I « Magnificience ». Traduction de René Sieffert, publications orientalistes de France, 1988. Le Genji monogatari (源氏物語) ou « Dit du Genji » est l’œuvre originale de Murasaki Shikubu (紫式部) rédigée au moyen-‐âge entre 1008 et 1010 durant l’époque de Heian. Murasaki Shikubu est la première femme de la littérature japonaise à laisser durablement son nom dans l’histoire et son chef d’œuvre le « Dit du Genji » dont nous tirons cet extrait est considéré comme un des trésors de la littérature nippone.
9
propos car plus qu’à « la lumière de lune qui, rassemblée en halo, se distingue au travers de la petite
fenêtre », le terme correspond par usage à « la lumière qui se fait grâce à la force de discernement sur
ce qui n’est pas directement visible dans l’être »18. Il y a de la part du confident une ouverture et une
volonté qui ne peuvent être compatibles avec sa conceptualisation comme otage de la confidence.
Si le confident n’a pas lui aussi cette liberté minimale d’accepter et d’être intrigué par celui qui se
confie, alors le contenu du message glisse sur lui et ne provoque aucune catalyse comme celle que la
confidence, nous le supposons, opère entre deux êtres. La lumière ne pointe pas, on ne discerne rien
dans le « non directement » visible de la personne en face. Il n’y a pas le mode d’attention, la
curiosité requise pour que la confidence ne soit pas qu’un cri étouffé dont la chute du haut des
falaises de mon être n’éveille aucun écho en toi.
Il y aurait donc, en résumant les acquis jusqu’à présent, un souci partagé de notre nature altérée
initiant comme une mise en abîme ou plutôt, un jeu de miroir affectif entre nous et les autres quand
la confidence se risque, entendu comme condition minimale pour sa réalisation. L’interaction ne
semble pouvoir accéder au statut de confidence pleine et entière qu’en étant cette rencontre
heureuse et a priori indéterminable entre nos sensibilités respectives. Cette rencontre heureuse et
rare qui a pour objet une information que l’on transmet en interpellant aussi la sensibilité de l’autre. Il
ne peut ainsi y avoir de confidence transmise à l’aide d’un mode uniquement rationnel et épuré de
toute affectivité dans le discours confidentiel. Il y a une inquiétude tout à fait irrationnelle, un
ressenti à l’endroit du confident que recherche forcément celui qui se confie. C’est ce que le Prince
Genji veut dire dans la lettre qu’il adresse à la fille d’Akashi : « mille soucis en mon cœur me
tourmentent mais personne ne me fait la grâce de s’en inquiéter ». Le souci et l’inquiétude sont les
deux faces individualisées du même phénomène discursif qu’est la confidence. Cette base est
littéralement la condition sine qua none pour que la confidence puisse se risquer et s’accomplir sans
se compromettre. Elle peut se comprendre et se trouver dans la philosophie bouddhique comme le
ishin-‐denshin (以心伝心)19, une communion « cœur à cœur » qui unit le maitre et son élève.
Cette base nous fait affirmer que la problématique du confident, de celui ou celle à qui la confidence
est confiée, est en fait centrale dans la logique de la confidence en japonais. Qu’il ne peut être
n’importe qui, que sa disponibilité s’ouvre et que son pathos se risque aussi dans l’échange. Et c’est
d’autant plus représentatif que, quand celui qui se confie choisit un inconnu pour cela, c’est en tant
que caisse de résonnance de lui-‐même qu’il le fait. Il y trouve dans ce que l’on appellera avec
précaution un « miroir », rendu possible par le relatif anonymat, la surface lisse sur laquelle va
pouvoir se refléter avec précision et en parfaite correspondance les mouvements de son cœur, ce
qu’il a à confier. Mais pour que cela ne soit pas un monologue ou une introspection, il faut
absolument que ce confident soit un autre que soi-‐même, d’où la relativité de l’anonymat. Et cette
absolue nécessité d’un alter ego indique clairement une chose : qu’il y a, chez le confident et en tant
que croyance ou espérance minimale de la part de celui qui confie, une possibilité même infime
18 人に見えないものを見分ける力を明と言う. 19 Devenu classique de la pensée mystique au Japon, ce terme trouve une traduction malheureuse dans nos langues sous l’indice « communication d’esprit à esprit » ou « télépathie », ce qui serait déjà plus juste si seulement l’usage courant du terme le comprenait littéralement comme télé-‐pathos et non comme télé-‐éthos
10
d’ouverture, de compréhension, d’aval, sans quoi le monologue ou l’introspection seuls suffiraient.
Considérer le confident comme otage du « confieur » serait comme oublier la part minimale mais
absolument nécessaire pour que la confidence en tant que processus s’accomplisse jusqu’au bout.
Nous le verrons tout de suite en analysant ce que confident veut dire en japonais.
Le « cœur au ventre »
Le confident se dit avec deux formes composées et un substantif au moins. Les formes composées
précisent « un compagnon auquel est confié un secret » ou « un ami auquel on consent un accès au
cœur »20.
La troisième forme, le substantif, se dit fukushin et s’écrit 腹心. On reconnait déjà le cœur
qui illustre encore à quel point la confidence s’inquiète de sujets sensibles, quasi sensuels parfois21,
que l’intime et le charnel y sont irrémédiablement liés. Ici, inutile de recourir au kaiji pour déchiffrer
les arcannes du concept, le mot est clair : le premier signe, fuku (腹) représente le ventre, l’abdomen,
le siège des humeurs et celui, autant au Japon que chez nous, du sentiment de notre terrestre
condition et de notre inaliénable appartenance à la ϕύσις. Le deuxième signe shin (心) représente le
cœur. Ainsi, caché dans le « confident » en français, le lien fondamental, qui « vient des tripes » et
indispensable entre celui qui se confie et celui qui reçoit la confidence réapparaît en japonais, et ne
se pense d’ailleurs pas sans cette communauté d’esprit et de cœur22.
C’est un peu ce que nous indique le uchiake banashi de l’introduction, lorsqu’on y voit le point de vue
du confident et cette attente patiente et récompensée de ce dernier prêtant une oreille attentive à
celui qui se confie. Sa récompense devient cette « lumière » qui « pointe », celle de la connaissance
qui se nourrie d’empathie, créant du même coup la confidence de celui qui s’avance pudiquement,
celle-‐là même qui tantôt ne pouvait exister qu’à l’état d’intentionnalité pure quand elle n’était qu’un
désir né chez le « confieur ».
Ces considérations nous mènent tout droit à un aspect vu également en introduction : nous
venons de parcourir aussi profondément que l’espace impartis nous le permettait, les éléments
relatifs aux acteurs de la confidence, en essayant de mettre en avant ce que les signes
idéographiques ou logographiques disent tout bas de la relation entre ces acteurs. Or, tout ceci ne
20 Pour ces deux versions, il est difficile pour moi en japonais de faire la distinction entre le degré d’intervention du « confieur » et celui du confident dans leur interaction de confidence car les définitions laissent perplexe quant à l’implication des acteurs (les sujets ne sont pas tous précisés et la forme utilisée peut être interprétée comme soit passive soit potentielle sans qu’il soit possible de le déterminer avec certitude). Ceci surtout, on le devine car c’est assez fréquent en japonais, pour laisser place au contexte d’énonciation en lui délégant la liberté de choisir lequel des sujets impliqués l’on voudra mettre en avant. Ce que l’on peut dire en revanche, c’est que les deux versions composées présentent le confident au minimum comme disponible et attentif. 21 Et l’on sait, en France surtout, à quel point les romans épistolaires de notre littérature se sont attachés au sensuel et au passionnel comme sujets de confidence. 22 Le cœur, shin 心, correspond parfois en japonais à l’esprit. Le signe est employé indifféremment pour esprit et cœur (il en existe d’autres afin de préciser certaines subtilités), preuve supplémentaire de l’aberration dualiste pour les peuples d’Extrême-‐Orient.
11
serait qu’abstraction s’il n’existait pas un autre indice mettant en valeur l’aspect nécessairement
pragmatique et dynamique de cet échange.
12
Pragmatique de la communication confidentielle
Césure & asymétrie : le Hanashi
« Orgon : Ce fut par un motif de cas de conscience.
J’allais à mon traître en faire la confidence ;
[…]
Cléante : Vous voilà mal, au moins, si j’en crois l’apparence ;
Et la donation et cette confidence,
Sont, à vous en parler selon mon sentiment,
Des démarches par vous faites légèrement. »
Molière, Le Tartuffe, Acte V scène I.
Ainsi, entre le temps du secret que l’on peine à donner et celui du secret que l’on attend
patiemment, il existe un troisième opérateur logique qu’il nous faut ajouter et que nous avons
jusqu’ici passé sous silence : le Hanashi (話).
En effet, himitsu (秘密) et uchiake (打ち明け) peuvent se comprendre et s’utilisent seuls en japonais,
sans l’intervention du suffixe hanashi (話).
Le himitsu (秘密) seul indique un substantif, le « secret », et le uchiake indique un verbe dans sa
forme uchiake-‐ru (打ち明け−る)23, soit « confier ». Il n’est ainsi pas rare de trouver la forme suivante :
« confier un secret », soit himitsu o uchiakeru (秘密+を+打ち明ける)24. Mais pour en revenir à nos
termes pris séparément et privés jusqu’à présent de leur suffixe hanashi, sa prise en compte révèle
deux choses :
23 La seule avec uchiake banashi. 24 Précisons tout de même que la traduction française peut nous induire en erreur quant à l’apparente symétrie entre uchiake-‐ru et
« confier ». Dans tous les cas, c’est indéniable, le sujet de la phrase reste l’énonciateur et ce même dans la version uchiake banashi. Or,
comme je l’avançais plus haut, le uchiake banashi saisit le point de vue du confident. Nous pouvons préciser et clarifier l’ambigüité hic et
nunc en disant que la différence entre le français et le japonais, et entre tous les termes en japonais, se fait surtout sur la manière de
pondérer les sujets (plus ou moins l’énonciateur, plus ou moins le confident), ayant ainsi pour effet la mise en avant de l’un des acteurs
avec, comme toile de fond et toujours sous-‐entendu, le « je » de l’énonciation comme origine de l’interaction. Cela n’est pas difficile à
comprendre dans le premier cas, celui du himitsu, le secret qui se risque et, pour le second, on le comprendra en français comme « je te
donne cette chose de moi totalement nouvelle qui pointe pour toi comme une lumière me dévoilant, qui attire ta curiosité et devant
laquelle tu es bien disposé ». C’est le « je » qui parle – le « je » ayant introduit la forme, le style – mais c’est à « ton » endroit que la synthèse
se fait, qu’elle va, depuis le bouillonnement de l’indétermination qui m’habite et aidée de ma pudeur, décider, d’un coup et comme
touchée par la grâce d’un « eurêka ! » brillant, du sens qu’elle prendra pour moi, pour toi et entre nous.
13
-‐ Premièrement et c’est important, l’auteur de la confidence reste le sujet principal,
l’énonciateur. Il a, en tant que celui qui se livre et celui qui informe un double pouvoir sur
l’acte de langage, qu’il initie très souvent lui-‐même car sa pudeur nécessaire sied
difficilement à toute forme de contraintes extérieures. En ce sens, l’échange se fait d’entrée
de jeu sur un type de relation que nous pourrions qualifier d’asymétrique, donnant à celui qui
se confie la maîtrise de l’énoncé. C’est ce que hanashi redouble.
-‐ Deuxièmement, le hanashi place une césure, une rupture dans un environnement énonciatif.
Appelons à notre secours le kaiji et voyons pourquoi l’intervention de ce petit idéogramme qu’est le
hanashi installe une différence décisive d’avec les versions pour lesquelles il n’apparaît pas.
Hanashi que l’on écrit 話 signifie dans le langage courant « discours », « langage » au sens
de « langue parlée », et désigne plus généralement la « prise de parole » d’un individu suivie d’une
énonciation. Il indique ainsi avec précision l’acte de langage en tant que tel, qu’il soit passé, présent
ou futur.
Décomposons-‐le à présent : hanashi est formé de deux termes, le premier étant koto25 (言) qui peut
vouloir dire « parler » ou « mot » et le second shita (舌) qui vaut pour l’organe qu’est la « langue ».
Ainsi, 言+舌=話.
Voyons le premier, c’est à dire koto (言). Sans entrer dans les détails, lui-‐même se compose de shin (
辛), « piquant » ou « pointu » ou encore « perçant » et placé au dessus de kuchi (口), la « bouche ».
C’est à comprendre ici comme ce que l’on rumine et qui pointe avec une clarté soudaine.
Le second, c’est à dire shita (舌) se compose quant à lui de kan 干, un « outil » dont l’on se sert pour
l’attaque et la défense (une arme à double tranchant) et placé au dessus de kuchi 口, la bouche. C’est
l’aspect technique du langage qui est mis en avant ici, un instrument à double tranchant (mais pas
seulement) au service de la pensée réfléchie.
Ensemble, et c’est ce que redit chaque fois le composé hanashi (話), ils rappellent combien la prise
de parole en confidence est cette violence faite à soi-‐même et aux autres mais que l’on ne peut
retenir, et que l’on veut obtenir dans le cas du confident. Confident qui le devient ainsi pleinement,
en s’inquiétant. Cette violence nous arrache au « silence des choses » comme l’observait Merleau-‐
Ponty et elle signifie ici cette coupure douloureuse mais nécessaire au don de soi qu’est la
confidence. Car au sein du hanashi se trouvent présents à la foi la brisure, le piquant ou le perçant de
ce que l’on délivre dans l’énonciation par rapport à ce qui le précède diachroniquement (ce qui se
traduit par l’initiative du locuteur), une violence faite aux sujets impliqués demandant efforts de la
part de l’une et écoute de la part de l’autre, et un risque couru par chacun car, n’oublions pas, l’arme
est à double tranchant.
25 Comme tous les idéogrammes précédents, celui-‐ci a plusieurs prononciations et sens dans le langage courant, tels que gen, gon, gin, kotoba, ware etc… Je n’ai choisi koto que par convention et parce qu’il représente une prononciation japonaise vernaculaire qui n’est donc pas dérivée d’une prononciation chinoise modifiée.
14
Ainsi, le hanashi, depuis sa nouvelle genèse que représente et incarne sa symbiose avec le
himitsu ou le uchiake des paragraphes précédents, ne signifie pas seulement le « discours » sur le
« contenu » que serait le secret reçu ou donné. Plutôt, il s’associe pour former une nouvelle notion
que l’on ne peut comprendre que comme la confidence, impliquant une certaine mise en scène du don
et qui aurait sa traduction littérale dans ce qui spatialement, formellement et chronologiquement
apparaît avec le himitsu no hanashi et le uchiake banashi, traduction que l’on pourrait qualifier de
« mode » particulier du don26.
26 Ce qu’il faut retenir également, c’est que cette violence que nous venons d’invoquer avec le hanashi ne se donne pas n’importe comment, elle n’explose pas, elle ne balbutie pas non plus. Dans le cas de la confidence, elle est maitrisée et donnée par la grâce d’une pudeur aux aguets et qui, de sa nature policée, ordonne la pensée (n’oublions pas l’aspect réfléchi du hanashi).
15
Cas d’étude
Le Yunazu : l’allégorie du bain japonais
Voyageons pour finir dans l’espace et le temps et illustrons l’ensemble du propos avec une
œuvre de l’époque d’Edo à peine naissante27 qui s’intitule Yunazu (湯女図). Comme très souvent en
Asie et à cette époque, les auteurs apparaissent rarement et ce sont les écoles qui signent les
œuvres.
Auteur inconnu, Yunazu(湯女図 ), peinture sur rouleau mural de 72.5×80.1, début du 17ème siècle, période Kanei, époque
d’Edo28, école du modernisme. Musée de Shizuoka.
27 L’époque d’Edo (江戸時代,appelée aussi « de fermeture » ou « âge d’or »), période de stabilité sous le règne de la famille shogunale des Tokugawa (徳川), s’ouvre en 1603 pour se finir en 1867-‐1868 lors de la chute du Shogunat, entrainant le retour de l’empereur (Meiji, 明治天皇) sur le devant de la scène politique ce qui est synonyme, pour les livres d’histoire, du début de l’ère industrielle et de la « modernité » au Japon. 28 La période Kanei (寛永年間) s’étend du 30 février 1624 au 16 décembre 1664 et correspond plus au moins au règne du 110ème empereur Gokômyô (後光明天皇) qui court de 1633 à 1654.
16
Yunazu signifie littéralement une peinture (図) représentant les dames (女) du bain (湯)29 30.
Tout comme Sôtatsu31 et beaucoup de leurs contemporains, l’artiste du Yunazu renoue avant lui
avec certaines techniques de l’époque Heian32 notamment concernant l’utilisation de la feuille d’or. Il
jouit alors d’une grande liberté et n’appartient ni à l’école de Kano qui reprend les thématiques
naturelles et monumentales, ni à celle de Tosa qui elle s’intéresse à la narration et au yamato-‐e33. Il
est important, pour comprendre comment la confidence fait son entrée dans le Yunazu et contre
toute attente compte tenu du style de l’époque, de remettre cette œuvre dans le contexte de l’ère
du bakufu34 des Tokugawa. Les œuvres précédents l’époque d’Edo et présentant des scènes de bain
sont assez caractéristiques l’une de l’autre en ce sens que des foules y sont toujours représentées,
que beaucoup d’importance est attachée au monumentalisme de la Nature, des hommes et des
femmes ou à la narration du quotidien. On y trouve des scènes explicites de la vie quotidienne
mélangeant ainsi une multitude de petits détails sur le support, et où le décor comme le paysage ont
une place prépondérante dans l’œuvre et dans le vocabulaire des artistes. Or, le Yunazu marque une
rupture assez significative avec cette tradition car le paysage disparaît complètement, les scènes de
foule se réduisent au minimum signifiant, et les détails de la vie quotidienne ne sont plus figurés
mais évoqués, jouant ainsi plus sur la subtilité des rapports interindividuels et une exploitation plus
intense de l’espace d’indétermination nécessaire à tout dialogue entre l’œuvre et son public. Or
l’époque d’Edo est caractérisée par un raffinement exacerbé et une codification de plus en plus
stricte et complexe des rapports sociaux et ce à tous les niveaux de la société japonaise35. Il sera
donc naturel de voir les arts s’intéresser à ces dynamiques interindividuelles et sociales, mais à
l’époque du Yunazu, le pouvoir des Tokugawa est encore jeune et cette période se démarque par une
grande liberté dans les arts que les artistes, dont les dissidents du machi-‐eshi36, sauront exploiter en
devenant en quelque sorte cette avant-‐garde d’un goût pour ces situations discursives et sociales
singulières.
Premièrement et techniquement, la vacuité du fond est une première tentative pour diriger le
regard du spectateur sur le peu de personnages présents alors qu’il voyageait dans les œuvres
précédentes de groupes en groupes. La différence d’avec les peintures relatives au genre est que
nous avons ici une focalisation sur un événement unique à l’intérieur duquel se retrouve la multitude
de la tradition, incarnée par les différentes poses et dynamiques du corps des jeunes femmes. Les
mœurs et leurs importantes modifications à l’époque d’Edo deviennent une des préoccupations
29 Le dernier idéogramme que nous interprétons comme bain veut dire littéralement « eau chaude » et vaut en fait ici pour les onsen (温泉) japonais, sortes de bains publics dont l’usage est encore très répandu de nos jours et ce quelle que soit la catégorie sociale. 30 Le thème des bains est un thème classique de l’art japonais et cette représentation peut être reconnue comme étant une transition, une rupture plus exactement dans le style autour de cette époque. 31 Artiste réputé de cette période, ayant inspiré le mouvement ukiyo-‐e. 32 L’époque d’Heian (平安時代) marque le déplacement de la capitale du Japon impérial à Heian-‐Kyo, l’actuelle Kyôtô, en 794 par le 50ème empereur du Japon Kammu (桓武天皇) et s’achève en 1185 avec l’avènement de l’époque Kamakura et du shogunat (dite du bakufu, littéralement « sous la tente » instituant la prédominance du pouvoir militaire du shogun sur celui impérial basé à Kyôtô). 33 Ces deux écoles marquent profondément l’époque et sont proches du pouvoir shogunal et impérial. L’auteur du Yunazu, quant à lui, a probablement fait parti d’un courant non conventionnel de cette époque, le machi-‐eshi qui pourrait correspondre à une forme d’avant-‐garde de part sa nature novatrice et marginale, née dans la bourgeoisie citadine d’Edo (actuelle Tôkyô). 34 Voir note 27. 35 La peinture n’y fera pas exception et dès la fin du 17ème siècle les codes sont durablement inscrits et reproduis par tous les artistes. 36 Voir note 33.
17
centrales pour ces artistes qui vont peindre, comme dans le cas du Yunazu, des moments volés de
communication très précis.
Deuxièmement, et pour en finir abruptement avec la comparaison chronologique, ce que l’artiste
dessine ici des femmes représentées est un changement social et statutaire important car ce sera le
seul dans le statut de ces femmes que l’on employait aux bains. Avant la période d’Edo, elles
portaient à la manière des hommes un pantalon blanc nommé Hakama surmonté d’une tunique aux
manche amples et béantes sur les côtés. De plus, elles avaient pour fonction de procéder à la toilette
des hôtes et d’offrir quelques menus plaisirs aux hommes pendant leur bain. Dans l’œuvre au-‐
dessus, nous voyons que les femmes ont troqué leur hakama et leur tunique pour un Kosade,
l’ancêtre du kimono moderne, tenu à la taille par quelque chose ressemblant à un Obi37. La
particularité de ce kosade était d’avoir des manches bouffantes dont l’orifice au niveau du poignet se
resserre autour du membre supérieur. Il y a dans le symbolisme de la manche tout un vaste champ
d’étude au Japon mais nous nous bornerons à relever ce détail pour la suite38. On sait déjà à l’aide de
ces signes et de ce changement officialisé de statut et de fonction, figuré par l’œuvre, que les Yuna
(appelons-‐les comme cela) ne sont plus de simples employées attachées à de basses fonctions mais
deviennent de véritables compagnes, assistant les hôtes lors des services du thé, extrêmement
importants au Japon, et de la table.
Enfin, il y a l’interprétation de ces signes qui indiquent quantité de détails significatifs autour du
thème, disons-‐le enfin, de la pudeur et de l’arrêt sur image d’une confidence en train de naitre. Tout
d’abord, les scènes de bain traditionnelles représentent les personnages nus ou à demi nus. Ici, c’est
différent, on veut transmettre quelque chose de cette pudeur raffinée par l’habit, la composition
graphique et la position des personnages.
Cette pudeur raffinée fleurie sous l’impulsion des Tokugawa lors d’Edo avec l’habit dans un premier
temps et le corps que l’on couvre, celui que l’on cache avec le kosade derrière de larges pans de tissus
aux dessins rivalisant de beauté. On transpose la naturelle beauté du corps en arrière-‐plan et on le
devine à grande peine, à l’aide du rappel gracieux des avant-‐bras des yuna placées à gauche, tant
l’artifice du génie humain occupe et recouvre de motifs ces corps autrefois dénudés. On veut ainsi et
comme nous l’avons remarqué, à travers cette peinture, montrer un peu de ce nouveau statut que
les Yuna obtiennent en tant que compagnes. Mais ce changement de statut révèle un point
important pour notre propos : ce sont des compagnes qui deviennent dépositaires de secrets plus
importants de part leur fonction.
C’est ce que l’on peut voir dans le choix pris de ne pas les dessiner au travail (composition
graphique), comme dans les œuvres antérieures ou contemporaines, mais en train d’y aller. C’est
tout à fait nouveau et cela signifie beaucoup pour notre propos39. Car, et les détails précédents nous
37 Ceinture typique des kimonos japonais. 38 Ainsi, dans le Genji monogatari, du Prince qui danse pour la court, réalisant de magnifiques figures avec ses manches afin de charmer la princesse en lui dessinant son affection, ou encore ces manches d’une « robe de Chine » qui « pleurent » ou qui s’interposent afin de « maintenir la distance » (Livre VI), ou même ces autres qui accablées se « chargent » de « boue » (Livre IX)… 39 Car nous nous intéressons aussi à cette pragmatique de la communication confidentielle qui nous fait nous interroger sur l’importance du contexte, de ce qui spatialement, formellement et chronologiquement apparaît avec la confidence.
18
le reconfirment, les foules que l’on avait l’habitude de dessiner nous indiquaient bien plus qu’un
style : c’est un mode de vie qui place la communauté40 au premier plan de tout souci de la pensée
individuelle. Indiquons pourquoi la substitution de la focale du travail par celle du déplacement vers
le travail est importante ici en observant la composition du Yunazu : les yuna de gauche regardent
presque sévèrement ou intriguées celles de droites. Leurs bras dénudés sont comme en train de se
préparer à pénétrer dans le onsen pour se mettre au travail, et elles semblent invectiver du regard les
retardataires qui, lascives au centre et afférées à droite, sont continuellement soumises à ce regard
symbolisant la communauté. Symbolisé par la ou les foules auparavant, c’est le jeu des interactions
sociales visuellement exprimées ici qui réfère cette fois-‐ci à la communauté. Les yuna du centre
quant à elles indiquent le sens de la marche, formant un mur protecteur pour celles de droite et sans
savoir ce qui se trame derrière elles. Enfin, ce que l’auteur du Yunazu montre avec les yuna de droite
est précisément cette césure du hanashi dont nous parlions tantôt, mettant en scène uchiake et
himitsu. Les yuna de droite forment déjà graphiquement comme une enclave en forme d’ovale,
d’œuf, protégée des oreilles indiscrètes. Ce sont les seules du tableau à se livrer à un échange verbal,
et pour cause : c’est la multitude et la foule qui les attendent bientôt et qu’elles viennent à peine de
quitter. Il n’y a que très peu d’espaces et d’occasions pour se livrer des secrets. Cette marche
nonchalante en direction de leur lieu de travail, c’est précisément l’occasion de se livrer à des
confidences, parfois même sur les confidences reçues de part leur fonction. On peut présumer que
toutes peuvent échanger sur des secrets que les clients leurs livrent à tout moment, mais profiter
d’une occasion occlusive comme celle représentée ici fait montre d’un secret particulier qu’on ne
veut pas livrer à toutes, quelque chose qui implique le soi plus profondément et que l’on n’ose livrer.
Le regard de ces Yuna n’est pas plissé, espiègle ou sévère : quelque chose les affecte et doit se livrer
avant que d’entrer dans le onsen. Leur statut de confidente provoque ainsi comme une mise-‐en-‐
abîme et une infraction relative du code de la confidence qui, censée être le secret partagé entre
confieur et confident, circule. Mais là se trouve un exemple illustrant profondément ce que nous
entendions plus haut sur l’absence d’importance du contenu de la confidence : même dans le cas
d’une confidence reçue et que l’on fait circuler, cela sera tout de même une confidence si l’opération
entre confieur et confident réalise par l’intercession d’une pudeur partagée la rencontre entre un
trouble personnel qui veut se risquer (mais ne sait se dire) et une attention curieuse. Et le génie de
cette œuvre et de tout de même placer graphiquement et stylistiquement cette infraction du code
de la confidence dans une situation confidentielle, quel que soit le secret partagé d’ailleurs (qu’il
concerne les clients ou bien l’une d’entre elles). Le fond d’or redouble cette absence du monde
environnant qui devient l’espace privé nécessaire à la confidence : comment se faire des confidences
s’il en allait autrement ? Car même à la faveur de nuits discrètes, ces yuna ne sont jamais seules.
Mais bien plus qu’en posant une confidence qui se livre41, c’est surtout en gardant è l’esprit ce qui
40 Sans avoir ni le temps ni l’espace de ce que l’on devra postuler comme une nécessaire remise en cause, pour notre pensée, des notions de l’intime et de l’individu, précisons seulement que les moments d’existence (mais pas « d’être », c’est souvent l’erreur interprétative conçue par les observateurs occidentaux du « communautarisme » japonais) de l’individu, et c’est encore assez prégnant au Japon de nos jours, sont ses moments d’existence communautaire. La solitude et l’isolement sont donc doublement tragiques en ce sens qu’ils ne privent pas seulement l’individu de tout contact mais aussi de toute raison d’exister, sociologiquement parlant. 41 Car enfin pourrions-‐nous trouver des moyens d’interpréter ce fragment d’image comme un secret que l’on échange sans nécessairement qu’il ait l’aspect sensible, tremblant et risqué de la confidence comme nous l’avons décrit plus haut.
19
attend les Yuna que nous obtenons de précieuses informations sur le statut confidentiel de
l’échange : bientôt, à deux pas, un monde de silence et d’écoutes justement des confidences que les
clients seront tentés de livrer les attend. L’avant est un moment précieux, court, comme pressé (par
les deux Yuna de gauche et leur regard quasi réprobateur) avant que d’assurer un rôle qui,
normalement volontaire, est comme fonctionnalisé et institué au sein d’une profession quasi idoine
(en tous cas, qui le devient de part la transformation du rôle des Yuna).
Enfin la position des yuna nous donne encore d’autres informations. Nos yuna sont comme figées
« entrant en confidence » avant que d’entrer dans la confidence des clients, avec cette menace
palpable arrivant de l’ouest, celle d’être découvertes, et elles le font de manière tout à fait intrigante
et qui choque l’habitude que l’on a d’imaginer la confidence comme se faisant en un lieu retiré. Ici,
l’artiste montre aussi que ce besoin de se livrer est impérieux et qu’il profitera de la moindre
occasion, lorsqu’il n’y a plus le choix autant en soi qu’autour de soi, pour se livrer à la recherche
passionnément prudente d’un confident attentif.
Un dernier élément graphique attire notre curiosité : les manches, dont nous avons évoqué
l’importance symbolique dans la culture japonaise, nous disent autre chose de ces yuna. Si l’on y
prête attention, on remarquera qu’aucune manche n’est exhibée à part celles des yuna placées à
droite. Ces manches que l’on ne voit pas sont autant de retraits silencieux sur soi-‐même. En
revanche, celles des yuna forment une enclave, sont dressées et l’on voit même l’orifice de l’une
d’elle. Les bouches sont cachées et ce sont les manches, royaumes d’expressions diverses et quasi
médiateurs de l’âme et du cœur au Japon, qui s’unissent et forment comme une phase ondulatoire
mathématique, allégorie picturale de l’ishin-‐denshin de la tradition bouddhiques énoncée plus haut.
Il y a à n’en pas douter une intimité certaine entre ces yuna, que stigmatise l’apparente distance
entre toutes les autres, et la beauté de l’œuvre se trouve selon moi dans le doute maintenu entre qui
confie et qui reçoit la confidence. Il y a à l’évidence une pure confidence, à savoir l’essence même du
processus qui ne peut que se réaliser au moment de la rencontre et dans la façon qu’elle aura de
déployer les conséquences de cette rencontre sur les partenaires. Car même lorsque on se « confie »
à un journal intime ou à une machine, on ne le fait jamais qu’avec soi-‐même qui devient ce faisant
l’alter ego nécessaire à l’actualisation du processus confidentiel. Soi-‐même devenant, ainsi, un
Autre, pour paraphraser Ricoeur. Cette attention et ce souci de l’indétermination signifiante sera
précisément une des caractéristiques essentielle du style que manifeste le Yunazu. Une attention à
la relation plus qu’aux objets de la relation y est intensément présente. Quelque chose est transmit
certes, mais cela s’arrête là, et l’objet est sans intérêt. Car ce n’est pas uniquement ce qui est
transmit qui importe mais la manière, le mode spatial, formel et chronologique du don et de sa
réception.
20
Conclusion
La confidence: mode et fonctionnement dialogique
Ainsi, nous comprenons avec le maintien des différents termes en japonais que le secret ne
recouvre pas la confidence, mais que la confidence fait toujours état d’une chose secrète au sens
d’intime42.
Il lui faut cependant l’art et la manière, c’est à dire une certaine mise en scène pour accéder à
l’efficace d’une confidence, que l’on ne doit pas confondre avec une stratégie au sens strict. Il y a
aussi un consentement nécessaire de part et d’autre de la confidence sans quoi la confidence ne
peut se réaliser complètement. Et le fait même que celui qui confie l’espère dans le confident
occasionnel est un indice qui nous montre à quel point, une fois trouvé, le confident boucle ce
processus en le transformant et en l’actualisant comme une confidence.
L’art et la manière quant à eux, ne sont donnés ni par le bon goût, ni par un certain savoir-‐vivre,
mais plutôt par cette pudeur de tout un chacun et que saura reconnaître le confident, pudeur qui
saura également intéresser ou intriguer ce dernier le rendant ainsi disponible à l’écoute. Les modes
de la pudeur étant aussi variés que les individus eux-‐mêmes, c’est dans la reconnaissance de pudeurs
qui se ressemblent que la confidence passe d’un cœur à l’autre. Sans ce mode particulier qu’est la
confidence fonctionnalisé par des pudeurs qui se ressemblent, le secret devient autre chose : un
aveu, une confession, il rentre dans l’efficace d’un autre mode. Mais cet ensemble doit rester
inachevé quand celui qui se confie se risque. C’est la source même de l’angoisse qu’illustre le risque
dont nous parlions tantôt au sujet des profondeurs de l’être.
Ce mode si particulier n’est donc qu’à l’état de potentiel lorsque pris isolément et ne représente
qu’une ouverture et un espace bien apprêté en vu de la réception de ce qui sera confié. C’est à ce
moment, celui de la réception, que l’ensemble précité se catalyse, qu’il devient système, ouvert et
dynamique. Car c’est au confident d’intervenir afin de pouvoir comprendre cette modalité du don
comme une confidence43.
On sent à quel point déjà une idée du dynamisme et du dialogisme profond de la confidence
en japonais, du jeu inaliénable entre énonciateur et confident qui viderait de son sens les termes
42 Cette intimité n’est pas à confondre avec quelque chose qui n’est que présent et relatif à la personne qui se livre. L’intime semble évidemment lié à la confidence mais il me semble que, dans le cas du contexte japonais, il ne faut pas le négliger et le prendre pour argent comptant. Car l’intime signifie bien plus loin que la personne elle-‐même prise en tant qu’individu, il a, comme nous l’avons vu, une réalité propre qui s’actualise entre les individus au niveau des affects. S’approprier toute la complexité de l’intimité en japonais demanderait au préalable, comme nous le disions, de redéfinir les notions même d’individu et d’individuation. Disons au sujet de l’intime qu’il est ce qui affecte profondément la personne, et ne définissons pas plus au risque de dénaturer la signification. Cette charge individuelle ajoutée au secret se délivre de ses tensions propres au sein d’un aménagement particulier de l’interaction dont la pudeur est l’opérateur et que nous avons identifié, en tant qu’ensemble, comme un mode. 43 . Prenons un exemple simple avec la phrase : « j’ai eu d’innombrables conquêtes étant marié(e) ». Elle pourra être perçue comme et devenir une confidence, une confession ou même un aveu selon qu’elle est reçue par un ami proche aux mœurs volages, un homme d’église ou tout individu que nous tenons pour représentant un ensemble de valeurs que nous possédons et que nous avons le sentiment d’avoir enfreints, ou bien enfin son propre compagnon ou sa propre compagne.
21
eux-‐mêmes s’il venait à être ignoré, à quel point donc ces tensions sont présentes pour nous
indiquer l’importance de la communication, de la communion dans la confidence. Car ce dialogisme
profond ne doit pas souffrir pour être compris de ce que l’on voudrait lui faire dire par habitude :
l’origine et le code du message ne se trouvent pas au niveau de la langue mais bien à celui plus
profond des tensions affectives et de la reconnaissance pudique.
Related Documents