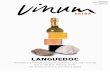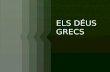FROM THE PILLARS OF HERCULES TO THE FOOTSTEPS OF THE ARGONAUTS Edited by ANTOINE HERMARY and GOCHA R. TSETSKHLADZE COLLOQUIA ANTIQUA ————— 4 ————— PEETERS LEUVEN – PARIS – WALPOLE, MA 2012

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
FROM THE PILLARS OF HERCULES TOTHE FOOTSTEPS OF THE ARGONAUTS
Edited by
ANTOINE HERMARY and GOCHA R. TSETSKHLADZE
COLLOQUIA ANTIQUA————— 4 —————
PEETERSLEUVEN – PARIS – WALPOLE, MA
2012
93773_Hermar_voorwerk.indd III93773_Hermar_voorwerk.indd III 1/06/12 11:111/06/12 11:11
TABLE OF CONTENTS
Series Editor’s Preface Gocha R. Tsetskhladze . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII
Introduction Antoine Hermary and Gocha R. Tsetskhladze . . . . . . . . . IX
List of Abbreviations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
List of Illustrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV
Part 1Greeks and Celts in Provence and Languedoc before Roman Rule
CHAPTER 1 Greeks and Natives in South Gaul: Relationship, Accul- turation and Identity Michel Bats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CHAPTER 2 Greeks, Celts and Ligurians in South-East Gaul: Ethnicity and Archaeology Sophie Collin Bouffier and Dominique Garcia . . . . . . . . 21
CHAPTER 3 Demographic Analysis of Pre-Roman Populations near the Greek Colony of Massalia (Southern France) Delphine Isoardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
CHAPTER 4 The First Century of Massalia: Foundation, Arrival of Migrants and Consolidation of a Civic Identity Adolfo J. Domínguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
CHAPTER 5 Topography and Town Planning in Ancient Marseilles Henri Tréziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
CHAPTER 6 Lakydôn, dieu ou héros indigène dans Marseille grec- que Antoine Hermary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
CHAPTER 7 Celts and Greeks: The Fight for Massalia in the Last Three Centuries of Her Independence. New Thoughts about the Chora Loup Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
93773_Hermar_voorwerk.indd V93773_Hermar_voorwerk.indd V 1/06/12 11:111/06/12 11:11
VI TABLE OF CONTENTS
CHAPTER 8 Grecs et Celtes en Languedoc Thierry Janin et Michel Py . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
CHAPTER 9 D’Agde à Béziers: les Grecs en Languedoc occidental (de 600 à 300 av. J.-C.) Daniela Ugolini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Part 2From Etruria to the Black Sea
CHAPTER 10 Demaratus of Corinth and the Hellenisation of Etruria David Ridgway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
CHAPTER 11 Sur l’urbanisme à Istros Petre Alexandrescu (†). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
CHAPTER 12 Scène de tragédie sur une hydrie de Prague: Clytemnèstre et Cassandre ou la Danaïde Hypermèstre et son époux? Jan Bouzek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
CHAPTER 13 Céramiques à figures rouges d’Apollonia du Pont, décou- vertes anciennes et récentes Antoine Hermary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
CHAPTER 14 Les ateliers primordiaux de coupes ioniennes à la lumière des trouvailles de la mer Noire Pierre Dupont et Vasilica Lungu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
CHAPTER 15 Contribution à la prosopographie externe des cités grec- ques et des peuples indigènes du nord et de l’est du Pont- Euxin Alexandru Avram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
CHAPTER 16 Pots versus People: Further Consideration of the Earliest Examples of East Greek Pottery in Native Settlements of the Northern Pontus Gocha R. Tsetskhladze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
List of Contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
93773_Hermar_voorwerk.indd VI93773_Hermar_voorwerk.indd VI 1/06/12 11:111/06/12 11:11
1 Roure 2004.2 Jacobsthal et Neuffer 1933.3 Jannoray 1955.4 Py 2003.
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC
Thierry JANIN et Michel PY
AbstractIn Languedoc, the relations between Greeks and the indigenous population manifest themselves differently from those in Provence. The texts offer much less evidence about the Greek presence and they suggest the existence of only two Greek settlements – Rhodanousia on the Rhône, certainly Espeyran at Saint-Gilles, founded in the late 6th century BC; and Agde on the Hérault, which from the late 5th century BC onward marked the border of Marseilles’ exclusive commercial domain. One should remember that, throughout this period, the natives had more partners than just the Greeks – in the Archaic period, they enjoyed close relations with the Phoenicians and the Etruscans, and later, in the Second Iron Age, those in the western part of the region had contacts with the Iberians. A strong local tradition and then the emergence of powerful political structures of the indigenous peoples predefined the limits of the Greek influence in the various regions of Languedoc, where, until the Roman conquest, the specific relations with the Greeks of Marseilles and Emporion developed and fell apart.
Les relations entre les Grecs et les ‘Celtes du Languedoc’ ont retenu l’attention des chercheurs depuis bien longtemps1 et ont fait l’objet de positions extrêmes et opposées, entre les tenants d’une présence grecque massive dans cette partie de la ‘Gallia Graeca’,2 et les vues plus sceptiques d’un Jannoray par exemple, à la suite de l’analyse des données d’Ensérune.3 Encore faut-il préciser quels Celtes et quels Grecs.
Par Celtes on entendra ici (évidemment) les populations indigènes occupant le littoral méditerranéen entre Rhône et Pyrénées, sans entrer dans la problé-matique de la celtisation du Midi de la Gaule qui constitue un autre thème de recherche largement débattu. On considère en effet aujourd’hui que cette région fait partie dès la fin de l’âge du Bronze de ce que l’on pourrait appeler les zones celtiques périphériques (au même titre d’ailleurs que la Provence et la Ligurie), nonobstant des apports continentaux sporadiques au cours de l’âge du Fer dont l’importance et le rôle restent discutés.4 Quant aux Grecs, il s’agit
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14193773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 141 1/06/12 11:201/06/12 11:20
142 THIERRY JANIN – MICHEL PY
5 Morel 1975.6 Verger 2000.7 Louis et al. 1958, 62 et 69.8 Taffanel et Taffanel 1956; Jully 1983, I, 464.9 Nickels et al. 1981; Nickels 1983.10 Mazière et Gomez 2002, 120.11 Mele 1979; 1986.
(évidemment aussi) principalement des Phocéens, bien que d’autres aient été envisagés pour début de la période, tels les Rhodiens sur la base d’allusions textuelles que l’archéologie n’a pas permis de confirmer,5 ou les Corinthiens récemment invoqués à partir de quelques offrandes occidentales de Pérachora.6
Les sources historiques concernant la présence, l’installation et l’action des Grecs en Languedoc sont beaucoup plus réduites qu’en Provence, où la fonda-tion et le rôle de Marseille ont focalisé l’attention des auteurs antiques. Dans cette région, deux établissements (ktiaçsmata) seulement sont formellement nommés: Agde et Rhoè/Rhodanousia ‘que baigne le grand fleuve Rhône’ (Pseudo-Scymnos 207–209) et dont Strabon (4. 1. 5) nous dit qu’ils ont été fon-dés comme ‘bastions avancés… du côté de l’Ibérie contre les Ibères’ et ‘contre les barbares qui habitent aux abords du Rhône’. Aucune autre allusion antique n’est véritablement exploitable sur la présence grecque dans cette région. C’est donc de l’archéologie principalement qu’il faut attendre un complément d’infor-mation. Nous examinerons dans cette optique quatre principaux dossiers.
LES PREMIERS CONTACTS
C’est au Languedoc qu’il revient d’avoir livré les plus anciennes céramiques d’origine méditerranéenne attestées en Gaule, nettement – antérieures à la fon-dation de Marseille, à savoir:
– un skyphos de la nécropole du Grand-Bassin I de Mailhac (Aude), coupe profonde de type protocorinthien avec décor de filets verticaux sur l’épaule.7 Des fragments d’une autre coupe ont été cités à Mailhac,8 mais il semble s’agir en réalité d’une coupe plus récente, sans doute de type ionien;
– trois skyphoi et une œnochoé de la nécropole du Peyrou à Agde (Hérault);9
– un skyphos de la nécropole du Bousquet à Agde, récemment découvert.10
On s’accorde à dater ces vases du milieu ou du troisième quart du VIIe s. et, du fait de leur isolement et de leur contexte de découverte (des tombes indi-gènes, parfois riches), à les rattacher à la pratique de la prexis, forme d’échange archaïque bien décrite par A. Mele.11 Cependant la provenance exacte de la
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14293773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 142 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 143
12 Nickels et al. 1981.13 Villard 1960, 74.14 Gras 2000, qui les rapproche de productions de Tarquinia.15 Jully 1983, 531.16 On renverra globalement aux inventaires dressés par Jully 1983.17 Formes 1/2 et 3A de Py et Py 1974.18 Dedet et Py 2006.19 Bats 1998.20 Taffanel et Taffanel 1970; Garcia et Orliac 1986; Garcia 1987; Dedet 1995.
plupart de ces pièces est encore sujette à discussion: grecques d’Italie du sud pour Nickels,12 elles seraient étrusques pour Villard13 et Gras,14 tandis que des travaux plus récents parlent de la Sicile pour l’une d’entre elles… Les hypo-thèses quant à l’identification des transporteurs ne sont pas moins nombreuses dans les études citées ci-dessus: Rhodiens, Corinthiens, Phocéens, Étrusques, et même Phénico-puniques.15 Ces possibilités, dont aucune ne peut être rejetée (ni acceptée) a priori, témoignent au demeurant de l’ouverture de la Méditer-ranée occidentale, en ce début de l’âge du Fer, à de multiples intervenants potentiels dont on analyse aujourd’hui l’action plutôt en terme de complémen-tarité que de concurrence. D’autres vases un peu plus récents peuvent être également évoqués:16
– des fragments de skyphoi de type protocorinthien de la grotte Saint-Véré-dème à Sanilhac (Gard);
– des skyphoi dits ‘rhodiens’, à bandes, à arêtes rayonnantes ou à rosettes de point: Grotte Suspendue à Collias (Gard), La Cartoule à Servian et La Monédière à Bessan (Hérault);
– quelques débris de coupes ioniennes A1: La Liquière (Gard), Tonnerre (Hérault);
– certains stamnoi et œnochoés de la nécropole de Pézénas dans l’Hérault.
Ces céramiques grecques de la fin du VIIe s. ou des environs de 600 sont relativement rares. En Languedoc central et oriental, elles sont accompagnées par un nombre bien supérieur d’importations étrusques, bucchero et surtout amphores de type ancien,17 ce qui a fait envisager un relais tyrrhénien plutôt qu’une intervention grecque ‘pré-coloniale’. Une telle conception reste à notre sens valide,18 même si la constatation de l’abondance des produits étrusques dans les couches du premier quart du VIe s. de Marseille a pu faire douter de l’existence d’un commerce étrusque autonome précédant l’interven-tion phocéenne.19 N’oublions pas que les importations étrusques de vin et de vases fins sont accompagnées d’une vaisselle de bronze relativement abon-dante (situles, bassins à rebord perlé, œnochoés) dont le prix fut certainement plus élevé.20
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14393773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 143 1/06/12 11:201/06/12 11:20
144 THIERRY JANIN – MICHEL PY
21 Arnal et al. 1972.22 Duval et al. 1974.23 Janin 2006.24 En dernier lieu Janin 2003.25 Guilaine et Rancoule 1996.26 Asensio et al. 2000.27 Bats 1999.
S’ajoutent encore plusieurs objets en bronze de typologie grecque ou ita-lique, traditionnellement datés entre le IXe et le VIIe s., telles que les fibules:21 mais le mode de diffusion de ces ustensiles, dont la dispersion est très vaste sur le territoire de la Gaule,22 n’est pas clair et pourrait être imputable à des relations internes au monde indigène, de la même façon que les productions métalliques originales recensées en Languedoc occidental, principalement dans les sépultures de faciès Grand Bassin I,23 à l’époque où commence dans cette zone un important processus de thésaurisation du bronze connu sous le terme de ‘Launacien’.24
Résumons la situation du Languedoc antérieure à la fondation de Marseille ou contemporaine de celle-ci: des importations grecques sont attestées, mais en nombre infime; plusieurs pourraient être des imitations étrusques, et renfor-cer l’idée de liens directs avec l’Étrurie, bien illustrés par les amphores et le bucchero, dans le cadre d’échanges limités et spécifiques touchant principale-ment la partie centrale et orientale de la région, de l’Hérault au Rhône, tandis que les Phéniciens, présents en Catalogne, s’aventurent jusqu’au Languedoc occidental,25 ultime étape de leur progression le long des côtes espagnoles.26 Il n’est pas exclu que les Grecs soient encore absents.
LE LANGUEDOC DANS L’EMPORIA ARCHAÏQUE:LES GRECS ET LES AUTRES
La fondation de Marseille, aux alentours de 600 av. J.-C., a longtemps été placée à l’origine du développement des réseaux commerciaux dans le Midi de la France et considérée comme le principal ferment de ‘structuration et de hiérarchisation’ des sociétés indigènes,27 les Phocéens nouvellement installés jouant dans cette optique un rôle quasiment exclusif dans l’acculturation des populations méridionales. Cependant, en Languedoc, les Grecs de Marseille furent loin de constituer les seuls interlocuteurs des communautés autochtones. D’autre part, considérer le Languedoc comme une entité culturelle uniforme, et donc les groupes qui le peuplent comme une seule et même composante anthropologique, équivaut à nier les particularismes géographiques et plus tard
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14493773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 144 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 145
28 Dedet et Py 2006.29 Py et al. 2006.30 Py 1985.31 Py et al. 1984.32 Gras 1993, 109.33 Gailledrat et al. 2002; Gailledrat et Solier 2004; Janin 2002; Marichal et al. 2003.34 Gailledrat 1997.
historiques qui ont marqué, depuis le Néolithique, les différentes parties de cette région.
Le cas du Languedoc oriental est en ce sens symptomatique: proche de la vallée du Rhône, cette zone aurait dû être touchée la première par le commerce marseillais; force est cependant de constater que les produits massaliètes n’y supplantent les marchandises étrusques qu’à partir de 525, voire plus tard.28 L’éventualité que le comptoir – l’emporion? – de Lattara ait été fondé par des Étrusques avant la fin du VIe s. av. J.-C. a été récemment envisagée.29 Dans le même contexte, et de façon complémentaire, les sites lagunaires de la région de Mauguio, qui ont livré de nombreux produits originaires d’Étrurie, ne sont abandonnés que vers 525:30 durant le VIe s., le rôle de ce réseau d’habitats comme point de départ d’une redistribution vers l’arrière-pays (notamment vers La Liquière en Vaunage)31 a déjà été souligné.32 Sur tous ces sites, cepen-dant, les produits grecs restent fort peu nombreux par rapport aux importations étrusques, ce qui laisse un doute sur l’importance réelle des trafics helléniques au VIe s. dans cette partie du littoral.
La situation est différente en Languedoc occidental où les rencontres ne sont pas uniquement étrusques ou grecques. On a rappelé ci-dessus que les produits phéniciens étaient présents dans cette zone dès avant 600: ils le restent au VIe s. à côté d’un mobilier étrusque quantitativement important. C’est ce que montrent les études récemment publiées.33 Mais surtout, c’est l’ambiance culturelle des séries étudiées qui tranche avec ce qu’on connaît au-delà de l’Hérault: le Languedoc occidental, à partir du milieu du VIe s. av. J.-C., peut assurément être rattaché au complexe Ibérique,34 et l’identité d’un faciès ibéro-languedocien est aujourd’hui difficilement discutable. Ce qui frappe en tout cas, c’est la diversité du mobilier livré par les sites ouest-languedociens, qui laisse supposer l’existence concomitante de partenaires multiples: Phéniciens, Étrusques, Ibères et, bien sûr, Grecs de Marseille et d’Emporion, mais aussi continentaux (Centre de la France, Atlantique).
La situation dans la vallée de l’Hérault, et plus globalement dans la zone Orb-Hérault, est plus délicate à appréhender dans la mesure où les publica-tions documentaires précises font encore largement défaut, si l’on excepte l’œuvre d’André Nickels. Il s’agit pourtant d’une zone d’interface dont la
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14593773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 145 1/06/12 11:201/06/12 11:20
146 THIERRY JANIN – MICHEL PY
35 Garcia 1993.36 Giry 1965; Nickels 1990.37 Jully 1983.38 Sourisseau 1997.39 Bats 2000.40 Py 1990a.41 Garcia 1993.
compréhension s’avère essentielle, comme l’ont montré des travaux récents.35 Et si, comme ailleurs, les produits grecs sont bien présents dans cette région à partir de la fin du VIe s., le mobilier recueilli sur les habitats et dans les nécropoles, comme par exemple à Saint-Julien de Pézenas (Hérault),36 témoigne également de la grande diversité des importations et soulève de multiples interrogations sur la part des intervenants potentiels à l’époque archaïque.37
Finalement, l’impression reste que cette période constitue une phase de compétition commerciale nettement plus ouverte en Languedoc qu’elle ne le fut en Provence, avec la mise en place de différentes zones d’influence dont la démarcation tendra ensuite à se renforcer.
LA MISE EN PLACE DES RÉSEAUX ET LA FONDATION D’AGDE
On s’accorde à reconnaître aujourd’hui – à la suite de recalages chronolo-giques concernant notamment les importations et les productions ampho-riques38 – que la fin du VIe s. représente une période charnière dans l’évolu-tion des rapports entre Grecs et indigènes en Gaule méridionale. Cette mutation, que l’on a eu tendance à attribuer de manière unilatérale à l’évolution de la situation de Marseille,39 concerne de fait tout autant la colonie phocéenne que les entités indigènes du Midi méditerranéen, suite à l’assimilation progressive des processus d’échange dans leurs propres pratiques et aux nouveaux besoins tant économiques que politiques que ceux-ci ont fait naître.40 Et, en même temps qu’elle a commencé à clarifier les étapes chronologiques du processus, la recherche archéologique, révélant la diversité des cas, a rendu nécessaire une régionalisation des problématiques, rendant de plus en plus insoutenable l’idée d’une évolution globale et uniforme.
Le Languedoc illustre bien cette nécessité, tant l’évolution des choses appa-raît aujourd’hui disparate selon les parties de cette région, entre Est et Ouest, mais aussi entre côte et intérieur. Pour faire bref, on distinguera principale-ment, sur le littoral méditerranéen du Languedoc, une zone orientale d’une zone occidentale, la ‘frontière’ entre ces deux entités géographiques ayant au demeurant pu varier au cours du temps entre Orb et Lez.41
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14693773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 146 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 147
42 Plutôt que vers 525, comme on l’admettait précédemment: cf. Dedet et Py 2006.43 Py 1990a; 1993.44 Py 1995.45 Py et al. 2006.46 Morel 1981.
Les résultats des recherches récentes en Languedoc oriental permettent aujourd’hui d’élaborer une hypothèse de travail sous la forme du scénario pro-bable d’un jeu de rôle tripartite entre monde indigène, Étrusques et Grecs de Marseille. Les choses commencent ici à changer à l’extrême fin du VIe s., disons autour de 500 avant notre ère.42 Trois phénomènes concomitants, concernant les trois principaux partenaires en présence, concrétisent en effet le début d’une nouvelle donne.
Premièrement, dans le monde indigène de l’hinterland, c’est l’apparition des premiers habitats construits en dur et fortifiés, ou la première installation, sous des formes encore parfois traditionnelles, sur des sites dont la stratigra-phie longue témoigne d’une incontestable tendance à la fixation de noyaux urbains sur un territoire donné: ainsi par exemple au Marduel près de Rémou-lins, à Nîmes, à Mauressip en Vaunage, à Villevieille ou à Gailhan sur le Vidourle. Les réalisations urbaines et les usages étant encore fortement empreints d’héritages, on s’est tourné vers une explication du processus sur des bases plutôt économiques que culturelles: ce serait l’augmentation signi-ficative du volume des échanges méditerranéens qui aurait joué comme un stimulus de l’évolution interne des communautés autochtones, incluant pro-gressivement dans leur projet la production de surplus négociables – comme le montre un développement significatif de l’agriculture céréalière et de l’élevage. D’où la nécessité de mettre en valeur des terroirs à long terme, gérés à partir d’habitats plus permanents; d’où également la naissance de conflits de voisinage liés à la protection des territoires et des biens, dont ren-draient compte les fortifications et la multiplication des armes; d’où proba-blement encore le renforcement de la position sociale des dirigeants locaux, dans leur double rôle de protection de la communauté et de contrôle des échanges.43
Le deuxième événement majeur de cette période est l’installation à Lattes, au débouché du Lez sur l’étang littoral, d’une communauté étrusque – peut-être originaire de Caere (Cerveteri) –, déjà soupçonnée à la suite des premiers sondages sur le site44 et confirmée de manière éclatante par les travaux récents.45 Cette installation physique d’Étrusques sur le rivage de la Gaule, prévisible au vu de la masse des apports d’amphores et de vaisselle recueillis sur les sites de la zone littorale,46 est désormais avérée, mais ni à l’époque où on l’attendait (à savoir le début ou le plein VIe s. où partout dominent les
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14793773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 147 1/06/12 11:201/06/12 11:20
148 THIERRY JANIN – MICHEL PY
47 Saint-Blaise: Bouloumié 1982.48 Py et Dietler 2003; Dietler et Py 2003.49 Barruol et Py 1978; Py 1990b.50 Py et Roure 2002.51 Barruol et Py 1978, 100.52 Bats 1986, n. 63.53 Ainsi dans la zone 27, celles-ci passent de 25% à 57% des vases de vaisselle entre le pre-
mier et le second quart du Ve s., tandis que les céramiques communes étrusques passent dans le même temps de 23% à 2%.
importations tyrrhéniennes), ni dans la zone où on l’avait supposée.47 Les fouilles des niveaux étrusques de Lattes n’en sont cependant qu’à leur début, et l’on ignore encore l’ampleur du phénomène: installation de quelques mar-chands lors de la création d’une ville indigène, ou bien véritable comptoir étrusque? La suite des travaux engagés le dira bientôt. On sait cependant dès maintenant que cette ville portuaire fut dès l’origine ouverte à des influences multiples, comme en témoigne l’équipement d’une statue de guerrier datable de la fin du VIe ou du début du Ve s. récemment découverte sur le site.48
La troisième donnée, toujours vers 500 av. J.-C., est la fondation, dans la même zone lagunaire et également au bord de fleuves, de comptoirs à forte connotation massaliète, dont on a un exemple sûr, celui d’Espeyran à Saint-Gilles, au bord du Rhône des Tourradons,49 et un autre exemple probable (bien que les niveaux de fondation n’aient pas été atteints), celui du Cailar au sud de la Vaunage, à la conjonction du Vistre et du Rhôny.50 On a supposé qu’Espey-ran pouvait correspondre au comptoir massaliète de Rhoè/Rhodanousia cité par les textes antiques, ‘ville du domaine de Marseille’ (Étienne de Byzance s.v.) ‘que le grand Rhône baigne de ses eaux’ (Pseudo-Scymnos 209),51 ce qui a été contesté sur des arguments culturels,52 mais reste actuellement à notre sens une hypothèse tout à fait valide.
Pour comprendre la signification historique, en quelque sorte, de ces données, il faut s’intéresser à ce qui se passe dans les décennies suivantes. Vers 475, l’habitat étrusque de Lattes est détruit apparemment avec violence, les maisons sont incendiées, arasées et bientôt remplacées par d’autres très différentes aussi bien par leurs techniques de construction que par leur plan et le mobilier qu’elles livrent, désormais dominé par les importations massaliètes (amphores et vais-selle fine). Ce changement de faciès présente une rapidité et une radicalité sans comparaison dans les autres sites régionaux, où les mutations s’effectuent d’or-dinaire de manière beaucoup plus évolutive. Tout se passe – du point de vue de la documentation archéologique – comme si les Massaliètes avaient chassé les Étrusques de Lattes, apparemment de manière brutale, peut-être avec l’alliance des indigènes de la région comme pourrait l’indiquer une forte remontée des céramiques non tournées locales dans le mobilier domestique.53 Le caractère
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14893773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 148 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 149
54 Py 1999.55 Bats 2004, 52.56 Nickels 1983.57 Tels que Béziers, Montlaurès ou Pech-Maho: Ugolini et al. 1991; Ugolini et Olive 1998;
Gailledrat et Solier 2004.58 Nickels 1995; Garcia 1995.59 Passelac et al. 1990.
massaliète du faciès lattois ne fera que se renforcer dans les périodes suivantes,54 tandis qu’Espeyran et le Cailar continuent de livrer un mobilier dominé de manière écrasante par les produits de Marseille.
On ne manquera pas d’évoquer, dans la suite de ces événements, la fonda-tion de la colonie d’Agde, sur un site occupé depuis le début du VIe s. par ‘un habitat indigène’55 largement ouvert au commerce méditerranéen, où l’on a voulu voir, abusivement, un établissement phocéen indépendant de Marseille.56 C’est vers 425, selon les indications des fouilles récentes (c’est-à-dire un demi-siècle après la prise en main de Lattes), que Marseille installe à Agde une colonie, dont Strabon indique clairement le rôle de protection contre les Ibères qui habitent au-delà. Le mobilier d’Agde, jusque-là comparable à celui des autres débarcadères ou sites d’interface de la zone occidentale du Languedoc,57 avec une réelle diversité d’approvisionnement (étrusque, ibéro-punique, mas-saliète et régional), prend dès lors une coloration spécifiquement massaliète (amphores et vases à pâte claire notamment).58
Si l’on relie cette fondation aux données précédemment évoquées, on per-çoit bien le mouvement général qui se dessine tout au long du Ve s.: après avoir conforté sa position en Provence, Marseille prend pied à l’orée du siècle en Languedoc, aux environs du Rhône, où elle participe probablement (sous une forme qui reste à définir) à la création d’Espeyran et peut-être du Cailar. Mais depuis un siècle déjà, cette région est l’une de celles où les Étrusques sont les mieux implantés, présence renforcée encore par l’occupation du vaste comptoir de Lattara. Tout se passe comme si cette installation effective avait contrarié les ambitions de Marseille, tandis qu’à partir de 475 l’élimination des Étrusques de Lattes ouvrait pleinement la route vers le reste du Languedoc. C’est dans le fil de ce mouvement de contrôle progressif de la côte que se place évidemment la création d’une colonie à l’emplacement du comptoir indi-gène d’Agde, que les commerçants Marseillais devaient connaître pour l’avoir auparavant fréquenté.
Bien que présentée comme un ‘rempart’ par les sources, Agde ne constitua pas la limite de l’action maritime massaliète, qui s’étendit au moins jusqu’au Roussillon, si l’on en croit la diffusion de ses amphores59 – encore qu’il soit toujours délicat de considérer les Massaliètes comme les seuls transporteurs
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 14993773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 149 1/06/12 11:201/06/12 11:20
150 THIERRY JANIN – MICHEL PY
60 Notamment de céramique attique: Jully 1980.61 Sanmarti 1992.62 Gailledrat et al. 2002.63 Jully 1980; Dubosse 2004.64 Nickels 1990.
possibles –, mais bel et bien la limite de son domaine d’influence, de cette ‘massaliotide’ dont nous parlent les textes, où la colonie phocéenne devenue métropole d’Occident imposa de la fin du VIe s. à sa chute un monopole quasi absolu sur les échanges. On a dit qu’au-delà se tenait le domaine d’Emporion, compte tenu des parallélismes relevés dans le rythme des importations de la zone occidentale du Languedoc et du comptoir catalan,60 compte tenu égale-ment des destinées divergentes des deux cités grecques.61 Mais au-delà se tenaient surtout les Ibères, dont les recherches récentes tendent à valoriser l’im-plication dans le commerce maritime et la présence active sur le littoral: et c’est bien comme poste frontière en face des Ibères que Strabon identifie Agde.
Reste à voir ce qui se passe à cette même époque au-delà de l’Hérault, en Languedoc occidental, dans le domaine ibéro-languedocien. L’archéologie a montré depuis longtemps que cette région avait été très tôt marquée par ses relations avec le monde phénico-ibérique, puis intégrée dans le complexe ibé-rique. Les habitats du Languedoc occidental suivent à partir de 525 un proces-sus de structuration parallèle à celui observé dans la partie orientale, qui se marque notamment par la réoccupation massive des hauteurs et l’érection de remparts puissants, comme on l’a relevé par exemple au Cayla de Mailhac.62 De nombreuses agglomérations nouvelles sont également créées, ce qui indique ici également que les communautés se regroupent et achèvent leur totale sédentarisation.
C’est à cette époque que les produits marseillais font leur apparition aussi bien dans les habitats que dans les sépultures, d’abord en petit nombre, puis plus massivement à partir de 475. Pour autant, le lien entre les deux observa-tions est loin d’être évident, comme l’ont montré les études sur la céramique attique diffusée dans cette région,63 qui témoigne d’un faciès, de quantités et de rythmes beaucoup plus proches de ceux observés à Emporion qu’à Marseille.
Il faut aussi tenir compte de l’implication des Indigènes du bassin audois (ces mercenaires élisyques dont parle Hérodote [7. 165], et qui purent être Narbon-nais, Bittérois, Mailhacois…) dans les conflits qui agitent la Méditerranée occi-dentale à cette époque. Leur présence dans la coalition carthaginoise à Himère en 480 av. J.-C., aux côtés de Phéniciens, de Libyens, d’Ibères, de Ligures, de Sardes et de Corses, confirme les liens privilégiés qu’entretenaient ces popula-tions avec les réseaux ibéro-puniques et a laissé supposer des relations tendues avec les Grecs aux marges mêmes de leur territoire.64 Les sépultures de cette
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15093773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 150 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 151
65 Janin 2002.66 Laurens et Schwaller 1989.67 Dietler 1992.
séquence témoignent d’ailleurs largement du rôle désormais important de l’ar-mement, de plus en plus présent au sein des assemblages funéraires,65 dans l’idéologie de ces sociétés.
L’IMPACT DES CONTACTS AVEC LES GRECS
On ne peut donc raisonnablement traiter les conséquences des contacts des ‘Celtes du Midi’ avec les Grecs sans rappeler que ces derniers ne furent pas les seuls étrangers à fréquenter les rivages gaulois: tout attribuer aux Grecs, selon une habitude enracinée chez bien des archéologues et historiens, est certaine-ment une erreur, et les indices invoqués d’une ‘hellénisation’ des populations indigènes correspondent en réalité de manière plus générale à une ‘méditerra-néisation’. Ainsi, le Languedoc fournit deux exemples caractéristiques de cette problématique: à l’ouest celui des Ibères, dont on devra prendre en compte le rôle dans la diffusion de mobiliers, de techniques et de concepts d’origine ou de type grec (à la suite de leurs propres ‘acculturation’ auprès des Empuri-tains), mais aussi d’origine ou de tradition phénico-punique; à l’est celui des Étrusques, dont on sait depuis les découvertes de Lattes qu’ils ont eu des contacts directs et prolongés avec les indigènes, et à qui il serait absurde de dénier toute participation dans les transferts culturels et techniques à haute époque. Même si bien sûr il reste vrai que la présence grecque fut la plus intense et la plus durable durant la Protohistoire en Gaule méridionale et à ses marges.
Parmi les apports méditerranéens les plus visibles figurent ici comme ailleurs le vin, et la vaisselle de table dont une partie significative est liée à sa consom-mation (coupes, canthares, œnochoés, cratères). Les apports grecs en ce domaine ne diffèrent guère des autres (notamment des apports étrusques, également dominés par les amphores à vin et les canthares), surtout à l’époque archaïque où les pièces figurées restent rares. Aux Ve et IVe s., l’accroissement des importations de céramique attique à figures rouges renforce l’aspect symbo-lique de cette consommation d’un produit exogène dans une vaisselle de luxe, dont les indigènes se sont probablement réappropriés les thèmes iconogra-phiques,66 tout en intégrant le vin dans leur propres pratiques sociales.67
Le service de boisson, on le sait, accompagnait le plus souvent les amphores dans le commerce maritime, et les épaves de la côte languedocienne ne disent
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15193773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 151 1/06/12 11:201/06/12 11:20
152 THIERRY JANIN – MICHEL PY
68 Gallet de Santerre 1961; Long 1990.69 Arcelin et al. 1982; Taffanel et Taffanel 1967; Nickels 1978; 1980.70 Ugolini et Olive 1988.71 Goury 1992.
pas autre chose.68 Plus que la vaisselle, qui fit l’objet de redistributions mul-tiples, ce sont les amphores qui renseignent le mieux sur l’origine des pro-duits: or, en ce domaine, le Languedoc (contrairement à Marseille) fournit très peu d’amphores grecques autres que marseillaises. Le vin qu’on boit ici avant 530 est surtout étrusque, un peu ibéro-punique, exceptionnellement grec, et, après 530, principalement marseillais à l’est de l’Hérault, partagé entre crus marseillais, ibériques et puniques à l’ouest. Ces répartitions témoignent – comme l’implantation des comptoirs – de la mise en place et de l’enracine-ment progressif, dans le Languedoc méditerranéen, de deux situations com-merciales opposées, à savoir un marché ouvert où interviennent à la fois Ibères, Empuritains et probablement Massaliètes (ou redistributeurs assimilés, tels qu’Agathois et pourquoi pas Lattois) dans la partie occidentale de la région, et un marché beaucoup plus fermé, sous contrôle quasi exclusif de Marseille, dans la partie orientale.
Mais la céramique de type grec ne témoigne pas seulement du commerce: elle témoigne aussi certainement de transferts de technologie, avec l’apparition précoce (dès les environs de 570) de productions locales tournées. Il s’agit d’abord, dans toutes les zones et parfois dans des régions reculées, d’ateliers produisant de la céramique à pâte grise (conventionnellement dénommée ‘grise monochrome’) qui se place technologiquement dans la tradition phocéenne, mais dont le répertoire est mixte (grec et indigène), s’adaptant par là au mar-ché local. L’étude typologique a permis de repérer de telles productions à dif-fusion microrégionale dans la vallée du Gardon, dans la vallée du Vidourle, dans la région d’Agde, dans le Narbonnais, en Roussillon,69 tandis que des fours destinés à cuire ce type de vases ont été mis au jour à Béziers70 et à Aspiran. Il s’agit ensuite de céramiques à pâte claire portant un décor peint: bandes linéaires dans la tradition des céramiques ioniennes, ou motifs plus complexes issus du répertoire des céramiques non tournées régionales à décor incisé dans le cas du style dit ‘subgéométrique’, sur la frange rhodanienne du Languedoc oriental.71
Ces productions de style grec posent le problème de la transmission vers le monde indigène de techniques de fabrication relativement complexes, en tout cas nettement différentes de celles de la céramique non tournée traditionnelle, tant en ce qui concerne l’épuration de l’argile que le montage au tour rapide et la cuisson maîtrisée, supposant des fours évolués. La précocité, la rapidité et l’aspect global de cette transmission (en l’absence de phases d’expérimentation
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15293773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 152 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 153
72 Py 1974.73 DICOCER, 204–05.74 Nickels 1976.75 Chazelles 1997.76 Alonso 1997.
progressive) orientent vers l’hypothèse de l’installation de potiers grecs en milieu indigène, plutôt que vers celle d’un simple processus d’imitation d’ob-jets manufacturés, tandis que les développements ultérieurs, au Ve s., peuvent raisonnablement être mis au compte d’une acculturation technique autochtone.
Non moins problématique est la disparition quasiment synchrone de la plu-part de ces productions régionales de céramiques de type grec à la fin du Ve ou au début du IVe s. Des processus différents s’observent d’ailleurs selon les zones. En Languedoc oriental, elles cèdent alors la place à des importations de vases équivalents, mais en majorité de provenance massaliète, dans la logique du monopole dont jouit Marseille dans cette région.72 En Languedoc central, autour de la vallée de l’Hérault, on a repéré une catégorie particulière (dite ‘claire héraultaise’) associant une technique grecque à un répertoire mixte, grec et celtisant, bien illustrée dans la nécropole d’Ensérune.73 En Languedoc occidental enfin, à côté de séries de tradition ibérique, ce sont principalement les vases tournés de type celtique qui se développent. Cette diversité de situa-tions n’aide pas à expliquer ce qui apparaît néanmoins comme une rupture assez générale dans les traditions potières qui s’étaient installées.
Bien d’autres domaines, parfois moins évidents que la céramique, sont sus-ceptibles de témoigner de tels transferts technologiques à différentes étapes de l’âge du Fer. Dans l’architecture par exemple, on a évoqué couramment la diffusion dès le VIe s. des constructions en briques de terre crue ou adobes, et raisonné parfois sur leurs mensurations (mais la métrologie demeure un domaine périlleux…).74 Cependant le doute existe aujourd’hui sur l’unicité grecque de l’origine de ce mode de construction,75 que les autochtones ont pu emprunter tant au monde punique qu’ibérique ou italique (voir par exemple les murs en briques des maisons étrusques de Lattes).
Les techniques agricoles sont apparemment touchées plus tard. Le cas des meules est symptomatique: jusqu’au Ve s. en effet, le Languedoc ne connaît que des formes de mouture très traditionnelles (meules à va-et-vient dites ‘de tradition néolithique’); c’est vers 400 qu’apparaissent des instruments plus perfectionnés: meules rotatives d’abord, puis, à partir de la fin du IVe s., meules à trémie ‘du type d’Olynthe’. La meule rotative est d’origine ibérique76 et c’est depuis l’Espagne probablement qu’elle se propage en Languedoc occi-dental. Mais en Languedoc oriental, où les premières meules rotatives sont en basalte d’Embonne, il n’est pas exclu qu’elles aient été introduites par les
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15393773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 153 1/06/12 11:201/06/12 11:20
154 THIERRY JANIN – MICHEL PY
77 Py 1992.78 Garcia 1992.79 Buxo et Py 2001.80 Moret 1996.81 Gailledrat 1997.82 Nickels 1976.83 Dedet 1990.84 Gailledrat et al. 2000; Marichal et al. 2003.85 Jannoray 1955.86 Garcia 2004.
Grecs d’Agde, de même que plus tard les meules à trémie fabriquées dans le même matériau. Néanmoins, tous les cas de figures sont possibles, comme en témoigne la découverte à Lattes des rebuts d’une fabrication locale de meules d’Olynthe à partir de l’importation de basalte d’Agde.77
On pourra évoquer dans le même domaine les pressoirs à huile, dont l’exemple le plus précoce est également à Lattes (vers 400) et qui se multi-plient ensuite dans l’aire de diffusion de l’olivier.78 Et bien sûr la vigne, culti-vée localement sur le littoral dès le VIe s. et connaissant à partir du IIIe s. une expansion notable dans cette région du Midi comme en Provence,79 en liaison avec le développement d’une production locale de vin. Justin (43. 4. 2) affirme que les indigènes du Midi doivent ces cultures aux Grecs; mais, bien sûr, ils ont pu les apprendre aussi, selon les régions, d’autres Méditerranéens.
Les apports grecs dans le domaine de la poliorcétique et de l’urbanisme, naguère mis en avant à la suite d’une allusion de Justin (43. 4), sont aujourd’hui relativisés. Il est difficile en effet de distinguer dans ces domaines la part réelle de ce qui peut revenir à des incitations ou des modèles étran-gers de ce qui découle de réponses locales à des besoins nouvellement sur-gis. Par ailleurs, l’éventail des sources potentielles d’inspiration s’est élargi. Par exemple, le ‘rempart grec’ de Pech-Maho (milieu du VIe s.) est de pré-férence intégré aujourd’hui dans la dynamique du monde ibérique,80 lui-même creuset dans lequel se sont fondues des influences multiples.81 L’ori-gine grecque des maisons à abside de La Monédière82 a été contestée au profit de la tradition indigène,83 bien illustrée par les découvertes récentes de Mailhac et de Ruscino.84
Le développement d’une architecture originale en terre massive à Lattes (Ve–IVe s.) pourrait trouver sa source dans les maisons construites par les Étrusques aux origines de la cité, selon des techniques connues aux VIIe–VIe s. en Étrurie (par exemple à Roselle). Les plans préconçus mis en œuvre sur certains habitats du IIe âge du Fer, naguère qualifiés ‘d’hippodaméens’,85 sont en général aujourd’hui rendus au génie indigène, même si des incitations à la régularité ont pu naître de la fréquentation des comptoirs grecs.86
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15493773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 154 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 155
87 Garcia 1993.88 Py 1990a, 729–35; Bessac 1995, 396.89 Nickels 1981; Bats 2004.90 Tréziny 2004.91 Py 1996.92 Marcet et Sanmarti 1989.93 Hesnard et al. 1999, 96.94 Chazelles 1999.95 Furtwängler 1978.96 Py 1990c.
Les cas languedociens où une influence grecque reste probable sont plutôt récents: ainsi, au IVe s., le rempart à décrochements de la Ramasse87 dans l’arrière-pays d’Agde, ou bien au IIe s., dans le Gard, les éléments de rempart d’Uzès et la tour de Mauressip, construits en grand appareil (IIe s.), avec dans le second cas des marques de tâcheron grecques.88 Concernant l’urbanisme, à part la colonie massaliète d’Agde,89 on ne connaît pour l’heure en Languedoc aucun plan d’habitat dont l’agencement puisse être directement comparé avec Olbia ou même Arles.90
Dans la grande majorité des cas, les maisons protohistoriques languedo-ciennes sont de petite taille et leur forme, même elle se complexifie quelque peu avec le temps, reste dans le fil d’une tradition vernaculaire. Seules en fait pour l’heure échappent à ce schéma les grandes maisons à cour de la ville portuaire de Lattes (IIIe–IIe s.).91 L’intérêt de ces demeures ne réside pas seu-lement dans leurs dimensions (entre 150 et 600 m2), leur agencement autour d’une cour intérieure et diverses composantes (porche, triclinium, boutiques) qui les rapprochent beaucoup des maisons des colonies grecques d’Occident telles que les illustrent les fouilles d’Emporion92 ou de Marseille.93 Cet intérêt réside aussi dans leur concomitance au sein de la ville avec un habitat beau-coup plus modeste, réparti en quartiers de petites habitations traditionnelles, qui dénote non seulement une hiérarchisation accrue de la société,94 mais éga-lement la reproduction, à date récente et sous des formes renouvelées, d’un processus élitiste d’acculturation méditerranéenne, peut être sur des bases ploutocratiques.
On pourrait multiplier les exemples du caractère à la fois limité et tardif de ces emprunts, compte tenu de l’ancienneté et de la continuité de la présence grecque sur les rivages gaulois: ainsi la monnaie, utilisée par les Marseillais et les Empuritains depuis la fin du VIe s.,95 dont l’usage ne se répand guère en Languedoc que deux siècles plus tard, nonobstant la circulation de quelques pièces isolées aux marges de la Provence et la Catalogne, et dont en vérité l’insertion dans les processus d’échanges indigènes n’intervient pas avant le Ier s.96 Ainsi encore l’écriture, qui très longtemps reste cantonnée dans un
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15593773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 155 1/06/12 11:201/06/12 11:20
156 THIERRY JANIN – MICHEL PY
97 Colonna 1980.98 Lejeune et al. 1988.99 Solier 1979; Untermann 1980.100 Lejeune 1985.101 Bats 2003.102 Jullian 1908.103 Jannoray 1955, 465.104 Dietler 1999, 664.
usage commercial et dénote le plus souvent l’intervention d’étrangers: Étrusques à Lattes,97 Étrusques et Grecs à Pech-Maho,98 Ibères sur les côtes du Languedoc occidental,99 alors que l’alphabet grec ne se diffuse pour noter le gaulois – en Languedoc oriental comme en Provence100 – qu’avec l’arrivée des Romains, et peut-être en réaction identitaire contre ces derniers.101
Les archéologues ont d’abord jugé ces ‘retards’ de l’extérieur, comme l’avaient fait les auteurs anciens, en attribuant cette relative imperméabilité à la rudesse et à la sauvagerie des ‘Ligures’ primitifs (les textes antiques foi-sonnent de ce topos), tandis qu’à partir du IIIe s., l’arrivée des ‘Celtes philhel-lènes’ aurait ouvert la voie à une véritable ‘hellénisation’102 ou permis qu’elle s’accentuât.103 On a tendance aujourd’hui à regarder les choses plutôt de l’inté-rieur, du point de vue des autochtones, en valorisant les attitudes de refus de telle ou telle pratique ou technique qui ne correspondaient pas à leurs besoins, à leurs projets ou à leur mode de vie; voire même en envisageant la possibilité d’une certaine indifférence de ces populations munies de fortes traditions régionales vis-à-vis de Grecs conçus comme des voisins indigènes parmi d’autres, se comportant autrement qu’eux et parlant un autre langage.104
BIBLIOGRAPHIE
Alonso Martinez, N. 1997: ‘Origen y expansión del molino rotativo bajo en el medi-terráneo occidental’. Dans Techniques et économie antiques et médiévales, le temps de l’innovation (Paris), 15–19.
Arcelin-Pradelle, C., Dedet, B. et Py, M. 1982: ‘La céramique grise monochrome en Languedoc oriental’. RAN 14, 19–67.
Arnal, J., Peyron, J. et Robert, A. 1972: ‘Fibules grecques et italiques en Languedoc’. Annales de la Société d’Horticulture et de Sciences Naturelles de l’Hérault 112, 1–11.
Asensio, D., Belarte, C., Sanmartí, J. et Santacana, J. 2000: ‘L’expansion phénicienne sur la côte orientale de la Péninsule ibérique’. Dans Janin 2000, 249–60.
Barruol, G. et Py, M. 1978: ‘Recherches récentes sur la ville antique d’Espeyran à Saint-Gilles-du-Gard’. RAN 11, 19–100.
Bats, M. 1986: ‘Le territoire de Marseille: réflexions et problèmes’. Dans EtMass 1, 17–42.
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15693773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 156 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 157
—. 1998: ‘Marseille archaïque, Étrusques et Phocéens en Méditerranée nord-occiden-tale’. MEFRA 110, 609–33.
—. 2000: ‘Les Grecs en Gaule au Ier âge du Fer et le commerce emporique en Médi-terranée occidentale’. Dans Janin 2000, 415–32.
—. 2003: ‘Les Gaulois et l’écriture aux IIe–Ier siècles avant J.-C.’. Dans Revue Archéologique de l’Ouest, Suppl. 10, 369–80.
—. 2004: ‘Les colonies massaliètes de Gaule méridionale, sources et modèles d’un urbanisme militaire aux IVe–IIIe s. av. J.-C.’. Dans Agusta-Boularot, S. et Lafon, X. (éd.), Des Ibères aux Vénètes (Rome), 51–64.
Bessac, J.-C. 1995: ‘Questions esthétiques, économiques et techniques dans les constructions hellénistiques de Gaule méditerranéenne’. Dans EtMass 4, 393–401.
Bouloumié, B. 1982: ‘Saint-Blaise et Marseille au VIe s. av. J.-C., l’hypothèse étrusque’. Latomus 41, 74–91.
Buxo, R. et Py, M. 2001: ‘La viticulture en Gaule à l’âge du Fer’. Gallia 58, 29–43.Chazelles, C.-A. 1997: Les maisons en terre de Gaule méridionale (Montagnac).—. 1999: ‘Les maisons de l’Âge du Fer en Gaule méridionale, témoins de différentes
identités culturelles et reflets d’une certaine disparité sociale’. Dans Habitat et société (XIXe Rencontres Internationales d’Archéologie et d’Histoire d’Antibes) (Antibes), 481–98.
Colonna, G. 1980: ‘Graffiti etruschi in Linguadoca’. StEtr 48, 181–85.Dedet, B. 1990: ‘Une maison à absides sur l’oppidum de Gailhan (Gard) au milieu du
Ve s. av. J.-C. La question du plan absidial en Gaule du sud’. Gallia 47, 29–55.—. 1992: Rites funéraires protohistoriques dans les Garrigues du Languedoc,
approche ethno-archéologique (Paris).—. 1995: ‘Etrusques, Grecs et indigènes dans les garrigues du Languedoc oriental au
Ier Age du Fer; habitats et sépultures’. Dans EtMass 4, 277–307.Dedet, B. et Py, M. 2006: ‘Les importations étrusques en Languedoc oriental, chrono-
logie et diffusion’. Dans Gli Etruschi da Genova ad Ampurias (Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi ed Italici) (Florence), 121–44.
Dietler, M. 1992: ‘Commerce du vin et contacts culturels en Gaule au premier Age du Fer’. Dans EtMass 3, 401–10.
—. 1999: ‘Reflections on Lattois Society During the 4th Century BC’. Dans Py, M. (éd.), Recherches sur le IVe siècle avant notre ère à Lattes (Lattes), 663–80.
Dietler, M. et Py, M. 2003: ‘The Warrior of Lattes: An Iron Age Statue Discovered in Mediterranean France’. Antiquity 77, 780–95.
Dubosse, C. 2004: Les céramiques grecques d’Ensérune et leurs contextes, essai de caractérisation des deux premières phases d’occupation du site (Mémoire, Uni-versité d’Aix-Marseille I).
Duval, A., Eluère, C. et Mohen, J.-P. 1974: ‘Les fibules antérieures au VIe s. av. n.è. trouvées en France’. Gallia 32, 1–61.
Furtwängler, A.E. 1978: Monnaies grecques en Gaule, le trésor d’Auriol et le mon-nayage de Massalia (525/520–460 av. J.-C.) (Fribourg).
Gailledrat, E. 1997: Les Ibères de l’Èbre à l’Hérault (Lattes).Gailledrat, E., Poupet, P. et Boisson, H. 2000: ‘Nouvelles données sur l’habitat proto-
historique de Mailhac (Aude) au premier âge du Fer (VIIe–Ve s. av. J.-C.)’. Dans Buxó, R. et Pons i Brun, E. (éd.), L’hàbitat protohistóric a Catalunya, Rosselló i Llenguadoc Occidental: actualitat de l’arqueologia de l’edat del ferro (Actes del
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15793773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 157 1/06/12 11:201/06/12 11:20
158 THIERRY JANIN – MICHEL PY
XXII col·loqui internacional per a l’estudi de l’Edat del Ferro, Girona, maig 1998) (Gérone), 173–84.
Gailledrat, E. et Solier, Y. 2004: Pech Maho 1. L’établissement côtier de Pech Maho (Sigean, Aude) aux VIe–Ve s. av. J.-C. (fouilles 1959–1979) (Lattes).
Gailledrat, E., Taffanel, O. et Taffanel, J. 2002: Le Cayla de Mailhac (Aude), Les niveaux du premier âge du Fer (VIe–Ve s. av. J.-C.) (Lattes).
Gallet de Santerre, H. 1961: ‘Recherches et trouvailles sous-marines faites le long du rivage languedocien et roussillonnais’. Dans Actes du IIe Congrès d’Archéologie Sous-marine, Albenga, 1958 (Bordighera), 199–218.
Garcia, D. 1987: ‘Le dépôt de bronzes launaciens de Roque-Courbe, Saint-Saturnin, Hérault’. DAM 10, 9–29.
—. 1992: ‘Les éléments de pressoirs de Lattes et l’oléiculture antique en Languedoc méditerranéen’. Dans Py, M. (éd.), Recherches sur l’économie vivrière des Latta-renses (Lattes), 237–58.
—. 1993: Entre Ibères et Ligures, Lodévois et moyenne vallée de l’Hérault protohisto-riques (Paris).
—. 2004: ‘Dynamique et composantes urbaines en Gaule méridionale aux IVe–IIe siècles avant J.-C.’. Dans Agusta-Boularot, S. et Lafon, X. (éd.), Des Ibères aux Vénètes (Rome), 51–64.
Garcia, D. et Orliac, D. 1986: ‘Bassins et disques en bronze à décor perlé du bassin moyen de l’Hérault’. Archéologie en Languedoc 8, 63–66.
Giry, J. 1965: ‘La nécropole préromaine de Saint-Julien, commune de Pézénas, Hérault’. Rivista di Studi Liguri 31, 117–238.
Goury, D. 1995: ‘Les vases pseudo-ioniens dans les vallées de la Cèze et de la Tave’. Dans EtMass 4, 309–24.
Gras, M. 1993: ‘Pour une Méditerranée des emporia’. Dans Bresson, A. et Rouillard, P. (éd.), L’emporion (Paris), 103–12.
—. 2000: ‘Les Étrusques et la Gaule méditerranéenne’. Dans Janin 2000, 229–41.Guilaine, J. et Py, M. 2000: ‘Le sud de la Gaule et les relations méditerranéennes et
occidentales (–1000/–500)’. Dans Janin 2000, 415–32.Guilaine, J. et Rancoule, G. 1996: ‘Les relations méditerranéennes précoloniales et les
débuts de l’âge du Fer languedocien: les influences puniques en Languedoc occi-dental’. Complutum 7, 125–40.
Hesnard, A., Moliner, M., Conche, F. et Bouiron, M. 1999: Parcours de villes. Mar-seille: 10 ans d’archéologie, 2600 ans d’Histoire (Aix-en-Provence).
Jacobsthal, P. et Neuffer, E. 1933: ‘Gallia Graeca, recherches sur l’hellénisation de la Provence’. Préhistoire 2, 1–64.
Janin, T. (éd.) 2000: Mailhac et le premier âge du Fer en Europe occidentale: hom-mages à Odette et Jean Taffanel (Actes du colloque de Carcassonne, 17–20 sep-tembre 1997) (Lattes).
—. 2002: ‘Nécropoles et espace géographique en Languedoc occidental au premier âge du Fer: essai sur l’organisation territoriale et politique de la société Élisyque’. Dans Garcia, D. et Verdin, F. (éd.), Territoires celtiques, Espaces ethniques et territoires des agglomérations protohistoriques d’Europe occidentale (Actes du XXIVe colloque international de l’Association Française pour l’Étude de l’Age du Fer, Martigues, 1–4 juin 2000) (Paris), 108–18.
—. 2003: ‘Chroniques de Protohistoire européenne: les dépôts d’objets métalliques en France et en Espagne’. DAM 26, 349–400.
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15893773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 158 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 159
—. 2006: ‘De la fin de l’âge du Bronze à la fondation de Marseille: systèmes chrono-logiques et groupes culturels dans le Midi de la France’. Dans Gli Etruschi da Genova ad Ampurias (Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi ed Italici) (Flo-rence), 93–102.
Jannoray, J. 1955: Ensérune, contribution à l’étude des civilisations préromaines de la Gaule méridionale (Paris).
Jullian, C. 1908: Histoire de la Gaule (Paris).Jully, J.-J. 1980: Les importations de céramique attique (VIe–IVe s.) en Languedoc
méditerranéen, Roussillon et Catalogne (Paris).—. 1982: Céramiques grecques ou de type grec et autres céramiques en Languedoc
méditerranéen, Roussillon et Catalogne (Paris).Laurens, A.-F. et Schwaller, M. 1989: ‘Vases attiques importés sur l’oppidum d’Ensé-
rune: essai d’approche anthropologique’. Dans Grecs et Ibères au IVe s. av. J.-C., commerce et iconographie (Bordeaux), 385–95.
Lejeune, M. 1985: Recueil des inscriptions gauloises I: Textes gallo-grecs (Paris).Lejeune, M., Pouilloux, J. et Solier, Y. 1988: ‘Etrusque et ionien archaïques sur un
plomb de Pech-Maho (Aude)’. RAN 21, 19–60.Long, L. 1990: ‘Amphores massaliètes: objets isolés et gisements sous-marins du lit-
toral français méditerranéen’. Dans EtMass 2, 27–70.Louis, M., Taffanel, O. et Taffanel, J. 1958: Le Premier Age du Fer languedocien. II:
Les nécropoles à incinération (Bordighera/Montpellier).Marcet, R. et Sanmarti, E. 1989: Empuries (Barcelone).Marichal, R., Rébé, I., Boisson, H., Gailledrat, E. et Janin, T. 2003: Ruscino (Château-
Roussillon, Perpignan, Pyrénées-Orientales), du Néolithique au premier âge du Fer (Lattes).
Mazière, F. et Gomez, E. 2002: ‘Agde, nécropole du Bousquet’. Dans Bilan Scienti-fique de la Région Languedoc-Roussillon 2001 (Montpellier), 120–21.
Mele, A. 1979: Il commercio greco arcaico, Prexis e Emporie (Naples).—. 1986: ‘Pirateria, commercio e aristocratia’. DHA 12, 67–109.Morel, J.-P. 1975: ‘L’expansion phocéenne en Occident, dix années de recherches
(1966–1975)’. BCH 99, 853–93.—. 1981: ‘Le commerce étrusque en France, en Espagne et en Afrique’. Dans L’Etru-
ria mineraria (Atti del XII Convegno di studi etruschi e italici, Firenze–Populo-nia–Piombino, 16–20 giugno 1979) (Florence), 463-508.
Moret, P. 1996: Les fortifications ibériques, de la fin de l’âge du Bronze à la conquête romaine (Madrid).
Müller, K. 1855: Geographi Graeci minores, vol. 1 (Paris).Nickels, A. 1976: ‘Les maisons à abside d’époque grecque archaïque de La Monédière
à Bessan (Hérault)’. Gallia 34, 95–128.—. 1978: ‘Contribution à l’étude de la céramique grise archaïque en Languedoc-Rous-
sillon’. Dans Les céramiques de la Grèce de l’est et leur diffusion en Occident (Centre Jean Bérard, Institut français de Naples, 6–9 juillet 1976: Colloque du CNRS) (Paris), 248–67.
—. 1980: ‘Les plats à marli en céramique grise monochrome de type roussillonnais’. Dans Barruol, G. et al., Ruscino, Château-Roussillon, Perpignan (Pyrénées-Orientales I: État des travaux et recherches en 1975 (Paris), 155–62.
—. 1981: ‘Recherches sur la topographie de la ville d’Agde, Hérault’. DAM 4, 29–50.
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 15993773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 159 1/06/12 11:201/06/12 11:20
160 THIERRY JANIN – MICHEL PY
—. 1983: ‘Les Grecs en Gaule: l’exemple du Languedoc’. Dans Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes (Cortona 1981) (Pise/Rome), 409–28.
—. 1990: ‘Essai sur le développement topographique de la nécropole protohistorique de Pézenas (Hérault)’. Gallia 47, 1–27.
Nickels, A., Pellecuer, C., Raynaud, C., Roux, J.-C. et Adgé, M. 1981: ‘La nécropole du Ier Age du Fer d’Agde: les tombes à importations grecques’. MEFRA 93, 89–125.
Passelac, M., Rancoule, G. et Solier, Y. 1990: ‘La diffusion des amphores massaliètes en Languedoc occidental et sur l’axe Aude-Garonne et ses abords’. Dans EtMass 2, 131–52.
Py, F. et Py, M. 1974: ‘Les amphores étrusques de Vaunage et de Villevieille, Gard’. MEFRA 86, 141–254.
Py, M. 1974: ‘Problèmes de la céramique grecque d’Occident en Languedoc oriental durant la période archaïque’. Dans Simposio de Colonizaciones (Barcelone), 159–82.
—. 1985: ‘Les gisements lagunaires au Premier Age du Fer’. Dans L’occupation des rivages de l’étang de Mauguio, Hérault, au Bronze final et au Ier Age du Fer, III, synthèses et annexes (Caveirac), 47–84.
—. 1990a: Culture, économie et société protohistoriques dans la région nîmoise (Rome/Paris).
—. 1990b: ‘Espeyran’. Dans Voyage en Massalie, 100 ans d’archéologie en Gaule du Sud (Aix-en-Provence), 190–193.
—. 1990c: ‘Considérations sur la circulation monétaire’. Dans Py, M. (éd.), Fouilles dans la ville antique de Lattes, les îlots 1, 3 et 4-nord du quartier Saint-Sauveur (Lattes), 377–90.
—. 1992: ‘Meules d’époque protohistorique et romaine provenant de Lattes’. Dans Py, M. (éd.), Recherches sur l’économie vivrière des Lattarenses (Lattes), 183–232.
—. 1993: Les Gaulois du Midi, de la fin de l’Age du Bronze à la conquête romaine (Paris).
—. 1995: ‘Les Étrusques, les Grecs et la fondation de Lattes’. Dans EtMass 4, 261–76.—. 1996: ‘Les maisons protohistoriques de Lattara (IVe–Ier s. av. n.è.), approche
typologique et fonctionnelle’. Dans Urbanisme et architecture dans la ville antique de Lattes (Lattes), 141–258.
—. 1999: ‘Le faciès de la céramique lattoise du IVe s. av. n.è.’. Dans Py, M. (éd.), Recherches sur le IVe siècle avant notre ère à Lattes (Lattes), 287–438.
—. 2003: ‘Les Celtes du Midi’. Dans Bats, M., Dedet, B., Garmy, P., Janin, T., Ray-naud, C. et Schwaller, M. (éd.), Peuples et territoires en Gaule méridionale, Hommages à Guy Barruol (Montpellier), 303–22.
Py, M. et Dietler, M. 2003: ‘Une statue de guerrier découverte à Lattes (Hérault)’. DAM 26, 235–49.
Py, M., Lebeaupin, D., Séjalon, P. et Roure, R. 2006: ‘Les Étrusques et Lattara: nou-velles données’. Dans Gli Etruschi da Genova ad Ampurias (Atti del XXIV Convegno di Studi Etruschi ed Italici) (Florence), 583–606.
Py, M., Py, F., Sauzet, P. et Tendille, C. 1984: La Liquière, village du Ier Age du Fer en Languedoc oriental (Paris).
Py, M. et Roure, R. 2002: ‘Le Caïlar (Gard), un nouveau comptoir lagunaire protohis-torique au confluent du Rhône et du Vistre’. DAM 25, 171–214.
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 16093773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 160 1/06/12 11:201/06/12 11:20
GRECS ET CELTES EN LANGUEDOC 161
Roure, R. 2004: La Gaule méditerranéenne et les Grecs: approche historiographique de la notion d’hellénisation au XXe siècle (Mémoire, Université de Montpellier III).
Sanmartí-Grego, E. 1992: ‘Massalia et Emporion: une origine commune, deux destins différents’. Dans EtMass 3, 27–41.
Solier, Y. 1979: ‘Découverte d’inscriptions sur plombs en écriture ibérique dans un entrepôt de Pech-Maho, Sigean’. RAN 12, 55–123.
Sourisseau, J.-C. 1997: Recherches sur les amphores de Provence et de la basse vallée du Rhône aux époques archaïque et classique (fin VIIe–début IVe s. av. J.-C.) (Mémoire, Université d’Aix-Marseille I).
Taffanel, O. et Taffanel, J. 1956: ‘La céramique du Ier Age du Fer à Mailhac, Aude’. Bulletin de la Société d’Études Scientifiques de l’Aude 56, 9–19.
––. 1967: ‘Les poteries grises du Cayla II à Mailhac, Aude’. Rivista di Studi Liguri 33, 245–76.
—. 1970: ‘Trois bronzes de type étrusque à Mailhac (Aude)’. RAN 3, 21–31.Tréziny, H. 2004: ‘Urbanisme grec, urbanisme indigène dans le Midi de la Gaule’.
Dans Agusta-Boularot, S. et Lafon, X. (éd.), Des Ibères aux Vénètes (Rome), 65–77.
—. (éd.) 1997: Languedoc occidental protohistorique, fouilles et recherches récentes, VIe–IVe s. av. J.-C. (Aix-en-Provence).
Ugolini, D. et Olive, C. 1988: ‘Un four de potier du Ve s. av. J.-C. à Béziers, Place de la Madeleine’. Gallia 45 (1987–88), 13–28.
Ugolini, D. et Olive, C., Marchand, G. et Columeau, P. 1991: ‘Un ensemble représen-tatif du Ve s. av. J.-C. à Béziers, Place de la Madeleine, et essai de caractérisation du site’. DAM 14, 141–203.
Untermann, J. 1980: Monumenta Linguarum Hispanicarum II: Die Inschriften in ibe-rischer Schrift aus Südfrankreich (Wiesbaden).
Verger, S. 2000: ‘Des objets languedociens et hallstattiens dans le sanctuaire d’Héra à Pérachora (Corinthe)’. Dans Janin 2000, 387–410.
Villard, F. 1960: La céramique grecque de Marseille (VIe–IVe s.), essai d’histoire économique (Paris).
93773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 16193773_Hermary_CA4_08_Janin-Py.indd 161 1/06/12 11:201/06/12 11:20
Related Documents