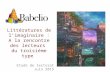1 Christophe MEUREE F.R.S./FNRS – Université catholique de Louvain Des formes d’une « convenance profonde » : le XVII e siècle dans l'imaginaire durassien Pour Georges Jacques et pour Caroline Proulx « Ça va être à la mode, l’inculture maintenant. C’est pas mal remarquez. » 1 L’époque contemporaine est celle des icônes iconoclastes. Souvent raillée pour des déclarations d’apparence oiseuse, Marguerite Duras n’en a pas moins inventé une nouvelle figure du « Grand Écrivain ». Si l’on connaît les aspects sulfureux de sa carrière, l’on n’a encore que très insuffisamment interrogé la façon dont elle s’est forgé une légitimité – littéraire, sociale et médiatique – à partir de ce qu’elle-même appelait les « grandes lectures » de sa vie. L’auteur de Moderato cantabile semble confiner la mémoire de ses lectures, dans un insu qui confine à l’oubli, élément constitutif de ce qu’elle appelle « la vraie mémoire ». Le rapport de Duras à la littérature passée est par conséquent nimbé de confusion : les goûts affichés sont plus ou moins constants mais les imprégnations et les phénomènes relevant de l’intertextualité ne présentent pas un caractère d’évidence. Ainsi, avec elle, il n’y a que très peu de citations directes 2 . Il s’agit dès lors moins d’afficher une filiation que d’assortir des influences stylistiques ou des références à des scènes célèbres dans le but de créer la posture du génie singulièrement inspiré. Je l’ai déjà dit : on n’écrit jamais seul, mais ce n’est pas seulement qu’on n’écrit jamais seul, on écrit avec des gens qui nous ont précédés. Moi j’écris avec Diderot, j’en suis sûre, avec Pascal, avec les grands hommes de ma vie, avec Kierkegaard, avec Rousseau, j’en suis sûre, avec Stendhal, pas avec Balzac, avec les autres, mais totalement à mon insu, c’est ma première nourriture que je lis avec avidité. 3 Dans cette énumération, le XVII e siècle occupe une portion pour le moins congrue, alors qu’il hante en permanence l’imaginaire durassien, ce qu’elle ne confesse qu’après avoir par deux fois réécrit la Bérénice de Racine, elle qui n’a jusqu’alors jamais pratiqué la reprise 4 , attribuant même subitement au XVII e siècle français un statut inégalé dans l’histoire littéraire. 1 Marguerite DURAS, « À tort et à travers » in Le Monde extérieur, Paris, P.O.L., 1993, p. 115. Dorénavant : ME, suivi de la pagination. 2 Cécile Hanania a pu en démontrer le caractère très approximatif, que le détournement soit volontaire ou non : Cécile HANANIA, « “Ce qui reste quand on a tout oublié”. Souvenirs d’amnésiques chez Marguerite Duras » dans Christophe MEURÉE et Pierre PIRET, dir., De mémoire et d’oubli : Marguerite Duras, Berne-Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2010, pp. 53-64. MARGUERITE DURAS. 3 Marguerite DURAS, Suzanne LAMY et André ROY, Marguerite Duras à Montréal, Montréal, Spirale, 1981, pp. 23-24. Une variante tardive se trouve dans Écrire, qui efface le XVII e siècle mais rétablit la place dévolue à Michelet et à l’Ancien Testament, qui sont les œuvres du passé que Duras évoque avec le plus de constance au fil de sa carrière : « Les grandes lectures de ma vie, celles de moi seule, c’est celles écrites par des hommes. C’est Michelet. Michelet et encore Michelet, jusqu’aux larmes. […] C’est Saint -Just, Stendhal, et bizarrement ce n’est pas Balzac. Le Texte des textes, c’est l’Ancien Testament. » (Marguerite DURAS, Écrire, Paris, Gallimard, 1993, p. 35. FOLIO). Il convient de se référer au livre de Françoise Barbé-Petit, largement suscité par cette déclaration (Françoise BARBE-PETIT, Marguerite Duras au risque de la philosophie. Pascal, Rousseau, Diderot, Kierkegaard, Lévinas, Paris, Kimé, 2010. PHILOSOPHIE EN COURS). 4 L’autre exception, dérivée d’un passage de L’Homme sans qualités de Robert Musil, sera également un texte destiné à la fois pour le cinéma, la scène et la lecture : Agatha (1981).

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Christophe MEUREE
F.R.S./FNRS – Université catholique de Louvain
Des formes d’une « convenance profonde » : le XVIIe siècle dans l'imaginaire
durassien Pour Georges Jacques et pour Caroline Proulx
« Ça va être à la mode, l’inculture maintenant. C’est pas
mal remarquez. »1
L’époque contemporaine est celle des icônes iconoclastes. Souvent raillée pour des
déclarations d’apparence oiseuse, Marguerite Duras n’en a pas moins inventé une nouvelle
figure du « Grand Écrivain ». Si l’on connaît les aspects sulfureux de sa carrière, l’on n’a
encore que très insuffisamment interrogé la façon dont elle s’est forgé une légitimité –
littéraire, sociale et médiatique – à partir de ce qu’elle-même appelait les « grandes lectures »
de sa vie. L’auteur de Moderato cantabile semble confiner la mémoire de ses lectures, dans
un insu qui confine à l’oubli, élément constitutif de ce qu’elle appelle « la vraie mémoire ».
Le rapport de Duras à la littérature passée est par conséquent nimbé de confusion : les goûts
affichés sont plus ou moins constants mais les imprégnations et les phénomènes relevant de
l’intertextualité ne présentent pas un caractère d’évidence. Ainsi, avec elle, il n’y a que très
peu de citations directes2. Il s’agit dès lors moins d’afficher une filiation que d’assortir des
influences stylistiques ou des références à des scènes célèbres dans le but de créer la posture
du génie singulièrement inspiré.
Je l’ai déjà dit : on n’écrit jamais seul, mais ce n’est pas seulement qu’on n’écrit jamais seul, on écrit
avec des gens qui nous ont précédés. Moi j’écris avec Diderot, j’en suis sûre, avec Pascal, avec les
grands hommes de ma vie, avec Kierkegaard, avec Rousseau, j’en suis sûre, avec Stendhal, pas avec
Balzac, avec les autres, mais totalement à mon insu, c’est ma première nourriture que je lis avec
avidité.3
Dans cette énumération, le XVIIe siècle occupe une portion pour le moins congrue, alors qu’il
hante en permanence l’imaginaire durassien, ce qu’elle ne confesse qu’après avoir par deux
fois réécrit la Bérénice de Racine, elle qui n’a jusqu’alors jamais pratiqué la reprise4,
attribuant même subitement au XVIIe siècle français un statut inégalé dans l’histoire littéraire.
1 Marguerite DURAS, « À tort et à travers » in Le Monde extérieur, Paris, P.O.L., 1993, p. 115. Dorénavant : ME,
suivi de la pagination. 2 Cécile Hanania a pu en démontrer le caractère très approximatif, que le détournement soit volontaire ou non :
Cécile HANANIA, « “Ce qui reste quand on a tout oublié”. Souvenirs d’amnésiques chez Marguerite Duras » dans
Christophe MEURÉE et Pierre PIRET, dir., De mémoire et d’oubli : Marguerite Duras, Berne-Bruxelles, PIE-Peter
Lang, 2010, pp. 53-64. MARGUERITE DURAS. 3 Marguerite DURAS, Suzanne LAMY et André ROY, Marguerite Duras à Montréal, Montréal, Spirale, 1981,
pp. 23-24. Une variante tardive se trouve dans Écrire, qui efface le XVIIe siècle mais rétablit la place dévolue à
Michelet et à l’Ancien Testament, qui sont les œuvres du passé que Duras évoque avec le plus de constance au
fil de sa carrière : « Les grandes lectures de ma vie, celles de moi seule, c’est celles écrites par des hommes.
C’est Michelet. Michelet et encore Michelet, jusqu’aux larmes. […] C’est Saint-Just, Stendhal, et bizarrement ce
n’est pas Balzac. Le Texte des textes, c’est l’Ancien Testament. » (Marguerite DURAS, Écrire, Paris, Gallimard,
1993, p. 35. FOLIO). Il convient de se référer au livre de Françoise Barbé-Petit, largement suscité par cette
déclaration (Françoise BARBE-PETIT, Marguerite Duras au risque de la philosophie. Pascal, Rousseau, Diderot,
Kierkegaard, Lévinas, Paris, Kimé, 2010. PHILOSOPHIE EN COURS). 4 L’autre exception, dérivée d’un passage de L’Homme sans qualités de Robert Musil, sera également un texte
destiné à la fois pour le cinéma, la scène et la lecture : Agatha (1981).
2
J’ai dû aller et venir souvent entre les siècles et les siècles pour finalement découvrir que c’était la fin
du XVIIe siècle français qui chaque fois me rendait plus violemment à la lecture. Et puis j’ai lu encore
et encore et bien, et mal, et ailleurs. Et puis de nouveau je suis tombée sur ces trente années qui
ferment le XVIIe siècle français et j’en ai relu ce que j’en avais déjà lu et c’est en y revenant que j’ai
découvert, là, ma convenance profonde. (ME, p. 141)
Il y a lieu de s’interroger sur cette « convenance profonde », aux termes si peu
durassiens dans leur association. Si les œuvres du Grand Siècle imprègnent et infléchissent
implicitement les œuvres de Duras depuis les débuts, leur soudaine convocation au moment
où elle retrouve le chemin de la littérature après avoir passé la décennie 1970 derrière une
caméra fait encore énigme. L’intertextualité – dès lors qu’elle devient explicite – se révèle
susceptible de nourrir une « posture »5 et de servir d’instrument de légitimation du discours
littéraire aussi bien que des déclarations de l’écrivain lorsqu’il quitte son champ pour
s’aventurer du côté de la sphère politique, par exemple. La façon dont Duras use de la
mémoire de la littérature du Grand Siècle après 1979 allie paradoxalement à une posture
consciemment élaborée de provocatrice et d’iconoclaste un « ethos discursif »6 où
l’inscription dans la grande tradition classique démontre un « souci de l’avenir »7 qui ne soit
pas exclusivement tourné vers le désir égocentrique de postérité mais aussi et surtout vers
l’assomption du rôle prophétique de l’écrivain8, qui ne va plus de soi au sein de la société
contemporaine.
La percolation mémorielle
Pascal, Racine et Mme
de La Fayette sont les trois principaux écrivains du XVIIe siècle
épinglés au tableau des imprégnations confessées par Duras. À l’évidence, toutefois, les
œuvres de ces trois écrivains marquent de leur empreinte la production durassienne bien avant
les aveux des années 1980, à travers un usage des textes qui tend à neutraliser (voire à effacer)
toutes les formes d’influence revendiquée, à commencer par l’intertextualité explicite. Il
s’agit, durant la première partie de la carrière de Duras, d’imposer un génie propre, libre
d’influence et mu par une certaine folie créatrice. Pourtant, La Princesse de Clèves plane sur
l’œuvre de l’écrivain et en particulier sur la fameuse scène de bal qui ouvre Le Ravissement
de Lol V. Stein. Le mécanisme d’appropriation de la mémoire de la littérature passée chez
Duras joue ici à plein pour créer l’effet si intense de l’entrée d’Anne-Marie Stretter au bal de
T. Beach, effet propre à justifier aux yeux des lecteurs la soudaineté du « changement » et de
« la nouvelle histoire de Michael Richardson »9. La parenté entre les deux scènes est assez
obvie :
Elle se tourna et vit un homme qu’elle crut d’abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui
passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l’on dansait. Ce prince était fait d’une sorte qu’il
5 Jérôme MEIZOZ, Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur, Genève, Slatkine, 2007.
6 Ruth AMOSSY, La Présentation de soi. Ethos et identité verbale, Paris, PUF, 2010. L’INTERROGATION
PHILOSOPHIQUE. 7 Christophe MEUREE, « Le souci de l’avenir, d’hier à aujourd’hui. Une introduction » in Les Lettres romanes,
« Le souci de l’avenir chez les écrivains francophones », dir. Christophe MEUREE, t. 66, n°3-4, 2012, pp. 349-
357. 8 Celui-là même que Paul BENICHOU a mis en lumière pour le XIX
e siècle (cf. Romantismes français, Paris,
Gallimard, 2004, 2 vol. QUARTO) et qui subsiste sous la forme d’une nostalgie ou d’un repère dans le chef des
écrivains français contemporains. 9 Marguerite DURAS, Le Ravissement de Lol V. Stein, Paris, Gallimard, 1964, p. 17. FOLIO. Dorénavant R, suivi
de la pagination.
3
était difficile de n’être pas surpris de le voir quand on ne l’avait jamais vu […] ; mais il était difficile
aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement.
Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que, lorsqu’il fut proche d’elle, et qu’elle lui
fit la révérence, il ne put s’empêcher de donner des remarques de son admiration. Quand ils
commencèrent à danser, il s’éleva dans la salle un murmure de louanges. Le Roi et les Reines se
souvinrent qu’ils ne s’étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser
ensemble sans se connaître.10
[…] [L]es deux dernières venues, deux femmes, franchissent la porte de la salle de bal du Casino
municipal de T. Beach.
[…]
Elles étaient ce matin à la plage, dit le fiancé de Lol, Michael Richardson.
Il s’était arrêté, il avait regardé les nouvelles venues, puis il avait entraîné Lol vers le bar et les plantes
vertes du fond de la salle.
Elles avaient traversé la piste et s’étaient dirigées dans cette même direction.
[…]
Avait-elle [Anne-Marie Stretter] regardé Michael Richardson en passant ? L’avait-elle balayé de ce
non-regard qu’elle promenait sur le bal ? C’était impossible de le savoir […].
S’étaient-ils reconnus lorsqu’elle était passée près de lui ?
[…]
[Michael Richardson] était devenu différent. Tout le monde pouvait le voir. Voir qu’il n’était plus
celui qu’on croyait. Lol le regardait, le regardait changer. (R, pp. 14-16, passim)
À comparer les deux scènes, il appert que Duras ménage ses effets en usant du même jeu de
regards que pratique Mme
de Lafayette mais en inversant le rapport des sexes : Nemours
occupe la place d’une femme, Anne-Marie Stretter ; Michael Richardson, celle de Mme
de
Clèves. Cette combinaison renverse le stéréotype de la scène du coup de foudre car, dans Le
Ravissement, la place centrale est tenue par le regard de l’absente – Lol est amoureusement
délaissée comme l’est Monsieur de Clèves. Lol est en effet là sans jamais être là, à plus forte
raison lorsque le nouveau couple qui se forme orchestre la tragédie de l’héroïne11
.
Outre l’inversion des sexes et de la perspective des regards, plusieurs effets narratifs
distinguent le bal de La Princesse de Clèves de celui du Ravissement de Lol V. Stein. Si Sylvie
Bourgeois12
invoque la scène du bal créée par Léon Tolstoï dans Anna Karénine, il faut
également y voir la présence des Contes de ma mère l’Oye de Charles Perrault. L’emprunt du
jeu de regard est en effet secondé par le même effet de silence que celui qui accompagne
l’entrée de Cendrillon dans cet autre bal célèbre de la littérature de la fin du XVIIe siècle :
Il se fit alors un grand silence ; on cessa de danser et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à
contempler les grandes beautés de cette inconnue.13
L’orchestre cessa de jouer. Une danse se terminait.
10
Madame DE LAFAYETTE, La Princesse de Clèves, édition de Jean MESNARD, Paris, Flammarion, 2009, p. 98.
GF. 11
Une intervention dans le cadre d’un sondage sur la fidélité vient confirmer l’admiration fidèle de Duras pour
l’œuvre romanesque de Mme
de La Fayette : « Les “amants” de Mme
de La Fayette et ceux de l’amour courtois, il
leur était donné de l’extérieur, du seigneur ou du prince, sous peine de mort, de ne pas se connaître autrement
que par la pensée » (ME, p. 207). 12
Sylvie BOURGEOIS, « Le bal du Ravissement de Lol V. Stein : une réécriture subversive de deux grandes scènes
de bal stéréotypées » dans Alexandra SAEMMER et Stéphane PATRICE, op. cit., pp. 35-43. Voir également Olivier
AMMOUR-MAYEUR, « L’u-topos de l’allégorie dans Hiroshima mon amour, l’œil cartographique de l’oubli »
dans Christophe MEURÉE et Pierre PIRET, op. cit., pp. 267-284. 13
Charles PERRAULT, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre dans Contes, édition de Jean-Pierre COLLINET,
Paris, Gallimard, 1981, p. 174. FOLIO CLASSIQUE.
4
La piste s’était vidée lentement. Elle fut vide. (R, p. 15).
Duras crée un mélange extrêmement hétérogène intégralement dépendant du seul motif du
bal. De cette façon, elle vient alimenter à neuf une scène de bal stéréotypée par le merveilleux
des fables sans pour autant sacrifier au fantastique.
Perrault demeure une référence implicite dans nombre d’autres textes de Duras, du point
de vue de l’atmosphère, des thèmes, de l’imaginaire aussi bien que de la structure narrative, et
ce durant toute la carrière de l’écrivain14
. Même lorsqu’elle réécrit du Racine, elle l’imprègne
de traits propres à Perrault : « Elle était très jeune, dix-huit ans, trente ans, deux mille ans »15
.
Les hyperboles temporelles ou le goût pour les héroïnes assaillies par un sommeil aussi
étrange qu’irrépressible comptent parmi les principaux traits touchant au merveilleux que
l’auteur du Ravissement emprunte à celui de La Belle au Bois dormant, à quoi s’ajoute
l’attrait plus général pour les héroïnes de conte et leur aristocratie de fantaisie. Duras insiste
en effet souvent sur l’allure princière ou royale qui doit caractériser ses personnages : « Lola
Valérie Stein est une reine. […] Le vice-consul, lui, est une sorte de prince – un prince
spirituel très ancien, fabuleux » (ME, pp. 26-27). Ce qui importe à Duras, c’est de conférer
aux scènes de ses récits la plus grande intensité possible, quitte à puiser dans un répertoire
plus populaire sans cependant s’en vanter. Ainsi altère-t-elle la mémoire de la littérature dont
elle fait l’usage en la passant à des cribles dont la source demeure secrète. L’écrivain
contemporain brouille les pistes : ne mentionner Perrault ni La Fayette dans le paratexte (du
moins pas avant 1985 pour cette dernière), c’est à la fois préserver la maximisation des effets
(et notamment de la conjugaison des effets empruntés à La Princesse de Clèves au même titre
que celui de Cendrillon). De surcroît, à l’issue de la décennie cinématographique, Duras pose
le choix de s’inscrire dans une tradition particulière qui privilégie les Anciens aux Modernes,
continuant de taire l’usage de Perrault mais invoquant au contraire le patronage des auteurs de
La Princesse de Clèves et de Bérénice.
*
* *
Césarée, texte poétique ayant donné lieu à un court-métrage en 1979, et le film Dialogo
di Roma (1982), devenu sous une forme modifiée le texte intitulé Roma dans le recueil Écrire
en 1993, sont les deux (ou trois) reprises de la Bérénice de Racine. Aucune ne comporte
pourtant la moindre citation littérale de l’œuvre du dramaturge classique. Duras procède par
extension de l’univers déployé dans l’hypotexte, plutôt que par une réécriture au sens strict : il
s’agit davantage de créer une chambre d’échos où résonne la substance du texte racinien, non
sa lettre. De plus, le personnage central de Bérénice, pas plus que celui de Titus, n’est
nommé16
. Les principaux référents qui renvoient à l’histoire de Bérénice tiennent à des
indications géographiques ou à des considérations d’ordre politique. Cependant, en dépit du
fait qu’elle prétende revenir au personnage historique, ce sont bien « les grands corps des
personnages de Racine, défaillants de désir » (ME, p. 144) qui suscitent son intérêt. Ce que
14
C’est encore le cas dans La Pluie d’été (1990), roman issu du seul album pour enfants jamais écrit par Duras,
Ah Ernesto ! (1971), qui ne laisse pas de rappeler Le Petit Poucet : Ernesto et ses multiples brothers et sisters (au
nombre de sept, mais Ernesto est l’aîné au lieu d’être le benjamin) se font sans cesse abandonner par des parents
trop pauvres dans la banlieue de Vitry-sur-Seine. Comme le petit Poucet, Ernesto se caractérise par une maturité
étonnante et par une capacité d’écoute tout à fait surprenante. 15
Marguerite DURAS, Césarée dans Le Navire Night, Paris, Mercure de France, 1979-1986, p. 88. FOLIO.
Dorénavant, C suivi de la page. 16
Voir, à cet égard : Nathalie DELGLEIZE, « “Une Reine des Déserts”. L’impossible nomination de Bérénice dans
l’œuvre durassienne » dans Pierluigi LIGAS et Anna GIAUFRET, dir., (D)écrire, dit-elle. Éthopée et
prosopographie, Vérone, Qui Edit, 2007, pp. 129-137.
5
Duras perçoit de grandiose dans la Bérénice de Racine, c’est ce qu’elle appelle la « gloire »
ou « le règne du subissement »17
auquel elle voue ses propres héroïnes.
Elle : […] Elle veut bien être une reine, elle veut bien être une captive, c’est selon.
Lui : D’où lui vient ce génie ?
Elle : Peut-être aussi déjà de sa fonction royale, de cette captivité du règne dans le règne. Et peut-être
aussi de cette disposition qu’elle a, personnelle.18
Comme l’a montré Christiane Blot-Labarrère19
, la mémoire de la pièce de Racine
s’entrelace avec d’autres reprises, évocations ou analyses célèbres de celle-ci : La Reine de
Césarée de Robert Brasillach (pièce écrite en captivité et créée en 1957), l’incipit de
l’Aurélien de Louis Aragon (1944), mais aussi Les Origines du christianisme d’Ernest Renan
(1881) et sans aucun doute le Sur Racine de Roland Barthes (1963). Racine devient alors le
prête-nom d’un réseau d’échos encadrant un mythe dont Duras cherche à saisir moins
l’essence que la substance, moins la lettre que la force lyrique. Le principal intérêt de Duras
réside dans le fait d’atteindre la musique qu’elle considère comme la marque des plus grands
écrivains : « La musique aussi, c’est le divin. Il faut beaucoup chercher pour le trouver dans
l’écrit, je l’ai trouvé : le vent du divin souffle dans les grandes forêts de Racine. Sur les cimes
de la grande forêt racinienne. C’est Racine mais pas détaillé, pas lu, pensé. C’est la musique
de Racine. C’est la musique qui parle. Ce n’est pas autre chose, on s’y trompe beaucoup ;
c’est Mozart, Racine aussi, à un point criant. »20
Duras invoque la protection de ce qu’on
pourrait appeler la « métaphore Racine » pour donner à son style si distinctif un patronage
valorisant. Plus qu’un réservoir de thèmes, l’œuvre de Racine ancre solidement dans le terreau
du grand style français les arbres majestueux que sont l’auteur du Ravissement, Aragon ou
Brasillach, deux écrivains dont Duras reconnaît le talent – avec les réserves idéologiques qui
l’empêchent sans doute d’en parler.
Brasillach avait suivi la démarche racinienne selon laquelle les personnages venaient à
dialoguer entre eux en combinant la première et la troisième personne, démarche visant à faire
de Titus et de Bérénice les acteurs et en même temps les témoins de leur propre tragédie dans
des répliques demeurées célèbres dans l’histoire littéraire :
Que le jour recommence et que le jour finisse,
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,
Sans que de tout le jour je puisse voir Titus !21
L’écrivain fusillé à la Libération avait à la fois affadi et amplifié l’écho de cette dimension
propre au héros tragique qui contemple et commente la course de son propre destin, au point
où l’ancrage historique tendait à se perdre à travers l’effet d’histoire vécue par procuration :
« Nous sommes ici parce que nous sommes Titus et Bérénice, que nous seuls au monde, dans
le silence des nations et des peuples, debout l’un devant l’autre et tremblants, nous voyons
17
Jean-Pierre CETON, Entretiens avec Marguerite Duras. « On ne peut pas avoir écrit Lol V. Stein et désirer
être encore à l’écrire, Paris, François Bourin, 2012, p. 81. 18
Marguerite DURAS, Dialogue de Rome dans Cahiers de l’Herne, « Marguerite Duras », dir. Bernard ALAZET et
Christiane BLOT-LABARRÈRE, n°86, 2005, p. 254. 19
Christiane BLOT-LABARRERE, « De Césarée à “Roma”, Marguerite Duras dans les forêts de Racine » dans
Alexandra SAEMMER et Stéphane PATRICE, op. cit., pp. 13-23. 20
Marguerite DURAS, La Vie matérielle, Paris, P.O.L., 1987, pp. 92-93. FOLIO. Voir également, sur les emprunts
stylistiques aux auteurs du Grand Siècle : Stéphane CHAUDIER, « Duras/Boileau : aux limites du langage » dans
Anne COUSSEAU et Dominique DENES, dir., Marguerite Duras : marges et transgressions, Nancy, Presses
universitaires de Nancy, 2006, pp. 279-288. LE TEXTE ET SES MARGES. 21
Jean RACINE, Bérénice, Acte IV, scène V, Paris, Gallimard, 1994, p. 89. FOLIO THEATRE.
6
resurgir notre passé tremblant, avec sa face pâle et ses lèvres entrouvertes. »22
Duras accentue
le procédé, surtout dans le Dialogue de Rome et dans Roma, en orchestrant la résonance
spectrale de la tragédie antique à travers l’échange d’un couple installé dans le hall d’un hôtel
de la Piazza Navona, revivifiant l’acuité de la douleur amoureuse.
— Vous aviez parlé d’un amour actuel, dans ce film ?
— Je ne sais plus. J’ai parlé d’un amour vivant il me semble, mais seulement de ça. […] Ce sont ces
dialogues autour de cet amour qui, au cours des siècles, ont recouvert Rome d’une nappe de fraîcheur.
C’est à l’endroit du corps massif et mort de son histoire que les amants auraient enfin pleuré de leur
histoire, de leur amour.
[…]
— Vous parlez des amants du Temple.
— Sans doute. Oui. Je ne sais pas de qui je parle. Aussi bien je parle de ceux-là, oui.23
De la sorte, dans La Reine de Césarée comme dans les textes de l’auteur de L’Amant,
l’histoire mythique de Bérénice devient l’occasion et le lieu d’une relecture de l’Histoire
passée et de l’Histoire contemporaine. Duras se place dans le sillage de Brasillach tout en en
prenant le contrepied, la tragédie de l’héroïne reposant sur son statut de victime d’une « raison
d’État » (C, pp. 87 et 88) défavorable à son origine juive. À cet égard, Duras a toujours
reconnu l’impulsion initiale qu’a constituée un voyage en Israël effectué quelques années plus
tôt24
. Duras s’était en effet promenée dans Césarée jusqu’à décider de repousser la date de son
retour en France, afin de mieux s’imprégner de l’atmosphère du lieu, qui ne prend sens qu’à
partir de son émotion de lectrice du texte racinien.
C’est probablement à Aragon qu’elle emprunte la confusion nécessaire entre le lieu, le
temps et le personnage. La rencontre d’Aurélien avec sa Bérénice de l’entre-deux-guerres le
reporte à l’un des vers de Racine : « Je demeurai longtemps errant dans Césarée… »25
, sans
qu’il puisse concevoir la moindre explication au phénomène. Il se trouve également incapable
de se rappeler du personnage qui prononce cette réplique, alors que le travail de la mémoire
lui apporte en réalité le nom sur un plateau, ce qui produit implicitement une première
superposition entre un personnage et un lieu : « D’ailleurs il ne se rappelait que dans ses
grandes lignes cette romance, cette scie. […] Césarée, c’est du côté d’Antioche, de Beyrouth.
Territoire sous mandat. […] Césarée… un beau nom pour une ville. Ou pour une femme. Un
beau nom en tout cas. Césarée… »26
Dans le roman d’Aragon, la ritournelle que constitue la
réplique d’Antiochus semble créer une indistinction entre les identités des personnages de
Racine mais aussi entre Bérénice et le lieu duquel elle provient. La même indistinction,
considérablement accrue, est à l’œuvre chez Duras, où le personnage d’Antiochus disparaît
totalement, la substance de son discours (son errance d’amant éperdu et éconduit dans
Césarée) étant littéralement absorbée par le personnage féminin. Mieux, la Bérénice de Duras
n’est nommée que par le lieu de son origine et de son errance. A posteriori de la fable
22
Robert BRASILLACH, La Reine de Césarée, Paris, Plon, 1954, pp. 76-77. 23
Marguerite DURAS, Roma, dans Écrire, op. cit., pp. 98-99, passim. Le synopsis du Dialogue de Rome dévoile
l’ambition exacte de l’écrivain cinéaste : « Toute cette conversation porterait sur un fait ancien de la vie du
couple, fait jamais explicité, impossible à expliciter, et qui représenteraient en quelque sorte le mal inguérissable
d’un amour. Ce mal se rapporterait à celui de l’exil. […] C’est dans l’engrenage des différentes versions de cette
difficulté de l’amour des amants que nous arriverons peut-être à atteindre une autre histoire, celle-là célébrée
dans le monde entier, exemplaire, celle de la Reine de Samarie, Bérénice, et de son amant, le destructeur du
Temple, le chef des armées romaines. » (Marguerite DURAS, Dialogue de Rome, op. cit., p. 250). 24
Marguerite DURAS, La Couleur des mots, Paris, Benoît Jacob, 2001, p. 172. Je remercie Ruth Amossy pour les
précisions qu’elle m’a apportées au sujet de ce voyage. 25
« Dans l’Orient désert quel devint mon ennui ! / Je demeurai longtemps errant dans Césarée, / Lieux charmants
où mon cœur vous avait adorée. » (Jean RACINE, op. cit., p. 48). 26
Louis ARAGON, Aurélien, Paris, Gallimard, 1944-1966, p. 28. FOLIO.
7
racinienne, le lieu de l’origine et du retour arbore les affects que les deux écrivains
contemporains prêtent au personnage.
Ce devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée d’un malheur.
Quelque chose comme une défaite. Désertée. […] Une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à
l’aube. Aurélien voyait des chiens s’enfuir derrière des colonnes, surpris à dépecer une charogne. Des
épées abandonnées, des armures. Les restes d’un combat sans honneur.27
Le lieu s’étrique et s’élargit à la fois chez Duras, mais la topographie est sensiblement la
même, à cette différence qu’elle lui confère les atours de la réalité contemporaine. La
confusion est maximale dans le jeu d’écho qui fait que c’est le lieu qui raconte l’histoire
davantage qu’un personnage ou un texte : les ruines de Césarée ne témoignent pas que d’elles-
mêmes, mais des aspirations conjuguées de plusieurs générations d’écrivains, tous rivés à ce
sujet tragique qu’est le renvoi de Bérénice par Titus. L’écho est largement amplifié, parce que
Duras situe Bérénice à deux moments du temps : à l’époque de Titus et longtemps après sa
mort, mais aussi à deux moments de l’espace : à Césarée et à Paris. La question d’un écho qui
résonne à travers le temps au départ d’un lieu incertain qui se caractérise par le vide ou le
négatif est à l’œuvre dans chacun des textes rassemblés dans le recueil de textes écrits pour
des projets cinématographiques intitulé Le Navire Night28
.
L’endroit s’appelle encore
Césarée
Cesarea.
[…]
Il ne reste que l’histoire
Le tout.
Rien que cette rocaille de marbre sous les pas
Cette poussière.
Et le bleu des colonnes noyées.
La mer a gagné sur la terre de Césarée.
Les rues de Césarée étaient étroites, obscures.
Leur fraîcheur donnait sur le soleil des places
l’arrivée des navires
et la poussière des troupeaux.
Dans cette poussière
on voit encore, on lit encore la pensée
des gens de Césarée
le tracé des rues des peuples de Césarée. (C, pp. 85-86)
Le lieu et le personnage, confondus, deviennent les réceptacles possibles d’une expérience
presque proustienne de mémoire involontaire. En ce sens, l’érosion même de la mémoire
permet un jeu prismatique d’échos ; l’événement contingent du souvenir ne hante le lieu que
parce que celui-ci s’offre à la lecture. La littérature du passé est revisitée selon les exigences
du présent : c’est à travers cet événement que se fait jour la « convenance ».
27
Ibid. 28
À cet égard, il convient de consulter le livre de Bernard ALAZET, Le Navire Night de Marguerite Duras. Écrire
l’effacement, Lille, Presses universitaires de Lille, 1992. TEXTES ET PERSPECTIVES. On pense également au
personnage emblématique de Madeleine, dans Savannah Bay (1983), la vieille comédienne dont la mémoire est
plus habitée par la fiction que par une mémoire factuelle.
8
François Mitterrand, Roi Soleil
Le moment où Duras se met à assumer explicitement l’influence de la fin du XVIIe siècle
français sur sa propre œuvre n’est pas, biographiquement parlant, insignifiant : elle vient
d’accéder au rang d’écrivain de premier plan avec l’attribution et le succès du Goncourt de
L’Amant (1984) et son amie Michelle Porte vient de réaliser un film documentaire sur la
Princesse Palatine (tourné au printemps 198429
), qu’elle a pris soin de commenter dans un
article de presse (décembre 1985). Dans cet article, Duras vante les mérites du regard
iconoclaste que son amie porte sur une portion de l’Histoire de longue date figée dans
l’imaginaire populaire, renouvelant par ce biais les perceptions erronées que les cours
d’Histoire peuvent véhiculer : « Seuls ceux qui ne savent rien ou presque rien peuvent
regarder Versailles comme les auteurs de ce film l’ont regardé » (ME, p. 38). Elle y retrouve
en quelque sorte sa façon singulière de s’approprier la mémoire de la littérature passée.
Lorsque l’article intitulé « La lecture dans le train », paru dans le New York Times de
juin 1985 puis dans L’Autre Journal en novembre de la même année, s’attarde sur les livres
qui ont profondément marqué (positivement ou non) la romancière, l’on y découvre en bonne
place – de façon plutôt surprenante – les écrits mémorialistes de Mme
de La Fayette.
Elle a entrepris d’écrire les Mémoires de la Cour de France de 1688 à 1689. On dirait le titre d’un
sujet de thèse. […] Elle écoute les potins, les nouvelles. Avec une miraculeuse intelligence, elle
détecte la vérité probable, c’est-à-dire qu’elle invente des choses que les gens reconnaissent sans les
avoir jamais vécues. Elle choisit d’être sur le passage de l’information quand celle-ci sort de la Cour,
et aussi d’être sur son passage lorsqu’elle y revient, colportée par les bourgeois, les marchands, les
foules des serviteurs du palais, les livreurs, les charlatans, les porteurs de billets, les jeteurs de sorts,
les entremetteurs qui envahissent tous les jours les Tuileries, qui suivent la Cour du roi à Versailles, à
Rambouillet, dans la Loire. C’est à ce moment-là qu’elle intervient et qu’elle commence à raconter
l’histoire. […] Mais beaucoup de gens reçus à la Cour viennent la voir, ne serait-ce que pour savoir ce
qui s’est passé tandis qu’eux-mêmes y étaient mais empêchés de voir et de connaître quoi que ce soit à
ce qui arrivait, plongés qu’ils étaient dans le désordre de l’événement en cours. (ME, p. 142-143)
Ce commentaire sur les Mémoires de Mme
de La Fayette constitue une forme de légitimation à
peine voilée de l’entreprise médiatique de Duras elle-même : orchestrer le récit des
événements auxquels les lecteurs ont assisté (par le biais des médias) sans pour autant
s’avérer capables « de voir et de connaître quoi que ce soit à ce qui arrivait ». Elle vante donc
les mérites de l’auteur de La Princesse de Clèves pour son rôle de passeuse d’informations en
atténuant l’empreinte de la « société du spectacle » par le truchement des atours de la cour des
rois de France30
. C’est ainsi que le « désordre de l’événement en cours », tel qu’il passe à la
télévision ou tel qu’il a pris place dans l’Histoire, est littéralement disséqué par l’auteur de
L’Été 80 jusqu’à obtention d’une « vérité probable », quitte à devoir en passer par l’invention
ou la fiction. Car fiction et invention participent pleinement de toute relation événementielle,
fût-ce seulement par l’expression de la subjectivité du rapporteur, cette subjectivité
passionnée et passionnelle que Duras se reconnaît en commun avec La Fayette et Racine31
.
29
La Princesse Palatine à Versailles. Portrait d’une famille royale, INA-TF1, diffusé sur TF1 en novembre
1985, 62’. L’article de Duras, du même titre, a paru dans L’Autre Journal en décembre 1985 (ME, pp. 37-43). 30
La Princesse Palatine, dans ses lettres, occupe pour Duras la même position que celle de Mme
de La Fayette et
Duras n’évoque publiquement comme influence que la seconde (à l’exception de l’article sur le film de Michelle
Porte), parce que la première lui paraît sans doute encombrante du point de vue postural. 31
Duras esquisse en effet un trait commun à La Fayette et à Racine, élargissant implicitement cette communauté
à sa propre œuvre : « le souffle de la passion est le même, libéré de même, il vient de plus loin que l’histoire
connue, il traverse les règnes, les forêts des envahisseurs, les églises, les schismes, les clans » (ME, p. 142).
9
La parenté entre les Mémoires de La Fayette et l’entreprise scripturale de Duras (par le
biais de textes de fiction, de chroniques, mais aussi d’entretiens) se situe à la fois sur le plan
d’une certaine rhétorique (de nombreux événements sont évoqués sans faire l’objet d’une
contextualisation claire, parce qu’ils sont empruntés à une actualité partagée par les lecteurs
contemporains, les référents contextuels sont gommés) mais aussi dans les prises de position
affectives portant sur les hommes qui font l’Histoire et sur leurs singularités32
. Son intimité
avec François Mitterrand, dont elle a soutenu la campagne en 1981, lui permet d’acquérir une
audience publique plus large, ce qui l’autorise à s’identifier, dans une certaine mesure, à un
écrivain officiel et d’identifier, par les ressources de l’imaginaire, le début du règne de Louis
XIV et le début de la présidence Mitterrand. Aucune comparaison n’est explicitement engagée
mais les articles évoquant chacun des deux chefs de l’État français entretiennent des
accointances, se servant d’une rhétorique similaire et de thèmes communs.
Duras se crée donc, au milieu des années 1980, une posture d’écrivain de cour, aussi
bien reconnu pour son génie narratif que pour sa proximité avec la source du pouvoir, dont
elle forge habilement un ethos de confidente du Président. En plus d’avoir conduit une série
d’entretiens avec le président de la République en exercice en 198533
, elle ne cesse de
souligner cette proximité au fil des articles qu’elle publie dans la presse :
J’aurais préféré parler directement avec Mitterrand de tout cela. Mais je ne pense pas qu’il aurait
accepté en raison de la prudence naïve de son entourage à mon endroit. Pourtant, en m’exprimant sur
cette affaire, je ne fais aucun mal à Mitterrand, j’en suis sûre, c’est juste le contraire. (ME, p. 82)
Mettant en évidence les lectures qui la marquent au XVIIe siècle, Duras s’assigne une position
dans l’Histoire équivalente à celles d’écrivains de cour comme Racine ou Mme
de La Fayette,
en même temps qu’elle découvre a posteriori des signes d’anticipation de son présent au sein
de la littérature du XVIIe siècle (à l’égard du siècle suivant et de sa Révolution en particulier,
mais aussi de trois siècles plus tard). Ainsi, la flèche du temps de l’imaginaire durassien se
porte dans les deux sens : le présent éclaire le passé par les parallèles et les similitudes qu’il
exprime au même titre que ce même passé anticipait déjà prophétiquement le présent.
Le réseau intertextuel qui se tisse entre ses textes et les œuvres du Grand Siècle crée
alors une caisse de résonance où se déploie la marche de l’Histoire. Duras dissémine ainsi les
appels aux périodes précédant ce qu’elle considère comme les grands bouleversements de
l’Histoire humaine : la décadence romaine, déjà présente dans la répudiation de Bérénice par
Titus, la Révolution française, que l’écrivain n’envisage qu’à la lumière du Roi Soleil34
, et la
destruction à venir des sociétés occidentales, annoncée par le péril atomique autant que par
l’avènement des idéaux de Mai 68 et du socialisme au pouvoir. C’est ainsi que Racine et Mme
de La Fayette incarnent littéralement aux yeux de Duras, dans les années 1980, l’essence des
« trente dernières années » du XVIIe siècle, qui se projette telle une ombre sur la seconde
moitié du XXe siècle et, partant, sur l’œuvre de l’auteur de Détruire, dit-elle.
32
Voir, à ce sujet, Christophe MEUREE, « La tentation mémorialiste de Marguerite Duras » in La Licorne, « Le
sens du passé. Pour une nouvelle approche des Mémoires », dir. Marc HERSANT, Jean-Louis JEANNELLE et
Damien ZANONE, n°104, 2013, pp. 175-190. 33
Ces entretiens ont paru partiellement dans L’Autre Journal et ont été publiés de manière doublement
posthume, sous le titre Le Bureau de poste de la rue Dupin (Paris, Gallimard, 2006). La simplicité est le mot
d’ordre à cette époque : « Je suis une inconditionnelle de Mitterrand. J’ai une totale confiance en lui, pas comme
chef d’État, mais comme dans une personne qui se trouve être soudain chef d’État. » (ME, p. 28). 34
Bérénice hante d’ailleurs Versailles, dans l’indifférence de sa déliquescence : « Il y a les salons où l’on danse,
ceux où l’on joue au trictrac, ceux où l’on écoute Bérénice, ceux où l’on parle, où l’on se tape dessus. » (ME,
p. 40).
10
L’irréversibilité dans la cyclicité est l’un des principaux traits apocalyptiques dans
l’imaginaire durassien35
, tout comme la littérature, à ses yeux, détient un pouvoir
prophétique : « Dans le gouvernement de François Mitterrand, il s’est passé quelque chose de
définitif, sur quoi on ne peut pas revenir, de spirituellement très élevé. La poésie, tout à coup,
et ça s’est refermé » (ME, p. 65). En ceci, il est essentiel pour elle de trouver une confirmation
du mouvement apocalyptique de l’Histoire dans les siècles qui l’ont précédée, mais aussi dans
les sujets que ceux-ci ont traités. C’est pourquoi elle retient Racine et La Fayette.
À l’intérieur de ces trente années ils sont deux. Avec eux, pour moi, dès l’abord de leurs œuvres le
pessimisme est là, comme après Karl Marx, il est à la base du bâtiment de leurs écrits, leurs fondations
d’origine. Dans la corruption profonde de la noblesse, la dissolution incroyable des mœurs, dans
l’ombre des rideaux détrempés par la pisse des princes, chacun de leur côté, ils découvrent, ils
découvrent ce qu’il en est de la passion humaine, de sa grandeur, de sa folie, de son immensité. (ME,
p. 142)
D’une certaine façon, dans l’imaginaire durassien, la fin du XVIIe siècle appelle la fin du XX
e
siècle : un pessimisme ambiant qui se marque dans un relâchement sur le plan moral, une
époque de crise qui ouvre la littérature à une exacerbation de certains thèmes, ces affects
extrêmes qui sont la signature de Duras. Les passions qu’elle estime partager avec La Fayette
et Racine ne peuvent éclore que dans un terreau historique spécifique : la littérature des trente
dernières années du XVIIe siècle en témoigne au même titre que celle des trente dernières
années du XXe siècle.
À la fin du XVIIe siècle, Versailles était par excellence le lieu du tragique, « [d]e nature
tragique comme la royauté » (ME, p. 37), y insiste Duras. Le règne de Louis XVI annonçait
déjà prophétiquement la fin d’un monde, dont il jetait le dernier éclat majestueux : « Il s’agit
ici du dernier des grands règnes de l’Histoire de France, de celui déjà inclus dans le siècle de
l’échafaud » (ME, p. 37). De la même façon, les victoires dorées de Mai 68 – cette autre
« dissolution incroyable des mœurs » – et du 10 mai 1981, auxquelles Duras a contribué avec
ses moyens d’écrivain médiatisé, sont les derniers flamboiements d’un siècle qui fut celui de
toutes les peurs et de toutes les fins : grande Guerre, Shoah, Hiroshima, Guerre froide, crises
économiques, etc. Par conséquent, Duras utilise les événements historiques pour donner
raison à ses propres annonces prophétisant la fin du monde occidental, modelées par
l’imaginaire, la littérature et le cinéma (Détruire, dit-elle et Le Camion en particulier). Le
monde est en voie de mutation ; la France d’après 68 se tourne progressivement vers la
gauche, mais comme dans un dernier soubresaut d’agonie :
Il m’est complètement indifférent que François Mitterrand réussisse ou non, ce qui m’intéresse ce sont
les propositions, des propositions socialistes qu’on avait oubliées, complètement merveilleuses, peut-
être impossibles, irréalisables. […] C’est ça qui fait avancer le monde et rien d’autre, ces tentatives-là,
sans doute vouées à l’échec. (ME, pp. 12-13)
Un tel prophétisme ne se construit qu’instruit du passé. Non d’un savoir scolaire, toujours
stérilisant, mais d’une expérience purement affective. La temporalité durassienne se fonde dès
lors sur ce phénomène d’inclusion illimitée : il s’agit pour l’écrivain de se ressaisir de
l’Histoire non tant pour en entériner le sens à travers un système causal que pour lui offrir un
sens inédit découvert à la croisée de plusieurs modes de lecture du temps : cyclique,
35
Voir notamment : Christophe MEUREE, « L’image apocalyptique », dans Caroline Proulx et Sylvano Santini,
dir.,, Le cinéma de Marguerite Duras : l’autre scène du littéraire ?, Berne-Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2015, à
paraître. MARGUERITE DURAS ; « Un style prophétique. D’un imaginaire présidant à l’histoire des Éditions de
Minuit », dans Michel Bertrand et Karine Germoni, dir., Existe-t-il un style Minuit ?, Aix-en-Provence, Presses
universitaires de Provence, 2014, à paraître.
11
rétrospectif et prospectif. Dès lors il va de soi que chacune des reprises de Bérénice par Duras
comporte un cadrage contemporain, comme la fin de Césarée en 1979 :
L’endroit s’appelle Césarée
Cesarea
Il n’y a plus rien à voir. Que le tout.
Il fait à Paris un mauvais été.
Froid. De la brume. (C, p. 89)
La « convenance profonde » met ainsi au jour une communauté transhistorique
confrontée aux mêmes événements, animés de ce même « gai désespoir » dont l’auteur de
L’Amant avait fait sa marque de fabrique dans les années 1970. Le même mot de
« convenance » se démarquait d’ailleurs également dans le texte central du numéro spécial
des Cahiers du cinéma de 1980 intégralement composé par l’écrivain, texte dédié et adressé à
son ami Jean-Pierre Ceton, l’un des jeunes soixante-huitards qui représentaient cette
destruction à venir et le renouveau forcément consécutif :
regardons venir la nuit, l’autre versant de la vie, ce retournement, à peine on le voit, à peine on le sent,
ce glissement, […] et puis voici, les voici venir, les génies, les génies du noir, à pas feutrés, ils
viennent, […] les moissons nouvelles, celles des non-travailleurs, ceux qui ne feront plus le travail, ne
souffriront pas, trouveront leur convenance dans le loisir illimité de la vie, regarde, écoute, ce temps
étrange, il vient, long, il est long, lent, il n’y a plus de travail, n’y aura plus de travail, les longs
chômages de la fin du XXe siècle […] ont commencé, vont rester là, devenir séculaires
36
Duras rend doublement à la littérature son pouvoir visionnaire : Racine et de Mme
de La
Fayette deviennent par capillarité des annonciateurs de Mai 68. Dans la « convenance » réside
indéniablement la possibilité de se reconnaître au miroir de ce qui fut et de ce qui vient à la
fois.
*
* *
L’on accède au rang de Grand Écrivain en faisant bon usage de ses « grandes
lectures » : « En apparence, j’ai lu n’importe comment, n’importe quoi. En fait, non. En fait,
j’ai toujours lu des livres dont on m’avait dit qu’il fallait les lire, des gens, des amis ou des
lecteurs en qui je croyais. » (ME, p. 138). Alors que Duras, jusqu’à la fin des années 1970,
rechigne à abattre les cartes de ses influences littéraires dans le but de maximiser les effets de
la savante alchimie intertextuelle à laquelle elle se livre, sa posture s’érige au contraire, à
partir de la décennie suivante, dans une tension paradoxale entre la référence classique qui
conforte une stature de grand écrivain et une manière iconoclaste de traiter la littérature
passée dictée par un amour fou, une passion ravageuse envers (et en commun avec) les
écrivains du Grand Siècle. L’emprunt d’une scène ou d’une atmosphère ajoute une double
dimension dans le phénomène de l’appropriation : d’une part, au grand dam ou à la risée de
ses détracteurs, Duras légitime son propre parcours en l’inscrivant dans une noble tradition et,
d’autre part, elle établit une logique d’effets en cascade, comme si une part de la littérature
antérieure venait à trouver un aboutissement dans ses propres productions.
Par le biais de son traitement de la littérature du Grand Siècle, Duras se construit à la
fois un ethos qui puisse refléter son « souci de l’avenir » et lui octroyer une légitimité par
36
Marguerite DURAS, Les Yeux verts, Paris, Paris, Étoile-Cahiers du Cinéma, 1996, p. 71, je souligne.
12
ricochet. La légitimité résulte de l’arc de résonance temporel que Duras tend vers l’avenir en
se saisissant de la contingence mémorielle, du surgissement de l’ombre du Grand Siècle sur la
seconde moitié du XXe siècle. Reconnaître les concordances entre les siècles devient la force
de l’écrivain et donne du crédit à son travail, à l’heure où celui-ci ne jouit plus du prestige
d’antan. Duras capte ainsi le prestige du siècle qui a fondé la littérature française postérieure,
à plus forte raison quand elle revient à la littérature après l’avoir quittée pendant dix ans.
« Oui, quand j’ai dit qu’on écrivait seul, c’est dans le temps même où on écrit. On est
quand même là où on est. Tu n’es pas au XIXe siècle, tu n’es pas au XXI
e siècle, tu es là, là où
tu es, toujours. »37
Si un imaginaire se forge nécessairement sur la mémoire des lectures
passées, s’il se revivifie dans la relecture ou dans la réécriture – la plus infidèle fût-elle –, il se
charge également d’investir les données de son époque au cœur même de cette mémoire,
jusqu’à l’en saturer. Lorsque Duras parle de Racine ou de Mme
de La Fayette, les textes
antérieurs n’existent plus, ils sont presque abolis. Toutefois, cette matière première exerce son
empire sur l’acte créateur qui s’empare à son tour du monde qui lui est contemporain et le
gorge d’un dialogue anachronique, où ne s’affrontent plus les distinctions contextuelles ni la
distance temporelle. Au contraire, de ce dialogue émerge une nouvelle perception de
l’Histoire, une perception résolument apocalyptique, entre destruction et révélation.
37
Marguerite DURAS, Suzanne LAMY et André ROY, op. cit., pp. 23-24.
Related Documents