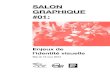Maternité en Yvelines et Périnatalité Active • CHI Poissy/St Germain en Laye • Pavillon Courtois • 2 ème étage 20, rue Armagis • 78100 ST GERMAIN EN LAYE Tel : 01 39 27 43 98 • Fax : 01 39.27.43.98 • Mail : [email protected] COMPTE-RENDU DE LA REVUE DE MORBI-MORTALITE DU RESEAU MYPA CHI Poissy St Germain – site de Saint Germain Le 5 novembre 2013 Etaient présents : Azza AGLAN, Gynécologue Obstétricien Julie BENIE, Sage-femme Pierre BLANIE, Anesthésiste Micheline BLAZY, Gynécologue Obstétricien Valérie BROSSAIS, Sage-femme Emmanuelle CIBOT, Sage-femme coordinatrice Chantal CONDAMINE PERSUY, Gynécologue médical Christine DECES PETIT, Sage-femme Anne DUBOIS, Sage-femme coordinatrice Dominique FORGET BILLIOT, Médecin PMI Nathalie GARDELLE, Assistante de coordination Charlotte GAUTHIER, Sage-femme Marie Christine GRENOUILLET, Anesthésiste Monique HANAUER, Gynécologue Obstétricien Laure LAROCHE, Etudiante Sage-femme Michelle LAURENTIN, Sage-femme PMI Lydie LOISY, Sage-femme PMI Ilona MANSOULIE, Gynécologue Obstétricien Jan MARIN, Gynécologue Obstétricien Jacques MERRER, Hygiéniste Pierre RAYNAL, Président CMS MYPA Michel RISCAL, Pédiatre Patrick ROZENBERG, Gynécologue Obstétricien Véronique RUET, Sage-femme Cadre Bénédicte SIMON, Gynécologue Obstétricien Claude VIRTOS, Gynécologue Obstétricien Les personnes présentes ont signé une feuille d’émargement. Introduction 1.1 Pourquoi faire des RMM L’objectif de la RMM est d’optimiser la sécurité des patientes par une analyse collective de toute complication morbide ou mortelle survenue de façon inattendue chez une patiente, son fœtus ou son nouveau-né, en présence des professionnels concernés, et sous couvert du secret professionnel dans le but d'une amélioration continue de la qualité des soins et de la prise en charge des patientes au sein du réseau MYPA. Le but est de s’interroger sur le caractère potentiellement évitable de l’événement inattendu et de proposer des axes d’amélioration, au regard des recommandations professionnelles, de recommandations bonnes pratiques, de conférences de consensus afin de prévenir la récidive (mises en place de protocoles ou de formations des professionnels, etc.)

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Maternité en Yvelines et Périnatalité Active • CHI Poissy/St Germain en Laye • Pavillon Courtois • 2ème étage 20, rue Armagis • 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Tel : 01 39 27 43 98 • Fax : 01 39.27.43.98 • Mail : [email protected]
COMPTE-RENDU DE LA REVUE DE MORBI-MORTALITE DU RESEAU MYPA
CHI Poissy St Germain – site de Saint Germain
Le 5 novembre 2013
Etaient présents :
Azza AGLAN, Gynécologue Obstétricien
Julie BENIE, Sage-femme
Pierre BLANIE, Anesthésiste
Micheline BLAZY, Gynécologue Obstétricien
Valérie BROSSAIS, Sage-femme
Emmanuelle CIBOT, Sage-femme coordinatrice
Chantal CONDAMINE PERSUY, Gynécologue médical
Christine DECES PETIT, Sage-femme
Anne DUBOIS, Sage-femme coordinatrice
Dominique FORGET BILLIOT, Médecin PMI
Nathalie GARDELLE, Assistante de coordination
Charlotte GAUTHIER, Sage-femme
Marie Christine GRENOUILLET, Anesthésiste
Monique HANAUER, Gynécologue Obstétricien
Laure LAROCHE, Etudiante Sage-femme
Michelle LAURENTIN, Sage-femme PMI
Lydie LOISY, Sage-femme PMI
Ilona MANSOULIE, Gynécologue Obstétricien
Jan MARIN, Gynécologue Obstétricien
Jacques MERRER, Hygiéniste
Pierre RAYNAL, Président CMS MYPA
Michel RISCAL, Pédiatre
Patrick ROZENBERG, Gynécologue Obstétricien
Véronique RUET, Sage-femme Cadre
Bénédicte SIMON, Gynécologue Obstétricien
Claude VIRTOS, Gynécologue Obstétricien
Les personnes présentes ont signé une feuille d’émargement.
Introduction
1.1 Pourquoi faire des RMM
L’objectif de la RMM est d’optimiser la sécurité des patientes par une analyse collective de toute complication morbide ou mortelle survenue de façon inattendue chez une patiente, son fœtus ou son nouveau-né, en présence des professionnels concernés, et sous couvert du secret professionnel dans le but d'une amélioration continue de la qualité des soins et de la prise en charge des patientes au sein du réseau MYPA.
Le but est de s’interroger sur le caractère potentiellement évitable de l’événement inattendu et de proposer des axes d’amélioration, au regard des recommandations professionnelles, de recommandations bonnes pratiques, de conférences de consensus afin de prévenir la récidive (mises en place de protocoles ou de formations des professionnels, etc.)

CR RMM 05/11/2013 2
Peuvent faire l’objet d’une déclaration en vue d’une RMM :
- Les décès maternels (du jour de l’accouchement au 42ème jour du post partum)
- Les décès néonataux
o Morts fœtales in utero dès la 22ème semaine
o Décès survenant dans les 28 premiers jours de vie
o Décès des nouveau-nés en réanimation et/ ou en salle de naissance
Les dossiers concernant les IMG ne seront pas présentés.
Toutes les complications morbides et presque accidents1
- Les complications liées à un transfert in utero
- Les évènements motivant une hospitalisation en réanimation de la mère ou de l’enfant
- Les hémorragies du post partum graves nécessitant une embolisation vasculaire, une chirurgie d’hémostase ou une transfusion sanguine.
- Les encéphalopathies anoxo-ischémique chez un nouveau-né nécessitant une hospitalisation en réanimation ou en soins intensifs.
1.2 Méthodologie d’analyse des dossiers
• Revue et Chronologie du dossier proposé au réseau
• Entretiens avec les personnels
• Analyse selon le modèle des accidents organisationnels : modèle de Reason adapté à la pratique clinique et proposé par Vincent & Col.
• L’analyse d’incident clinique =
• Moins mettre l’accent sur les individus
• Plus sur les facteurs organisationnels
• Méthode puissante d’apprentissage de l’organisation des soins
• Conduit directement aux stratégies d’amélioration de la sécurité du patient
Pour cela les questions posées sont déclinées dans plusieurs dimensions :
Quels sont les facteurs liés à l’environnement de travail ?
Quels sont les facteurs liés à l’équipe ?
Quels sont les facteurs individuels (personnel) ?
Quels sont les facteurs liés aux tâches à effectuer ?
Quels sont les facteurs liés aux patients ?
Quel est le contexte institutionnel - Facteurs organisationnels et de gestion ?
1 Situation qui aurait conduit à l'accident si des conditions favorables n'avaient pas permis de l'éviter

CR RMM 05/11/2013 3
Dossier RMM 5 novembre 2013
. Patiente âgée de 26 ans
. G3 P2
. ATCD Médicaux : Ø ; Ø Alcool/Tabac/Drogue
. ATCD Chirurgicaux : appendicectomie 15 ans
. ATCD Obstétricaux : 2008 : Grossesse simple. Acct 38SA. Forceps non progression. 3860g
2010 : Grossesse simple. Acct 38SA+1. 3050g
. Grossesse actuelle :
. DDG : 10/08/2011
. Toxo + ; Rubéole + ; Syphilis - ; VIH -
. Echo T1 : 11SA+6 RAS
. Echo T2 : 22SA+5 RAS
. Echo T3 : 32SA+2 RAS
. Grossesse suivie en ville
. 33SA+1j : 1ière CS maternité RAS
. 36SA : CS anesthésie
Le 14/04/2012
. 37SA + 2 :
17h30 : CS aux urgences obstétricales pour métrorragies modérées et CU/5min
A l’arrivée : TA : 11/6 ; Pouls 72 ; HU 32 cm
RCF : normo-oscillant , MAF +++ ; CU/2min
Col centré, épais, 2 doigts, céphalique appliquée
→ perte du bouchon muqueux, probable mise en travail
→ NFS plq (141 000 à 32SA + 2) AgHbs RAI VVP Ringer 1l
19h50 → Ballon. NB : panaris index mains Dt et G
. 21h00 : CU/2 ; 3min
MAF +
Col : intermédiaire ; épais en voie d’effacement, 3-4cm, souple, PC refoulable
→ Passage en SDN
. 21h20 : TA : 12/7
RCF normo oscillant normo-réactif
Pose APD/PCEA
. 22h30 : Col 7cm ; PDE bombante ; 4 à 5CU/10min
TA : 110/55 ; T° 37°6
. 23h30 : Col 9cm ; RSPDE LA clair ; OIGA ; 4CU/10min
TA : 110/65
Le 15/04/2012
. 0h10 : Dilatation complète ; OP engagée ; TA 125/80 → Efforts expulsifs
. 0h22 : naissance d’un garçon 2815g APGAR 10/10/10 DDC

CR RMM 05/11/2013 4
. 0h45 : Bon globe utérin ; Sg N.aux
15UI Syntocinon/500cc RL en cours
. 1h15 : Bon globe ; Ø Sg
. 1h45 : Bon globe ; Sg = peu
. 2h15 : Bon globe ; Sg N.aux
↕ KT APD ; ↕ perf synto ; toilette
Passage en SDC
En SDC
. Surveillance RAS puis …
. Le 16/04/12 . 2h (H25/acct) : T° 37°8
. 5h (H28) : douleur lombaire irradiant flanc droit. EVA 8-9
T° (axillaire) 36°5 Ø frissons ; TA 115/65 ; examen obstet N.al
vomissements
NFS ; CRP ; ECBU
perfusion G5 1l ; 1g perfalgan
→ Dic de tranchées
→ patiente soulagée
. 7h15 (H30) : reprises douleurs flanc droit
T° 37°8
Examen clinique par gynéco : douleur flanc Dt
CRP : 98
Perfalgan/Profenid 100 x2/Spasfon 6Amp
Clamoxyl 2g/24h IV. A jeun
Demande de scanner abdomino-pelvien. Patiente s’endort
. 10h10 : Saignements ++ → massage utérin par SF SDC ; utérus tonique 3TD
(H33) → appel médecin + interne
→ 5 UI Synto IVD + 10UI ds 500cc G5%
. 10h35 : saignements considérés normaux par le médecin. Poursuite Synto
. 11h10 : saignements abondants. T° 38°1 ; lochies « malodorantes » ; TA 11/7 ; Pouls 89
(H34) appel médecin
. 11h40 : médecin sur place
utérus douloureux à la palpation, « moyennement contracté »
douleur hypochondre droit
saignement vaginal actif
TV : col ouvert
Echo : petite rétention intra-utérine, vésicule biliaire ↑ taille
Conclusion : atonie utérine très probable
→ décision de révision utérine et utérotoniques
. 10h25 : Diarrhée

CR RMM 05/11/2013 5
. 12h15 : patiente admise en SDN pour saignements d’origine utérine
(H35)
Echo : vacuité utérine, lame d’épanchement abdominale
Anesthésie générale pour RU+examen du col sous valves → RAS ; Selles liquides
. Pdt l’intubation : gingivorragies, pétéchies, hémorragies sous muqueuses
Pose d’une sonde urinaire : hématurie macroscopique → CIVD probable
Bilan : NFS ; CRP ; TP ; TCK ; Fib ; RAI ; BHC
Bilan de 5h00 : Hb 13g/dl ; plq 117 000 ; GB 8000 ; CRP 98
. 13h00 : Appel d’un second médecin anesthésiste
(H36)
Syntocinon 20UI IVL (total 50UI depuis Acct)
Augmentin 2gIV ; Flagyl 500mg ; Exacyl 1g
TA : 63/35 ; Pouls 147 → Ephédrine puis passage en service de réanimation
. Service de réanimation
. A l’entrée T° 37°5 ; Glasgow : 15 ; TA 100/55 ; Pouls 129 ; Sat OK 3l O2
. Persistance saignement vaginal
. Bilan de 12h50 : Hb 12g/dl ; plq 53 000 ; TP < 10% ; TCK : 126 ; Fib < 0,6
. Traitement institué : Augmentin 1g x 3 IVL
Vancomycine 2g IVL(1h) puis 2g/24h IVSE
Gentamycine 300mg
Kaskadil (facteur II) ; Clotagène (fibrinogène)
Novoseven (facteur VII) ; PVI (plasma frais viro inactivé)
. Hypothèse de MAT (micro angiopathie thrombotique)
→ Appel Réa néphro Tenon
→ Dic de MAT non retenu
→ TT symptomatique pour faire ↑ les facteurs de coagulation
. 19h30 : Appel gynéco car persistance saignements
(H42)
Bilan à 17h25 : Hb 9,1g/dl ; plq 49 000 ; TP < 33% ; TCK : 47 ; Fib < 0,6 ; PDF 2560
Créat 89 . SGOT 41 . SGPT 9 . Hapto 0,1 ; LDH 611 ; schizo <0,5
TA 100/55 ; Pouls 129
Utérus +/-tonique ; Echo : vacuité utérine
saignements modérés, sang fluide
→ Nalador 1Amp/1h puis 1 Amp/6h
. 20h00 : scanner abdomino-pelvien
(H43) → . Utérus de structure discrètement hétérogène
. Collection hématique du recessus para vésical Dt remontant dans la gouttière
pariéto-colique Dte et espace para-rénal Dt antérieur → Probable saignement actif
. Thrombo-phlébite ovarienne Dt
→ dans ce contexte de CIVD, décision de NON intervention chirurgicale
A la fin du scanner, frissons intenses, marbrures généralisées, T° 41°C
→ décharge bactérienne probable

CR RMM 05/11/2013 6
. Altération de l’état clinique
→ Pulmonaire : nécessité masque à haute concentration
→ Troubles neurologiques, agitation extrème → sédation par Hypnovel
→ nécessité intubation
→ Troubles hémodynamiques sévères (systole = 70)
→ voie veineuse centrale et KT artériel fémoral
→ macromolécules et noradrénaline
→ Arrêt Augmentin, Ajout Rocephine, Oflocet et Vancomycine + Gentamycine
23h32 : Bilan : Hb 9,7 g/dl ; Plq 85 000 ; TP 51% ; TCK 52 (ratio 1,59) ; Fib 1,19 ; PDF 1280
(H46)
Créat 147 ; SGOT 59 ; SGPT 13 ; Lactates 8,3; Procalcitonine 38,98 (N 0,05-0,1)
CRP 231 ; Hapto 0,14 ; LDH 587 ; CPK 414
Transfusion 2CG ; 1CUP
Le 17/04/12
0h30 : écho cardiaque : tachycardie 150-160 bpm ; Bonne cinétique segmentaire et globale
(H47)
GDS : PH 7,25 ; PCO2 30 ; PO2 202 ; Excès de base -12,9 (N -2 à 2)
2h00 : défaillance multiviscérale ; T° 43°C ; SDRA ; NO; bicar
(H49)
Bilan : PH 7,18 ; PCO2 34 ; PO2 : 77 ; Excès de base : -14,6 ; Lactates 7,2 ; Créat : 198
SGOT 370 ; SGPT 51 ; hapto 0,06 ; LDH : 1214 ; CPK 2552
Hb 10,4 ; Plq 12 000 ; TP 20% ; TCK 33,5 (ratio 1,02) ; Fib 0,42 ; PDF 2560
→ Transfusion 1 CUP , PVI, Clottagene, Kaskadil, Novoseven
3h00 : appel chirurgien de garde pour tenter une exploration chirurgicale
(H50)
Arrêt cardio-circulatoire brutal ; MCE ; Adrénaline
saignements buccal, nasal, sonde gastrique
Bilan : PH 7,13 ; Lactates 9,2 ; TP 27% ; Plaquettes 4000 ; Fib 0,37 ; Hb 9,4 ; Créat 239
5h00 : décès de la patiente
(H52)
Au total : 7PVI ; 2CG ; 2CUP ; 3 Clottagene ; 7mg Novoseven ; 16 flacons Kaskadil
Conjoint tenu informé de l’évolution clinique
Proposition autopsie acceptée

CR RMM 05/11/2013 7
. Bactériologie
. Urines : Streptococcus pyogenes (groupe A) (sensible à ts AB, Inter genta)
et 105 et E.Coli 103
→ Génotypage Strepto A : génotypage protéine M : emm1
gène des toxines et super Ag : SpeA+ ; SpeB + ; Sic + ; Smez + ; SpeC -
SsA-
→ bactériologiste :
« les souches de ce génotype emm1 sont à la fois les plus
fréquentes et les plus virulentes. En 2011 les S Pyogenes emm1
ont été associés à un syndrome de choc toxique ds plus de 20%
des cas. L’évolution de ce choc septique a été rapporté comme
fatal ds 35% des cas »
Au Total :
Choc septique à Strepto A.
Association avec thrombophlébite pelvienne (embols septiques ?)
. Nouveau-né traité préventivement
. Voisine de chambre rappelée, traitée ainsi que son NN
. CLIN : prélèvement de l’ensemble du personnel en lien avec la patiente
. Port de bavette pour tout acte médical, obstétrical ou opératoire en SDN
. Recherche au cours des 6 mois suivant ds ts Pv de Strepto A
. Mesures préventives effectuées
. L’autopsie à des fins médicales n’a pas été recommandée par les soignants

CR RMM 05/11/2013 8

CR RMM 05/11/2013 9
Streptocoque du groupe A
et grossesse
P.Raynal MYPA RMM 05 Novembre 2013
Type de réservoir : Homme
Rhinopharynx, lésions cutanées
Plus rarement muqueuses génitales (vagin) ou digestive (anus)
Présence dans l'environnement de personnes porteuses ou infectées.
. Streptocoque du groupe A→ Streptoccocus pyogenes
Cocci gram positif β-hémolytique en chainette
Principale source : Sécrétions des voies aériennes supérieures ; Sang
Sécrétions génitales ; LCR ; Salive
Portage pharyngé 5 % adultes, 20 % enfants
Lésion peau, muqueuses génitales ou anales
Patiente dossier RMM : génotypage protéine M Strepto A : emm1
Exotoxines et super Ag : SpeA+ ; SpeB + ; Sic + ; Smez + ; SpeC - SSA-
Spe : streptococcal pyrogenic exotoxin
. Codage par gène emm
→ emm 1 : Facteur de virulenceJLB Byrne et al.
Groupe A streptococcal puerperal sepsis:initial characterization of
virulence factors in association with clinical parameters.
J Reprod Immunol 2009;82:74-83
Exotoxines pyrogènes
SpeA, SpeB, SpeC and SSA
Streptolysines O et S
Facteurs de virulence de Strepto AProtéine M
. Facteur majeur de pathogénicité
. Propriétés d’adhérence
. Inhibition de la phagocytose
. Plus de 100 types M

CR RMM 05/11/2013 10
Les infections non invasives :
. Plus de 80 % des maladies dues à S. pyogenes
. Concernent les muqueuses ou les téguments.
. Pharyngites ou angines → les plus fréquentes des infections à Strepto A
. L'impétigo par S. pyogenes ou Staphylococcus aureus
. Scarlatine
Les infections sévères et invasives
L'érysipèle
La cellulite extensive ou
fasciite nécrosante ou
dermo-hypodermite nécrosante
Les complications post-streptococciquesRhumatisme articulaire aigu
Glomérulonéphrite aiguë
→ Risque choc toxique streptococcique
1869 : Léon COZE et Victor FELTZ (Strasbourg) : chaînettes ds sang femme avec fièvre puerpuérale
1875 : Pasteur : Streptocoque dans lésions vaginales et sang patientes atteintes de fièvre puerpuérale
Streptocoque du groupe A et Grossesse
. Fièvre puerpuérale → SEMMELWEIS
. Mode de transmission :
. Contact des muqueuses avec mains/objets souillés par sécrétions oropharyngées
ou lésions cutanées d'un sujet infecté ou porteur
. Gouttelettes provenant des voies aériennes supérieures :
→ toux, éternuements, parole d'un sujet infecté

CR RMM 05/11/2013 11
. Portage asymptomatique vaginal fin de grossesse : 0,03%
Streptocoque du groupe A et grossesse
. Risque infection Strepto A enceinte X 20 / non enceinte
. 1995-2000 USA. 87 infection Strepto A/grossesse
→ mortalité 3,5%I.Chuang et al
Population based surveillance for postpartum invasive group A Strptoccocus infections, 1995-200
Clin Inf Dis. 2002;35:665-70
PB Mead et al
Vaginal-rectal colonization with group A
Streptococci in late pregnancy
Infect Dis Obstet-Gynecol 2000;8:217-9
. Revue de la littérature 1966-2009
. 55 cas infection Strepto A et grossesse
. 83% multipares
. 90% post partum
. 75% période hiver-printemps
. Syndrome pseudo-grippal
. 94% Forte fièvre
. 49% Troubles digestifs, diarrhée, vomissements
. 40% Trouble respiratoires
. 91% Evolution rapide vers le SCTS : Sd de choc toxique streptococcique
. 73% hypertonie utérine type HRP
. 58% mortalité maternelle ; 66% mortalité néonatale
. Depuis 2000 : TT AB rapide (Péni G, βlactamines + Clindamycine)
→ 29% mortalité maternelle
Yamada T et al
Invasive group A streptococcal infection in pregnancy
J inf. 2010;60:417-24
. Traitements :
. AB à initier le plus vite possible
. Pénicillines
. Clindamycine +++ en association avec les β-Lactamines
. Immunoglobulines polyvalentes
→ Etude précédente Yamada et col , ↓ mortalité à 9%
. Réanimation : Hémofiltration à haut débit ; ECMO
. Espoir : Peptides antagonistes des superantigènes
. CI AINS → majoration de l’infection

CR RMM 05/11/2013 12
RECOMMANDATIONS pour la PRATIQUE CLINIQUE 2005
Prévention des infections à streptocoque du groupe A en maternité
Port du masque chirurgical
La survenue d’un nouveau décès, en relation avec une infection à streptocoque du groupe A,
chez une accouchée, nous conduit à rappeler que :
a/ le pharynx est le réservoir principal de Streptococcus pyogenes ou streptocoque du groupe A.
b/ le port d’un masque chirurgical est indispensable pour toute personne (sage-femme ou
accoucheur) réalisant un accouchement par voie basse :
. Dès la rupture des membranes
. Dans toute maternité d’établissement public ou privé ou lors des accouchements
réalisés à domicile.
c/ le port de masque chirurgical est également requis dès la rupture des membranes pour
tout geste obstétrical (toucher vaginal, prélèvement vaginal…).
SHA

CR RMM 05/11/2013 13

CR RMM 05/11/2013 14

CR RMM 05/11/2013 15
Echanges / Discussion Les autopsies sont trop rarement demandées lors d’un décès maternel, elles sont essentielles à la bonne compréhension des phénomènes ayant conduit à l’issue tragique. L’asepsie en salle de naissance est essentielle (utilisation des SHA, respect des protocoles d’asepsie pour sondage urinaire …). Le port systématique du masque chirurgical est recommandé en salle de naissance dès lors que la poche des eaux est ouverte, également en suites de couches pour les soins de cicatrices d’épisiotomie et de césarienne. La part des infections dans les cas de mort maternelle augmente. Il est important de penser à une composante infectieuse en situation de risque vital, et traiter au plus vite avec les antibiotiques adaptés en fonction du contexte. Les AINS (anti inflammatoire non stéroïdiens) majorent l’infection, ils ne doivent pas être prescris en cas de suspicion d’infection. Dans le cas d’une infection à Strepto A, le traitement antibiotique permet de tuer la bactérie mais libère des toxines hautement pathogènes. Celles sont peuvent être maîtrisées par l’adjonction de Clindamycine. Le traitement antibiotique de choix pour une infection à Strepto A : B-Lactamine + Clindamycine. Un cas d’infection en Strepto A implique l’intervention d’une équipe opérationnelle d’hygiène ainsi qu’une enquête épidémiologique afin de définir le caractère communautaire ou nosocomial de l’infection, ainsi que la recherche d’une autre infection à Strepto A les 6 mois précédents ou en cours d’évolution dans l’unité (autres patients, personnels). Nécessaire éviction et traitement (24 heures) des personnels travaillant en salle de naissance en cas d’angine streptococcique (sauf impératif absolu de service, le port du masque est alors permanent). Toutes les mesures sont à mettre en œuvre pour éviter la récidive de telles infections dans la maternité. Nécessité d’effectuer un signalement à l’InVs des cas nosocomiaux ou des cas groupés d’infections invasives du post-partum. La question se pose quant à l’intérêt du dosage précoce de la Procalcitonine et des Lactates dans ce contexte d’infection sévère. Importance des procédures écrites dans les services, de leur connaissance et application par les équipes soignantes.
Related Documents