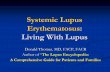This article appeared in a journal published by Elsevier. The attached copy is furnished to the author for internal non-commercial research and education use, including for instruction at the authors institution and sharing with colleagues. Other uses, including reproduction and distribution, or selling or licensing copies, or posting to personal, institutional or third party websites are prohibited. In most cases authors are permitted to post their version of the article (e.g. in Word or Tex form) to their personal website or institutional repository. Authors requiring further information regarding Elsevier’s archiving and manuscript policies are encouraged to visit: http://www.elsevier.com/copyright

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
This article appeared in a journal published by Elsevier. The attachedcopy is furnished to the author for internal non-commercial researchand education use, including for instruction at the authors institution
and sharing with colleagues.
Other uses, including reproduction and distribution, or selling orlicensing copies, or posting to personal, institutional or third party
websites are prohibited.
In most cases authors are permitted to post their version of thearticle (e.g. in Word or Tex form) to their personal website orinstitutional repository. Authors requiring further information
regarding Elsevier’s archiving and manuscript policies areencouraged to visit:
http://www.elsevier.com/copyright
Author's personal copy
Journal of Neuroradiology (2010) 37, 255—267
REVUE
Imagerie des atteintes intracrâniennes au cours desmaladies systémiquesCentral nervous system involvement in systemic diseases:Spectrum of MRI findings
A. Driera,∗, F. Bonnevilleb, J. Harochec, Z. Amourac, D. Dormonta, J. Chirasa
a Service de neuroradiologie, hôpital Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris, Franceb Service de neuroradiologie, hôpital Rangeuil, 31059 Toulouse, Francec Service de médecine interne, hôpital Pitié-Salpêtrière, 75651 Paris, France
Disponible sur Internet le 16 octobre 2010
KEYWORDSSystemic diseases;Brain MRI;Granulomatosis;Histiocytosis;Behcet’s disease
Summary Central nervous system (CNS) involvement in systemic disease (SD) is unusual. MRIfeatures of such lesions are unfamiliar to most radiologists. The diagnosis of SD is still basedon clinical features and laboratory findings but some characteristic MRI findings exist for eachSD: micronodular leptomeningeal enhancement in sarcoidosis, diffuse or focal pachymenin-geal involvement in Wegener disease, dentate nuclei and brain stem lesions in Langerhanscell histiocytosis, meningeal masses, dentate nuclei lesions and periarterial infiltration inErdheim-Chester disease, meningeal masses in Rosai-Dorfman disease, veinular pontic lesionsand cerebral vein thrombosis in Behcet, supratentorial microvascular lesions in lupus and anti-phospholipid and Gougerot-Sjögren syndrome. In this work, we explain, describe and illustratethe most characteristic MRI findings for each disease.© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
Introduction
Les maladies systémiques (MS) constituent un groupe hété-rogène de pathologies pouvant être définies comme uneatteinte inflammatoire diffuse d’origine inconnue, ayantune expression multisystémique. Les MS ont une faible inci-dence et l’atteinte neurologique centrale au cours de cespathologies y est peu fréquente, et donc souvent mécon-
∗ Auteur correspondant.Adresse e-mail : [email protected] (A. Drier).
nue. La connaissance de telles lésions du système nerveuxcentral (SNC) est cependant capitale car celles-ci présententun risque fonctionnel, voire vital, et constituent souvent uncritère de gravité dans l’évolution des MS.
Les mécanismes physiopathologiques des localisationsintracrâniennes des granulomatoses, des vascularites ou desconnectivites sont variés, et sont à l’origine d’un large éven-tail de lésions. Le but de ce travail est donc de présenterl’imagerie des lésions intracrâniennes observées au coursdes principales MS à savoir : sarcoïdose, granulomatose deWegener (GW), histiocytose langerhansienne (HL) et nonlangerhansiennes (maladie d’Erdheim-Chester [EC] et Rosai-Dorfman [RD]), maladie de Behcet (MB), lupus érythémateux
0150-9861/$ – see front matter © 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.doi:10.1016/j.neurad.2010.08.002
Author's personal copy
256 A. Drier et al.
disséminé (LED), syndrome des antiphospholipides (SAPL) etsyndrome de Gougerot-Sjögren primitif (SGSP). De plus, pourchacune de ces pathologies, sont rappelés les principauxcritères diagnostics, les hypothèses physiopathologiques etl’anatomopathologie de leurs principales lésions.
Le terrain de prédilection de survenue des MS, la fré-quence de l’atteinte neurologique centrale survenant aucours de ces pathologies, les mécanismes physiopatho-logiques d’atteinte du SNC et les principales atteintesintracrâniennes sont résumés dans le Tableau 1.
Neurosarcoïdose
La sarcoïdose est une granulomatose multisystémiqued’étiologie inconnue qui touche avec prédilection lesfemmes entre les deuxième et quatrième décennies. Lemécanisme physiopathologique n’est pas complètementconnu, il pourrait s’agir d’une réponse immunitaire contreun antigène non encore identifié. Son incidence parmiles Caucasiens est estimée à 20 pour 100 000. Aucun élé-ment clinique ou paraclinique n’est spécifique à lui seulet le diagnostic de sarcoïdose n’est étayé que par un fais-ceau d’arguments positifs et négatifs (érythème noueux,uvéite, atteinte thoracique avec adénopathies médias-tinales et lésions réticulo-nodulaires pulmonaires, tauxsanguin d’enzyme de conversion élevé, scintigraphie augallium positive. . . et absence d’autre cause de maladiegranulomateuse). Le diagnostic repose essentiellement surl’existence de preuves histologiques : la présence de granu-lomes épithélioïdes dépourvus de nécrose caséeuse [1]. Lesgrandes séries cliniques de sarcoïdose signalent une atteinteneurologique dans moins de 10 % des cas et l’atteinte neu-rologique est révélatrice de la maladie dans 0,5 à 2,5 % descas [2]. Les localisations neurologiques de la sarcoïdose ontla particularité d’être souvent multiples et diffuses. Ellesintéressent à des degrés variables les méninges, le SNC etles nerfs crâniens. De nombreuses localisations sont sou-vent asymptomatiques, et certains auteurs proposent leurrecherche systématique, notamment lors du bilan initial [3].
En IRM, des anomalies de signal de la substance blanchesont très fréquemment décrites au cours de la neurosar-
coïdose. Ces lésions apparaissent en hypersignal T2 et nese rehaussent pas après injection de gadolinium. Elles ontdonc un aspect non spécifique, pouvant ressembler à uneaffection démyélinisante ou à une leucopathie d’originevasculaire. Elles sont généralement irréversibles et nerépondent pas aux traitements corticoïdes ou immunosup-presseurs [4].
L’atteinte leptoméningée est observée en IRM dans envi-ron 40 % des cas de neurosarcoïdose [5]. Elle peut êtrediffuse ou focale, et se traduit par un rehaussementmicronodulaire ou linéaire des leptoméninges avec une pré-dilection pour les régions suprasellaire et de la base du crâne(Fig. 1).
L’extension en profondeur des granulomes leptoméningésle long des espaces périvasculaires de Virchow-Robin peutégalement être à l’origine d’une atteinte intraparenchyma-teuse [6]. Un rehaussement leptoméningé, considéré commeun stade préalable à l’infiltration intraparenchymateuse, estsouvent associé à la présence de nodules multiples dissémi-nés ou coalescents, formant de véritables masses d’allurepseudotumorale, évocatrices du diagnostic lorsqu’elles sonten hyposignal sur les séquences pondérées en T2 [5] (Fig. 2).Une atteinte peut survenir également par extension deslésions des leptoméninges le long de l’axe hypothalamo-hypophysaire. Ces lésions, de taille variable, peuvent aussiêtre isolées, et ainsi toucher l’hypothalamus, la tige ouplus rarement l’antéhypophyse. Elles apparaissent en iso- ouhyposignal T2 et se rehaussent de facon intense et homogèneaprès injection de gadolinium (Fig. 2) [7].
La dure-mère peut être épaissie de facon diffuse oufocale, et apparaît alors volontiers en franc hyposignalT2, avec un rehaussement particulier préférentiellementpériphérique (Fig. 3). La coalescence de granulomes sar-coïdosiques dure-mèriens peut se présenter comme unemasse extra-axiale prenant le contraste, semblable à unméningiome, en isosignal à la substance grise en T1 et enhyposignal T2 [8]. Cette atteinte pachyméningée n’est engénéral pas associée à une extension intraparenchymateuse.De même, l’atteinte simultanée pachy- et leptoméningéeest rare, l’arachnoïde jouant certainement un rôle de bar-rière face à l’extension de la maladie.
Figure 1 Neurosarcoïdose. Axiale T1 après injection de gadolinium. Rehaussement micronodulaire des leptoméninges frontoba-sales (A). Rehaussement micronodulaire leptoméningé étendu aux espaces périvasculaires du pont (B).
Author's personal copy
Imagerie des atteintes intracrâniennes au cours des maladies systémiques 257
Tableau 1 Terrain de prédilection de survenue des maladies systémiques, fréquence de l’atteinte neurologique centrale,mécanismes physiopathologiques d’atteinte du SNC au cours de ces maladies et principales atteintes intracrâniennes.
Terrain Fréquencedes atteintesdu SNC (%)
Mécanismesphysiopathologiques
Localisations principales intracrâniennes
Sarcoïdose Femme entre20 et 40 ans
< 10 Prolifération méningée desgranulomesExtension des granulomesleptoméningés le long desespaces périvasculairesVascularite rare
Rehaussement micronodulaire leptoméningéLésion nodulaire intraparenchymateuseAtteinte de l’axe HH : hypothalamus ++Épaississement des pachyméningesAtteinte des nerfs crâniens HydrocéphalieVascularite et accidents vasculaires rares
Wegener Homme entre50 et 60 ans
< 8 Extension intracrânienned’une lésiongranulomateuse d’unelésion granulomateuseGranulome intracrânien àdistance de toute lésionextracrânienneVascularite
Épaississement des pachyméninges : focal parextension d’un granulome du massif facial,ou diffus à distance de toute autre atteinteAccidents ischémiques cérébrauxLésion nodulaire intraparenchymateuseAtteinte de l’axe HH
Histiocytoselangerhansienne
Enfant Faible Prolifération tissulaire descellules de Langerhans(CD1a+)Lésions neurodégénérativesdépourvues d’histiocytes
Atteinte de l’axe HH : nodulespituitaires/hypothalamusÉpaississement pachyméningédiffus/pseudoméningiomateuxAtteinte des noyaux dentelés et de la SBpéri-denteléeLésion nodulaire intra-parenchymateuse(pont ++)Lésions osseuses ± extension méningées(temporal)
Erdheim Chester Femme entre40 et 50 ans
30 Prolifération tissulaired’histiocytes spumeux(CD1a−, CD68+)Lésions neurodégénérativesdépourvues d’histiocytes
Atteinte de l’axe HH : nodules pituitairesÉpaississement pachyméningédiffus/pseudoméningiomateuxAtteinte des noyaux dentelés et de la SBpéridenteléeLésion nodulaire intraparenchymateuse rareEngainement péri-artériel (élargissement dessinus caverneux en hyposignal T2 ++)Ostéosclérose diffuse de la voûte
Rosai-Dorfman Homme jeunemoins de20 ans
Faible Prolifération tissulaired’histiocytes (CD1a−,CD68, ACT et lysozyme+) etlymphocytaire
Lésions méningées pseudo-méningiomateuses
Behcet Homme entre20 et 35 ans
5 à 35 Vascularite de siègeessentiellement veinulaireThrombose veineusecérébrale
Lésion pontique et mésencéphaliqueHypersignaux T2 de la SBThrombose veineuse cérébraleAtteinte des voies visuelles rare
Lupus/SAPL Femme entre20 et 30 ans
25 à 70 Occlusion artérielle liée àla présence d’Ac ou de CICInteraction directe d’Acavec le parenchymecérébralVascularite rare
Hypersignaux T2 de la SBAccidents ischémiques cérébrauxHypersignal T1et T2 des NGC au cours dulupusThrombose veineuse cérébraleRehaussement micronodulaire leptoméningéerare au cours du lupus
Gougerot Sjögren Femme entre40 et 50 ans
< 25 Probablement mécanismeauto-immun
Hypersignaux T2 de la substance blanche etdes NGC
Axe HH : axe hypothalamo-hypophysaire ; ACT : alpha-1-antichymotrypsin ; SB : substance blanche ; SNC : système nerveux central ; SAPL :syndrome des antiphospholipides ; NGC : noyaux gris centraux.
Author's personal copy
258 A. Drier et al.
Figure 2 Neurosarcoïdose. Coronale FLAIR (A) et T1 après injection de gadolinium (B). Lésions parenchymateuses d’allure pseu-dotumorales temporale interne et supracalleuse droites en hypersignal FLAIR et se rehaussant de facon homogène après injection.Atteinte hypothalamique en isosignal FLAIR, rehaussée après injection.
L’atteinte des nerfs crâniens se traduit par un élargis-sement et surtout un rehaussement pathologique sur lesséquences en pondération T1 après injection de gadolinium.Dans le cadre d’une neurosarcoïdose, cette atteinte objec-tivée en IRM peut être infraclinique, et a contrario, uneparalysie d’un nerf crânien, peut s’accompagner d’une ima-gerie normale [9]. L’infiltration du nerf facial est la plussouvent rapportée dans la littérature [9]. Le nerf optiqueet les nerfs oculomoteurs sont plus rarement atteints, ainsique le nerf trijumeau [10].
L’hydrocéphalie est une complication relativement peuconnue mais classique, observée dans 5 à 12 % des neurosar-coïdoses [5]. Elle peut être communicante, probablementdue à des troubles de résorption du liquide cérébro-spinal(secondaire à une arachnoïdite de la base), ou de typeobstructif, associée à une atteinte lepto- ou pachyménin-gée (ventriculite granulomateuse, sténose de l’aqueduc dumésencéphale, obstruction du V4 par les granulomes).
Enfin, en dehors de l’extension des lésions le long desespaces périvasculaires, il peut exister dans de très rarescas une atteinte inflammatoire de la paroi des vaisseaux depetit et moyen calibres, possiblement à l’origine d’accidentsvasculaires ischémiques ou hémorragiques. Ces lésions devascularite, lorsqu’elles sont suspectées en IRM, ne sonten général pas visibles sur l’angiographie par résonancemagnétique (ARM), en particulier en raison de l’atteinte trèsdistale de cette artérite [11].
Granulomatose de Wegener
La GW est une MS associant des lésions de vascularitenécrosante des petits vaisseaux et des granulomes extra-vasculaires nécrosants et ulcérants à cellules géantes.Aux États-Unis, la prévalence de la GW est estimée à30 par million d’habitants. L’incidence culmine aux environs
Figure 3 Neurosarcoïdose. Axiale FLAIR (A) et T1 après injection (B). Épaississement des pachyméninges de la tente du cerveleten hyposignal FLAIR (A), avec rehaussement en périphérie de cet épaississement après injection (B).
Author's personal copy
Imagerie des atteintes intracrâniennes au cours des maladies systémiques 259
Figure 4 Granulomatose de Wegener. Axiale T2 (A) et T1 après injection (B). Epaississement focal dural par extension d’ungranulome de l’orbite gauche à travers la grande aile du sphénoïde gauche, en franc hyposignal T2 (A), rehaussé après injection(B).
de 50—60 ans avec une discrète prédominance masculine.L’atteinte neurologique centrale est rare, rapportée chez2 à 8 % des patients en fonction des études [12]. Cette mala-die se distingue par l’atteinte constante des voies aériennessupérieures et inférieures et par la fréquence des néphro-pathies qui font souvent la gravité de la maladie. La GWest considérée comme une MS auto-immune, les anticorpsc-ANCA antiprotéinase 3 retrouvés chez au moins 90 % despatients étant spécifiques de la maladie. De nombreux argu-ments expérimentaux suggèrent un rôle des ANCA dans lagenèse des lésions de vascularite [12].
Trois mécanismes principaux sont retenus pour expli-quer l’atteinte du SNC : atteinte par extension d’une lésiongranulomateuse d’origine extracrânienne, nasale ou sinu-sienne ; apparition d’un granulome intracrânien à distanced’éventuelles autres lésions extracrâniennes ; vasculariteavec atteinte des vaisseaux de petit et moyen calibres duSNC [13].
Trois types de lésions intracrâniennes prédominent :épaississement des pachyméninges (58 %), lésions non spéci-fiques de la substance blanche (53 %) et infarctus cérébraux(21 %) [14].
L’épaississement des pachyméninges peut être diffus oufocal, en plaque ou nodulaire. Il apparaît en hyposignal T2 ets’accompagne d’un rehaussement plutôt périphérique aprèsinjection de gadolinium [13]. Les atteintes focales duralescorrespondent à une extension transosseuse en regard delésions orbitaires, des sinus et des cavités nasales (Fig. 4).Elles sont exceptionnellement à distance de ces lésions [14].En revanche, les lésions diffuses des méninges sont plutôt àdistance d’une atteinte des sinus ou des orbites. Elles sontplutôt symétriques et peuvent s’étendre simultanément à latente du cervelet et à la convexité (Fig. 5). L’épaississementdes pachyméninges est responsable d’atteinte des nerfscrâniens, principalement le III, V, VI, VII et VIII [13]. Lesneuropathies peuvent également être secondaires à des
Figure 5 Granulomatose de Wegener. Coronale T2 (A) et T1 après injection (B). Épaississement diffus des pachyméninges de lafaux et de la tente du cervelet en franc hyposignal T2 (A), rehaussé après injection de gadolinium (B).
Author's personal copy
260 A. Drier et al.
lésions de vascularite par atteinte des vaisseaux de petitcalibre (vasa vasorum). Les atteintes des leptoméninges etdes espaces périvasculaires ne sont que très rarement rap-portées [15].
Des lésions non spécifiques de la substance blanche appa-raissent en hypersignal sur les séquences pondérées T2. Ellessont de petite taille, le plus souvent multiples, sus- et sous-tentorielles [14].
Des accidents ischémiques cérébraux peuvent survenir.Ils peuvent être liés notamment à des lésions de vascula-rite ou à une occlusion artérielle par extension d’une lésiongranulomateuses depuis les sinus ou les cavités nasales, àtravers la base du crâne. En raison de l’atteinte préféren-tielle des vaisseaux de petit calibre (50—300 �m), l’angio-RMest souvent normale [16].
Le parenchyme peut être très rarement le siège de granu-lomes, uniques ou multiples, en hypersignal T2, hyposignalT1 et qui se rehausse de facon homogène ou en périphérieaprès injection de gadolinium. Ces lésions sont au contactou à distance d’éventuels granulomes méningés [16].
La glande hypophysaire peut être augmentée devolume avec un rehaussement principalement en péri-phérie après injection, probablement lié à la présenced’une nécrose hypophysaire, aspécifique et stérile. La tigepituitaire peut être infiltrée, épaissie. Cette infiltrationpeut s’accompagner d’un diabète insipide avec perte del’hypersignal T1 physiologique de la posthypophyse [17].
Histiocytoses
Les histiocytoses constituent un vaste groupe de maladiestrès hétérogènes au plan clinique et physiopatholo-gique dont le point commun est l’accumulation tissulaired’histiocytes. Dans ce travail, nous nous limiterons volontai-rement aux histiocytoses les plus fréquemment responsablesde manifestations neurologiques à l’âge adulte : l’HL et lesmaladies d’Erdheim-Chester et de Rosai-Dorfman.
Histiocytose langerhansienne
On appelle HL un groupe d’affections de présentation cli-nique et de pronostic très variés, qui ont en commun uneinfiltration tissulaire par des cellules de Langerhans, leplus souvent organisées en granulomes. L’HL atteint lesenfants et plus rarement les adultes. On estime qu’il y a40 à 50 nouveaux cas d’HL par an en France chez l’enfant[12]. L’épidémiologie de cette maladie chez l’adulte estmoins bien connue. La physiopathologie des HL reste spécu-lative : prolifération clonale pseudotumorale des cellules deLangerhans ou dysfonctionnement du système immunitaire[18]. Les manifestations neurologiques surviennent quasi-exclusivement au cours des formes multifocales d’évolutionchronique (syndrome de Hand-Schüller-Christian caracté-risé par la triade : lésions osseuses, exophtalmie et diabèteinsipide d’origine centrale) et sont considérées comme unfacteur de mauvais pronostic. Le diagnostic est affirmé enanatomopathologie (peau, os, ganglions. . .) par la présencede cellules de Langerhans reconnues en immunohistochimiecomme des cellules CD1a positives, appartenant au systèmeréticulo-endothélial [19]. La prévalence des manifestationsneurologiques centrales est faible, difficile à évaluer. Ces
Figure 6 Histiocytose Langerhansienne. Coronale T1 aprèsinjection de Gadolinium. Atteinte hypothalamique avec rehaus-sement homogène après injection.
manifestations apparaissent en moyenne cinq ans après lediagnostic d’HL, elles sont exceptionnellement révélatricesde la maladie. Les localisations intracrâniennes sont presquetoujours symptomatiques.
L’atteinte de l’axe hypothalamo-hypophysaire est lalésion intracrânienne la plus fréquemment visualisée aucours de l’HL, retrouvée dans 79 % des cas [20]. L’IRM objec-tive alors un épaississement plus ou moins nodulaire de latige pituitaire, en isosignal T1 et T2, fortement rehausséeaprès injection de gadolinium. Cette atteinte, respon-sable d’un diabète insipide, s’accompagne de la perte del’hypersignal T1 physiologique et fonctionnel de la posthypo-physe. L’infiltration de la tige pituitaire peut être associéeà des lésions de l’hypothalamus ou du chiasma, qui pourrontêtre augmenté de taille, en hypersignal T2, isosignal T1 etrehaussés après injection [20] (Fig. 6).
Des lésions osseuses, en particulier de l’os temporal etde la voûte, sont fréquentes, rapportées environ une foissur deux, et peuvent s’étendre aux méninges adjacentes quise rehaussent [20]. Ces localisations osseuses apparaissenten isosignal T1 (par rapport à l’hypersignal de la graissemédullaire), de signal hétérogène en pondération T2 et serehaussent après injection.
Une atteinte méningée peut survenir, diffuse ou locali-sée, avec dans certains cas de véritables masses méningées,hypointenses en T2 et se rehaussant de facon inconstanteaprès injection [20]. Cette atteinte méningée peut secompliquer d’un envahissement veineux allant jusqu’à lathrombose.
Le parenchyme cérébral peut être le siège de deux typesd’atteinte : des anomalies d’allure infiltratives avec dis-tribution vasculaire, avec en anatomopathologie présenced’histiocytes CD1a+ spécifiques, et des lésions de leucoen-céphalopathie ou lésions neurodégénératives, pauvres enhistiocytes, siège d’une destruction neuronale et axonale.Des lésions de petite taille, nodulaires ou micronodulaires,disséminés dans la substance blanche sus- et sous-tentorielleau contact des espaces de Virchow Robin sont rapportées
Author's personal copy
Imagerie des atteintes intracrâniennes au cours des maladies systémiques 261
Figure 7 Histiocytose Langerhansienne. Axiale T2 (A). Lésions en hypo- et en hypersignal T2 de la substance blanche du pont,étendues aux pédoncules cérébelleux moyens et aux hémisphères cérébelleux, en particulier aux noyaux dentelés. Œdème périlé-sionnel avec effet de masse et élargissement du pont. Axiale T1 après injection de Gadolinium (B). Rehaussement micronodulairedes lésions.
[20] : elles suivent en effet une distribution vasculaire etsont vraisemblablement en rapport avec des proliférationshistiocytaires granulomateuses, au sein des espaces de Vir-chow Robin, qui infiltrent le parenchyme adjacent [19]. Ceslésions prédominent dans le pont, sont en hyposignal T1,hypersignal T2 et peuvent se rehausser après injection. Ellespeuvent être responsable d’un effet de masse (Fig. 7).
Des altérations diffuses du parenchyme cérébral sontattribuées à des lésions neurodégénératives. En IRM, ellesapparaissent comme des lésions aspécifiques, diffuses etde petite taille, en hypersignal T2, non rehaussées par legadolinium, touchant les ganglions de la base, la substanceblanche sus- et sous-tentorielle où elles touchent préféren-tiellement le pont [21]. De manière très caractéristique, ilexiste des lésions plus sévères dans les noyaux dentelés quiapparaissent classiquement de facon symétrique en hyper-signal T1, et de signal variable en T2. Ces lésions peuvents’étendre à la substance blanche cérébelleuse péridentelée[20]. Ces images sont plus évidentes dans le plan coronalavec un aspect évocateur en « ailes de papillon » [21]. Lesganglions de la base tels que le pallidum et les noyaux cau-dés peuvent également être affectés de facon symétrique,visibles en hypersignal T1, mais sans anomalie de signal enT2 [20,21]. Ces lésions peuvent évoluer vers une atrophiecortico-sous-corticale qui prédomine alors à l’étage sous-tentoriel et en particulier aux hémisphères cérébelleux.
De rares cas de lésions des plexus choroïdes, volontiersbilatérales, en franc hyposignal T2 et se rehaussent aprèsinjection ont été décrites. Enfin, la glande pinéale peut êtreaugmentée de taille, se rehausser intensément ou présenterdes remaniements kystiques [22].
Maladie d’Erdheim-Chester
La maladie d’EC est une forme rare et sporadiqued’histiocytose non langerhansienne. Elle est caractéri-sée par une infiltration tissulaire xanthogranulomateusedisséminée, atteignant de multiples organes et en par-ticulier les os longs. Elle est trois fois plus fréquentechez la femme. L’âge moyen au début de la maladie
est de 43 ans et de 48 ans lors de l’atteinte neurologiquecentrale [23]. L’origine exacte de la maladie d’EC estinconnue, mais deux hypothèses principales tentent d’enexpliquer la physiopathologie : soit l’existence de troublesmétaboliques du stockage des lipides, soit la possibilitéd’un processus néoplasique avec prolifération monoclonaled’histiocytes. Le diagnostic repose sur la biopsie (os, tissusrétro-orbitaires, rétropéritoine) qui montre une infiltra-tion constituée d’histiocytes spumeux, chargés de lipides,CD68 positif et CD1a négatif. L’atteinte neurologique cen-trale clinique est présente chez 30 % des patients porteursde la maladie d’EC et les manifestations les plus fréquentessont le diabète insipide, les syndromes cérébelleux, lessignes liés aux lésions orbitaires et aux masses méningées[23].
L’éventail de lésions visibles en IRM est très largedans la maladie d’EC. Tout comme dans les HL, des his-tiocytes peuvent infiltrer et épaissir la tige pituitaire,
Figure 8 Erdheim-Chester. Coronale T1 après injection degadolinium. Infiltration nodulaire de la tige pituitaire (flèche).
Author's personal copy
262 A. Drier et al.
Figure 9 Erdheim-Chester. Axiale T1 après injection de gado-linium. Masses intra-axiales se rehaussant après injection, avecimportant œdème périlésionnel.
parfois de facon nodulaire (Fig. 8), entraînant une perte del’hypersignal T1 physiologique de la posthypophyse [24].
Les pachyméninges peuvent aussi être atteintes, de facondiffuse ou sous forme d’épaississements focaux pseudo-méningiomateux uniques ou multiples, pouvant comprimerles structures cérébrales adjacentes [23]. Ces lésionspseudo-méningiomateuses sont fréquemment localisées enregard du tronc cérébral, à la faux du cerveau ou encoredans la région sellaire [25]. Ces masses extra-axiales appa-raissent en isosignal sur les séquences pondérées T1, enhyposignal parfois très marqué sur les séquences pondéréesT2 et se rehaussent de facon intense et homogène aprèsinjection de gadolinium [25].
Les lésions intraparenchymateuses visibles au cours de lamaladie d’EC sont moins fréquentes que les lésions ménin-gées, et restent moins fréquemment rapportées que cellesrencontrées au cours des HL. Les mécanismes physiopatho-logiques et les résultats histopathologiques sont moins bienconnus. Toutefois, il semble que l’on puisse opposer, commedans les HL, deux types de lésions : des lésions d’allure infil-trative, qui se rehaussent après injection de gadolinium avecà la biopsie la présence d’histiocytes, et des lésions d’allureneurodégénératives qui au contraire ne se rehaussent pas etsont dépourvues d’histiocytes.
Les lésions infiltratives apparaissent en hypersignal surles séquences pondérées T2, en isosignal T1 et se rehaussentaprès injection de gadolinium (Fig. 9). À noter que cerehaussement peut rester visible jusqu’à huit jours aprèsl’administration de gadolinium, sans doute en raison d’unerétention anormale du gadolinium par les histiocytes [26].Les lésions sont plus ou moins étendues, nodulaires ou réa-lisant de véritables masses, avec peu ou pas d’œdèmepéri-lésionnel. Elles sont principalement situées à l’étagesous-tentoriel mais peuvent également être visibles dans leshémisphères cérébraux et les noyaux gris centraux [23].
Les lésions d’allure neurodégénérative apparaissent leplus souvent, et de manière caractéristique, comme unhypersignal T2 symétrique des noyaux dentelés et de
Figure 10 Erdheim-Chester. Lésions neurodégénératives desnoyaux dentelés. Axiale T2. Les noyaux dentelés et la substancepéridentelée apparaissent en hypersignal T2.
la substance blanche péridentelée (Fig. 10). On pourraégalement observer un hypersignal T2 des pédonculescérébelleux moyens et supérieurs et de la jonction ponto-mésencéphalique [27].
Si l’infiltration périvasculaire, et notamment péri-aortique, est classiquement décrite au cours de la maladied’EC, une infiltration engainant les artères à destinée cépha-lique, tant dans leurs segments extra-qu’intracrâniens estbeaucoup plus rare. Elle apparaît cependant en isosignalT1, hyposignal T2 et se rehausse après injection de gado-linium (Fig. 11). Cet engainement peut ainsi être à l’origined’une diminution du calibre des vaisseaux et entraîner descomplications ischémiques. À noter qu’il existe égalementde très rares cas d’infiltration histiocytaire au sein des sinusveineux intracrâniens [24,28].
En plus des lésions intracrâniennes, l’IRM cérébrale metégalement en évidence des lésions intra-orbitaires et desstructures osseuses, dont l’association est suggestive dudiagnostic de maladie d’EC. Ainsi, les os de la face ou dela voûte sont souvent épaissis et le siège d’une ostéosclé-rose diffuse, apparaissant alors en hyposignal T1 et T2, etles orbites contiennent des lésions granulomateuses en posi-tion intracônique retro-oculaire, volontiers bilatérales, enhyposignal T2 et rehaussées par le gadolinium [24].
Rosai-Dorfman
La maladie de RD est une forme rare d’histiocytose nonlangerhansienne. Elle est caractérisée par une infiltra-tion tissulaire histiocytaire et lymphocytaire de multiplesorganes et en particulier les ganglions cervicaux. La mala-die débute le plus souvent au cours des deux premièresdécennies, avec une discrète prédominance masculine [29].La physiopathologie reste spéculative : la maladie de RDpourrait être secondaire à dysfonctionnement du systèmeimmunitaire, mais pourrait également être liée à une infec-tion virale, notamment l’EBV. Le diagnostic repose surla biopsie qui montre une infiltration de lymphocytes et
Author's personal copy
Imagerie des atteintes intracrâniennes au cours des maladies systémiques 263
Figure 11 Erdheim-Chester. Infiltration péri-artérielle. Axiales T1 après injection de gadolinium (A et B). Engainement des deuxartères carotides internes sous-pétreuses (flèches) (A). Engainement par contigüité des segments intracaverneux des artères caro-tides internes avec élargissement bilatéral des sinus caverneux (flèches) (B).
surtout d’histiocytes qui sont notamment CD68, alpha-1-Antichymotrypsin (ACT) et lysozyme positifs et CD1a négatif[29,30].
Les atteintes intracrâniennes sont rares et surviennent leplus souvent chez les hommes (78 % des cas). Elles se mani-festent essentiellement sous la forme de lésions méningéespseudo-méningiomateuses, uniques ou multiples, apparais-sant en isosignal T1 et T2, se rehaussant de manière intenseet homogène après injection de gadolinium et pouvant êtreentourées d’un œdème périlésionnel important (Fig. 12)[29—31].
Maladie de Behcet
La MB est une vascularite systémique d’étiologie inconnueatteignant le réseau artériel et veineux. Au niveau du SNC,l’atteinte veineuse est nettement prédominante, l’atteinteartérielle n’étant que très rarement observée. La MB débute
chez l’adulte jeune entre 20 et 35 ans, l’homme étant troisà cinq fois plus souvent atteint que la femme. L’atteinteneurologique centrale est de fréquence variable selon lesséries, de 5,3 à 35 %. Elle survient en moyenne dans les cinqans après le diagnostic de MB [12] et fait la gravité dela maladie par les séquelles fonctionnelles, mais aussi lesexceptionnels décès, qu’elle peut entraîner. Le diagnosticde MB est difficile, il repose avant tout sur la clinique avecla recherche d’ulcérations orales et génitales récurrentes etd’une uvéite. Si la présence d’HLA B51 est fréquente (50 %des cas [32]), il ne s’agit pas d’un critère de diagnostic oud’exclusion.
Au cours des phases inflammatoires aiguës, la paroi desvaisseaux et le parenchyme cérébral périvasculaire sontlésés. L’œdème et l’infiltration cellulaire inflammatoirepeuvent être très importants et l’IRM objective sur lesséquences pondérées T2 des zones d’hypersignal de taillevariable, parfois confluentes en larges plages et touchantpréférentiellement le pont, le mésencéphale et les noyaux
Figure 12 Rosai-Dorfman. Coronale T2 (A) et axiale T1 après injection de gadolinium (B). Masse méningée fronto-insulaire gaucheisolée, simulant un méningiome. À noter la quasi-absence de pris de contraste de la dure-mère adjacente.
Author's personal copy
264 A. Drier et al.
Figure 13 Neuro-Behcet. Axiales FLAIR. Lésion en hypersignal T2 du mésencéphale (A) et étendue aux thalamus (B).
gris centraux (Fig. 13). Cette distribution lésionnelle, enfaveur d’une vascularite de siège essentiellement veinu-laire, est très évocatrice de la MB [33]. Un hypersignallinéaire le long de la capsule interne (bras postérieur plusparticulièrement) semble être une autre lésion caractéris-tique du neuro-Behcet. Les lésions récentes s’accompagnentparfois d’un effet de masse, elles peuvent se rehausseraprès injection de gadolinium et l’aspect peut être pseu-dotumoral [34] (Fig. 14). Une composante hémorragiqueest rarement observée [33]. Dans la majorité des cas, lataille, l’effet de masse et le rehaussement de ces lésionsaiguës régressent au cours du premier mois de traitementavec une possible disparition complète des lésions initiales[35].
Au cours de l’évolution du neuro-Behcet, de minimeslésions, punctiformes le plus souvent, en hypersignal enpondération T2 peuvent apparaître, principalement loca-lisées à la substance blanche sus-tentorielle. Ces lésionsdoivent faire suspecter une évolutivité infraclinique de lavascularite [35]. Il a également été observé l’apparition
d’une atrophie cortico-sous-corticale, prédominant au tronccérébral, évidente après au moins un an d’évolution duneuro-Behcet [33].
La MB peut entraîner des lésions des nerfs optiques avecun hypersignal T2 et un rehaussement associé si l’examenest réalisé à la phase aiguë [33], de manière similaire auxanomalies rencontrées dans d’autres vascularites.
Enfin, les thromboses veineuses cérébrales sont relati-vement fréquentes au cours de la MB, estimées entre 7 et8 % [12]. À noter que ces thromboses veineuses cérébralessont rarement associées aux lésions parenchymateuses spé-cifiques de la MB, décrites plus haut (4 % des cas).
Lupus érythémateux disséminé
Le LED est une maladie auto-immune, non spécifiqued’organe. Il peut donc potentiellement léser tous lesorganes (peau, articulations, séreuses. . .), mais l’atteintedu rein et celle du SNC sont classiquement considérées
Figure 14 Neuro-Behcet. Coronales T2 (A) et T1 après injection de gadolinium (B). Lésions symétriques du mésencéphale, dupont et des pédoncules cérébelleux moyens en hypersignal T2 (A) présentant un rehaussement micronodulaire après injection (B).
Author's personal copy
Imagerie des atteintes intracrâniennes au cours des maladies systémiques 265
Figure 15 Lupus érythémateux disséminé. Axiale diffusion (A) et T1 après injection de gadolinium (B). Multiples hypersignauxcorticaux et sous-corticaux microvasculaires (A). Rehaussement micronodulaire du cortex cérébral, de topographie globalementsuperposable à certains hypersignaux en diffusion (B).
comme les plus graves. Le LED est caractérisé par laproduction de nombreux auto-anticorps dirigés notammentcontre divers constituants nucléaires, anticorps anti-ADNnatif en particulier ou encore facteurs antinucléaires, anti-corps antinucléosome. . . qu’il faudra donc rechercher. Laprévalence du LED est de 1/2000. Il survient préférentielle-ment chez la femme en période d’activité ovarienne, avecun sex-ratio de neuf femmes pour un homme, et débuteau cours de la deuxième ou de la troisième décennie. Laprévalence des atteintes neurologiques centrales est diver-sement appréciée en fonction des critères retenus, variantentre 25 et 70 % des cas de LED [12]. Contrairement à uneidée répandue, un processus de vascularite n’est que trèsrarement en cause pour expliquer l’atteinte cérébrale duLED. L’atteinte du SNC peut être focale ou diffuse. Schéma-tiquement, les manifestations artérielles ischémiques sontle plus souvent en rapport avec la présence d’anticorps anti-phospholipides (aPL) et de complexes immuns circulants,qu’il s’agisse de thrombose in situ ou d’embolies issuesde valvulopathies mitrales ou aortiques, très fréquentesdans ce contexte [36]. Les atteintes encéphaliques diffusessemblent directement secondaires à la présence d’anticorpspouvant interagir avec le parenchyme cérébral, notammentdes anticorps antineurones [36].
L’IRM est pathologique dans 65 % des cas lorsqu’il existedes signes cliniques neurologiques ou psychiatriques [37].Les lésions les plus fréquentes, observées dans 60 % des casde neurolupus, apparaissent comme des lésions de petitetaille, punctiformes ou nodulaires, en hypersignal T2, tou-chant avec prédilection la substance blanche sous-corticalefrontale et pariétale [37]. Elles peuvent toutefois êtrevisibles dans l’ensemble du parenchyme cérébral, y comprisdans le tronc cérébral et le cortex. Leur nombre augmenteavec la durée et la sévérité de la maladie. Elles sont rela-tivement aspécifiques et demeurent compatibles avec desinfarctus lacunaires, des zones de démyélinisation ou deslésions de vascularite. Les séquences d’angio-RM utiliséesen routine ne sont généralement pas assez sensibles pourmettre en évidence les variations de calibre des petitesartères atteintes au cours du LED [37].
À côté des micro-infarctus liés à l’atteinte de vaisseauxde petits calibres, de véritables accidents vasculaires céré-braux ischémiques territoriaux peuvent survenir, en relationavec le taux des anticorps aPL [38].
Des anomalies en hypersignal T1 et hyposignal T2 ont éga-lement été décrites de manière bilatérale et symétriquedans les noyaux gris centraux. Ces anomalies, parfois réver-sibles, ont été corrélées à l’apparition et à la régression demouvements choréiques dans le neurolupus. En cas de cho-rée de Sydenham, ces anomalies seraient liées à des lésionsde vascularite cérébrale, associant des phénomènes dégé-nératifs et inflammatoires plus prononcés dans les noyauxgris centraux que dans la substance blanche [39].
L’évolution vers une atrophie cérébrale diffuse, corticaleou cortico-sous-corticale est également rapportée [37].
L’atteinte des leptoméninges est rare dans le lupus. Elleserait liée à des phénomènes inflammatoires microangiopa-thiques. Elle se traduit par un rehaussement micronodulairedes leptoméninges après injection. Ces lésions peuvents’étendre aux vaisseaux du cortex cérébral adjacent etentraîner localement des micro-infarctus avec apparitiond’un hypersignal en diffusion (Fig. 15) [40].
De manière non spécifique, des troubles de la coagulationpeuvent favoriser la survenue d’occlusion des sinus veineuxet des veines cérébrales profondes, plus fréquemment rap-portée lorsqu’il existe un SAPL associé [41].
Enfin, les nerfs et le chiasma optiques peuvent être decalibre augmenté et se rehausser après injection de gadoli-nium. Ces lésions sont en rapport avec une vascularite desnerfs optiques et n’ont pas de caractéristiques IRM spéci-fiques [42].
Syndrome des anti-phospholipides
Les liens entre LED et SAPL sont étroits. Le SAPL estdéfini par l’association d’une ou plusieurs manifestationscliniques (thromboses de sièges divers et/ou avortementsrépétés) à la présence durable d’anticorps aPL. Il est ditprimaire lorsqu’il n’est pas associé à un LED ou à une
Author's personal copy
266 A. Drier et al.
autre MS (syndrome de Gougerot Sjögren primitif) [12].Les principaux anticorps aPL sont les anticorps anticardioli-pine, l’anticoagulant circulant de type lupique et l’anticorpsdirigé contre la bêta-2-glycoprotéine I. La cause de la pro-duction d’aPL est inconnue.
Au sein des atteintes viscérales, le SNC constitue la cibleprivilégiée et souvent révélatrice des manifestations arté-rielles ischémiques du SAPL. L’âge moyen lors du premieraccident vasculaire cérébral au cours du SAPL se situe dansla quatrième décennie [12]. Dans une série européenne mul-ticentrique de 1000 SAPL, les accidents constitués étaientrévélateurs chez 13 % des patients et les accidents transi-toires chez 7 % [43]. La physiopathologie des manifestationsischémiques est encore mal élucidée mais ces lésions pour-raient être secondaires à des micro-embolies cérébralesà point de départ cardiaque, un état d’hypercoagulabilitéentraînant une thrombose in situ, ou encore une le fruitd’une théorie auto-immune de l’athérosclérose [44].
L’IRM montre le plus fréquemment deux typesd’anomalies chez les patients porteurs d’aPL et pré-sentant des manifestations neurologiques : des imagesséquellaires d’accidents ischémiques cérébraux et deshypersignaux T2 multiples de la substance blanche mesu-rant quelques millimètres. Les accidents ischémiquesconcernent surtout le territoire sylvien et ses branches,ils peuvent être multiples, plutôt de topographie sous-corticale. Les lésions atteignent plus rarement le tronccérébral ou le cervelet [45]. L’angio-RM peut montrer deslésions sténosantes intracrâniennes, voire l’occlusion d’uneartère ou d’une branche intracrânienne [44]. Bien que cesanomalies IRM ne soient pas spécifiques, le diagnostic deSAPL devra être évoqué lorsque ces lésions surviennent chezdes sujets jeunes, de moins de 50 ans, en particulier lorsqueaucun facteur de risque thrombotique n’est retrouvé [45].Au cours de l’évolution du SAPL, une atrophie cérébralediffuse, principalement corticale peut apparaître.
Enfin les thromboses veineuses cérébrales sont rares,alors que les phénomènes thrombotiques prédominent surle versant veineux dans le reste du corps.
Syndrome de Gougerot-Sjögren primitif
Le SGS est une maladie auto-immune chronique caracté-risée par une xérophtalmie et une xérostomie. Il est dit« primitif » lorsqu’il est isolé et « secondaire » s’il est associéà une autre maladie auto-immune. Le SGSP atteint préféren-tiellement les femmes (sex-ratio de 9/1) et plus volontiersentre 40 et 50 ans [12]. La fréquence des atteintes du SNCest difficile à évaluer : ces complications ne sont pas ou peuretrouvées dans certaines populations alors qu’elles sontprésentes dans 25 % des cas de SGSP dans certaines études[12]. La présence d’au moins un des deux anticorps suivantsest nécessaire pour porter le diagnostic : anticorps anti-Ro/SSA et/ou anti-La/SSB ainsi que la présence de critèreshistologiques d’atteinte des glandes salivaires accessoires[46].
Les lésions du SNC peuvent être liées à un mécanismeauto-immun. Elles sont associées dans plus de 60 % des casà la présence d’anticorps anti-SSA, suggérant un potentielrôle de ces anticorps dans la physiopathologie des lésions[47].
En IRM, les lésions du parenchyme cérébral sont prin-cipalement représentées par des lésions multifocales nonspécifiques en hypersignal T2 de la substance blanche. Ceslésions sont de petite taille, nodulaires ou micronodu-laires et touchent indifféremment la substance blanchepériventriculaire, profonde ou juxta-corticale. Elles ne serehaussent pas après injection de gadolinium. Il peut s’yassocier des anomalies de signal des noyaux gris centraux,également en hypersignal T2. Au cours de la maladie, uneatrophie cortico-sous-corticale diffuse peut apparaître [48].
Conclusion
Des hypersignaux T2 de la substance blanche sont fréquem-ment rencontrés au cours des différentes MS. Ces lésionssont non spécifiques et ce sont des associations lésionnellesou d’autres lésions plus spécifiques, souvent en hyposignalT2, qui orientent davantage le diagnostic. Ainsi, nous retien-drons comme évocateurs : les micronodules leptoméningesdiffus et l’extension des granulomes le long des espacespérivasculaires dans la neurosarcoïdose, les épaississementsfocaux des pachyméninges par extension de lésions granu-lomateuses au cours de la maladie de Wegener, les lésionsneurodégénératives des noyaux dentelés et de la substanceblanche péridentelée des histiocytoses associées à desmasses pontiques, sellaires et pseudo-méningiomateusesrehaussées par le gadolinium. On se souviendra égalementqu’au cours de la MB, les veines et les veinules sont principa-lement lésées, entraînant avec prédilection des lésions dela jonction mésencéphalo-diencéphalique et des thrombosesveineuses cérébrales, alors que ce sont préférentiellementles petites artères qui sont atteintes au cours du lupus, duSAPL et du syndrome de Gougerot-Sjögren, entraînant ainsides lésions sus-tentorielles microvasculaires chez des sujetssouvent jeunes.
Conflit d’intérêt
Aucun.
Références
[1] Chapelon-Abric C. Neurosarcoidosis. Ann Med Interne (Paris)2001;152:113—24.
[2] Pickuth D, Spielmann RP, Heywang-Kobrunner SH. Role ofradiology in the diagnosis of neurosarcoidosis. Eur Radiol2000;10:941—4.
[3] Shah R, Roberson GH, Curé JK. Correlation of MR imaging fin-dings and clinical manifestations in neurosarcoidosis. AJNR AmJ Neuroradiol 2009;30:953—61.
[4] Dumas JL, Valeyre D, Chapelon-Abric C, Belin C, Piette JC,Tandjaoui-Lambiotte H, et al. Central nervous system sarcoido-sis: follow-up at MR imaging during steroid therapy. Radiology2000;214:411—20.
[5] Smith JK, Matheus MG, Castillo M. Imaging manifestations ofneurosarcoidosis. AJR Am J Roentgenol 2004;182:289—95.
[6] Weber-Donat G, Pons-Ukkola E, Garcia C, Teriitehau C,Minvielle F, Baccialone J. An unusual MRI observation of neu-rosarcoidosis. J Neuroradiol 2010;37:64—7.
[7] Bihan H, Christozova V, Dumas JL, Jomaa R, Valeyre D, Tazi A,et al. Sarcoidosis: clinical, hormonal, and magnetic resonanceimaging (MRI) manifestations of hypothalamic-pituitary disease
Author's personal copy
Imagerie des atteintes intracrâniennes au cours des maladies systémiques 267
in 9 patients and review of the literature. Medicine (Baltimore)2007;86:259—68.
[8] Rodriguez F, Link MJ, Driscoll CL, Giannini C. Neurosarcoidosismimicking meningioma. Arch Neurol 2005;62:148—9.
[9] Christoforidis GA, Spickler EM, Recio MV, Mehta BM. MR ofCNS sarcoidosis: correlation of imaging features to clinicalsymptoms and response to treatment. AJNR Am J Neuroradiol1999;20:655—69.
[10] Arias M, Iglesias A, Vila O, Brasa J, Conde C. MR imaging fin-dings of neurosarcoidosis of the gasserian ganglion: an unusualpresentation. Eur Radiol 2002;12:2723—5.
[11] Zuber M, Blustajn J, Arquizan C, Trystram D, Mas JL, MederJF. Angiitis of the central nervous system. J Neuroradiol1999;26:101—17.
[12] Dechy BW, Hausfater P, Rancurel G, Piette JC. Atteintesneurologiques au cours des maladies systémiques. Paris: Flam-marion;2003.
[13] Seror R, Mahr A, Ramanoelina J, Pagnoux C, Cohen P, GuillevinL. Central nervous system involvement in wegener granuloma-tosis. Medicine (Baltimore) 2006;85:54—65.
[14] Murphy JM, Gomez-Anson B, Gillard JH, Antoun NM, Cross J,Elliott JD, et al. Wegener granulomatosis: MR imaging findingsin brain and meninges. Radiology 1999;213:794—9.
[15] Nusbaum AO, Morgello S, Atlas SW. Pial involvement inWegener’s granulomatosis shown on MRI. Neuroradiology1999;41:847—9.
[16] Provenzale JM, Allen NB. Wegener granulomatosis: CT and MRfindings. AJNR Am J Neuroradiol 1996;17:785—92.
[17] Goyal M, Kucharczyk W, Keystone E. Granulomatous hypophy-sitis due to Wegener’s granulomatosis. AJNR Am J Neuroradiol2000;21:1466—9.
[18] Emile JF, Peuchmaur M, Fraitag S, Bodemer C, Brousse N.Immunohistochemical detection of granulocyte/macrophagecolony-stimulating factor in Langerhans’ cell histiocytosis. His-topathology 1993;23:327—32.
[19] Grois N, Prayer D, Prosch H, Lassmann H. Neuropatho-logy of CNS disease in Langerhans cell histiocytosis. Brain2005;128:829—38.
[20] Prayer D, Grois N, Prosch H, Gadner H, Barkovich AJ.MR imaging presentation of intracranial disease associatedwith Langerhans cell histiocytosis. AJNR Am J Neuroradiol2004;25:880—91.
[21] Martin-Duverneuil N, Idbaih A, Hoang-Xuan K, Donadieu J,Genereau T, Guillevin R, et al. MRI features of neurodegenera-tive Langerhans cell histiocytosis. Eur Radiol 2006;16:2074—82.
[22] Gizewski ER, Forsting M. Histiocytosis mimicking a pineal glandtumour. Neuroradiology 2001;43:644—6.
[23] Lachenal F, Cotton F, Desmurs-Clavel H, Haroche J, TailliaH, Magy N, et al. Neurological manifestations and neuro-radiological presentation of Erdheim-Chester disease: reportof 6 cases and systematic review of the literature. J Neurol2006;253:1267—77.
[24] Drier A, Haroche J, Savatovsky J, Godenèche G, Dormont D,Chiras J, et al. Cerebral, facial bone, and orbital involvementin Erdheim-Chester bisease: CT and MR imaging findings. Radio-logy 2010;255:586—94.
[25] Johnson MD, Aulino JP, Jagasia M, Mawn LA. Erdheim-chesterdisease mimicking multiple meningiomas syndrome. AJNR AmJ Neuroradiol 2004;25:134—7.
[26] Martinez R. Erdheim-Chester disease: MR of intraaxial andextraaxial brain stem lesions. AJNR Am J Neuroradiol1995;16:1787—90.
[27] Weidauer S, von Stuckrad-Barre S, Dettmann E, Zanella FE, Lan-fermann H. Cerebral Erdheim-Chester disease: case report andreview of the literature. Neuroradiology 2003;45:241—5.
[28] Gazzeri R, Galarza M, Amoroso R, De Bonis C, D’Angelo V. Neu-rological picture. Torcular Erdheim-Chester disease. J NeurolNeurosurg Psychiatry 2006;77:1078.
[29] Kitai R, Llena J, Hirano A, Ido K, Sato K, Kubota T. MeningealRosai-Dorfman disease: report of three cases and literaturereview. Brain Tumor Pathol 2001;18:49—54.
[30] Lu M, Guo DY. Leptomeningeal Rosai-Dorfman disease. J Neu-roradiol 2010;37:196—7.
[31] Idir I, Cuvinciuc V, Uro-Coste E, Penna M, Boetto S, CognardC, et al. MR perfusion of intracranial Rosai-Dorfman mimickingmeningioma. J Neuroradiol; 5 [in press].
[32] Wechsler B, Sbai A, Du-Boutin LT, Duhaut P, Dormont D, PietteJC. Neurological manifestations of Behcet’s disease. Rev Neurol(Paris) 2002;158:926—33.
[33] Kocer N, Islak C, Siva A, Saip S, Akman C, Kantarci O, et al. CNSinvolvement in neuro-Behcet syndrome: an MR study. AJNR AmJ Neuroradiol 1999;20:1015—24.
[34] Matsuo K, Yamada K, Nakajima K, Nakagawa M. Neuro-Behcet disease mimicking brain tumor. AJNR Am J Neuroradiol2005;26:650—3.
[35] Gerber S, Biondi A, Dormont D, Wechsler B, Marsault C.Long-term MR follow-up of cerebral lesions in neuro-Behcet’sdisease. Neuroradiology 1996;38:761—8.
[36] Greenwood DL, Gitlits VM, Alderuccio F, Sentry JW, TohBH. Autoantibodies in neuropsychiatric lupus. Autoimmunity2002;35:79—86.
[37] Jennings JE, Sundgren PC, Attwood J, McCune J, Maly P.Value of MRI of the brain in patients with systemic lupuserythematosus and neurologic disturbance. Neuroradiology2004;46:15—21.
[38] Sibbitt Jr WL, Sibbitt RR, Brooks WM. Neuroimaging in neu-ropsychiatric systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum1999;42:2026—38.
[39] Kashihara K, Nakashima S, Kohira I, Shohmori T, FujiwaraY, Kuroda S. Hyperintense basal ganglia on T1-weighted MRimages in a patient with central nervous system lupus andchorea. AJNR Am J Neuroradiol 1998;19:284—6.
[40] Takahashi T, Kokubun Y, Okuhata Y, Sawada S, Mizutani T. Acentral nervous system lupus showing peculiar findings on cra-nial magnetic resonance imaging (MRI). Rinsho Shinkeigaku2003;43:409—16.
[41] Lalani TA, Kanne JP, Hatfield GA, Chen P. Imaging fin-dings in systemic lupus erythematosus. Radiographics 2004;24:1069—86.
[42] Sklar EM, Schatz NJ, Glaser JS, Post MJ, ten Hove M. MR ofvasculitis-induced optic neuropathy. AJNR Am J Neuroradiol1996;17:121—8.
[43] Cervera R, Piette JC, Font J, Khamashta MA, ShoenfeldY, Camps MT, et al. Antiphospholipid syndrome: clinicaland immunologic manifestations and patterns of diseaseexpression in a cohort of 1,000 patients. Arthritis Rheum2002;46:1019—27.
[44] George J, Haratz D, Shoenfeld Y. Accelerated atheroma, anti-phospholipid antibodies, and the antiphospholipid syndrome.Rheum Dis Clin North Am 2001;27:603—10.
[45] Kim JH, Choi CG, Choi SJ, Lee HK, Suh DC. Primary anti-phospholipid antibody syndrome: neuroradiologic findings in11 patients. Korean J Radiol 2000;1:5—10.
[46] Vitali C, Bombardieri S, Jonsson R, Moutsopoulos HM, Alexan-der EL, Carsons SE, et al. Classification criteria for Sjögren’ssyndrome: a revised version of the European criteria proposedby the American-European Consensus Group. Ann Rheum Dis2002;61:554—8.
[47] Alexander EL, Ranzenbach MR, Kumar AJ, Kozachuk WE, Rosen-baum AE, Patronas N, et al. Anti-Ro(SS-A) autoantibodiesin central nervous system disease associated with Sjögren’ssyndrome (CNS-SS): clinical, neuroimaging, and angiographiccorrelates. Neurology 1994;44:899—908.
[48] Pierot L, Sauve C, Leger JM, Martin N, Koeger AC, Wechsler B, etal. Asymptomatic cerebral involvement in Sjögren’s syndrome:MRI findings of 15 cases. Neuroradiology 1993;35:378—80.
Related Documents