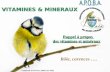GT 2009-03 GUIDE PRATIQUE D'IDENTIFICATION DES MINERAUX

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

GT 2009-03GUIDE PRATIQUE D'IDENTIFICATION DES MINERAUX

Notions élémentaires de minéralogie
Guide pratique
d'identification des minéraux

• • • • Guide pratique • d'identification • • des minéraux • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC
1000, route de l'Église, bureau 500, Québec (Québec) GIV 3V9
•
• •
VENTE ET DISTRIBUTION Téléphone : 418 643-5150 ou, sans frais, 1 800 463-2100 Télécopie : 418 643-6177 ou, sans frais, 1 800 561-3479
Internet : www.publicationsduquebec.gouv.gc.ca
•
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec
et Bibliothèque et Archives Canada
Ledoux, R. L. (Robert Louis), 1933-
Guide pratique d'identification des minéraux: notions élémentaires de minéralogie
Éd. rev. et augm.
Éd. précédente par: Jean Girault et Robert Ledoux. Québec: Direction
de l'assistance à l'exploration minière, 1991.
Comprend des réf. bibliogr. et un index.
ISBN 978-2-551-19839-9
1. Minéraux — Identification — Guides, manuels, etc. 2. Minéralogie — Guides, manuels, etc. 3. Minéraux — Québec (Province) — Identification — Guides, manuels, etc. I. Jacob, Henri-Louis. II. Québec (Province). Ministère des ressources naturelles et de la faune. Ill. Girault, Jean, 1923- . Guide pratique d'identification des minéraux. IV. Titre.
QE366.8.L42 2009 549 C2009-941686-7

Guide pratique
d'identification des minéraux
Notions élémentaires de minéralogie • • • ROBERT LEDOUX • HENRI-LOUIS JACOB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC Quebec N N
• •

La présente édition, revue et augmentée, a été préparée par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Les auteurs de la précédente édition étaient Jean Girault et Robert Ledoux.
Coordination de la publication Charlotte Grenier, Service de la diffusion et de l'intégration, MRNF Pierre Verpaelst, Direction de l'information géologique du Québec, MRNF
Rédaction Robert Ledoux, professeur retraité, Département de géologie et de génie géologique, Université Laval, Québec Henri-Louis Jacob, ingénieur-géologue retraité, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Québec
Révision linguistique Marie Racine Anne Veilleux, Direction des communications, MRNF
Cette édition a été produite par Les Publications du Québec 1000, route de l'Église, bureau 500 Québec (Québec) G1V 3V9 3 4 5
Chef de projet Ann Picard
Directrice artistique 6
Brigitte Carrier
Chargée de production 1. Pyrite (n° 8) Marjolaine Rondeau 2. Agates (n° 52)
Graphisme 3. Plagioclase (n° 27)
Charles Lessard 4. Rubis (n° 45) 5. Talc (n° 28) 6. Quartz cristallisé (n° 24)
Dépôt légal —'2009 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque et Archives Canada
ISBN 978-2-551-19839-9
Code de diffusion : GT 2009-03
© Gouvernement du Québec, 2009
Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction par quelque procédé que ce soit et
la traduction, même partielles, sont interdites sans l'autorisation des Publications du Québec.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• •
• PRÉSENTATION •
• • • • Collectionner des minéraux est un loisir intéressant, éducatif et accessible aux
gens de tous âges. Sachant que la croûte terrestre renferme près de 4000 espèces • minérales, ce passe-temps pourrait devenir une passion pour toute une vie. Au
• Québec seulement, plus de 600 minéraux différents ont été identifiés jusqu'à
• maintenant.
Finalement, la troisième partie du guide intitulée «Tables de détermination» vous • fournira des techniques et des conseils judicieux pour identifier méthodiquement
• vos minéraux et les classer parmi 120 minéraux choisis.
• Les gens du Québec s'éveillent de plus en plus au monde minéral. En effet, des associations et des clubs de minéralogie, de gemmologie et de paléontologie • (fossiles) ont vu le jour ces dernières années. Plusieurs régions du Québec pos-
• sédent leur propre musée minéralogique.
• De plus, mentionnons qu'au Québec plusieurs établissements d'enseignement (écoles secondaires, cégeps, universités) offrent des cours sur ces sujets et
• donnent la possibilité aux jeunes élèves, étudiants et étudiantes de faire carrière
• dans ce domaine.
• Pour terminer, nous vous proposons de vous munir d'un marteau de prospecteur, d'une loupe (grossissement 10X) et d'un sac pour vos échantillons et de partir à
• la découverte des richesses minérales qui vous attendent, peut-être méme au
• seuil de votre porte. Ouvrez donc grands les yeux. Nous vous souhaitons une
• bonne lecture et une bonne cueillette de minéraux.
• •
Le présent document peut être considéré comme un guide d'initiation à la • minéralogie. Il a pour but de vous aider à étudier et à identifier les minéraux
• sans nécessairement posséder au préalable des connaissances dans cette
• science.
La première partie du guide traite des différentes propriétés physiques des minéraux, • pour permettre de les regrouper selon leurs caractéristiques et ainsi les identifier.
• La deuxième partie du document fournit l'illustration, la description détaillée, les
• usages et les modes de gisements de 40 minéraux que l'on peut se procurer au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, soit directement à la
• boutique du Musée ou par courriel à [email protected].
• Ces 40 minéraux, qui se retrouvent en grande partie et sans trop de difficulté sur le territoire québécois, donnent un aperçu des nombreuses variétés minérales • existant au Québec et sur la surface de la Terre. Un supplément décrivant les
• principaux métaux nobles, pierres précieuses et pierres fines ornementales reflète
• une partie de la diversité du potentiel minéral québécois.


Umiujaq
Radision TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
,..r-S‘-'s
~.TL~
n eei~~
"l ~
Î ecédenôn~
!`
11
I Mistissini. Sel'.
©
p Matage'', Havre-Saim-P~ere
9 Chibougamau
~Rouyn-Norantla C Baie-Gemmi . , ~— -
I. .,Gaspé \ I Îles-de•la- '
J Va l-d'Or ♦ Saguenay ~ Rimouski - Madeleine (
A -Vw..-`. \ /
/ \ ~/
o
Ile a Am,cos„
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CARTE MINÉRALE DU QUÉBEC
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2009
• \ Québec
~ . Trois-Poviércl
• ~ 1 `^!
ONTARIO ---.-_ —She • S Montr011 e-
ÉTATS-UNIS '
NOUVEAU- !BRUNSWICK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Provinces géologiques
L] Appalaches
Basses-Terres du Saint-Laurent
D Grenville
Supérieur
Churchill
Mines
® Or
• Or, cuivre, zinc
• Fer, fer et titane (ilménite)
• Nickel, cuivre, EGP, or
• Niobium
• Zinc, cuivre
VII
Chrysotile
• Graphite
• Mica
• Sel
A Silice
A Feldspath


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
TABLE DES MATIÈRES
V Présentation
VII Carte minérale du Québec
1 Introduction
3 Propriétés spécifiques des minéraux
5 Éclat
5 Couleur
8 Transparence
8 Dureté
11 Ténacité
11 Densité
13 Clivage
15 Séparation
16 Forme
16 Formes cristallines des minéraux
17 Cristaux à faces striées
18 Cristaux maclés
23 Toucher
23 Saveur
23 Effervescence
23 Propriétés diverses
23 Fluorescence
23 Thermoluminescence
24 Magnétisme
24 Radioactivité
24 Odeur
25 Fusibilité
25 Classification
29 Description des minéraux

73 Métaux nobles et gem
75 Métaux nobles
78 Pierres précieuses
84 Pierres fines
89 Résumé des principales caractéristiques d'identification
93 Tables de détermination
95 Tables d'identification des principaux minéraux
115 Index minéralogique
123 Fiche d'identification des minéraux
127 Localisation des gisements de minéraux au Québec
135 Renseignements complémentaires sur les spécimens photographiés
139 Pour en savoir plus

• • • • 11 INTRODUCTION
•
•
•
• La minéralogie est la science • qui s'occupe des minéraux. • •
• Qu'est-ce qu'un minéral?
• Un minéral est une substance naturelle solide, homogène, formée généralement
• par des procédés inorganiques, ayant une composition chimique déterminée et possédant un certain nombre de propriétés physiques, chimiques et cristallo-
• graphiques qui permettent de le reconnaître. Les minéraux sont fournis par les
• matériaux de l'écorce terrestre et les météorites. Le nombre de minéraux connus actuellement est d'environ 4000. Chaque année, quelques dizaines de nouveaux
• minéraux sont découverts.
• Qu'est-ce qu'une roche?
• Une roche est un agrégat de minéraux. Cependant, certaines roches sont compo-
• Sées exceptionnellement d'un seul minéral.
• Le quartz (n° 25), le feldspath (n° 26) et le mica (n° 30) sont des corps homogènes appelés minéraux; un agrégat de ces trois minéraux est une roche appelée granite.
• Le quartzite est une roche formée presque uniquement de quartz.
• Ce guide pratique d'identification ne traite que des minéraux. Les roches sont
• décrites dans une autre publication intitulée Guide pratique d'identification des
roches (Publications du Québec). On y trouve la description détaillée d'une col-
• lection de 30 roches.
• Qu'est-ce qu'un minerai?
• On appelle au sens large minerai toute substance minérale qu'on peut exploiter
• avec profit.
• La valeur commerciale d'un minerai dépend de nombreuses conditions: teneur du minerai, prix de la substance que l'on extrait, nature et pourcentage des impu-
• retés, proximité d'un marché, frais d'exploitation et de traitement. Ii ne faut pas
• oublier qu'on découvre sans cesse de nouvelles méthodes de traitement et de nouveaux usages: une substance actuellement inexploitable avec profit peut
• devenir demain un minerai recherché.
•
•
• •

Qu'est-ce que la gangue?
On appelle gangue l'ensemble des substances sans valeur marchande qui accompagnent les minerais: quand on exploite un filon de quartz renfermant de l'or, on dit que le quartz est la gangue de l'or.
Comment reconnaître les minéraux?
Chaque minéral possède un ensemble de propriétés physiques, chimiques et morphologiques qui permettent de le distinguer de tous les autres minéraux. Son éclat, sa dureté, sa composition chimique et sa forme particulière le cafactérisent.
2

•
• • • • • •
Propriétés spécifiques des minéraux
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


11 I/ 11 1
1 11
11 11 11 11
I/ 11 11 11 11 11 11 lb 11 11 10 11 1
1 11
lb 11 11 11 11 11 I/ 11 11 ID 11 11 11
Plusieurs de ces propriétés spécifiques sont faciles à observer sans l'aide d'instruments et sont d'une grande utilité Our l'identification des minéraux les plus communs.
■ ÉCLAT
L'éclat, c'est l'aspect qu'offre la surface d'un minéral quand elle réfléchit la lumière.
Les minéraux n'ont pas tous le même éclat, on distingue:
• L'éclat métallique: brillant et vif, comme celui des métaux. De nombreux
minéraux métalliques, tels que la galène (n° 3), la stibine (n° 7) et la molyb-
dénite (n° 10) possèdent cet éclat.
• L'éclat non métallique: celui des minéraux qui ne possèdent pas l'éclat
métallique et qui est décrit par les qualificatifs suivants:
— l'éclat vitreux: comme le verre.
Exemple: le quartz (n° 25);
— l'éclat gras: la surface semble enduite d'une substance huileuse.
Exemple: le talc (n° 28);
l'éclat adamantin: réfléchit vivement la lumière.
Exemple: le diamant (n° 44);
l'éclat résineux: comme la résine.
Exemple: le soufre;
l'éclat soyeux: comme la soie.
Exemple: l'amiante chrysotile (n° 31).
• L'éclat sous-métallique: ressemble à un éclat métallique, mais la quantité
de lumière réfléchie est faible.
Exemple: la chromite (n° 18).
■ COULEUR
La couleur d'un minéral à l'état massif est celle que l'on observe sur une
cassure fraîche. Il est particulièrement important d'observer la couleur sur une
cassure fraîche quand on examine des minéraux à éclat métallique, car leur
surface montre souvent des ternissures ou des irisations qui dissimulent la vraie
couleur. Bien que certains minéraux (comme le graphite, n° 1) aient toujours à
5

Noire ou brun foncé
Jaune
Jaune laiton
vert foncé
Noire
Brun à jaune brunâtre
Noire
Noir verdâtre
Gris verdâtre
Brune
0 41 41 41 41 0 41 40 41 41 41 41 6 lb 41 41 41 41 41 6 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 4 1 41 4 1 41 41 41
peu près la même couleur, d'autres peuvent avoir des couleurs variées, soit parce qu'ils renferment des impuretés, soit parce qu'ils sont altérés ou pour d'autres raisons. Ainsi, le quartz (n° 25) peut être incolore, blanc, gris, rouge, violet, vert, noir, alors que la chalcopyrite (n° 5), habituellement jaune, peut prendre, par altération, un aspect irisé.
La couleur de la poussière des minéraux, ou trait, varie beaucoup moins que la couleur à l'état massif. Pour cette raison, quand on désire identifier un minéral, on doit toujours déterminer la couleur de sa poussière par la trace qu'il laisse quand on le frotte sur une plaque de porcelaine non émaillée ou sur la cassure fraiche d'un objet de porcelaine blanche. On peut aussi pulvériser finement le minéral ou le frotter avec une substance plus dure que lui.
En général, les minéraux ne présentent pas, à l'état massif, la même couleur et le même éclat que leur poussière. Ce caractère permet de distinguer entre eux des minéraux que l'on risquerait autrement de confondre. En voici quelques exemples:
MINÉRAL COULEUR DE LA MASSE COULEUR DE LA POUSSIÈRE
Sphalérite (n° 4)
Pyrite (n° 8)
Chalcopyrite (n° 5)
Hornblende (n° 34)
Chromite (n° 18)
Cependant, certains minéraux présentent la même couleur à l'état massif et en poussière. Exemple:
MINÉRAL COULEUR DE LA MASSE COULEUR DE LA POUSSIÈRE
Graphite (n° 1)
Gris foncé
Gris foncé
Galène (n° 3)
Gris plomb
Gris plomb
Magnétite (n° 17)
Noire
Noire
Or (n° 41)
Jaune doré
Jaune doré
La couleur de la poussière permet souvent de différencier des minéraux ayant la même couleur à l'état massif.
6

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Examinons les échantillons d'hématite (n°13), d'ilménite (n°14), de chromite (n°18), de pyrolusite (n°15) et de magnétite (n°17). Tous ces minéraux sont gris plus ou moins foncé ou noirs. Frottons-les sur la plaque de porcelaine. L'hématite laisse un trait rouge, l'ilménite, un trait noir grisâtre, la chromite, un trait brun, la pyrolusite et la magnétite, un trait noir. Comme la magnétite est fortement magnétique (voir page 24), on évite ainsi de la confondre avec ces autres minéraux. A partir de la simple observation de la couleur du trait et du magnétisme, nous avons pu distinguer ces cinq minéraux entre eux.
En général, on peut associer le caractère foncé ou pâle de la poussière du trait avec le type d'éclat du minéral : les minéraux à éclat métallique ou sous-métallique ont un trait foncé ou nettement coloré, tandis que les minéraux à éclat non métallique donnent un trait blanc ou faiblement teinté.
MINÉRAUX MINÉRAUX COULEUR DE COULEUR DE MÉTALLIQUES NON MÉTALLIQUES LA MASSE LA POUSSIÈRE
Cuivre natif (n°2)
Rouge-brun Rouge pâle (rosé)
Pyrrhotite (n° 6)
Jaune bronzé Noir grisâtre
Stibine (n° 7)
Gris plomb Gris plomb
Spoduméne (n° 33) vert clair Blanche
Pyroxène (n° 32) Noir verdâtre Gris verdâtre pâle
Tourmaline (n° 36) Noire Gris verdâtre pâle
Frotter successivement sur une feuille de papier blanc une paillette de graphite (n° 1) et une paillette de molybdénite (n° 10).
Frotter avec le doigt les traces sur le papier et les comparer soigneu-sement. Constater que leur couleur (grise pour le graphite, verdâtre pour la molybdénite) permet de distinguer ces deux minéraux l'un de l'autre, malgré leur ressemblance de couleur (masse grise), d'éclat (métallique) et de forme (feuilletée).
7

■ TRANSPARENCE
La transparence est la propriété que possèdent les minéraux de laisser passer
plus ou moins la lumière. Un minéral est dit:
• transparent
S'il laisse passer parfaitement la lumière et si l'on peut voir clairement un
objet à travers.
Exemple: une mince feuille de muscovite (n° 29).
• translucide
S'il laisse passer plus ou moins la lumière, particulièrement sur les arêtes
vives, sans que l'on puisse distinguer un objet à travers.
Exemple: le quartz (n° 25).
• opaque
S'il ne laisse passer aucune lumière.
Exemple: la magnétite (n° 17).
• DURETÉ
La dureté d'un minéral est sa résistance à se laisser rayer.
On détermine la dureté d'un minéral en la comparant à celle des dix minéraux
indiqués ci-après. Ces minéraux ont été choisis par le minéralogiste allemand
Friedrich Mohs (1773-1839) de telle sorte que chacun d'eux raye celui qui le
précède et est rayé par celui qui le suit. Les chiffres 1 à 10 sont assignés à ces
minéraux placés dans un ordre de dureté croissant; ainsi, la fluorite a une dureté
de 4. La série porte le nom d'échelle des duretés relatives de Mohs.
DURETÉS DE MOHS
Rayés par l'ongle
Rayés par une pièce de monnaie de 1 cent
Rayés par une pointe de canif
Rayent le verre
1 Talc (n° 28) 2 Gypse* (n° 40)
3 Calcite (n° 21) 4 Fluorite (n° 19)
5 Apatite (n° 38) 6 Feldspath** (no 26)
7 Quartz (n° 24) 8 Topaze (n° 48) 9 Corindon (n° 12)
10 Diamant (n° 44)
Très tendres
Assez tendres
Assez durs
Très durs
- Le gypse a l'état massif est plus difficile à rayer avec l'ongle que le gypse en lamelles transparentes (sélénite). Le microcline est un feldspath.
NOTE: les minéraux de l'échelle de dureté sont communs à l'exception du topaze et du diamant. ll est facile de se procurer ces minéraux pour avoir à sa disposition une échelle de dureté de Mohs.
8

•
•
• Il ne faut pas confondre la dureté, qui exprime la résistance d'un corps à se laisser
• égratigner, avec la ténacité, qui est la résistance au choc (voir page 11): le quartz, • qui a une dureté élevée de 7, et le diamant, qui est la substance la plus dure que
l'on connaisse avec une dureté de 10, se brisent tous deux facilement à coups de
• marteau, même s'ils sont plus durs que l'acier du marteau.
• Comment mesurer la dureté d'un minéral?
• Pour mesurer la dureté d'un minéral, on essaye successivement de le rayer avec • l'ongle, avec une pièce d'un cent et avec une pointe de canif. On cherche aussi à
déterminer s'il raye le verre. Enfin, on observe quel minéral de l'échelle des duretés • relatives de Mohs est rayé le plus difficilement par le minéral étudié.
• Les remarques suivantes vous permettront d'éviter des erreurs:
• 1. Frotter une arête vive résultant d'une cassure fraîche du minéral à identifier • sur une surface plane du minéral de l'échelle de Mohs. Avant de conclure,
essuyer le trait, pour s'assurer qu'il persiste. Si l'on appuie trop fort, on risque
• d'écraser un minéral sans qu'il y ait rayure et d'aboutir ainsi à une conclusion • fausse.
• 2. Si l'on frotte un minéral tendre sur un minéral dur, il peut y laisser une marque; bien entendu, dans ce cas, c'est le minéral tendre qui est rayé.
• 3. Si l'on essaye de rayer un minéral finement grenu, des grains peuvent s'en • détacher et simuler une rayure.
• 4. Deux minéraux de même dureté peuvent se rayer mutuellement.
• 5. La dureté d'un minéral peut varier légèrement selon la face essayée; ainsi, la dureté du spoduméne varie de 6 à 7 environ.
• 6. Un minéral altéré a généralement une dureté inférieure à sa valeur normale.
•
• e''~u'
• La halite (n°20) n'est pas rayée par l'ongle, mais est rayée par une pièce
• d'un cent. Elle a une dureté de 2,5. La pyrite (n° 8) ne se raye pas au • canif, mais elle marque le verre si l'on applique une pression suffisante.
Sa dureté est de 6,5. •
• La dureté est une propriété physique très utile dans l'identification des minéraux.
• Elle permet souvent de distinguer les uns des autres des minéraux qui se ressem- • blent extérieurement.
• • • • • g
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Il arrive que des échantillons de gypse (n° 40), de calcite (n° 21), de
fluorite (n° 19), de feldspath (n° 26), de quartz (n° 25), de béryl (n° 35) et
de corindon (n° 12) soient tous blancs. En se basant uniquement sur la
couleur, on risque alors de les confondre entre eux. Mais, il est facile
de les distinguer en déterminant simplement leur dureté.
Le corindon, le béryl et le quartz rayent le verre, mais le microcline
(feldspath) dépolit à peine le verre. Tous ces minéraux ont une dureté
supérieure à 5,5 et ils marquent d'autant plus facilement que leur
dureté est élevée. Les autres minéraux, fluorite, calcite et gypse, ne
marquent pas le verre et ils sont égratignés par la lame d'un canif avec
d'autant plus de facilité que leur dureté est faible. En plus:
• le corindon, de dureté 9, raye le béryl;
• le béryl, de dureté 7,5 à 8, raye le quartz et est rayé par le corindon;
• le quartz, de dureté 7, raye le feldspath et est rayé par le béryl;
• le feldspath, de dureté 6, raye la fluorite et est rayé par le quartz;
• la fluorite, de dureté 4, raye la calcite et est rayée par le feldspath;
• la calcite, de dureté 3, raye le gypse et est rayée par la fluorite;
• le gypse ne raye aucun de ces autres minéraux, mais est rayé par
tous.
L'étude des minéraux et de leur dureté permet de tirer les conclusions suivantes:
• les minéraux qui renferment des métaux lourds, tels que l'or, l'argent, l'anti-
moine, le bismuth, le cuivre, le mercure, le plomb, etc., sont généralement
tendres;
• la plupart des carbonates, des phosphates et des sulfates sont assez
tendres; il en est de même de beaucoup de sulfures;
• les sulfures, les arséniures et les oxydes de fer, de nickel et de cobalt sont
durs. Généralement, c'est aussi le cas des silicates. Font exception les
oxydes et silicates hydratés.
Bien entendu, ces règles sont données simplement à titre de guides et il ne faut
pas oublier qu'elles comportent plusieurs exceptions.
10

• •
• • • TÉNACITÉ
• Un minéral est tenace s'il résiste bien au choc; s'il casse facilement, il est dit .
• fragile ou friable. Les minéraux les plus durs ne sont pas les plus tenaces: le quartz (n° 25), très dur, se broie facilement; la barite (n° 39) est très friable, tandis
• que les fibres de chrysotile (n° 31), assez tendres, sont très tenaces.
• On peut regrouper dans la même catégorie les propriétés qui suivent:
• • sectilité Un minéral est dit sectile si l'on peut en détacher des copeaux avec une • lame de canif. Exemples: le graphite (n° 1) et le cuivre natif (n° 2).
• • malléabilité Un minéral est dit malléable si l'on peut l'aplatir à coups de marteau sans • qu'il se brise.
• Exemples: le cuivre (n° 2), l'argent natif (n° 42) et l'or natif (n° 41).
• ductilité Un minéral est dit ductile si l'on peut l'étirer en un long fil sans le rompre. • Exemple : l'or (n° 41).
• • flexibilité • Un minéral est dit flexible si l'on peut le courber de façon permanente sans
qu'il se brise. • Exemples: des lamelles de talc (n° 28) ou de vermiculite.
• élasticité • Un minéral est dit élastique si l'on peut le courber sans qu'il se brise et s'il
reprend sa forme première quand on le lâche. • Exemple: de minces feuilles de mica (n° 29).
• • • DENSITÉ
• La densité d'un minéral est le rapport qui existe entre la masse d'un certain
• volume de ce minéral et la masse d'un même volume d'eau, à une température déterminée.
• Une balance à deux plateaux (fig. 1) est utilisée pour illustrer la notion de densité
• d'un minéral. Si l'on place, sur le plateau de gauche, un cube de pyrite (n° 8) de
• 1 cm3, il a exactement une masse de 5 g. Afin d'équilibrer cette masse, il faut placer sur le plateau de droite une masse d'eau de 5 g dont le volume serait de 5 cm3,
ce qui revient à dire que 1 cm3 de pyrite est cinq fois plus lourd que 1 cm3 d'eau
• et que la densité de la pyrite est de 5.
• La densité est une propriété qui peut être mesurée avec une grande précision et est une constante physique qui caractérise un minéral pur donné. Cependant, la
• mesure exacte demande l'emploi d'instruments de laboratoire maniés soigneu-
• sement et, en plus, requiert un échantillon très pur d'un minéral. Les échantillons
• 11 •

que l'on recueille comportent le plus souvent des impuretés, comme d'autres minéraux, qui introduisent des erreurs dans la mesure de la densité. Pour ces raisons, on se limite, en pratique, à soupeser un minéral et à apprécier sa densité par comparaison avec d'autres minéraux de densité connue et de volume sensiblement identique.
La densité est dite:
• légère si comprise entre 2,0 et 2,6: comparaison avec la halite (2,1 - n° 20) et le quartz (2,65 - n° 25).
• moyenne si comprise entre 2,6 et 2,9: comparaison avec le quartz (2,65 - n0 25) et la magnésite (3,0 - n° 22).
• lourde si comprise entre 2,9 et 5,0: comparaison avec la magnésite (3,0 -n° 22) et la pyrite (5,0 - n^ 8).
• très lourde si supérieure à 5,0: comparaison avec la galène (7,6 - n° 3).
Constater la forte différence de densité qui existe entre le quartz (n° 25) et la galène (n° 3) en les soupesant successivement dans la main: la densité du quartz est de 2,65 et celle de la galène, 7,6. Répéter cette expérience avec la barite (n° 39) et la halite (n° 20): la densité de la barite est de 4,5, celle de la halite, 2,1.
Le mercure natif a une densité de 13,6 alors que l'or natif (n' 41) a une densité de 19,3. C'est le platine natif (n 43), avec une densité de 21,4, qui est le minéral le plus dense connu.
FIGURE 1 DENSITÉ
1 cm, de pyrite pèse autant que 5 cm3 d'eau. La pyrite est donc cinq fois plus pesante que l'eau; on dit qu'elle a une densité de 5.
Eau 5 cm'
12

•
•
• • la plupart des minéraux qui forment les roches ont un éclat non métallique • et une densité comprise entre 2,6 et 3,5: quartz, feldspaths, micas, amphi- • boles, pyroxènes, etc. Les exceptions sont le corindon et les minéraux
de plomb, de baryum et de strontium de la classe des sulfates et des • carbonates;
• • à part le graphite (2,2), les minéraux d'éclat métallique ont une densité • supérieure à 4. Quelques minéraux d'éclat sous-métallique possèdent
aussi une densité inférieure à 4. •
• • CLIVAGE
• Le clivage est la propriété que possèdent de nombreux minéraux de se diviser, • soit lors d'un choc au moyen d'un marteau, soit lors d'une pression exercée avec • un burin ou une lame de canif, en produisant des surfaces planes, lisses et réflé-
chissantes appelées plans de clivage. La ou les cassures planes apparaissent suivant une, deux, trois ou, parfois, quatre directions et seront toujours les mêmes
• pour un minéral donné. Ainsi, en donnant un coup de marteau sur un minéral qui • possède du clivage (fig. 2), il se produit des fissures planes, lesquelles peuvent
s'entrecouper pour libérer des petits fragments, délimités par une ou plusieurs
• surfaces planes, appelés fragments de clivage.
•
• Eà PÉR E °âme'. • Lorsqu'on frappe légèrement un morceau de calcite (n° 21), celui-ci se • divise en petits fragments de clivage de forme caractéristique (fig. 3C
et 41-0: la calcite possède trois clivages faciles et parfaits. Par contre, • pour briser le quartz (n° 25), il est nécessaire d'appliquer un coup de • marteau plus violent. Les fragments qui en résultent sont des tessons
avec des surfaces de cassure incurvées et marquées de stries plus ou • moins concentriques rappelant l'intérieur d'une coquille. Le quartz ne • possède pas de clivage, sa cassure est dite conchoïdale.
• • • • •
• 13 •
• L'étude de la densité des minéraux permet de tirer les conclusions suivantes:
• • les minéraux ayant une densité inférieure à 2,5 sont peu nombreux. Les trois • minéraux les plus fréquents possédant une très faible densité sont la. • halite (n° 20), le graphite (n° 1) et le gypse (n° 40) avec des densités de 2,1,
2,2 et 2,3 respectivement;

Fragments
de clivage
_
D Fluorite
1A Mica
L~ Calcite
_ CLIVAGE ET CASSURE
Clivage
Cassure conchoidale
FIGURE 3 EXEMPLES DE CLIVAGE
On reconnaît les directions de clivage soit par l'examen de la surface brisée, soit par la présence de stries (lignes) droites plus ou moins profondes, soit par le miroitement, sous une vive lumière, de la surface plane de cassure. Quand on a repéré une ou plusieurs directions de clivage dans un minéral, on peut le cliver en le frappant légèrement avec un marteau ou en appuyant l'arête d'un burin, d'un ciseau à froid ou la lame d'un canif dans la direction des stries (fig. 3A).
Selon l'aspect plus ou moins lisse de la surface obtenue, les clivages sont dits parfaits, imparfaits ou distincts. Ils sont dits très faciles, faciles ou difficiles suivant qu'on peut les mettre plus ou moins aisément en évidence en brisant l'échantillon.
14

•
•
• • Certains minéraux, comme la fluorite (n° 19), la barite (n° 39) et le gypse (n° 40),
possèdent un clivage parfait et facile à observer quand ils se trouvent sous forme
• de cristaux. Par contre, quand ces minéraux sont à l'état massif, le clivage est
• parfois difficile ou même impossible à mettre en évidence (page 20).
•
• • Appliquer la lame d'un canif sur la tranche d'un échantillon de mica
(n° 29 ou 30). En appuyant sur la lame, le mica se sépare en feuilles
• (fig. 3A). Le mica possède un clivage parfait et très facile. Donner un
• léger coup d'un petit marteau sur un coin d'un échantillon de halite
(n° 20). Les trois plans de clivage qui se coupent perpendiculairement
• les uns des autres (fig. 3B) produisent des petits cubes. La même
• expérience réalisée sur la calcite (n° 21) libérerait de petits rhombes.
• Ceci démontre que la calcite possède trois plans de clivage se recou-
pant avec des angles différents de 90°, précisément de 105° (fig. 3C).
•
• La plupart des échantillons de la collection ont été réduits à leur taille actuelle
• à partir de gros spécimens et plusieurs d'entre eux présentent des faces de
• clivage. Remarquer que l'échantillon de microcline (n° 26) s'est brisé en fournis-sant deux surfaces planes et brillantes, perpendiculaires l'une à l'autre; les
• autres surfaces de l'échantillon sont des cassures irrégulières et mates. Le
• pyroxène (n° 32) présente deux plans de clivage brillants qui se coupent à 90°,
tandis que l'amphibole (n° 34) présente deux clivages qui se recoupent avec un
• angle différent de 90°, plus exactement de 56° ou de 124°. La fluorite possède
• quatre plans de clivage; sur un de ces plans (fig. 3D), on observe la trace des
trois autres formant des petits triangles.
•
• • SÉPARATION
• Certains minéraux qui ont subi des déformations dues à des contraintes géolo-
• gigues, à des cisaillements ou à des pressions mécaniques développent, en
• réaction à ces forces, des plans de faiblesse le long desquels ils se brisent
facilement, semblables à des plans de clivage. Cependant, cette cassure plane de
• séparation se distingue du clivage: premièrement, elle n'apparaît que sur les
• spécimens provenant de localités géologiques qui ont subi de telles déformations;
• deuxièmement, les plans de séparation sont relativement espacés et ne sont pas
divisibles à l'infini; troisièmement, leur éclat est plus mat.
• Exemple: pyroxène (n° 32); les deux plans de clivage sont brillants, le plan de
• séparation est plus mat.
• La séparation est aussi appelée pseudoclivage ou parting (terme anglais).
•
• 15 •

■ FORME
Les minéraux montrent assez souvent des formes particulières qui aident à les reconnaître: ce sont les formes cristallines, les cristaux à faces striées, les macles et les formes imitatives ou faciès d'agrégats.
On dit qu'un minéral devient un cristal quand il présente des surfaces planes, plus ou moins lisses, ayant une certaine régularité qui exprime une certaine symétrie. L'un des exemples les plus connus est la variété de quartz qui porte le nom de cristal de roche (n° 24).
La formation d'un cristal est due au fait que les éléments qui entrent dans la composition d'un minéral ne sont pas disposés au hasard, mais suivant un ordre bien précis. On dit alors que le minéral est cristallisé. La forme et la symétrie des cristaux ne sont que l'image extérieure de cette disposition de leurs éléments. La plupart des minéraux sont cristallisés, bien qu'ils ne se présentent pas toujours sous forme de cristaux visibles à l'oail nu. Il faut alors les examiner soit avec une loupe 10X, une binoculaire, un microscope polarisant ou un diffractomètre à rayons X.
Les très rares minéraux qui ne sont pas cristallisés sont dits amorphes
NOTE: On trouvera dans la bibliographie des références à des livres qui c bel • planches et photos en couleurs de minéraux cristallisés.
Les échantillons 24 et 25 sont tous deux du quartz. Bien que seul le n° 24 forme un cristal, ils possèdent tous deux la même structure cristalline ordonnée et la même composition chimique. Le n° 25 ne forme pas un cristal, mais il est tout de même cristallin, car ses élé-ments sont disposés avec un arrangement ordonné et périodique.
Formes cristallines des minéraux
Les cristaux limpides et de grandes tailles sont plutôt rares, les minéraux se trouvant le plus souvent sous forme de masse irrégulière. Cependant, certains minéraux se présentent assez souvent sous forme de cristaux caractéristiques qu'il est bon de reconnaître: la halite, la pyrite et la galène (fig. 4A); la fluorite, la magnétite et la chromite (fig. 4B); les grenats (fig. 4C); la pyrite (fig. 4D); l'analcime (fig. 4E); la sphalérite (fig. 4F); l'apatite, le béryl et le corindon (fig. 4G); la calcite (fig. 4H et 41); le quartz (fig. 4J); le feldspath orthoclase (fig. 4K); le pyroxène augite (fig. 4L).
16

Grenat
F❑ Sphalérite
❑I Calcite
Augite
Halite, pyrite g Fluorite, magnétite
D I Pyrite
Apatite, béryl
J I Quartz
Analcime
Calcite
OK Orthoclase
17
• • • • Cristaux à faces striées
• Quelques minéraux montrent des surfaces cristallines marquées par de fines
stries parallèles. Ces stries résultent de formes combinées sur un même cristal
• qui croissent à des vitesses différentes, et c'est à l'intersection de ces formes sur
• les faces du cristal qu'apparaissent les stries dites de croissance. Par exemple, la
tourmaline montre des stries parallèles à l'allongement du cristal (fig. 5A). Les
• cristaux cubiques de la pyrite montrent souvent trois séries de stries disposées
• à angle droit les unes des autres (pyrite dite triglyphe, fig. 5B). Finalement, le quartz
• présente sur les faces du prisme des stries horizontales parfois discontinues
(fig. 5C).
FIGURE 4 3 EXEMPLES DE FORMES CRISTALLINES`',

O
A Tourmaline
B Pyrite
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
F ,,. RF F EXEMPLES DE CRISTAUX A FACES STRIÉES
Quartz
Cristaux maclés
Certains minéraux forment des cristaux groupés selon une association définie par une loi cristallographique et non aléatoire, ce sont les macles. On peut distinguer les types de macles suivants:
1. Macles de pénétration il s'agit généralement de deux cristaux d'un même minéral qui s'interpé-nètrent suivant une orientation définie. Exemples: deux cristaux cubiques de fluorite interpénétrés qui se sont développés en mettant en commun la diagonale de leur cube (fig. 6A); deux cristaux de staurotide, un vertical et l'autre horizontal, s'interpénètrent pour former une croix appelée croisette de Bretagne (fig. 6B); deux cristaux d'orthoclase, un tourné de 180° autour d'un axe vertical par rapport à l'autre, s'interpénètrent pour former la macle de Carlsbad (fig. 6C).
2. Macles d'accolement simple Deux cristaux d'un même minéral réunis suivant une face d'accolement déterminée. Exemples: deux cristaux octaédriques de spinelle croissent à partir d'une face commune parallèle à une face de l'octaèdre, dont un est tourné de 120° par rapport à l'autre (fig. 6D); deux cristaux de cassitérite ou de rutile qui sont jumelés de manière à former un «genou» (fig. 6E).
3. Macles d'accolement multiple (polysynthétique) Des lamelles d'un minéral sont accolées selon un plan parallèle. On reconnaît ce type de macle polysynthétique par la présence de fines stries parallèles visibles sur une face clivée du spécimen. Exemples: la calcite (fig. 6F); les feldspaths albite et labrador (fig. 6G et 6H).
18

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
IGURF 6 EXEMPLES DE MACLES
1. Macles de pénétration
Fluorite
J Staurotide Orthoclase (Carlsbad)
2. Macles d'accolement simple
Spinelle
LEI Cassitérite, rutile
3. Macles d'accolement multiple (polysynthétique)
r Calcite C1 Albite, labrador H Labrador
NOTE: Lorsque les macles sont présentes, elles permettent souvent de confirmer l'identification d'un minéral.
19

Formes imitatives ou faciès
Les agrégats de grains ou de petits cristaux d'un même minéral développent des formes que l'on convient d'appeler imitatives ou faciès. Les faciès les plus fréquemment observés (fig. 7) sont les suivants:
• granulaire Agrégat formant une mosaïque de grains d'un minéral enchevêtrés ou cimentés entre eux et dont le contour de chaque grain est visible à l'oeil nu ou à la loupe 10X. Exemple: ilménite (n° 14). Si les grains présentent des faces planes et des contours réguliers en forme de polygone, on dit alors que le faciès est cristallin.
• massif Agrégat trop finement grenu pour que le contour des grains soit visible même à la loupe 10X. Exemple: pyrrhotite (n° 6).
• lamellaire En forme de lamelles qui peuvent être séparées le long des plans de clivage. Exemple: micas (n° 29 et n° 30).
• folié En forme de minces lamelles, écailles ou paillettes parallèles qui peuvent être pliées ou déformées. Exemples: talc (n° 28), molybdénite (n° 19), graphite (n° 1).
• fibreux En forme de fibres qui peuvent être effilochées. Exemple: amiante chrysotile (n° 31).
• aciculaire En forme d'aiguilles très fines. Exemple: trémolite (variété d'amphibole).
• prismatique De forme allongée représentant souvent des colonnettes. Exemple: tourmaline (n° 36).
• radié En forme de lamelles ou d'aiguilles disposées en éventail. Exemple: strontianite (carbonate de strontium).
• botryoïde En forme de grappe de raisin. Exemple: goethite (oxyde de fer).
• réniforme En forme de rognons. Exemple: psilomélane (oxyde de manganèse). Semblable à la forme botryo de, mais de plus grande dimension.
20

•
•
• • rubané • En couches parallèles ou concentriques de différentes couleurs. • Exemple: agates.
• • dendritique En forme de branches d'arbre.
• Exemple : pyrolusite (oxyde de manganèse).
• • stalactitique • De forme allongée comme celle de glaçons qui pendent aux gouttières des
toits. • Exemple: calcite des grottes.
• • drusique • En cristaux tapissant l'intérieur de cavités.
Exemple: géode tapissée d'améthystes (variété de quartz violacé, n° 49).
• pisolitique • Avec des sphères de la taille de petits pois. • Exemple: bauxite (minerai d'aluminium).
• • figurée Une substance minérale remplace la matière d'un corps organique en
• conservant les structures fines. Peut représenter une multitude de formes
• • arborescent • En forme de petites branches d'aiguilles de sapin. • Exemple: argent natif (n° 43).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 21 •
• différentes. Exemple: bois pétrifié.

FIGURE 7 EXEMPLES DE FACIÈS D'AGRÉGATS
Granulaire Massif Lamellaire Folié
Fibreux Aciculaire Prismatique Radié
Botryoïde
Rubané
Dendritique Stalactitique
ou réniforme
Drusique Pisolitique Arborescent
22

• •
• • ■ TOUCHER
• Certains minéraux ou roches se reconnaissent par le toucher. La stéatite, formée • de talc compact ou granulaire (n° 28), est douce et onctueuse au toucher, ce
qui lui a valu le nom de «pierre à savon«. Le graphite (n° 1) a un toucher gras et • doux tandis que la pierre ponce a un toucher rude. Enfin, quelques minéraux, • notamment les argiles, happent à la langue.
• • ■ SAVEUR
• Un petit nombre de minéraux ont une saveur particulière: la halite (n° 20) a un • goût salé; la marcasite (sulfure de fer) laisse une saveur d'encre.
• ■ EFFERVESCENCE
• Par l'action d'un acide (acide chlorhydrique ou muriatique, acide acétique ou • vinaigre fort), soit à froid ou à chaud sur la masse ou sur la poussière de l'échan- • tillon, les minéraux de la classe des carbonates (exemples: la calcite n° 21, la • magnésite n° 22 et la sidérite n° 23) se décomposent chimiquement en
produisant des bulles de gaz carbonique; cette réaction spécifique aux carbo- • nates est appelée «réaction d'effervescence».
• • • PROPRIÉTÉS DIVERSES
• Certains minéraux possèdent des propriétés particulières qui peuvent être utiles • pour la prospection: les principales sont la fluorescence, la thermoluminescence,
le magnétisme et la radioactivité.
• Fluorescence
• Les minéraux dits fluorescents possèdent la propriété de devenir lumineux dans • l'obscurité quand ils sont irradiés par des rayons ultraviolets. C'est le cas de • l'autunite (phosphate de calcium et d'uranium), de certains échantillons de
willémite (silicate de zinc), de fluorite, de calcite, de sphalérite, etc. Les lampes • produisant des rayons ultraviolets sont très utilisées pour la recherche du minerai • de tungstène (tungstate de calcium). Un minéral qui continue d'être lumineux
même après que la lampe a été éteinte est phosphorescent. • • Thermoluminescence
Certains minéraux deviennent lumineux quand on les chauffe; ils sont dits • thermoluminescents. C'est notamment le cas de la fluorite chauffée entre
• 50 et 100 °C. Pour observer ce phénomène, on doit se placer dans une obscurité • complète.
•
• 23
•

Placer un fragment de fluorite (n° 19) sur une plaque chauffante; la plaque ne doit pas être chauffée au rouge. Au bout d'une minute ou deux, la fluorite prend une belle couleur violette, nettement visible dans l'obscurité. La chaleur nécessaire peut être différente selon les variétés
de fluorite.
Magnétisme
Certains minéraux renfermant du fer possèdent la propriété d'être attirés par un
aimant, on les dit magnétiques. La magnétite (n° 17) est fortement magnétique, la pyrrhotite (n° 6) l'est plus ou moins et l'hématite (n° 13) ne l'est pas du tout. Une lame de canif peut être facilement aimantée en la frottant plusieurs fois sur un bon aimant. Il suffira ensuite d'approcher la lame d'un petit grain du minéral que l'on étudie. Si celui-ci est attiré, c'est qu'il est magnétique. Cependant, il faut se méfier de la magnétite qui accompagne souvent les autres minéraux en tant qu'impureté.
Approcher lentement l'échantillon de magnétite (n° 17) d'une boussole. Constater que l'aiguille aimantée dévie à son approche.
Radioactivité
Certains éléments chimiques ont la propriété de se désintégrer spontanément en émettant des radiations; les minéraux qui en contiennent sont dits radioactifs. Les éléments les plus connus sont l'uranium, le potassium, le radium et le thorium. Le meilleur moyen de déceler les minéraux radioactifs consiste à employer un compteur Geiger, un scintillométre ou un spectromètre de rayons gamma; ces instruments servent à la prospection d'uranium.
• ODEUR
En soufflant sur un morceau d'argile ou en le mouillant, on sent une odeur terreuse
caractéristique.
Si l'on chauffe au chalumeau des minéraux renfermant du soufre (pyrrhotite n° 6, pyrite n° 8), ils produisent une odeur sulfureuse. Les minéraux renfermant de l'arsenic (arsénopyrite, FeAsS) grillés à la flamme d'un chalumeau dégagent une odeur d'ail. Si l'on mouille certains sulfures broyés en poudre avec des acides dilués, ils dégagent une odeur d'ceufs pourris (anhydride sulfureux, H2S).
A l'état naturel, la plupart des minéraux n'ont pas d'odeur.
24

•
•
• • • FUSIBILITÉ
• C'est la résistance à la chaleur. On détermine la fusibilité relative des minéraux en • la comparant à celle de sept minéraux qui fondent de plus en plus difficilement.
Ces minéraux sont les suivants:
• • Stibine: fond facilement (525 °C) dans la flamme d'une bougie.
• • Chalcopyrite: fond facilement (800 °C) dans un bec de gaz.
• • Grenat almandin: fond facilement (1050 °C) au chalumeau.
• • Actinote (amphibole): fond moins facilement (1200 °C) au chalumeau.
• • Orthoclase (feldspath): fond difficilement (1 300 °C) au chalumeau.
• • Pyroxène: fond très difficilement (1400 °C) au chalumeau.
• • Quartz: infusible au chalumeau (fond à 1 710 °C).
• Le nombre de minéraux qui fondent facilement est peu élevé. Aussi, il est nécessaire de disposer d'un petit chalumeau si l'on veut déterminer la fusibilité
• des minéraux.
•
•
• Tenir avec des pinces un petit fragment de stibine (n° 7) dans la flamme • d'une bougie. Constater qu'il fond facilement en dégageant des fumées
blanches (antimoine) et une odeur sulfureuse (soufre). •
•
• • CLASSIFICATION
• On classifie les minéraux suivant un certain ordre, basé sur leur composition • chimique et leur structure atomique. De manière générale, les minéraux sont • regroupés dans les huit classes suivantes:
• 1 Éléments natifs On groupe dans cette classe tous les minéraux formés d'éléments non
• combinés chimiquement. • Exemples:
diamant (n° 44) C (carbone) • graphite (n° 1) C (carbone) • or natif (n° 41) Au • argent natif (n° 42) Ag
cuivre natif (n° 2) Cu
• • • • 25 •

2. Sulfures et arséniures Les minéraux de cette classe sont formés d'un ou plusieurs métaux combinés à du soufre, à de l'arsenic ou à ces deux éléments.
Exemples: pyrite (n° 8) sulfure de fer, FeS2 molybdénite (n° 10) sulfure de molybdène, MoS2 pyrrhotite (n° 6) sulfure de fer, Fe1 _xS chalcopyrite (n° 5) sulfure de fer et cuivre, CuFeS2
arsénopyrite sulfo-arséniure de fer, FeAsS
smaltite arséniure de cobalt et nickel, (Co,Ni)As3
3. Oxydes Formés d'un ou plusieurs métaux combinés à de l'oxygène. Exemples: chromite (n° 18) oxyde de fer et de chrome, FeCr204 hématite (n° 13) oxyde de fer, Fe203 magnétite (n° 17) oxyde de fer, Fe304 ilménite (n° 14) oxyde de fer et de titane, FeTiO3 uraninite oxyde d'uranium, 002 corindon (n° 12) oxyde d'aluminium, A1203 pyrolusite (n° 15) oxyde de manganèse, Mn02
4. Halogénures et fluorures Dans cette classe, on range les minéraux formés d'un ou plusieurs métaux ou métalloïdes combinés avec l'élément chlore ou fluor. Exemples: halite (n° 20) chlorure de sodium, NaCI sylvite chlorure de potassium, KCI fluorite (n° 19) fluorure de calcium, CaF2 cryolite fluorure de sodium et d'aluminium, Na3AIF6
5. Carbonates Ce sont des combinaisons de carbone et oxygène avec un ou plusieurs
métaux ou métalloïdes Exemples: calcite (n° 21) carbonate de calcium, CaCO3
magnésite (n° 22) carbonate de magnésium, MgCO3
dolomite carbonate de calcium et magnésium, CaMg(CO3)2 sidérite (n° 23) carbonate de fer, FeCO3
malachite (n° 9) carbonate de cuivre hydroxyle, Cu2CO3(OH)2
6. Silicates Les silicates combinent silicium et oxygène avec un ou plusieurs métaux ou métalloïdes. Les silicates constituent une classe particulièrement importante par le nombre de minéraux qui s'y rattachent, par leur extrême abondance dans la nature et par le rôle qu'ils jouent dans la composition
26

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
des roches. Toutes les roches ignées, de même qu'un grand nombre de roches métamorphiques et sédimentaires, sont formées de silicates.
Il existe, dans la classe des silicates, un certain nombre de familles, groupant des minéraux voisins par leurs caractères ou leur composition. Il est important de connaître les familles suivantes:
• les feldspaths Ce sont des silicates en charpente de K, Na, Ca. Exemples: orthoclase, microcline (n° 26), labrador (n° 27).
• les micas Ce sont des silicates en feuillets de K, Mg, Fe, Al hydroxylés. Exemples: muscovite (n° 29), phlogopite, biotite (n° 30).
• les pyroxènes Ce sont des silicates en chaînes de Mg, Fe, Ca. Exemples: enstatite, hypersthène, augite (n° 32), diopside.
• les amphiboles Ce sont des silicates en chaînes complexes de Na, Ca, Fe hydroxylés.
Exemples: hornblende (n° 34), actinote, trémolite. •
• les argiles Ce sont des silicates en couches d'AI, Mg, Fe hydroxylés ou hydratés. Exemples: kaolinite, bentonite.
• la famille de la silice Ce sont des silicates en charpente de composition Si02 parfois hydratés
(opale) et incluant dés impuretés (jaspe). Exemples: quartz (n0s 24 et 25), améthyste (n° 49), citrine, morion,
oeil-de-tigre, agate, silex.
7. Phosphates Formés de phosphore et oxygène combinés avec un ou plusieurs métaux ou métalloïdes. Exemples:
• apatite (n° 38) phosphate de calcium, Ca5(F,CH,CI)(PO4)3
autunite phosphate de calcium et uranium, Ca(UO2)(PO4)210H20
8. Sulfates Formés d'une combinaison de soufre et oxygène avec un ou plusieurs
métaux ou métalloïdes Exemples: barite (n° 39) sulfate de baryum, BaSO4
gypse (n° 40) sulfate de calcium hydraté, CaSO42H2O
27


• • • • • • • • Description des minéraux
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MINÉRAUX
n° 1 — GRAPHITE
n° 2 — CUIVRE NATIF
n° 3 — GALÈNE
n° 4 — SPHALÉRITE
n° 5 — CHALCOPYRITE
n° 6 — PYRRHOTITE
n° 7 — STIBINE
n° 8 — PYRITE
n° 9 — MALACHITE
n° 10 — MOLYBDÉNITE
n° 11 — BRUCITE
n° 12 — CORINDON
n° 13 — HÉMATITE
n° 14 — ILMÉNITE
n° 15 — PYROLUSITE
n° 16 — LIMONITE
n° 17 — MAGNÉTITE
n° 18 — CHROMITE
n° 19 — FLUORITE
n° 20 — HALITE
n° 21 — CALCITE
n° 22 — MAGNÉSITE
n° 23 — SIDÉRITE
n° 24 — QUARTZ
n° 25 — QUARTZ
n° 26 — MICROCLINE
n° 27 — PLAGIOCLASE
n° 28 — TALC
n° 29 — MUSCOVITE
n° 30 — BIOTITE
n° 31 — CHRYSOTILE
n° 32 — PYROXÈNE
n° 33 — SPODUMÈNE
n° 34 — AMPHIBOLE
n° 35 — BÉRYL
n° 36 — TOURMALINE
n° 37 — GRENAT
n° 38 — APATITE
n° 39 — BARITE
n° 40 — GYPSE

• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GRAPHITE
Carbone plus ou moins pur
Dureté: 1
Densité: 2,2
Composition à l'état pur: C
Nom: du grec graphein, écrire.
• Description: couleur noir de fer ou gris acier. Trait noir ou gris foncé, marque le
• papier. Éclat plus ou moins métallique. Opaque. Clivage parfait donnant de fines
paillettes brillantes. Les lamelles peu épaisses sont flexibles. Toucher gras.
• Caractères distinctifs: couleur grise et dureté peu élevée. Il tache les doigts et
• le papier. Il peut être confondu avec la molybdénite (n° 10) dont la couleur est
• moins noire et plus bleutée. Cependant, la trace du graphite sur le papier lorsque
frottée avec les doigts est grise, tandis que celle de la molybdénite est verdâtre.
• De plus, le graphite n'est pas décomposé par les acides forts et est infusible.
• Mode de gisement et associations: se trouve en paillettes dans certains
marbres et calcaires cristallins, disséminés dans certains schistes, conglomérats • et gneiss ou en veinules dans les pegmatites.
• Usages: creusets réfractaires (point de fusion 3927 °C), moules de fonderie,
• industrie électrique (brosses de moteur, accumulateurs, électrodes), ralentisseur
• de neutrons dans les réacteurs nucléaires, garnitures de frein, dans les peintures
protectrices des métaux, dans certains lubrifiants, dans les mines de crayon et
• comme fibres légères dans les articles de sport.
• Gisements au Québec: gisements de graphite en paillettes dans la région des
• Laurentides à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles (au sud de Mont-Laurier) et à Rivière-
Rouge (secteur Sainte-Véronique), sur la Côte-Nord au sud de Fermont (lac Knife)
• et dans le secteur du réservoir Manicouagan (lac Guéret) ainsi qu'en Outaouais
• dans la réserve de Papineau-Labelle (gîte Carmin au nord du lac la Rouge). Le
gisement de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles est le seul en exploitation.
• Des gîtes de graphite en veines se trouvent dans les Laurentides, plus exactement
• près des localités de Grenville (mine Miller), de Saint-Rémi-d'Amherst (mine
• Graphite Ltée) et de Labelle (mine Clot).
•
• 31

•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
CUIVRE NATIF
Dureté: 2,5 à 3
Densité: 8,9
Composition à l'état pur: Cu
Nom: :lu grec khalkos, cuivre.
Description : couleur de la masse rouge clair, virant rapidement au rouge cuivre ou rouge brun. Trait rouge pâle, brillant. Éclat métallique, malléable et ductile. Le plus souvent en dendrites irrégulières ou lamelles parfois tordues, filiformes. Les cristaux bien formés sont rares. Pas de clivage, cassure identique à une feuille de métal déchirée (aspérités piquantes).
Caractères distinctifs: couleur rouge cuivre, éclat brillant, densité élevée, très malléable, en dendrites ou feuillets, souvent altéré en malachite (n° 9, taches vertes) ou en azurite (taches bleues). Noirci par oxydation (ténorite, Cu0).
Mode de gisement et associations: les gisements de cuivre natif les plus connus se trouvent dans les laves basaltiques de la péninsule de Keweenaw, en bordure du lac Supérieur, au Michigan. Au Québec, le cuivre natif apparaît dans la partie inférieure de la zone d'oxydation de sulfures de cuivre où il est associé à la malachite (n° 9), à la chalcocite (Cu2S) ou à la cuprite (Cu20). Les pépites trans-portées par les glaciers et dispersées dans les alluvions étaient recueillies par les Amérindiens qui l'utilisaient pour fabriquer des objets en cuivre. Rarement en quan-tité suffisante pour 'être exploité, sauf dans les gisements de cuivre du Michigan.
Usages: minerai de cuivre. Excellent conducteur d'électricité, il est largement utilisé dans le câblage électrique. Il a remplacé le plomb dans la tuyauterie. Dans les alliages de bronze (cuivre et étain) et de laiton (cuivre et zinc), dans la fabri-cation de nombreux articles de cuisine et d'artisanat, dans la petite monnaie et les médailles.
Gisements au Québec: on trouve du cuivre natif dans la région du Bas-Saint-Laurent (canton de Saint-Denis, au sud de Matane) et en Gaspésie dans le secteur du mont Alexandre. Dans le Nord-du-Québec, on en a trouvé aussi dans les parties oxydées des gisements de cuivre de Chibougamau ainsi qu'à la mine Selbaie, dans le canton de Brouillan.
32

•
•
• • GALÈNE
• Sulfure de plomb
• j
Dureté: 2,5 r
• ^ n. Densité: 7,6
• Composition à l'état pur: PbS
• - Plomb: 86,6 % • - Soufre: 13,4%
• Cristallisation cubique
•
•
• Nom: du grec galênê, plomb.
• Description: couleur de la masse et du trait gris de plomb. Éclat métallique. • Clivages parfaits donnant des fragments de forme cubique. Peut être granulaire.
Quand elle se présente en cristaux cubiques, ils sont souvent déformés avec des • surfaces courbées. Fond facilement au chalumeau. Chauffée, elle dégage une • odeur de soufre.
• Caractères distinctifs: dureté faible, clivages cubiques, densité élevée. C'est le plus lourd des sulfures communs.
• Mode de gisement et associations: dans les veines de quartz (n° 24), souvent • associée à des minerais de zinc (sphalérite n° 4), de cuivre (chalcopyrite n° 5) et • d'argent; dans les filons de barite (n° 39); en amas dans diverses roches sédimen-
taires ou métamorphiques. Elle renferme souvent de l'argent.
• Usages: principal minerai de plomb. Le plomb entre dans la fabrication des • batteries de véhicules, de la peinture, des tuyaux, des alliages de balles de fusil, • du verre de cristal ainsi que de glaçures et de poterie. Dispositifs de radiopro-
tection.
• Gisements au Québec: assez répandue: au Témiscamingue, dans le canton • Duhamel (mine Wright); en Outaouais, sur l'île du Grand Calumet (mine New • Calumet); en Mauricie à Montauban-les-Mines; en Gaspésie dans le canton de
Lemieux (mine Candego); dans le Nord-du-Québec, à la baie d'Hudson dans le
• secteur du lac Guillaume-Delisle.
• • • • • • 33

SPHALÉRITE
Sulfure de zinc
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 3,5 à 4
Densité: 3,9 à 4,1
Composition à l'état pur: ZnS
— Zinc: 67,1% — Soufre: 32,9%
(contient presque toujours du fer)
Nom: du grec sphaleros, trompeur, car on la confond facilement avec la galène.
Description: couleur généralement brune, noirâtre ou noire, parfois jaune miel. Trait jaune brunâtre à brun foncé. Éclat résineux, adamantin, sous-métallique ou métallique. Plus la teneur en fer est élevée, plus la couleur de la masse et du trait est foncée et plus l'éclat est métallique. Cristaux avec clivage parfait (fig. 4F) ou granulaire. Peut être fluorescente ou phosphorescente en donnant une couleur orange.
Caractères distinctifs: couleur du trait jaune à brun, clivage parfait, associée à la pyrite (n° 8), la galène (n° 3), la pyrrhotite (n° 6) et la chalcopyrite (n° 5). Facilement confondue avec la galène dont elle diffère par le trait (brun), la couleur et la densité.
Mode de gisement et associations: en filons ou en amas dans les roches métamorphiques, en sulfures massifs dans certaines roches volcaniques, en remplissage dans les brèches (dolomie et calcaire). Accompagne souvent les minéraux de plomb et de cuivre.
Usages: principal minerai de zinc. Le zinc entre dans la fabrication de la tôle galvanisée, du laiton, de la peinture et dans les produits de préservation du bois. Utilisé aussi en médecine.
Gisements au Québec: en Abitibi-Témiscamingue, dans les gisements de sulfures massifs de Rouyn-Noranda, de val-d'Or et de Barraute; dans le Nord-du-Québec à Matagami, à Chibougamau et dans le canton de Brouillan; en Mauricie à Montauban-les-Mines; en Outaouais sur l'île du Grand Calumet et dans le secteur de Bouchette; en Gaspésie dans les cantons de Lemieux et de Boisbuisson; en Estrie dans les cantons de Stratford et d'Ascot.
Synonyme: blende
34

CHALCOPYRITE
Sulfure de fer et de cuivre
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dureté: 3,5 à 4
Densité: 4,1 à 4,3
Composition à l'état pur: CuFeS2
— Cuivre: 34,6% — Fer: 30,4% — Soufre: 35%
Nom: du grec khaikos, cuivre et puros, feu (allusion à la pyrite).
• Caractères distinctifs: dureté plus faible que la pyrite (n° 8). Sa couleur noir • verdâtre et sa fragilité la distinguent de l'or qui a un trait jaune doré et qui est • malléable et ductile.
• Mode de gisement et associations: souvent dans les filons de quartz, associée parfois à la pyrite et à l'or natif; dans les gisements de sulfures avec des
• minerais de zinc (sphalérite n° 4), de plomb (galène n° 3) et de nickel (pentlandite).
• Usages: principal minerai de cuivre. Le cuivre entre dans la fabrication des • alliages d'aluminium, du laiton (Cu et Zn) et du bronze (Cu et Sn), dans les tuyaux
de plomberie, les fils électriques et les toitures d'édifices.
•
•
•
•
•
•
•
• 35
• Description: couleur jaune laiton souvent irisée. Trait noir verdâtre. Éclat métal- • ligue. Cassure inégale. Se raye au couteau. Le plus souvent à l'état massif, rarement
en cristaux.
• Gisements au Québec: très répandue en Abitibi-Témiscamingue, surtout aux • alentours de Rouyn-Noranda et de Val-d'Or, dans le Nord-du-Québec (Matagami • et Chibougamau), en Estrie (cantons d'Acton, d'Ascot, de Bolton, de Leeds et de
Weedon) et en Gaspésie à Murdochville. •

PYRRHOTITE
Sulfure de fer
Dureté: 3,5 à 4,5
Densité: 4,6 à 4,7
Composition variable: Fe1_xS
- Fer :±60% - Soufre: ±40%
(moins de soufre que la pyrite n° 8)
Nom: du grec purrhos, roux (allusion a la teinte vive).
Description: couleur jaune bronze foncé, parfois irisée (surface altérée colorée en bleu ou en rouge). Trait noir grisâtre. Éclat métallique. Cassure inégale. Massive, granulaire, rarement en cristaux hexagonaux. Plus ou moins magnétique, mais elle l'est toujours lorsque réduite en petits grains ou en poudre.
Caractères distinctifs: se distingue de la pyrite par sa couleur bronzée sur une cassure fraîche et sa dureté plus faible. Son magnétisme permet de la distinguer de la bornite fraîche et de la pentlandite.
Mode de gisement et associations: se trouve dans les roches basiques, où elle est souvent associée au principal minerai de nickel, la pentlandite, ainsi que dans les filons avec d'autres sulfures, dans les pegmatites et dans les roches métamorphiques.
Usages: ne présente pas par elle-méme d'intérêt économique, mais elle indique souvent la présence possible de minéraux de cuivre (chalcopyrite n° 5), de nickel (pentlandite) et, parfois, de cobalt (smaltite) ou, encore, de métaux précieux comme l'or et ceux du groupe du platine.
Gisements au Québec: présente dans presque tous les gîtes de cuivre et de nickel du Québec, soit en Abitibi-Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, en Estrie et en Mauricie.
36

n° 7 STIBINE
Sulfure d'antimoine
Dureté: 1
Densité: 4,6
• • • • • • • • • • • • • • •
Composition à l'état pur: Sb2S3
— Antimoine: 71,2% — Soufre: 28,3%
Nom: du latin stibium, antimoine.
• Description: couleur et trait gris de plomb à gris d'acier. Massive, granulaire, la- • mellaire ou aciculaire. Un clivage parfait, souvent recourbé. Fusibilité 1 (fond à la
flamme d'une bougie en dégageant des fumées blanches et une odeur de soufre). • Légèrement sectile.
• Caractères distinctifs: très faible fusibilité et volatilisation totale, couleur et • clivage.
• Mode de gisement et associations: généralement dans les filons, associée à la sphalérite (n° 4), à la galène (n° 3), à la barite (n° 39), à la bornite (Cu5FS4) et au
• quartz (n° 25). On la trouve aussi dans certaines roches sédimentaires. Elle • renferme parfois de l'or, ce qui augmente sa valeur.
• Usages: minerai d'antimoine. Ce métal entre dans la fabrication d'alliages d'imprimerie, d'alliages de plomb dans les batteries de véhicules, dans les pièces
• pyrotechniques, les allumettes, les détonateurs, la vulcanisation du caoutchouc
• et les pigments de verre.
• Gisements au Québec: on en trouve à la mine Québec Antimoine près de Saints-Martyrs-Canadiens (Centre-du-Québec) ainsi qu'en Gaspésie dans les
• cantons de New Richmond, de Carleton et de Patapédia.
• • • • • • • • 37

PYRITE
Sulfure de fer
Dureté: 6 à 6,5
Densité: 5
Composition à l'état pur: FeS2
— Soufre: 53,4% — Fer: 46,6%
Cristallisation cubique
Nom: du grec puros, feu (par allusion aux étincelles produites en frappant le minéral avec un objet dur).
Description : couleur jaune laiton clair, parfois irisée. Trait noir. Éclat métallique. Cassure inégale ou conchoïdale. Pas de clivage. Ne se raye pas au couteau et marque le verre. Assez fréquemment sous forme de petits cubes brillants ou en forme de masses compactes, grenues ou réniformes, parfois en cristaux présen-tant des faces à cinq côtés (fig. 4D). Les cubes présentent souvent des faces striées (pyrite triglyphe, fig. 56).
Caractères distinctifs: a cause de sa couleur jaune et de son éclat brillant, on la prend parfois pour de l'or natif, d'où le nom d'«or des fous». Cependant, son trait noir, sa friabilité et sa dureté élevée la distinguent de l'or. Ternie, elle ressemble à la chalcopyrite (n° 5), mais cette dernière est rayée par un canif et ne marque pas le verre (consulter le tableau à la page 91).
Mode de gisement et associations: extrêmement répandue dans de nom-breuses roches, c'est le sulfure le plus commun. Elle est fréquemment associée aux minerais métalliques et à l'or.
Usages: seuls les spécimens bien cristallisés offrent une valeur aux collec-tionneurs de minéraux. Autrefois, les gîtes importants étaient exploités pour l'extraction du soufre et la fabrication de l'acide sulfurique. Elle sert surtout d'indicateur de minéralisation en prospection minière.
Gisements au Québec: très répandue. Elle est particulièrement abondante dans les gîtes de cuivre et d'or. On la trouve communément aussi dans les roches argileuses des Appalaches et des Basses-Terres du Saint-Laurent.
38

•
•
•
•
• • MALACHITE
Car~
he de cuivre • hydroxyle •
Dureté: 3,5 à 4
• Densité: 3,9 à 4,03 ..,~
• Composition à l'état pur: Cu2CO3(OH)2
• — CuO: 71,9% (Cu = 57,4%) • - CO2 : 19,9% •
-H20:8,2% H20:
•
• Nom: du grec malakhé, la mauve, une plante médicinale à feuilles vertes; • prononciation [-kit].
• Description: couleur verte, alternance de bandes vert foncé et vert clair. Éclat généralement soyeux, les cristaux sont vitreux. Cassure finement esquilleuse.
• S'observe en masses nodulaires, concrétionnées, mamelonnées ou stalacti- • formes, avec alternance de zones concentriques ou parallèles variant du vert très
foncé au vert clair, particulièrement nette sur surface polie. Les cristaux sont rares • et de petite taille.
• Caractères distinctifs: couleur verte (ton vert-de-gris), au faciès concrétionné, • zoné concentriquement en vert plus ou moins sombre. Sa faible dureté la distingue
de la chrysocolle et de la dioptase (silicates de cuivre hydroxyles). Soluble dans • HCI en produisant des bulles d'effervescence.
• Mode de gisement et associations: essentiellement un minéral d'altération
• des minerais de cuivre (cuivre natif n° 2, chalcopyrite n° 5). Dans les zones faible-ment oxydées, elle forme de minces films d'altération, mais dans les zones plus
• oxydées, elle forme des encroûtements et des masses compactes. Fréquem- • ment associée à l'azurite (carbonate de cuivre bleu azur). Très répandue, sauf
que les gisements de qualité sont rares. Les plus gros gisements exploités se • trouvent en République démocratique du Congo dans la ceinture de cuivre de la
• province du Katanga. Le gisement le plus célèbre de l'Antiquité était celui de
• Chypre. Les plus gros spécimens ont été extraits en Russie.
•
• 39 •
Usages: minerai de cuivre (57,4% Cu). Surtout en artisanat (sculptures d'animaux,
• boules, œufs, cendriers, appuie-livres, coffrets, tables, etc.) et en joaillerie (colliers,
• bagues, cabochons, bracelets, etc.). Autrefois utilisée dans la construction
• d'édifices publics comme revêtement ornemental, colonnes ou mosaïques. Les débris servent de pigment vert dans la peinture et la teinture.

Gisements au Québec: en Estrie dans les anciennes mines de cuivre Capelton (canton d'Ascot), Saint-François (canton de Cleveland) et Lord Aylmer (canton de Roxton); en Gaspésie à la mine Gaspé (Murdochville) et à la mine Madeleine (canton de Boisbuisson); en Abitibi dans les haldes de la mine Rainville (Colom-bière) et de New Formaque (près d'Amos); dans le secteur de Chibougamau à la mine icon et à la mine Copper Rand.
40

• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
n°1 MOLYBDÉNITE
Sulfure de molybdène
Dureté: 1 à 1,5
Densité: 4,6 à 4,7
Composition à l'état pur: MoS2
— Molybdène: 59,9% — Soufre: 40,1%
Nom: du grec molubdos, plomb (ressemble au plomb).
• Description: couleur gris de plomb, reflets bleutés. Trait gris verdâtre. Éclat • métallique. Clivage parfait. Se trouve souvent sous la forme de paillettes brillantes,
flexibles, mais non élastiques. Toucher gras. Sectile. Tache le papier et les doigts. • Parfois en cristaux hexagonaux.
• Caractères distinctifs: ressemble au graphite dont on peut la distinguer par la • couleur du trait sur le papier. Frotté avec le doigt, il devient verdâtre, tandis que
pour le graphite, le gris persiste. Se différencie facilement des autres minéraux par • sa couleur, sa dureté peu élevée, son clivage et son toucher gras.
• Mode de gisement et associations: dans certains granites, pegmatites et • aplites. Se trouve aussi dans les filons de quartz avec la scheelite (CaW04), la
wolframite [(FeMn)W04], la topaze [AI2SiO4(F,OH)2] et la fluorite (CaF2). Associée • aux sulfures.
• Usages: minerai de molybdène. Ce métal sert à la fabrication d'aciers réfractaires et de produits chimiques.
• Gisements au Québec: les principaux gisements se trouvent en Abitibi dans les • cantons de La Corne et de Preissac. Ailleurs au Québec, plusieurs petits gisements • ont été découverts: en Outaouais dans les cantons d'Onslow et d'Huddersfield • ainsi que dans le secteur de Maniwaki; en Estrie dans les cantons de Whitton et
de Gayhurst. Elle est présente aussi dans les gisements de cuivre de Murdochville • et de Chibougamau.
•
•
•
•
• 41 •

n°11 BRUCITE Hydroxyde de magnésium
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 2,5
Densité: 2,4
Composition à l'état pur: Mg(OH)2
- Magnésie (Mg0): 69% - Eau (H20):31%
Nom: en l'honneur d'Archibald Bruce (1777-1857), minéralogiste britannique.
Description: se présente sous différents aspects: lamellaire, folié, fibreux, granulaire ou massif. Dans les calcaires dolomitisés, elle forme de petites boules massives, grisâtres et cireuses qui blanchissent par oxydation. Souvent, dans les serpentinites, elle est fibreuse, sa couleur varie du blanc, au jaune et au vert, son éclat est soyeux et porte alors le nom de «némalite». Sous forme lamellaire ou foliée, l'éclat est nacré et elle est flexible.
Caractéristiques distinctives: se distingue des micas par ses lamelles flexibles, non élastiques et l'éclat nacré. Fibreuse, elle peut être confondue avec l'amiante chrysotile (n° 31), mais la brucite s'effiloche moins facilement et, en général, les fibres sont plus cassantes.
Mode de gisement et associations: la brucite provient de l'altération de sili-cates magnésiens, surtout de la serpentine. Se trouve également dans les calcaires cristallins dolomitisés. Associée à la serpentine (chrysotile n° 31), à la dolomite [CaMg(CO3)2] et à la magnésite (n° 22).
Usages: associée à la magnésite, elle est transformée en magnésie (Mg0) pour la fabrication de briques et ciments réfractaires. On l'emploie aussi comme charge dans les plastiques pour retarder le feu.
Gisements au Québec: on trouve des gisements de brucite granulaire en Outaouais dans le secteur de Wakefield, à Bryson et sur l'île du Grand Calumet ainsi qu'au nord-ouest du lac Saint-Jean.
La brucite fibreuse se trouve dans les gisements d'amiante du sud du Québec (Asbestos, Thetford Mines, Black Lake).
42

CORINDON
Oxyde d'aluminium
Dureté: 9 de l'échelle de Mohs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Densité: 4 à 4,1
Composition à l'état pur: A1203
- Aluminium: 52,9% - Oxygène: 47,1%
Nom: du vieux terme indien kauruntake, pierre très dure, ou du tamoul corun-
dum.
Description: couleurs très variées. Poudre blanche ou très pâle. Éclat adamantin ou vitreux. Transparent, translucide ou opaque. Cassure inégale ou conchoïdale. Pas de clivage, mais plans de séparation. Les cristaux bien formés ont l'aspect de barillets à six côtés.
Caractères distinctifs: dureté très élevée, raye le verre et le quartz facilement, n'est rayé que par le diamant. La forme des cristaux a six côtés. Densité plus grande que la plupart des silicates.
Mode de gisement et associations: se trouve souvent dans les syénites, les syénites à néphéline et les pegmatites à néphéline. On le trouve aussi dans diverses roches métamorphiques: calcaires cristallins, schistes talqueux, etc.
Usages: les variétés limpides sont des pierres précieuses: le rubis (du latin rubeus, rouge) est du corindon rouge coloré par le chrome alors que le saphir (de
l'hébreu sappir, pierre bleue) est du corindon bleu coloré par du fer et du titane. Le corindon ordinaire sert comme abrasif (papier à poncer, sablage des métaux), mais son emploi a diminué à cause de la concurrence des abrasifs artificiels.
Gisement au Québec: rare. Se trouve en Abitibi dans les gneiss et pegmatites
à
néphéline affleurant sur la rive est et les îles du réservoir Cabonga.
43

n°13 HÉMATITE
Oxyde de fer
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 5 à 6
Densité: 5,2 à 5,3
Composition à l'état pur: Fe203
- Fer: 70% - Oxygène: 30%
Nom: du grec haimatos, sang (allusion au trait rouge).
Description: couleur gris d'acier à noir. Plus les grains sont fins, plus elle est rougeâtre. Trait rouge ou brun rougeâtre. Éclat métallique à sous-métallique. Cassure conchoïdale ou inégale. Pas de clivage, mais plans de séparation. Se trouve sous forme de masses compactes grenues, en lamines ou en lamelles brillantes ressemblant quelque peu au mica (variété «spécularite ») et en rosettes. Certaines variétés terreuses rouges sont ternes et ont une dureté apparente moins élevée.
Caractères distinctifs: couleur à l'état massif gris d'acier et couleur rouge du trait. Densité plus élevée que le mica noir (n° 30). L'absence de magnétisme la distingue de la magnétite (n° 17).
Mode de gisement et associations: très répandue. Les gisements importants, les seuls exploitables, sont généralement d'origine sédimentaire. On la trouve parfois en filons.
Usages: principal minerai de fer. La variété noire brillante, dit fer spéculaire (du latin speculum, miroir), sert de bijoux de deuil (colliers, bagues, camées et entailles).
Gisements au Québec: des gîtes considérables d'hématite spéculaire se trouvent dans la région de la Côte-Nord entre la localité de Fermont et l'ancienne ville de Gagnon. Plus au nord, dans le secteur de Schefferville, on trouve des gisements d'hématite à grain fin.
Des gîtes économiquement moins importants se trouvent en Estrie (cantons de Chester et de Cleveland) et à Gatineau (canton de Templeton).
Synonyme: oligiste.
44

ILMÉNITE
Oxyde de fer et de titane
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dureté: 5 à 6
Densité: 4,7 à 4,8
Composition à l'état pur: FeTiO3
— Fer:36,8% — Titane: 31,6% — Oxygène: 31,6%
Nom: des monts Ilmen en Russie où sont exploités d'importants gîtes.
• Caractères distinctifs: l'aspect granulaire et la couleur du trait noir la distin-
• guent de l'hématite (n° 13) et de le chromite (n° 18); l'absence de magnétisme la
• différencie de la magnétite (n° 17). Cependant, la magnétite qui l'accompagne
fréquemment en inclusions fines peut rendre l'échantillon faiblement magnétique.
• la trouve également dans les sables de lacs ou de rivières.
• Usages: principal minerai de titane, le fer comme sous-produit. Ce minerai sert
principalement dans la fabrication de l'oxyde de titane appelé «blanc de titane»,
• le pigment blanc utilisé dans les peintures. Sert à fabriquer des alliages anticor-
• rosifs utilisés dans l'aéronautique et les vaisseaux spatiaux. Aussi comme bioma-
tériaux dans les prothèses médicales et dentaires.
• Gisements au Québec: des massifs très riches en ilménite se trouvent sur la
• Côte-Nord dans le secteur du lac Allard (au nord de Havre-Saint-Pierre) et au lac
• Brûlé (près de Labrieville), dans les Laurentides dans le canton de Beresford (près
de Sainte-Agathe-des-Monts) et dans Charlevoix à Saint-Urbain. Beaux cristaux
• d'ilménite trouvés à Girardville au Lac-Saint-Jean.
• Description: couleur noir de fer. Trait noir. Éclat métallique ou sous-métallique.
Granulaire avec cassure conchoïdale ou inégale.
• Mode de gisement et associations: le plus souvent associée à des roches
• telles que les gabbros, les diorites, les anorthosites ou certaines pegmatites. On
•
•
•
•
•
•
• 45

n°15 PYROLUSITE
Dureté: 6 à 6,5 (en cristaux) 2 à 6 (à l'état massif)
Densité: 4,4 à 5,1
Composition à l'état pur: Mn02
- Manganèse: 63,2% - Oxygène: 36,8%
Nom: du grec puros, feu, et /usis, dissolution (allusion à la purification de la trans-parence du verre par oxydation au feu).
Description: couleur gris d'acier plus ou moins foncé. Trait noir. Éclat métallique à sous-métallique. Les cristaux montrent un clivage parfait, mais la cassure est inégale à l'état massif. En dendrites sur les parois des roches altérées et dans les agates. Les variétés tendres tachent les doigts et le papier. Non magnétique.
Caractères distinctifs: trait noir, non magnétique. Si tendre, elle tache les doigts.
Mode de gisement et associations: dans les filons, avec d'autres oxydes de manganèse et divers minerais métalliques. On la trouve aussi dans les roches sédimentaires et dans les nodules polymétalliques des fonds océaniques.
Usages: minerai de manganèse. Ce métal est employé en métallurgie dans de nombreux alliages, dans l'industrie du verre plat pour améliorer la transparence de la vitre, comme colorant dans les briques, le glaçage des poteries et des céramiques.
Gisements au Québec: associé aux gisements de fer près de Schefferville. On le trouve aussi aux Îles-de-la-Madeleine (Île du Cap-aux-Meules) et en Estrie dans le secteur du lac Saint-François.
Un autre minerai de manganèse, le psilomélane (appelé aussi wad ou manga-nèse des marais) se dépose dans les tourbières ou les zones marécageuses. Il peut contenir de petites quantités de baryum. Les endroits les plus remarquables sont situés au sud de Matane dans le canton de Saint-Denis, en Mauricie dans le secteur de Saint-Maurice et en Estrie dans le canton de Stanstead. Le psilomélane est généralement très impur.
46

Nom: du latin limus, boue (allusion à la boue ocre des marais).
• •
•
•
•
•
•
LIMONITE
Oxyde de fer hydraté
Dureté: très variable
• : "` . Densité: très variable
•
+t
Composition: sue. - p~ ~.
Fe0(OH) . nH2O • - ' ti (mélange de divers oxydes • f ::~- Y; de fer hydratés)
•
•
•
•
• Description: couleur ocre à brun plus ou moins foncé. Trait jaune ocre brunâtre, • parfois rougeâtre. Se trouve sous de nombreuses formes: en encroûtements,
stalactitique, botryoïde, réniforme ou massive (fig. 7). Éclat le plus souvent mat et • terreux, parfois sous-métallique. Certaines variétés très tendres s'écrasent entre • les doigts en les tachant de poudre jaune ocre.
• Gisements au Québec: se trouve en de nombreux endroits dans le sud du • Québec. La limonite a été exploitée comme minerai de fer dans la région de • Drummondville ainsi qu'en Mauricie, dans le secteur des Vieilles-Forges, au nord • de Trois-Rivières, et au lac à la Tortue.
•
•
•
•
•
• 47 •
Caractères distinctifs: couleur ocre brunâtre de la masse et du trait, éclat mat • et terreux. Des petits fragments chauffés dans une éprouvette produisent des
• gouttelettes d'eau sur les parois froides, les fragments deviennent brun foncé et • magnétiques.
Mode de gisement et associations: dans les dépôts secondaires résultant • de l'altération superficielle de gîtes d'hématite (n° 13) et de magnétite (n° 17) ou
• d'autres minéraux riches en fer. Autour des sources, dans les lacs et les marais.
• Usages: exploitée autrefois comme minerai de fer. La limonite argileuse ocre entre dans la fabrication des peintures.

n°17 MAGNÉTITE
Oxyde de fer magnétite
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 5,5 à 6,5
Densité: 5,2
Composition à l'état pur: Fe304
— Fer: 72,4% — Oxygène: 27,6%
Nom: de Magnes, nom d'un berger grec qui a découvert ce minéral qui collait par magnétisme aux clous de ses chaussures.
Description: couleur noire. Trait noir. Éclat métallique ou sous-métallique, parfois mat. Cassure inégale ou subconchoidale. Fortement magnétique. Se présente parfois sous forme de cristaux octaédriques (fig. 4B), le plus souvent en masses grenues.
Caractères distinctifs: magnétisme très fort (essayer avec un barreau aimanté ou un aimant en fer à cheval, une boussole ou une lame de canif aimantée), ce qui la distingue de l'ilménite (n° 14) qui est moins magnétique. Son trait noir la différencie de la chromite (n° 18) dont le trait est brun et qui est faiblement magnétique.
Gisement et associations: très répandue sous forme de gîtes en amas assez importants pour être exploitables ou accompagnant l'ilménite (n° 14) dans les sables noirs de lacs et de rivières. Aussi dans les formations de fer sédimentaire.
Usages: minerai de fer. La présence d'impuretés, comme le titane, le soufre, le phos-phore et la silice, en diminue la valeur. C'est l'hématite (n° 13) qui est le principal minerai de fer exploité au Québec.
Gisements au Québec: très répandue. Des gisements considérables se trouvent dans le Nord-du-Québec (Chibougamau, lac Albanel), en Abitibi-Témiscamingue (lac Waswanipi, canton de Vauquelin), au Saguenay—Lac-Saint-Jean (lac Matonipi, canton de Lyonne). On trouve aussi des gisements en Estrie (cantons d'Ascot, de Bolton et de Sutton) et en Outaouais (cantons de Bristol et de Hull, Grand lac Rond ou lac Roddick ). Des gîtes importants de magnétite titanifère se trouvent dans la région de la Côte-Nord (Sept-Îles, rivière Magpie) et dans les Laurentides (canton de Wexford).
48

CHROMITE
Oxyde de fer et de chrome
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 5,5
Densité: 4,5 à 4,8
Composition variable à l'état pur: FeCr204
— Fer: 25% — Chrome: 46,4% — Oxygène: 28,6%
Nom: du grec khrôma, couleur.
Description: couleur noire ou noir grisâtre. Trait brun. Éclat métallique à sous-métallique. Cassure inégale. Pas de clivage. Parfois faiblement magnétique. Géné-ralement en masses grenues.
Caractères distinctifs: se distingue de la magnétite par le fait qu'elle est très peu ou pas magnétique et par la couleur brune de son trait.
Mode de gisement et associations: se trouve presque exclusivement dans les roches basiques, telles que les péridotites et les serpentinites. Elle est souvent associée au pyroxène (n° 32), au grenat vert (n° 37), à la magnétite (n° 17) et à la pyrrhotite (n° 6).
Usages: excellent minerai de chrome quand elle contient un pourcentage suffi-sant de ce métal. La présence de fer en trop grande quantité ou celle de diverses impuretés dont l'aluminium en diminue la valeur. Sert, en métallurgie, dans la fabrication de l'acier inoxydable et du nichrome; dans l'industrie chimique pour préparer les chromates et l'acide chromique, le traitement du cuir et de la laine, dans les insecticides, les pigments verts et jaunes des peintures, des encres et des plastiques; sert aussi dans la fabrication de briques réfractaires et d'autres matériaux réfractaires.
Gisements au Québec: plusieurs gîtes ont été exploités par le passé en Estrie
dans les cantons de Coleraine, de Cleveland et d'Orford. On trouve aussi de la chromite en Gaspésie au mont Albert ainsi que dans les cantons de Weir et Awantjish. Des gisements ont aussi été trouvés sur le territoire de la Baie-James (lac Menarik et lac des Montagnes).
49

FLUORITE
Fluorure de calcium
Dureté: 4 de l'échelle de Mohs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Densité: 3,2
Composition à l'état pur: CaF2
- Calcium: 51,3% - Fluor: 48,7%
Cristallisation en cubes ou en octaèdres
Nom: du latin fluere, couler (allusion à la propriété de fondant).
Description: couleur variable: incolore, blanche, jaune, bleue, verte, violette, rouge, brune, etc. Le trait est incolore ou faiblement teinté: par exemple, un échan-tillon de fluorite violet foncé aura un trait violet clair. Éclat vitreux. Transparente ou translucide. Trois clivages parfaits (fig. 3D). Fragile. Thermoluminescente.
Caractères distinctifs: 'orme cubique (fig. 4A), parfois octaédrique (fig. 4B). Les clivages découpent des triangles plus ou moins équilatéraux (fig. 3D). Sa dureté peu élevée permet de la distinguer des pierres fines et précieuses.
Mode de gisement et associations: le plus souvent en filons, associée à la barite (n° 39), au quartz (n° 25), a la molybdénite (n° 10) ou aux minéraux de lithium (spoduméne n° 33).
Usages: utilisée comme flux (fondant) par les industries de l'acier, de l'aluminium, des verreries, des céramiques. Dans l'industrie chimique, pour la fabrication de l'acide fluorhydrique. Les variétés très pures et limpides entrent dans la construc-tion de certains instruments d'optique.
Gisements au Québec: signalée en faibles quantités en de nombreux endroits au Québec, notamment: en Abitibi dans le canton de Preissac (mine Cadillac Moly) et dans le canton de Montbeillard; en Outaouais dans le secteur d'Otter Lake et sur l'île du Grand Calumet; dans Charlevoix à Baie-Saint-Paul; en Mauricie à Montauban-les-Mines.
Synonyme: fluorine.
50

HALITE
Chlorure de sodium (sel gemme)
Dureté: 2,5
Densité: 2,16
Composition à l'état pur: NaCI
- Sodium :39,4% - Chlore: 60,6%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • • • Nom : du grec halos, sel.
• Description: se présente fréquemment en cristaux cubiques (fig. 4A). On la
• trouve également sous forme massive ou granulaire. Elle est soit incolore, soit
blanche ou grise, parfois rougeâtre à cause de la présence d'impuretés de sylvite
• (KCI) ou bleue à cause de sodium libre. Son éclat est gras. Trois plans de clivage
• parfaits (fig. 3B).
• Caractères distinctifs: fragile et transparente, clivage cubique parfait, saveur
salée et soluble dans l'eau. Elle colore la flamme en jaune.
• Mode de gisement et associations: la halite est formée dans des lits d'origine
• sédimentaire interstratifiés avec d'autres sédiments. On donne à ces lits le nom
• d'« évaporites». ils résultent de l'évaporation, au cours des périodes géologiques,
de l'eau de mer contenue dans des bassins salés et fermés. Associée à la sylvite
• (KCI) et au gypse (n° 40).
• Usages: comme sel de déglaçage des routes; dans l'industrie chimique pour la
• fabrication de l'acide chlorhydrique, du carbonate de soude, l'extraction du métal
sodium et du gaz chlore; dans l'industrie alimentaire pour la salaison des viandes
• et poissons et pour les aliments en conserve; dans le procédé de tannerie.
• Gisements au Québec: des gisements importants, dont celui de la mine Seleine,
• se trouvent en profondeur, sous les îles de la Madeleine.
•
•
•
•
•
•
• 51

n° 21 CALCITE Carbonate de calcium
Dureté: 3 de l'échelle de Mohs
Densité: 2,7
Composition à l'état pur: CaCO3
— Chaux (Ca0): 56% — Dioxyde de carbone
(CO2): 44%
Nom: du latin calx, chaux.
Description: généralement blanche, mais peut être incolore ou de couleurs très variées: grise, gris noirâtre, rose, bleue, brune. Trait blanc. Éclat vitreux ou vif en cristaux, mat si massive. Les cristaux ont trois clivages parfaits donnant des faces en forme de losange (fig. 3C, 4H). Le plus souvent translucide, parfois transparente et laissant voir une double image des objets observés au travers. Soluble avec effervescence dans l'acide dilué à froid. Peut être fluorescente.
Caractères distinctifs: effervescence vive sur le cristal ou la masse. La forme en losange des fragments de clivage et sa dureté moins élevée permettent de la distinguer du quartz (n° 25) et des feldspaths (n° 26 et 27). La double image, les angles des clivages à 105° et l'absence de goût salé la discernent de la halite (n° 20).
Mode de gisement et associations: les calcaires ordinaires et les marbres sont formés de calcite plus ou moins pure. On la trouve également dans diverses roches, dans les filons de remplissage et en association avec des minéraux métalliques.
Usages: la principale utilisation du calcaire est la fabrication du ciment. Elle sert également: à produire la chaux; dans les industries métallurgiques; comme neutralisant dans l'industrie chimique et des pâtes et papiers; en agriculture comme amendement. Utilisée aussi comme pierres concassées et de construction.
La variété parfaitement transparente, appelée « spath d'Islande», était utilisée dans les instruments d'optique (aujourd'hui remplacée par des polaroïds).
52

•
• Gisements au Québec: la calcite et surtout le calcaire sont très répandus dans
• les Basses-Terres du Saint-Laurent et les Appalaches.
• Des marbres à grain grossier, constitués de rhombes enchevêtrés de calcite, se
trouvent dans les assemblages sédimentaires de la Province de Grenville en
Outaouais (canton de Bouthillier), au Saguenay—Lac-Saint-Jean (Saint-Eugène-
• d'Argentenay, lac Dulain) et en Mauricie (canton de Polette).
• Sur la Côte-Nord, des veines de calcite pure se trouvent à la Grande Anse près de
Tadoussac, et aux Bergeronnes.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
• 53 •

MAGNÉSITE
Carbonate de magnésium
Dureté: 3,5 à 4,5
Densité: 3
Composition à l'état pur: MgCO3
— Magnésie (Mg0):47,8% — Dioxyde de carbone
(CO2) : 52,2%
Nom: de Magnésie, ville d'Asie Mineure.
Description: blanche, jaunâtre ou grisâtre. Trait blanc. Éclat vitreux en cristaux, éclat mat si massive. Clivages parfaits identiques à la calcite (n° 21, fig. 3C, 4H). Se raye au couteau.
Caractères distinctifs: ne réagit pas à l'acide dilué froid, mais est soluble avec effervescence dans l'acide chaud ou concentré. Les autres propriétés sont identiques à celles de la calcite (n° 21).
Mode de gisement et associations: se trouve le plus souvent dans certains schistes talqueux ou chloriteux, dans les serpentinites et dans les marbres dolomitiques.
Usages: sert à la fabrication de la magnésie (Mg0) obtenue par calcination. Utilisée dans les briques et ciments réfractaires, dans l'industrie chimique et comme source du magnésium métallique.
Gisements au Québec: des gisements de magnésite ont été exploités durant de nombreuses années à Kilmar dans la circonscription d'Argenteuil. D'importants gisements de magnésite sédimentaire se trouvent dans le secteur des monts Otish, au nord-ouest du lac Mistassini. En Estrie, dans les mines d'amiante de la région de Thetford Mines, on trouve de la breunnérite, une variété de magnésite ferrifère.
54

• • • • • • • •
SIDÉRITE
Carbonate de fer
Dureté: 3,5 à 4,5
Densité: 3,9
• Composition • à l'état pur: FeCO3
- Oxyde de fer (Fe0): • 62,1%
- Dioxyde de carbone • .. er' t (CO2): 37,9%
•
•
• • Description : couleur brun grisâtre, brune ou rougeâtre. Trait blanc ou faiblement
teinté jaune. Cristallisée, elle présente des clivages parfaits comme ceux de la
• calcite (n° 21, fig. 3C) et un éclat vitreux. Si massive, l'éclat est mat. Se raye au • couteau. Densité assez élevée. Soluble avec effervescence dans l'acide chaud.
Devient magnétique après chauffage.
• Usages: minerai de fer, mais rarement sous forme de gîtes suffisamment • importants.
• Gisements au Québec: on a signalé de la sidérite en Estrie à la mine Huntingdon
• (canton de Potton) ainsi que dans le Nord-du-Québec, à Chibougamau et dans le secteur du lac Albanel. Des beaux cristaux de sidérite ont été trouvés au mont
• Saint-Hilaire et à la carrière Francon à Montréal.
• • • • • • •
55
room: du grec sidéras, fer.
• Caractères distinctifs: sa couleur brune, ses clivages en losange, sa densité • relativement élevée et son association avec des minéraux d'oxydes de fer • hydratés [goethite, Fe0 (OH), limonite n° 16] permettent de la distinguer de la • calcite (n° 21), de la dolomite [CaMg(CO3)2] et de la magnésite (n° 22). L'effer-
vescence à chaud la différencie de la sphalérite (n° 4).
• Mode de gisement et associations: dans divers calcaires et schistes, associée • a des formations ferrifères, parfois dans les filons minéralisés; en beaux cristaux
avec la cryolite (Na3AIF6).

n°S 24 At 25
QUARTZ
Cristallisé, massif laiteux
Silice pure
Dureté: 7 de l'échelle de Mohs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Densité: 2,65
Composition à l'état pur: Si02
— Silicium: 46,7% — Oxygène: 53,3%
Nom: ancien terme allemand querertz, filon transversal.
Description: couleur très variable selon la présence d'impuretés: en cristaux incolores et parfaitement limpides (cristal de roche), blanc laiteux, violet (amé-thyste n° 49), jaune brunâtre (citrine), rouge (jaspe), bleu, etc. Trait incolore. Éclat vitreux. Transparent ou translucide. Pas de clivage. Cassure conchoïdale. Granulaire (n° 25), souvent en cristaux (n° 24) délimités par des prismes â six faces striées horizontalement, terminés en pointe par six autres facettes (fig. 4J, 5C).
Caractères distinctifs: dureté élevée, raye facilement le verre, parfois en prismes hexagonaux stries. Sa dureté moins élevée et la forme des cristaux le distinguent du diamant. Le quartz est rayé facilement par le corindon (n° 9 de l'échelle), tandis que le corindon ne raye pas le diamant.
56

•
• Mode de gisement et associations: c'est l'un des minéraux les plus répandus.
• Il entre dans la composition de nombreuses roches: le quartzite et le grès sont formés presque exclusivement de quartz. On le trouve aussi dans les roches
• ignées acides, les roches métamorphiques et les pegmatites. En veines ou en • filons, parfois avec minéraux métalliques.
• Usages: les cristaux limpides et purs étaient employés en optique, en horlogerie, dans les appareils d'ultrasons et les sonars; aujourd'hui, remplacés par des
• cristaux de quartz synthétiques.
• Les variétés limpides et colorées servent en joaillerie: améthyste (n° 49), citrine,
• quartz rose ou rutilé, morion (enfumé à noir), oeil-de-tigre, agates (no 52), etc.
L'opale est de la silice hydratée.
• Le quartz granulaire pur (n° 25) sert dans les industries de la céramique, de la • porcelaine, de la faïence, du verre plat et des contenants de verre. Entre dans la • fabrication du ferrosilicium (moteurs électriques), du carbure de silicium (abrasif),
du sable de nettoyage au jet, du papier de verre et dans les matériaux réfractaires.
• Utilisé aussi en sidérurgie.
• Gisements au Québec: importants gîtes de quartzite dans la Province de
• Grenville: dans Charlevoix (Petit lac Malbaie), dans les Laurentides (canton d'Amherst), dans Lanaudière (Saint-Donat) ainsi que sur la Côte-Nord (Fermont,
• Baie-Comeau, Forestville).
• Des gîtes de grès quartzitiques se trouvent dans les Basses-Terres du
• Saint-Laurent (Saint-Canut, Sainte-Clotilde-de-Châteauguay), au Témiscamingue (Guigues) et dans les Appalaches à Saint-Vianney (Bas-Saint-Laurent).
• Des veines de quartz renfermant de beaux cristaux de quartz se trouvent
• notamment en Estrie (cantons de Shefford et de Risborough) ainsi qu'au
• Lac-Saint-Jean (canton de Métabetchouan).

MICROCLINE
Feldspath potassique (silicate d'aluminium et potassium)
Dureté: 6 de l'échelle de Mohs
Densité: 2,55
Composition à l'état pur: KAISi308
— Potasse (K20): 16,93% — Alumine (A1203):
18,35% — Silice (Si02) : 64,72%
Nom: du grec mikros, petit, et klinein, incliner.
Description: couleur blanche, grise, beige, rose, verte (amazonite, n° 50), rouge. Trait blanc. Dureté assez élevée, suffisante pour dépolir le verre, mais rayé par le quartz (n° 24). Deux clivages parfaits a ± 90°, les faces de clivage ont un éclat vitreux et vit quelque peu nacré. Les autres cassures offrent un éclat mat de porcelaine brisée. Opaque ou translucide.
Caractères distinctifs: la forme des fragments de clivage et la dureté permet-tent de le distinguer des autres minéraux. Le microcline se différencie assez facilement des autres variétés de feldspath, comme le plagioclase, l'albite et le labrador, par sa couleur et l'absence de stries de macle polysynthétique sur les faces de clivage (fig. 6G et 6H).
Mode de gisement et associations: observé dans diverses roches ignées acides ou métamorphiques, mais les plus gros cristaux se trouvent dans les pegmatites.
Usages: le feldspath potassique entre dans la céramique, la porcelaine, les glaçures, la briqueterie et la verrerie. Dans les savons et poudres à nettoyer. La variété verte (amazonite, n,, 50) est une pierre fine utilisée en joaillerie.
Gisements au Québec: feldspath potassique très répandu, principalement en Outaouais dans les cantons de Derry, de Portland-Est, de Portland-Ouest, Buckingham, de Wakefield et de Templeton ainsi que sur la Côte-Nord à Baie-Johan-Beetz. D'autres gîtes sont signalés au Saguenay—Lac-Saint-Jean (Girardville), dans les Laurentides et dans Lanaudière.
58

• •
•
•
•
•
• • •
•
•
•
• • •
PLAGIOCLASE
Feldspath labrador
Dureté: 6 à 6,5
Densité: 2,7
Composition à l'état pur: 50% NaAISi308 et 50% CaAI2S1208 (silicate d'aluminium, de sodium et de calcium)
Nom: du Labrador.
Mode de gisement et associations: important constituant de diverses roches •
basiques. Souvent associé à l'olivine [(Mg,Fe)2SiO4], aux pyroxènes (augite n° 32),
• à. la biotite (n° 30) et à I'ilménite (n° 14).
• Usages: comme pierre architecturale utilisée en construction et comme pierres
ornementales. On recherche surtout les roches formées presque uniquement de
• feldspath labrador, les «anorthosites».
• Gisements au Québec: il existe de nombreux massifs de roches riches en
• labrador notamment: au Lac-Saint-Jean (Péribonka, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-
Nazaire); sur la Côte-Nord à Rivière-Pentecôte et au nord de Havre-Saint-Pierre;
• dans Lanaudière (canton de Lussier).
• • • • • • • • • 59
• Description : couleur généralement grise ou gris bleu à noir. Trait blanc. Montre
• parfois de beaux reflets bleutés, verdâtres et pourpres d'irisation interne (jeux
de couleurs). Deux clivages parfaits avec une des faces portant de fines stries
• parallèles de macle polysynthétique (fig. 6G, 6H).
• Caractères distinctifs: clivages parfaits, stries parallèles de macle, reflets irisés,
• dureté 6.

n° 28 TALC
Silicate de magnésium hydroxylé
Dureté: 1 de l'échelle de Mohs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Densité: 2,8
Composition à l'état pur: Mg3Si4010(OH)2
— Magnésie (Mg0): 31,7% — Silice (Si02): 63,5% — Eau (H20):4,8%
Nom: du mot arabe talq.
Description: couleur blanche, grise, vert plus ou moins foncé. Trait blanc. Clivage parfait donnant de fines paillettes flexibles avec éclat nacré; à l'état massif, l'éclat est cireux. Toucher gras comme du savon. Très tendre, se raye facilement à l'ongle. Le talc compact ou granulaire s'appelle stéatite ou «pierre à savon».
Caractères distinctifs: toucher gras, paillettes ou lamelles flexibles et non élastiques le différencient des micas (n°s 29 et 30).
Mode de gisement et associations: dans les roches magnésiennes comme certains schistes à phlogopite (mica ambré) ou talqueux, dans les dolomies et les serpentinites. Souvent associé à des variétés d'amphibole (trémolite), à l'olivine, la serpentine et la chlorite.
Usages: le talc a de très nombreux usages: matériel de charge dans la peinture, les lubrifiants, la pâte à papier, le caoutchouc, les cosmétiques, les textiles, les ma-tières plastiques, les carreaux de polyvinyle, matériel de support pour les insecti-cides et dans les céramiques.
On emploie la stéatite pour tailler des objets devant résister à la chaleur et aux acides ou en sculpture.
Gisements au Québec: on trouve des gîtes de talc et de stéatite associés aux serpentinites en plusieurs endroits dans les Appalaches. Les principaux gîtes se trouvent en Chaudière-Appalaches dans les cantons de Broughton, de Thetford et de Leeds ainsi qu'en Estrie dans les cantons de Bolton et de Potton.
60

• • • • • MUSCOVITE • Mica blanc
• Dureté: 2,5 à 3
• - Densité: 2,7 à 3
• Composition : • KAI2(AISi30ro)(OH)2
tip. (silicate d'aluminium et • de potassium hydroxylé)
•
•
•
• Nom: de verre de Muscovie, nom de la muscovite dans la vieille Russie.
• Description: transparente et claire en lamelles minces. Les livrets de lamelles
• sont translucides à opaques et de couleur gris clair ou brun clair à jaunâtre
selon l'épaisseur. Elle peut être verte (fuchsite). Brillante. Clivage parfait (fig. 3A)
• donnant de minces lamelles ou paillettes élastiques. Se présente parfois sous
• forme de feuilles de grandes dimensions.
• Caractères distinctifs: clivage parfait, couleur claire et élasticité. L'aspect en
paillettes brillantes ou en feuilles est caractéristique. Elle se distingue de la chlorite
• verte par sa transparence et l'absence de couleur et du talc (n° 28) par son toucher
• neutre et son élasticité.
• Mode de gisement et associations: présente dans un grand nombre de
roches: granites, schistes à micas, gneiss, etc. Parfois grandes feuilles dans
• certaines pegmatites.
• Usages: le mica muscovite en feuilles a de nombreux usages: isolant électrique
411, et thermique, matériel de charge dans les peintures, les plastiques, les panneaux
de gypse, les ciments à joints et le papier à tapisser.
• Gisements au Québec: dans Charlevoix (lac du Pied des Monts); sur la Côte-
• Nord (canton de Bergeronnes; en Abitibi (canton de Lacorne); au Témiscamingue
• (cantons de Boisclerc et de Campeau); au Saguenay (cantons de lonquiére, de
Taché et de Harvey); en Outaouais (canton de Villeneuve); dans Lanaudiére
• (Saint-Michel-des-Saints).
•
•
•
•
• 61
•

BIOTITE
Mica noir
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 2,5 à 3
Densité: 2,8 à 3,2
Composition: K(Mg,Fe)3AISi3010(OH)2 (silicate de potassium, de magnésium, de fer et d'aluminium hydroxylé)
Nom: en l'honneur de Jean-Baptiste Biot, physicien français.
Description: clivage parfait, éclat vitreux et vif. Les livrets de lamelles sont
opaques, de couleur noir à brun verdâtre sombre. Les minces lamelles (fig. 3A) sont translucides et présentent un aspect enfumé. Trait faiblement teinté verdâtre.
Les lamelles fraîches sont élastiques. Cependant, si elles sont passablement altérées, de teinte mordorée et transformées partiellement en vermiculite, elles sont alors flexibles. En paillettes ou en grandes feuilles.
Caractères distinctifs: clivage parfait, couleur sombre même en lamelles
minces, élastique à l'état frais. De teinte mordorée et souvent tachée d'oxydes de
fer lorsque altérée. Sa couleur noire et son toucher neutre la distinguent de la
chlorite (silicate de magnésium et de fer hydroxylé vert d'aspect micacé) et du
talc (n° 28). À ne pas confondre avec le stilpnomélane dont les lamelles minces
sont cassantes (non élastiques) et qui se présente généralement en touffes
aciculaires radiées.
Mode de gisement et associations: fréquente dans un très grand nombre de
roches: granites, schistes a micas, gneiss, pegmatites, etc.
Usages: aucun, sauf si intensément altérée en vermiculite.
Gisements au Québec: très répandue dans les roches précambriennes au nord du Saint-Laurent.
62

•
•
•
•
• ~ ~ • ~~ ~~~ CHRYSOTILE
• 4 Variété fibreuse de
• ~ ~ ~~ ~ serpentine, •
!Pi amiante ,~, blanc
• ~F'i' ~IF~ ±
' . ;~~
Dureté:2 a 3
• Densité: 2,3 à 2,5
• Composition : z Mg3Si205(OH)4
• — Magnésie (Mg0): 43% • — Silice (Si02): 44,1%
Eau (H20): 12,9%
•
• Nom: du grec khrusos, or et tila, plume.
• Caractères distinctifs: fibres très fines et souples, se plient sans qu'elles se • brisent, ce qui les différencie de la «némalite», une variété de brucite fibreuse • (n» 11). Toucher onctueux. On distingue assez facilement l'amiante chrysotile des
amphiboles fibreuses qui lui ressemblent: la trémolite se trouve sous forme • d'aiguilles très fines et cassantes, qui piquent les doigts; les fibres d'anthophyllite • et d'amosite sont brunes et celles d'actinote sont vertes, elles sont toutes
cassantes et ne s'effilochent pas. La crocidolite est bleue (appelée commercia- • lement «amiante bleu»).
• Mode de gisement et associations: il résulte de l'altération hydrothermale de • roches ultrabasiques, surtout celles qui renferment de l'olivine [(Mg,Fe)2SiO4] et
le pyroxène enstatite Mg(SiO3) (dunites et péridotites), souvent accompagné de • minéraux magnésiens : antigorite (serpentine massive), brucite (n° 11), magnésite • (n° 22); et un peu de magnétite (n° 17).
• Usages: nombreux usages: fabrication de tissus incombustibles, matériaux igni-fuges, industrie de la construction, fibrociment, amiante-ciment, joints thermiques
• de fusées spatiales, isolation contre le bruit, garnitures de frein, joints d'étanchéité, • filtres, etc. Les meilleures variétés sont les fibres transversales les plus longues
dans les filons.
• Description: généralement sous forme de fibres flexibles, faciles à séparer et à • effilocher. Couleur le plus souvent vert pâle, parfois jaunâtre, dorée ou grise. Éclat
soyeux. Les fibres ne brûlent pas.
• Gisements au Québec: une très grande portion de l'amiante chrysotile utilisé • dans le monde vient des régions de l'Estrie et de Chaudière-Appalaches (Thetford • Mines et Asbestos). On a également trouvé du chrysotile en Outaouais, en Abitibi- • Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec (Chibougamau, Asbestos Hill).
• • 63

• • • •
PYROXÈNE r ~` ~ • Augite ~ ~ .;~ ~~~ ~ r► • Dureté: 5 à 6 ` •
Densité: 2,8 à 3,7 -~ . ~ „~ ~. _~~~ti;=t ,A
•
• Composition: +~ • Ca(Mg,Fe,AI)(Si,Al2)06 + ;+> • (silicate de calcium,
rr. de magnésium, de fer :♦ ~ u • et d'aluminium) •
• •
Nom: pyroxène, du grec puros, feu, et xenos, étranger; augite, du grec auge, éclat. •
Description: généralement vert plus ou moins foncé, parfois gris, brun ou noir. • Trait blanc ou teinté vert pâle. Éclat vitreux. Les cristaux (fig. 4L) généralement • trapus présentent deux clivages parfaits qui se coupent à angle droit (90°); les faces de clivage sont brillantes. Plan de séparation mat. Translucide, devient plus • opaque et de densité croissante selon la teneur en fer. Il existe plusieurs espèces • au sein de la famille des pyroxènes: enstatite, hypersthène, diopside, augite, acmite (gyrine), jadéite, etc. •
Caractères distinctifs: forme des cristaux (fig. 4L). Les clivages à angle droit • permettent la distinction d'avec les amphiboles (n° 34). Plan de séparation. •
Mode de gisement et associations: les pyroxènes se trouvent dans de • nombreuses roches ignées, dans certaines roches comme les cipolins, les calcaires impurs recristallisés (marbres) et les carbonatites ainsi que dans les • roches riches en mica phlogopite. •
Usages: pratiquement pas d'usage, sauf pour certaines jadéites et enstatites • comme pierres fines en joaillerie.
Gisements au Québec: on trouve de beaux cristaux de pyroxène (diopside) • dans les anciennes mines de mica et d'apatite de la région de l'Outaouais. Il existe • aussi, en Estrie notamment, d'importants massifs de pyroxénite (roche formée • en majeure partie de pyroxène).
•
•
•
•
•
• 64
•

no 344
SPODUMÈNE
Pyroxène lithinifère
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dureté: 6 à 7
Densité: 3 à 3,2
Composition: LiAISi206
— Oxyde le lithium (Li02): 8,1% — Alumine (A1203): 27,4% — Silice (Si02): 64,5%
(silicate d'aluminium et de lithium)
Nom: du grec spodoumenos, réduire en cendres colorées.
• Description: couleur blanc grisâtre, vert pâle, vert jaunâtre, lilas ou rose. Trait
• blanc ou à peine teinté. Éclat vitreux. Clivages prismatiques à ± 90°. Plan de séparation. Dureté élevée, raye le verre. Se trouve souvent sous forme de • cristaux assez longs et aplatis. Parfois fluorescent. II colore la flamme en rouge.
• Caractères distinctifs: dureté élevée, clivages prismatiques à ± 90°, plan de • séparation, gros cristaux fréquents, couleur le plus souvent à reflet verdâtre ou
lilas. Colore la flamme en rouge.
• comme la lépidolite (mica rose ou lilas) et l'amblygonite (LiAIFP04).
• Usages: minerai de lithium. Le lithium sert en verrerie, en céramique, dans l'industrie chimique, les produits pharmaceutiques, dans la préparation de certains
• alliages légers et lubrifiants. Les variétés limpides lilas (la kunzite) et vert jaunâtre • (l'hiddénite) sont des pierres fines.
• Gisements au Québec: Des gisements de pegmatites à spoduméne se trouvent: en Abitibi dans les cantons de Lacorne, de La Motte et de Figuery (au nord de
• val-d'Or) ainsi que dans le canton de Montanier au sud de Cadillac; au Témisca-
• mingue dans le secteur du lac Simard; dans le Nord-du-Québec, dans le secteur
de la rivière Eastmain et au nord de Chibougamau (lac Moblan et lac Sirmac). •
• Mode de gisement et associations: on le trouve le plus souvent dans les
• pegmatites, parfois aussi dans les gneiss. Associé à d'autres minéraux de lithium
•
•
•
•
•
• 65

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 5 à 6
Densité: 3 à 3,4
Composition complexe: (Ca, Na)2 _3(Mg, Fe,AI)5 (SI,AI)8022(OH)2 (silicate de calcium, sodium, magnésium, fer hydroxyle)
Nom: amphibole du grec amphibolos, ambigu; hornblende de l'allemand horn, corne et blende, décevoir.
Description: composition et couleurs analogues à celles du pyroxène (n°32), mais hydroxylée. La hornblende commune est une amphibole vert foncé, presque noire. Les cristaux sont prismatiques ou aciculaires (fig. 7). Éclat vitreux. Trait faiblement teinté verdâtre. Clivages faciles à 124°. Le groupe des amphiboles comprend un très grand nombre d'espèces dont les plus fréquentes sont la hornblende commune (noire), la trémolite (blanche), l'actinote (verte). Certaines espèces sont asbestiformes, telles la crocidolite appelée «amiante bleu» et l'amosite appelée «amiante ferrifère ».
Caractères distinctifs: les clivages à 124° et l'aspect en prisme allongé, fibreux ou aciculaire permettent de distinguer les amphiboles des pyroxènes (n° 32), lesquels ont des clivages à 90° et sont le plus souvent courts et trapus. Les couleurs aident à différencier entre elles les espèces appartenant au groupe des amphiboles.
Mode de gisement et associations: dans un grand nombre de roches ignées et métamorphiques: granites, pegmatites, amphibolites et gneiss. Associées avec les plagioclases (n°27).
Usages: pas d'usage, sauf pour quelques variétés asbestiformes, telles la croci-dolite (amiante bleu), l'amosite (amiante brun ferrifère) et la néphrite (variété d'actinolite verte) qui est le jade de Chine.
Gisements au Québec: minéral très répandu dans les roches ignées et métamorphiques, notamment dans les collines Montérégiennes et les massifs de syénite du bouclier Laurentien.
66
AMPHIBOLE
Hornblende commune

• • • •
BÉRYL
• Silicate d'aluminium • et de béryllium
• Dureté: 7,5 à 8 • • f' - Densité: 2,65 à 2,9
• % Composition • à l'état pur: (Be3AI2Si6O18)
Silice (Si02): 67% • — Alumine (A1203): 19%
— Oxyde de • béryllium (Be0): 14%
•
• Nom: du grec bêrullos, minéral vert (allusion à l'émeraude).
• Mode de gisement et associations: surtout dans des veines de pegmatites • de même que dans certains micaschistes et gneiss.
• Usages: les variétés limpides servent en bijouterie, particulièrement la variété • verte (émeraude, n° 47). Le béryl ordinaire est employé pour la fabrication de
céramiques réfractaires et des fenêtres des tubes à rayons X. On l'utilise aussi
• comme source de béryllium. Ce métal très léger et à haut point de fusion entre
• dans la composition de divers alliages légers de cuivre et d'aluminium et dans la fabrication des sels de béryllium présents dans les tubes fluorescents. Il sert
• aussi dans les appareils informatiques et en aérospatiale. Cependant, le principal
• minerai de béryllium est la bertrandite (Be4Si 207(OH)2).
• Gisements au Québec: on a trouvé du béryl dans des pegmatites en plusieurs endroits: au Saguenay—Lac-Saint-Jean (cantons de Harvey et de Taché); dans
• Charlevoix près du lac du Pied des Monts; sur la Côte-Nord (cantons de
• Bergeronnes et de Johan-Beetz); dans les Laurentides près de Mont-Laurier; en Abitibi-Témiscamingue dans le canton de Lacorne et au nord du lac Simard.
•
• • • • 67
• Description: le plus souvent vert, parfois incolore, blanc, jaune doré ou bleu. Trait
• blanc. Éclat vitreux. Transparent, translucide ou opaque. Cassure inégale. Dureté élevée, raye facilement le verre. Se trouve en cristaux à six faces (fig. 4G). Les
• variétés limpides sont des pierres précieuses: émeraude (verte), aigue-marine • (bleu-vert), héliodore (jaune doré), morganite (rose).
• Caractères distinctifs: forme prismatique hexagonale. Sa dureté élevée permet de le distinguer de l'apatite (nr 38) et du spoduméne (n° 33).

TOURMALINE
Borosilicate d'aluminium complexe
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 7 à 7,5
Densité: 2,9 à 3,2
Composition complexe: (Na,Ca)(AI,Fe, Mg)(B03) Si6018(OH)4
Nom : tumali, gemmes du Ceylan en cingalais.
Description: couleur très variable, le plus souvent vert très foncé ou noire. Éclat vitreux. Assez fréquemment sous forme de baguettes allongées, cannelées ou striées. Si l'on regarde une baguette par le bout, elle a souvent un aspect plus ou moins triangulaire (fig. 5A). Cassure inégale ou conchoïdale. Le plus souvent noir opaque (le «schorl»), mais il existe des variétés limpides multicolores ou monochromes comme la « rubellite », de rose à rouge, la «dravite», de marron jaune à marron foncé, l'«indigolite», dans les tons de bleu.
Caractères distinctifs: cristaux allongés en baguettes, cannelés, avec coupe transversale triangulaire et dureté élevée.
Mode de gisement et associations: dans les pegmatites avec la microcline (n0 26), le quartz (n°° 24 et 25), le béryl (n°35), l'apatite (n°38), la fluorite (n0 19) et les minéraux de lithium (n 33). Dans certaines roches métamorphiques: schistes à tourmaline et gneiss. Dans certains filons de quartz aurifère.
usages: les variétés limpides sont utilisées en bijouterie, entre autres la rubellite rose à rougeâtre. Certains cristaux engendrent des charges électriques sous prés sion (piézo-électricité) et servent comme manomètre en balistique. Les variétés massives de tourmaline sont sans valeur.
Gisements au Québec: la tourmaline noire est très répandue, notamment dans les pegmatites du secteur de Buckingham en Outaouais, de Saint-Michel-des-Saints dans Lanaudière et de Baie-Johan-Beetz sur la Côte-Nord ainsi que dans plusieurs mines d'or en Abitibi. On a trouvé un peu de tourmaline limpide près de Saint-Pierre-de-Wakefield, en Outaouais.
68

• • • • • • • • • • • •
• •
•
n
GRENAT
Silicate d'aluminium, calcium, fer, etc.
Dureté: 6,5 à 7,5
Densité: 3,5 à 4,3
Composition variable: A3B2(SiO4)3
- A = Ca, Mg, Fe ou Mn - B = Al, Fe, Ti ou Cr
Nom: du latin granatum, grenade (fruit à grains).
• Description: groupe incluant plusieurs espèces qui se distinguent par leur • composition chimique, leur densité et leur couleur. Les plus fréquentes sont
rouges, les autres sont brunes, vertes, roses, jaune verdâtre, orange foncé, noires • ou plus rarement incolores. Dureté élevée, raye facilement le verre. Densité assez • forte. Éclat vitreux à adamantin. Opaque, parfois translucide ou transparent. Se
trouve souvent en cristaux de forme caractéristique dodécaédrique (fig. 4C). • Cassure conchoïdale, pas de clivages, parfois plan de séparation.
• Caractères distinctifs: forme des cristaux dont les faces sont souvent en petits • losanges (fig. 4C), aspect granulaire, cassure conchoïdale. La densité et la couleur
différencient les espèces du groupe des grenats.
• Mode de gisement et associations: dans diverses roches métamorphiques: • gneiss, schistes à biotite, calcaires cristallins, serpentinites ainsi que dans les • péridotites, les pegmatites et les sables de rivières.
Gisements au Québec: minéral commun dans de nombreuses roches de la • Province de Grenville. En abondance dans les gneiss des secteurs de Laniel • (Témiscamingue), de Rawdon et de Shawinigan ainsi que dans les skarns du
secteur d'Otter Lake en Outaouais. De beaux cristaux d'hessonite ont été • découverts dans les mines de chrysotile des régions de Thetford Mines et
• d'Asbestos.
•
•
•
• 69
• Usages: les variétés limpides servent en bijouterie, entre autres le «pyrope» (rouge vermillon), le «démantdide» (vert émeraude) et l'«hessonite» (orange
• foncé, couleur de cannelle). Le grenat ordinaire sert d'abrasif pour sablage à jet • ou avec papier.

APATITE
Phosphate de calcium luoré, chloré ou hydroxylé
Dureté: 5 de l'échelle de Mohs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Densité: 3,2
Composition variable: Ca5(F,CI,OH)(PO4)3 - Chaux (CaO): 53,8% - Oxyde de phosphore
(P2O5): 41,0% - Autres (F, Cl, H2O, c02): 5,2%
Nom: du grec apaté, tromperie.
Description: souvent verte, quelquefois blanche, grise, brunâtre, rougeâtre ou bleue. Trait blanc. Éclat vitreux. Cassure inégale. Fréquemment opaque, parfois translucide ou transparente. Soit en cristaux hexagonaux (fig. 4G), soit granulaire ou en encroûtement massif à texture saccharoïde. Parfois fluorescente.
Caractères distinctifs: forme hexagonale (fig. 4G). Sa dureté moins élevée permet de la distinguer du béryl (n` 35), auquel elle ressemble par sa forme et sa couleur, tous deux se trouvant associés aux mêmes gisements.
Mode de gisement et associations: dans les pegmatites où elle forme parfois de gros cristaux; dans les carbonatites; dans diverses roches métamorphiques, tels les schistes cristallins et les calcaires cristallins; dans certains filons. Souvent associée avec les amas d'ilménite et de magnétite titanifére dans les complexes de roches ignées.
Usages: comme source de P2O5 dans les superphosphates (engrais); dans l'industrie chimique pour la fabrication de l'acide phosphorique et des sels de phosphore. L'apatite vert limpide est vendue en joaillerie sous le nom de « pierre-asperge ».
Gisements au Québec: des cristaux d'apatite associés à de la calcite et de la phlogopite se trouvent un peu partout en Outaouais, notamment dans les cantons de Portland-Est, de Portland-Ouest, de Buckingham, de Hull, de Templeton et de Huddersfield. Plusieurs de ces gisements ont été exploités comme source de phosphate dans la seconde moitié du xixe siècle. Les très beaux cristaux d'apatite découverts dans ces gisements se trouvent dans des musées, un peu partout dans le monde.
L'apatite est aussi présente dans les carbonatites de Saint-Honoré (Lac-Saint-Jean), d'Oka et de Buckingham ainsi que dans les massifs d'anorthosite de la Côte-Nord et du Lac-Saint-Jean, associée aux minéralisations en fer et titane.
70

• • • n° 39 • • BARITE
Sulfate de baryum • • Dureté: 3
• Densité : 4,5
• Composition • ~w à l'état pur: BaSO4
• ;
- Baryte (Ba0): 65,7% - Trioxyde de
• soufre (SO3): 34,3%
•
•
• Nom: du grec barus, lourd.
• Description: couleur blanche, rougeâtre, jaunâtre, brunâtre. Trait blanc. Éclat • vitreux. Souvent opaque, parfois translucide ou transparente. Les cristaux pré-
sentent des clivages parfaits et l'éclat des faces de clivage est souvent nacré. • Densité élevée pour un minéral non métallique. Très friable.
• Caractères distinctifs: clivages parfaits des cristaux, densité élevée et sa • grande fragilité.
• Mode de gisement et associations: en couches ou en masses dans diverses roches sédimentaires (calcaires, schistes argileux et grès) ainsi que dans les
• carbonatites. Forme souvent des filons. Associée ou non avec des minéraux • métalliques: galène (n°3) ou sphalérite (n°4).
• Usages: sert principalement comme boues lourdes dans les forages de puits de pétrole. Elle sert également dans l'industrie chimique, comme charge dans la
• peinture, la verrerie, le caoutchouc et le papier ainsi qu'en radiologie médicale.
• Gisements au Québec: des veines de barite massive se trouvent dans le • Bas-Saint-Laurent à Saint-Fabien (MRC de Rimouski-Neigette), dans le canton de
Woodbridge (MRC de Kamouraska) et dans le canton de Tessier (au sud de Matane) • ainsi qu'en Outaouais (cantons d'Onslow, de Hull et de Buckingham). Gîte de barite • d'origine sédimentaire à Upton, en Montérégie. De gros cristaux de barite ont été
découverts au gîte de niobium de Saint-Honoré, au nord de Chicoutimi.
• Synonyme: barytine.
•
•
•
•
• • 71

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
40 GYPSE
Sulfate de calcium hydraté
Dureté: 2 de l'échelle de Mohs
Densité: 2,3
Composition à l'état pur: CaSO4 .2H20
— Chaux (CaO): 32,6% — Trioxyde de
soufre (SO3): 46,5% — Eau (H20): 20,9%
Nom: du grec gupsos, plâtre.
Description: blanc, parfois incolore, jaunâtre, gris ou rouge. Le plus souvent opaque, parfois translucide ou transparent («sélénite»). Trait Blanc. Dureté très faible; est rayé par l'ongle. Les cristaux ont un clivage parfait et un éclat vitreux, mais il est mat à l'état massif. Se trouve parfois à l'état fibreux.
Caractères distinctifs: sa très faible dureté, sa densité peu élevée, la forme des cristaux et l'absence d'effervescence le distinguent de la calcite (n('21). Chauffé dans une éprouvette, il produit abondamment des gouttelettes d'eau sur les
parois froides.
Mode de gisement et associations: se trouve le plus souvent dans les roches
sédimentaires, produit d'altération des sulfures.
Usages: sert à la fabrication du plâtre. On l'utilise aussi en agriculture. Il entre dans la fabrication du ciment et du mortier. L'« albâtre », utilisé comme pierre ornementale, est une variété de gypse à grain fin.
Gisements au Québec: dépôts aux îles-de-la-Madeleine, notamment sur l'île de Cap-aux-Meules et de Havre-aux-Maisons. Certains dépôts contiennent de l'albâtre qui est utilisé sur place pour la sculpture.
72

• • • • • • • • les et gemmes
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
M T8IIY RIOR1 PC
Métaux de grande valeur
n° 41 - OR NATIF
n°42-ARGENT NATIF
n° 43 - PLATINE NATIF
PIERRES PRÉCIEUSES Gemmes de grande valeur
n° 44 - DIAMANT
n° 45- RUBIS
n° 46 - SAPHIR
n° 47 - ÉMERAUDE
n° 48 - TOPAZE
DPFR Fc
Gemmes ornementales
n° 49 - AMÉTHYSTE
n° 50 - AMAZONITE
n° 51 - GRENATS
n° 52 - AGATES
n° 53 - JADE

Nom: du latin aurum, métal or.
• •
•
•
•
•
•
•
•
OR NATIF
Dureté: 2,5 à 3
Densité: 19,3 à l'état pur, peut être réduite jusqu'à 15,5 selon le type d'alliage naturel.
• Composition • à l'état pur: Au
•
•
•
• Description: couleur jaune d'or. Les variétés riches en argent (électrum) sont
• jaune clair et celles avec cuivre (cuproaurite) sont jaune laiton. Éclat métallique. • Trait jaune brillant. Très malléable et ductile. Densité élevée. Généralement en
masses compactes, pépites, paillettes ou grains. Aussi filiforme, dendritique ou
• arborescent. Rarement en cristaux dont la forme est octaédrique ou cubique.
• Caractères distinctifs: couleur jaune d'or, éclat métallique resplendissant, trait jaune opaque et brillant, dureté faible, très lourd, grande malléabilité, inaltérable
• à l'air, insoluble dans les acides sauf dans l'eau régale (mélange d'acides nitrique
• et chlorhydrique). Se distingue de la pyrite, de la chalcopyrite, de l'arsénopyrite et du mica jaune par son trait métallique jaune, sa faible dureté, sa grande malléa-
• bilité, sa densité très élevée et l'absence de clivage.
• Mode de gisement et associations: sous forme de pépites dans les dépôts
éluviaux et alluviaux appelés placers. En 1866, Archibald McDonald trouve
• une pépite de 45 onces dans la seigneurie Rigaud-De Vaudreuil, en Beauce. En • paillettes dans les sédiments des cours d'eau et dans des gîtes filoniens avec du
quartz. Il apparaît généralement à l'état natif, mais peut former des alliages
• naturels avec l'argent, le cuivre, les minéraux du groupe du platine, le sélénium et
• le bismuth. Il est souvent piégé à l'intérieur des minéraux comme la pyrite, la chalcopyrite et l'arsénopyrite. Il s'associe au tellure pour former la sylvanite
• (AuAgTe4) ou la calavérite (AuTe2).
• Usages: en bijouterie et en orfèvrerie. La teneur en or est exprimée en carats (un
• carat correspond à un vingt-quatrième de la masse totale d'or). Monnaies, feuilles de dorure pour décorer les oeuvres d'art et les bâtiments, vitraux, verrerie, placage
• de montres, stylos et robinetterie. Aussi utilisé dans les circuits électroniques, les ordinateurs, les téléphones cellulaires, les satellites et les DVD.
• veines de quartz.
•
•
75
• Gisements au Québec: en Abitibi (Val-d'Or, Rouyn-Noranda, etc.) et à la Baie-
• James. Le plus souvent très finement disséminé, l'or est parfois visible dans les

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ARGENT NATIF
Dureté: 2,5
Densité: 10,5 à l'état pur, peut augmenter jusqu'à 12 selon les impuretés.
Composition à l'état pur: Ag
Nom: du latin argentum, métal argent.
Description: couleur blanc argenté. Éclat métallique brillant en cassure fraîche, devient mat et noircit avec le temps. Trait blanc argenté brillant. Malléable, ductile, cassure dentelée. Densité élevée. Généralement en agrégats arborescents ou réticulés, aussi en fils enroulés, touffes fibreuses, dendrites, copeaux, feuillets flexibles, rarement en cristaux. Soluble dans les acides chlorhydrique et nitrique (HNO3), noircit en présence de l'hydrogène sulfuré (H2S) de l'air.
Caractères distinctifs: éclat métallique, couleur blanc argenté brillant devenant brun jusqu'a noir mat par exposition à l'air, trait blanc argenté, dureté faible, densité élevée, malléabilité, forme squelettique, réticulée ou filiforme, soluble dans HCI et HNO3. Il se distingue du platine natif (n° 43) par sa plus faible dureté, sa densité moindre, sa ternissure noire et sa solubilité dans les acides.
Mode de gisement et associations: le plus souvent dans les zones d'oxyda-tion des gîtes de sulfures et de minéraux d'arsenic, d'antimoine ou de bismuth; forme fréquemment un alliage avec l'or, le cuivre et le mercure; aussi associé à l'argentite (Ag2S) et aux sulfures de cobalt, nickel ou plomb. Un bloc de 612 kg a été trouvé à Cobalt, en Ontario.
Usages: en bijouterie, orfèvrerie, argenterie de table (alliage avec le cuivre), monnaies, comme conducteur électrique et thermique, industrie chimique anode et cathode, pharmacie et photographie argentique.
Gisements au Québec: signalé en Abitibi (cantons de Barraute, de Dalquier et de Duverny), au Témiscamingue (canton de Gaboury) et à la mine Selbaie (canton de Brouillan).
76

. • • n° 43 • • PLATINE NATIF
Dureté: 4 à 4,5
• Densité: 21,4 à l'état pur, • varie de 14 à 19 selon
les alliages naturels
• et les impuretés.
• Composition • à l'état pur: Pt
.
.
•
• Nom: de l'espagnol platina, signifiant argent.
• Description: couleur gris acier. Éclat métallique brillant. Trait gris pâle métallique. • Densité très élevée. Malléable et ductile. On le trouve en pépites, grains irréguliers,
rarement en cristaux. Magnétique, car il contient presque toujours du fer (4 à • 10%). Inaltérable dans la nature. Insoluble dans les acides sauf dans l'eau régale • (mélange de HCI et de HNO3).
• Caractères distinctifs: densité très élevée, magnétique, malléable et ductile. Il diffère de l'argent natif par sa dureté plus élevée, son inaltérabilité (absence
• de ternissure brune ou noire), son insolubilité dans HCI ou HNO3, son infusibilité • (point de fusion 1769 °C).
• Mode de gisement et associations: sous forme de pépites ou d'agrégats granulaires dans les dépôts alluvionnaires (placers), souvent avec l'or; dans les
• roches ignées ultrabasiques (dunites), en association avec les gisements de cuivre, • de nickel ou de chromite.
• Usages: dans l'industrie chimique et pétrochimique comme catalyseurs, pots d'échappement des automobiles, creusets, électrodes, filages résistifs des fours
• de haute température, thermocouples, instruments chirurgicaux, joaillerie et • placage.
• Présence: Sudbury, en Ontario
Gisements au Québec : le platine est associé au nickel dans les gîtes de Raglan • (Nord-du-Québec) et du lac Renzy (Abitibi).
•
•
•
•
• 77
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DIAMANT
Dureté: 10 de l'échelle de Mohs
Densité: 3,5
Composition à l'état pur: C
Nom: du grec diaphanès, transparent et adamas, invincible.
Description: habituellement incolore ou jaune pâle, parfois avec une teinte de
bleu, rose, rouge, orange, brun ou noir grisâtre (bort ou diamant noir). Taillé, il
présente un éclat vif adamantin, non taillé, l'éclat est gras. Dispersion forte de la
lumière responsable du scintillement (les feux) des pierres taillées. Dureté excep-
tionnellement élevée, 150 fois celle du corindon (n° 12), c'est le plus dur de tous
les minéraux. Cristaux à faces octaédriques incurvées, clivage parfait suivant les
faces de l'octaèdre. Insoluble dans les acides et les bases.
Caractères distinctifs: le diamant naturel se distingue du quartz par sa dureté
1000 fois supérieure, sa forme octaédrique commune à faces courbées, son
clivage parfait, sa densité plus élevée et son indice de réfraction beaucoup plus
grand (2,4). Les gemmologistes se servent d'un instrument de mesure de la
conduction thermique pour distinguer le diamant du quartz, du zircon et des
verres plombés.
Mode de gisement et associations: soit disséminé dans les placers (dépôts
d'alluvions) en raison de son inaltérabilité, de sa dureté et de sa densité supé-
rieures aux autres minéraux alluvionnaires, soit dans les roches ultrabasiques
d'origine profonde (150 à 200 km), les pipes de kimberlite et les lamproïtes, en
associations avec la chromite, le grenat rouge (pyrope), le pyroxène vert (diopside
chromifère), le spinelle chromifère et l'ilménite magnésienne (geikielite).
Usages: les principaux usages sont industriels (75%) pour couper le verre, la
pierre, la maçonnerie, les métaux et les pierres précieuses. Des pâtes diamantées
servent au polissage des métaux, des pierres architecturales et de pierres gemmes dures.
78

•
• En joaillerie, le diamant est la pierre précieuse la plus importante. Sa valeur
• dépend généralement de quatre propriétés (les 4 C): le nombre de carats (un carat = 0,2 g); la coupe responsable du scintillement (les feux); la clarté,
• l'absence de défauts, de givres et de matières charbonneuses; la couleur, variant
• d'incolore à jaune d'or, bleue, rose rouge, orange, verte. Elle peut être intensifiée • artificiellement par irradiation avec une source d'énergie nucléaire (comme le
cobalt radioactif).
• Gisements au Québec: des kimberlites diamantifères ont été découvertes dans • le secteur des monts Otish (Nord-du-Québec).
•
0
0
•
•
•
•
•
•
0
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
• 79 •

n° 45 RUBIS
Dureté: 9, varie selon la direction
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Densité: 4
Composition à l'état pur: Al2O3
plus traces de chrome
Nom: du latin rubeus, rouge.
Description: variété rouge foncé et limpide de corindon (voir n°12), la teinte rouge sang-de-pigeon est la plus recherchée. Le chrome à l'état de trace est responsable de la couleur rouge. Florescence rouge carmin. Taillé, l'éclat est adamantin. Aucun clivage. Les inclusions de rutile peuvent produire dans les coupes en cabochon des rayons lumineux à six branches (astérisme).
Caractères distinctifs: il se distingue des grenats rouges (pyrope et almandin, n°37), du spinelle rouge, de la tourmaline rubellite et des verres synthétiques rouges principalement par sa dureté plus élevée (9), l'astérisme des cabochons, le pléochrôisme (changement de couleur suivant l'orientation de la pierre). Les rubis naturels non taillés forment des cristaux à six côtés.
Mode de gisement et associations: voir n° 12, corindon.
Usages: joaillerie, incrustations en orfèvrerie, pivots dans les montres mécaniques et instruments techniques, lasers.
80

SAPHIR
Dureté: 9
Densité: 4
Composition à l'état pur: A1203
plus traces de Fe et de Ti
Nom: de l'hébreu sappir pierre bleue.
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • Description: variété bleue et limpide de corindon (no 12). La couleur la plus • recherchée est le bleu bleuet qui est dü à la présence en trace de fer et de titane.
L'aspect trouble ou givré de certains saphirs naturels disparaît par traitement • thermique (1700-1800 °C). Tout comme le rubis, le saphir taillé en cabochon • montre l'astérisme à six branches.
• Caractères distinctifs: le saphir se distingue de la cordiérite, de la kyanite, du spinelle bleu, de la topaze bleue (n° 48), du lapis-lazuli et des verres teintés par sa
• dureté plus élevée, l'astérisme des cabochons et le pléochroïsme.
• Mode de gisement et associations: voir n°12, corindon.
• usages: joaillerie et incrustations en orfèvrerie.
• Gisements au Québec: on a rapporté la présence de minuscules saphirs dans • les gisements de magnésite près de Kilmar.
• • • •
•
•
•
•
•
•
• 81

•
• • •
• •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ÉMERAUDE
Dureté: 7,5 à 8
Densité: 2,67 à 2,78
Composition à l'état pur: Be3(AI,Cr)2Si6018
Nom: du grec smaragdos, signifiant briller.
Description: variété vert foncé et limpide de béryl (voir n0 35). Le plus précieux des béryls, les autres variétés sont l'aigue-marine, bleue à bleu-vert, la morganite, rose à rose violacée, et l'héliodore, jaune d'or.
Caractères distinctifs: l'émeraude diffère de l'apatite, du diopside vert, du péridot et des verres synthétiques par sa dureté plus élevée, du grenat vert par sa forme à prismes hexagonaux ainsi que de l'aventurine verte (inclusions lamel-laires de fuchsite) et du jade (n° 53) par sa couleur vert profond et sa limpidité.
Mode de gisement et associations: voir n'' 35, béryl.
Usages: joaillerie et pierres incrustées dans les oeuvres d'art sacré et
d'orfèvrerie.
Gisement au Québec: on a rapporté des petits grains d'émeraude dans un échantillon de pegmatite provenant des environs du gisement d'or Éléonore, à
la Baie-James.
82

Nom: du grec Topazion, une île de la mer Rouge.
• • • • • • •
n° 48 TOPAZE
Dureté: 8 de l'échelle de Mohs
• // Densité:3,5
• Composition • à l'état pur:
AI2SÎO4(F,OH)2
•
•
•
•
•
• Description: éclat vitreux. Couleurs variables: incolore, bleue, rose, la plus ré- • pandue étant le jaune tirant sur l'orange. Trait blanc. Transparente à translucide. • Clivage basal parfait. Cassure conchoïdale. Cristaux prismatiques. Dans les
pegmatites, en association avec l'amazonite et la tourmaline.
• Caractères distinctifs: à ne pas confondre avec le quartz jaune citrin et lamé- • thyste rendue jaune par chauffage (sans clivage, prismes hexagonaux).
• Usages: en joaillerie.
• Gisements au Québec: on aurait trouvé de la topaze à la mine Lac à la Mine (canton de Taché) au Saguenay.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 83

AMÉTHYSTE Variété de quartz
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 7
Densité: 2,65
Composition: SiO2
plus traces de fer liées à des irradiations naturelles
Nom: du grec a, privatif et methustês, ivrogne.
Description: variété de quartz (voir n' 24) de couleur violet pourpré, devenant
jaune si chauffée à plus de 450 °C. Trait blanc. Éclat vitreux. Transparente à
translucide. Cristaux à prismes hexagonaux (fig. 4i). Sans clivage et cassure
conchoïdale. Les plus beaux cristaux se trouvent dans les géodes et les filons de
pegmatite.
Caractères distinctifs: a ne pas confondre avec la fluorite violette (dureté 4,
formes cubique ou octaédrique, fig. 3D et 4B), la tourmaline violacée ou la rubellite
(prismes allongés à section triangulaire et stries longitudinales, fig. 5A) et le verre
coloré (dureté inférieure à 7).
Usages: variété de quartz la plus recherchée. Les cristaux sont taillés à facettes
mixtes ou en baguette, façonnés en objets décoratifs, polis au tonneau en boules
pour collier ou en cabochons vendus en joaillerie.
Gisements au Québec: à la mine Fédéral (canton de Lemieux) en Gaspésie.
84

AMAZONITE
Variété de
microcline
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 6 à 6,5
Densité: 2,57
Composition à l'état pur: KAIS1308
Nom: du fleuve Amazone, Amérique du Sud.
Description: variété de microcline (voir n°26) de couleur vert pâle à vert bleuté disparaissant si chauffée à plus de 300 °C. Trait blanc. Éclat vitreux. Souvent opaque. Cristaux prismatiques (fig. 4L). Clivage parfait. Généralement parcourue de fines veinules blanches d'albite (perthite). Minéral fréquent dans les pegmatites.
Caractères distinctifs: à ne pas confondre avec le jade (absence de clivage, agrégats de grains fins ou de fibres entremêlées, n° 53), la serpentine (dureté 2,5, absence de clivage, éclat et toucher gras) ou la turquoise (sans clivage).
Usages: polie au tonneau en boules pour collier, cabochons, façonnée en petits objets d'art, peu utilisée en sculpture à cause de son clivage parfait.
Gisements au Québec: au Lac-Saint-Jean dans le canton de Saintonge (au nord de Saint-Ludger-de-Milot); au Témiscamingue (lac Sairs); en Outaouais près des localités de Saint-Pierre-de-Wakefield (carrière Lachaine) et de Blue Sea Lake.
85

COMPOSITION NOM COULEUR
Pyrope
Almandin
Démantoïde
uvarovite
Grossulaire
Rouge feu
Rouge violacé
vert émeraude
vert émeraude
incolore à jaune-orangé (cannelle)
Mg3Al2(SiO4)3
Fe3Al2(SiO4)3
Ca3Al2(SiO4)3
Ca3Cr2(SiO4)3
Ca3Al2(SiO4)3
GRENATS Variétés rouges, vertes, incolores et jaune brunâtre
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 6,5 à 7,5
Densité: 3,4 à 4,3
Composition : voir description.
Nom: du latin granus, grain ou granatum, grenade, dont les fruits sont rouges.
Description: famille de minéraux de couleurs diverses (voir n°37). Éclat
adamantin. Translucide. Trait blanc ou faiblement teinté. Sans clivage. Cassure
conchoïdale. Forme dodécaédrique (fig. 4C). Les grenats les plus fréquents sont:
L'hessonite est une variété de grossulaire de couleur jaune-orangé (cannelle).
Caractères distinctifs: ne pas confondre les grenats rouges avec le rubis
(dureté 9), le spinelle rouge (dureté 8) et la tourmaline rubellite (coupe trian-
gulaire, fig. 5A) ainsi que les grenats verts avec l'émeraude (densité 2,7, prismes
hexagonaux, m47).
Usages: il est taillé en facettes pour bijoux et pierres décoratives, poli en cabo-
chons ou en boules pour collier et boucles d'oreilles.
Gisements au Québec: hessonite à la mine Jeffrey à Asbestos; uvarovite à la
mine Orford Nickel (canton d'Orford).
86

• • • • • • • • • • • • • • •
AGATES
Dureté: 6,5 à 7
Densité: 2,60
Composition: SiO2
plus diverses impuretés
Nom: du grec Akhatés, cours d'eau de Sicile.
• Description: l'agate est constituée de couches concentriques de calcédoine
• (agrégat de petits cristaux de quartz microscopiques ou submicroscopiques),
chaque couche individuelle étant caractérisée par une couleur déterminée et une
• épaisseur constante. Éclat vitreux ou cireux. Trait blanc. Opaque à translucide. Sans
• clivage. Cassure irrégulière. Elles se forment en masses nodulaires ou boules
remplissant des cavités dans les roches volcaniques. Le centre est souvent tapissé
• de cristaux de quartz incolore ou laiteux. Les agates qui sont translucides et qui
• présentent des dendrites ou des figures évoquant des fougères ou des paysages
sont appelées «agates arborisées ou agates paysages», tandis que celles avec
• inclusions de chlorite sont dites »agates mousses».
• Caractères distinctifs: à ne pas confondre avec les gemmes rubanées dont le
• marbre onyx (dureté 3 à 4) ou l'albâtre (gypse de dureté 2).
• Usages: dans la fabrication d'objets d'art et de parures en bijouterie. Dans
l'industrie des pierres gemmes, les agates naturelles grises sont généralement
• traitées avec des teintures de couleurs vives, lesquelles sont absorbées Biffé-
• remment selon la porosité des couches concentriques. Exemples de colorants:
l'oxyde de fer pour le rouge; le ferrocyanure de potassium pour le bleu; le chlorure
• de fer pour le jaune; les sels de chrome ou de nickel pour le vert.
• Gisements au Québec: en Gaspésie, dans les roches volcaniques du mont Lyall
• et du montTuzo et en plusieurs endroits sur les plages de la baie des Chaleurs.
• • • • • 87 •

JADE
Jadéite et néphrite
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté: 6,5 à 7
Densité: 2,9 à 3,3
Composition:
- Jadéite: NaAI(Si2O6) - Néphrite:
Ca2(Mg,Fe)5(Si401 1)2(OH)2
Description: le nom jade est utilisé indifféremment pour désigner deux minéraux fibreux, le pyroxène jadéite et l'amphibole néphrite. Couleur vert pomme à vert émeraude. Éclat vitreux pour la jadéite et huileux pour la néphrite. Opaque à translucide. Trait blanc. Aucun clivage. Cassure granuleuse ou feutrée. Tenace en raison de l'enchevêtrement compact des fibres.
Caractères distinctifs: la texture fibreuse ou granulaire et la ténacité du jade permettent de le distinguer de l'émeraude (n°47) et de l'amazonite (n°50).
Usages: objets d'art décoratifs, sculptures, vases, bijoux.
Gisements au Québec: dans certaines mines d'amiante de la région de Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches.
88

•
•
•
• RÉSUMÉ DES PRINCIPALES • CARACTÉRISTIQUES • D'IDENTIFICATION
•
• Avant d'essayer d'identifier les minéraux qu'il découvrira lors de ses excursions,
• le débutant fera bien de s'exercer à reconnaître les caractères des échantillons de la collection vendue par le Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
• ([email protected]) en procédant comme suit:
• • éclat • examiner l'aspect que présente une cassure fraîche du minéral sous une
lumière vive (voir page 5).
• • couleur
• détacher un petit fragment du minéral et observer la couleur de la cassure
• fraîche (voir page 5).
• trait • frotter le minéral sur la plaque de porcelaine qui accompagne la collection
• (voir pages 6 et 7).
• • dureté • essayer de rayer le minéral avec des substances de dureté connue (voir
pages 8, 9 et 10).
• • sectilité • essayer de couper le minéral avec un couteau (voir page 11).
• • densité soupeser le minéral dans la main, puis faire de même avec des échantillons de même grosseur et de densité connue (voir pages 11 et 12).
• clivage • frapper légèrement le minéral avec un marteau ou, s'il montre des stries,
appuyer la lame d'un couteau parallèlement à celles-ci (voir page 13).
• minéral avec une lame de couteau aimantée (voir page 24).
•
•
•
•
•
•
• 89
•
• • magnétisme • approcher l'échantillon d'une boussole ou essayer d'attirer un petit grain du

On continuera de s'exercer avec des minéraux connus jusqu'à ce que les obser-vations faites concordent avec les descriptions données dans le présent guide. On pourra alors utiliser les tables de détermination. Pour s'en servir adéquate-ment, on fera bien de se rappeler les conseils et observations ci-après:
1. Les principales divisions des tables reposent sur les caractères suivants: éclat, couleur de la poussière (trait), couleur de la masse, dureté, densité et clivage. Autant que possible, on devra déterminer tous ces caractères avant de se reporter aux tables pour identifier un minéral. Il est utile de noter les propriétés observées sur une fiche d'identification (voir pages 123, 124 et 125).
2. La plupart des minéraux non métalliques ont un trait blanc ou faiblement teinté et presque tous les minéraux métalliques ont un trait nettement coloré.
3. La connaissance de la dureté et de la densité des minéraux permet souvent de tirer des conclusions utiles sur leur composition ou sur leur nature (voir pages 8 à 11). En particulier, la distinction entre minéraux légers et mi-néraux lourds est très importante.
4. Les caractères de plusieurs minéraux peuvent varier de façon notable. Ainsi, la sphalérite peut être noire, brune ou jaune; le clivage parfait de la stibine, de la pyrolusite, du gypse et de la barite, facile à observer quand ces miné-raux forment des cristaux, est souvent très difficile à reconnaître quand ils se trouvent à l'état massif. En règle générale, les caractères d'un minéral sont plus faciles à observer quand celui-ci se trouve sous forme de cristaux. Pour ces raisons, on trouvera des mentions de certains minéraux à plusieurs endroits dans les tables de détermination.
5. Il ne faut jamais tenter d'identifier un minéral d'après un seul caractère, car la conclusion risque d'être fausse. Ainsi, à cause de leur couleur et de leur éclat, on confond parfois la pyrite, la chalcopyrite et le mica jaune avec l'or. Le tableau qui suit montre qu'il faut déterminer plusieurs caractères avant de pouvoir dire auquel de ces quatre minéraux l'on a affaire.
90

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Comment différencier l'or natif, la pyrite,
la chalcopyrite et le mica jaune
CARACTÈRES OR PYRITE CHALCOPYRITE MICA JAUNE
Éclat Métallique Métallique Métallique Vif
Couleur Jaune Jaune Jaune Jaune ou bronzée
Trait Jaune Noir Noir verdâtre Blanc
Dureté et Tendre: peut Très dure: Assez tendre: sectilité se rayer et ne se raye se raye au Assez tendre
se couper pas au couteau au couteau couteau sans se couper
Si on le frappe Le minéral Le minéral Le minéral Le minéral à coups s'aplatit est réduit est réduit se brise de marteau en poussière en poussière en donnant
de petites paillettes
Densité Très lourde Lourde Lourde Légère
Clivage Pas de Pas de Pas de Clivage clivage clivage clivage parfait
9 I


• • • • , TABLES DE DÉTERMINATION • • • • Classification générale des tables de détermination
• En premier lieu, les minéraux sont classifiés, dans les tables de détermination, en trois classes, I, Il et Ill, d'après leur éclat et la couleur du trait. Ensuite,
• ils sont groupés selon leur dureté en deux groupes, A et B. Les autres
• subdivisions sont basées sur la couleur de la masse, la densité et le clivage.
• • I❑ Minéraux à éclat métallique ayant un trait coloré
• • B. Difficiles à rayer ou non rayables avec une pointe d'acier
• (voir page 98)
• • Il Minéraux à éclat sous-métallique ou non métallique • ayant un trait coloré • • A. Faciles à rayer avec une pointe d'acier
(voir page 100) • • B. Difficiles à rayer ou non rayables avec une pointe d'acier
• (voir page 102)
• • Minéraux à éclat non métallique ayant un trait blanc • ou faiblement teinté
• A. Faciles à rayer avec une pointe d'acier
• (voir page 103) • • B. Difficiles à rayer ou non rayables avec une pointe d'acier
• (voir page 108)
• 93 •
• • A. Faciles à rayer avec une pointe d'acier
(voir page 95)

L'échantillon n° 3 a un éclat métallique; si on le frotte sur la plaque de porcelaine, il laisse une trace grise. Il appartient donc à la classeIQ (minéraux à éclat métallique ayant un trait coloré). On le raye facile-ment avec la lame d'un canif, ce qui le place dans le groupe A (faciles à rayer avec une pointe d'acier). Il a une couleur grise. Sans essayer de mesurer sa densité, on constatera, en le soupesant, qu'il est plus lourd que la pyrite (échantillon n° 8, densité 5). Si on le frappe légèrement avec un marteau, il se brise en donnant de petits fragments brillants à aspect cubique (clivage facile et parfait). Ces propriétés sont celles de la galène (comparer avec la description de ce minéral, page 33).
L'échantillon n° 16 ne possède pas d'éclat métallique; il ne fait donc pas partie de la classe I❑. Si on le frotte sur la plaque de porcelaine, il laisse un trait jaune-brun; par conséquent, il appartient à la classe II (minéraux à éclat non métallique et ayant un trait coloré). On constate qu'on le raye facilement avec la pointe d'une lame de canif (groupe A). On vient de voir que son trait est jaune-brun; il peut donc s'agir de sphalérite, de manganite ou de limonite. Comme la couleur du minéral est brun jaunâtre, ce n'est pas de la manganite; comme il ne possède pas de clivage et qu'il a un éclat mat, ce n'est pas de la sphalérite. L'échantillon n° 16 est donc de la limonite (comparer avec la description de ce minéral, page 47).
L'échantillon n° 24 n'a pas d'éclat métallique; il est incolore et sa poussière est blanche. Il appartient, par conséquent, à la classe (minéraux à éclat non métallique et ayant un trait blanc ou faiblement teinté). Il n'a pas de clivage et possède un éclat vitreux. En le frottant sur un morceau de verre, on constate qu'il raye facilement ce dernier; par contre, il est rayé par l'échantillon de corindon (n°12) qui a pour dureté 9. Le minéral n'est donc pas du diamant, puisque la dureté du diamant est 10. Comptons les faces du cristal; il possède six faces formant un prisme hexagonal et six autres faces formant une pyra-mide. Ces caractères sont ceux des cristaux de quartz (comparer avec la description des cristaux de quartz, page 56).
94

•
•
•
• , TABLES D'IDENTIFICATION
• DES PRINCIPAUX MINÉRAUX
•
•
• n Minéraux à éclat métallique ayant un trait coloré
• À l'exception du graphite, cette classe est constituée entièrement de miné- • raux métalliques ayant une densité élevée.
• A. Faciles à rayer avec une pointe d'acier
• • Minéraux jaunes, jaunâtres ou jaune bronzé
• Couleur jaune d'or. Trait jaune brillant sur la plaque • de porcelaine. Sectile et malléable.
Très lourd. Or natif/41 • BIJOUX, MONNAIE
• Couleur jaune laiton pâle à jaune bronzé. Parfois ternissure • grise irisée. Trait noir verdâtre. Cristaux aciculaires, radiés • ou en touffes chevelues. Millérite
• Couleur jaune laiton foncé, parfois irisée. Trait noir verdâtre. • Cassure inégale. Non magnétique. Le plus souvent en masses • sans forme définie. Chalcopyrite
MINERAI DE CUIVRE
• Couleur jaune laiton à bronze. Trait noir. Cristaux tabulaires, striés,
• parfois regroupés par quatre ou six en rosette. Cassure irrégulière. • Massif. Fortement magnétique. Cubanite
• Couleur bronze brunâtre, parfois irisée. Trait noir. Généralement • massif. Cassure inégale. Plus ou moins magnétique, les petits • grains sont facilement attirés par l'aimant. Pyrrhotite/6
Pseudoclivage et non magnétique. Pentlandite • MINERAI DE NICKEL
• Minéraux rouges ou rougeâtres
• • Couleur rouge bronze sur cassure fraîche devenant
facilement pourpre ou bigarrée par ternissement. • Trait gris noir. Généralement à l'état massif. Cassure inégale. Bornite
•
• 95 •

•
•
• Couleur rouge cuivre sur cassure fraîche. Souvent ternissure • brune ou noirâtre. Trait rouge cuivre brillant sur la plaque de porcelaine. Sectile et malléable. Se coupe au couteau • en donnant des copeaux. Cuivre natif/2 •
Couleur rouge-brun à rouge foncé. Si transparent, • rouge rubis et éclat métallique-adamantin. Trait rouge • brunâtre. Massif, capillaire ou en cristaux cubiques. Cassure conchoïdale, irrégulière. Cuprite •
Minéraux gris de plomb ou bleus •
• Couleur gris foncé, souvent avec reflets bleus ou verts. • Trait gris foncé ou noir. Légèrement sectile. Cassure conchoïdale. Chalcocite •
MINERAI DE CUIVRE •
Couleur bleu indigo à bleu noirâtre. Très tendre (dureté 1,5 à 2). • Clivage parfait. En lamelles flexibles ou à l'état massif. Covellite •
Couleur grise à noir de fer. Trait noir à brun. Cristaux • en forme de tétraèdres ou à l'état granulaire. Cassure • conchoïdale ou inégale. Fond à la flamme d'une bougie. Tétraédrite •
Couleur gris foncé à noir. Trait gris noirâtre brillant. • Ternissure noire. Sectile. La coupure fraîche est brillante. • Très lourd (densité 7,3). Cassure sous-conchoïdale. Fond à la flamme d'une bougie. Acanthite •
MINERAI D'ARGENT • Couleur noir de fer ou gris d'acier. Trait noir ou gris foncé brillant. Flexible, mais non élastique. • Sectile. Léger. Clivage facile et parfait. Toucher gras. • Se trouve en paillettes ou à l'état massif. Tache les doigts et le papier, la trace sur le papier restant grise si • on la frotte avec le doigt. Graphite/1 .
Couleur gris bleuâtre. Trait verdâtre ou bleuâtre. • Paillettes flexibles, mais non élastiques. Sectile. • Clivage facile et parfait. Se trouve en paillettes ou à l'état massif. Toucher gras. Tache les doigts et • le papier, la trace sur le papier devenant verdâtre • si on la frotte avec le doigt. Molybdénite/10 •
•
•
• 96
•
MINERAI DE MOLYBDENE

•
•
• • Couleur gris plomb. Trait gris plomb. Très lourd.
Clivage facile et parfait donnant de petits morceaux • à aspect cubique. Se trouve en cubes, • à l'état massif ou grenu.
Galène/3 MINERAI DE PLOMB
• • Couleur gris plomb ou gris d'acier. Parfois noirâtre
ou irisée à la surface. Trait gris. Légèrement sectile. • Les cristaux ont un clivage parfait et facile. Parfois fibroradiée. • Se trouve souvent en masses grenues. Fond à
la flamme d'une bougie en donnant des fumées • blanches et une odeur de soufre. Stibine/7 • MINERAI D'ANTIMOINE
• Couleur grise. Trait gris. Souvent sectiles. En petites • masses finement grenues, rarement en cristaux.
Très lourds. Fondent à la flamme d'une bougie • en dégageant des fumées blanches. Tellurures
• MINERAI D'OR
• Couleur blanc argenté. Ternissure grise ou noire. • Trait blanc brillant d'argent sur la plaque de porcelaine. • Très lourd (10 à 12). Filaments enroulés, écailles
ou lamelles minces. Malléable. Argent natif/42 • ARGENTERIE, MONNAIE, BIJOUX
• Couleur gris acier. Éclat brillant. Trait gris pâle brillant. • Densité très élevée (14 à 21). Pépites ou grains. Malléable. • Parfois magnétique. Platine natif/43
CHIMIE, BIJOUX
•
• Minéraux noirs
• Couleur noire. Fréquents reflets bleus ou verts. • Trait gris foncé ou noir. Légèrement sectile.
Cassure conchoïdale. Chalcocite • MINERAI DE CUIVRE
• Couleur noire. Trait gris noirâtre brillant. Sectile. • La coupure fraîche est brillante. Très lourde (densité 7,3). • Cassure sous-conchoïdale. Fond à la flamme d'une bougie. Acanthite • MINERAI D'ARGENT
•
•
• 97 •

Couleur noir de fer. Trait noir ou gris foncé, brillant. Flexible, mais non élastique. Sectile. Léger. Clivage facile et parfait. Toucher gras. Se trouve en paillettes ou à l'état massif. Tache les doigts et le papier, la trace sur le papier restant grise si on la frotte avec le doigt. Graphite/1
Couleur noire ou gris foncé. Trait noir ou noir bleuâtre. Parfois en cristaux, le plus souvent en masses réniformes, fibreuses, dendritiques, grenues ou pulvérulentes. Tache les doigts. Pyrolusite/15
MINERAI DE MANGANÈSE
Couleur noire. Trait brun plus ou moins foncé. Éclat sous-métallique, parfois résineux ou adamantin. Clivage parfait. Sphalérite/4
MINERAI DE ZINC
B. Difficiles à rayer ou non rayables avec une pointe d'acier
Dépolissent ou égratignent le verre.
Minéraux jaunes ou jaunâtres
Couleur jaune laiton, parfois irisée. Trait noir. Cassure conchoïdale ou inégale. Souvent en boules ou en cristaux cubiques, brillants, striés. Pyrite/8
Couleur jaune bronzé pâle (blanc d'étain sur cassure fraiche). Trait noir grisâtre ou noir brunâtre. Clivage distinct. Cassure inégale. Goût d'encre. Marcasite
Minéraux rouges ou rougeâtres
Couleur rouge cuivre pâle, avec parfois une ternissure grise ou noirâtre. Trait noir brunâtre. Très lourde. Fond facilement au chalumeau. Nickéline
Couleur brun rougeâtre. Trait rouge ou brun rougeâtre. Se trouve parfois en masses tendres rouges ayant un aspect terreux, granulaires ou botryoïdes. Hématite/13
MINERAI DE FER
98

•
•
• • Minéraux gris ou blancs
• Couleur gris d'acier à noir. Trait rouge ou brun rougeâtre. Se trouve soit en cristaux tabulaires rhomboédriques, • réniformes, en rosettes ou sous forme de paillettes brillantes
• ressemblant au mica, mais beaucoup plus lourdes et • plus dures (oligiste spéculaire), parfois irisées.
Hématite/13 MINERAI DE FER
• • Couleur blanc d'argent à gris d'acier. Trait noirâtre.
Cristaux à stries très visibles. Clivage distinct. Cassure inégale. • Odeur d'ail en le broyant ou en le grillant au chalumeau. Arsénopyrite • MINERAI D'ARSENIC
• Couleur blanc d'étain. Parfois ternissure grise, bleuâtre ou • irisée. Cassure conchoïdale ou inégale. Dégage, par grillage
au chalumeau, une odeur d'ail. S'altère en donnant • une croûte terreuse d'érythrite (fleur de cobalt). Smaltite • MINERAI DE COBALT
• Couleur gris d'acier à reflet rosâtre. Trait noir grisâtre.
• Cristaux cubiques à faces striées, aussi en grains informes ou masses homogènes. Cobaltite
• MINERAI DE COBALT
• • Minéraux noirs
• Couleur noire. Trait noir. D'ordinaire en masses grenues, parfois en cristaux octaédriques. Clivage suivant les faces • de l'octaèdre. Fréquemment dans les sables noirs.
• Très fortement magnétique. Magnétite/17 • MINERAI DE FER
• Couleur noir de fer. Trait noir. Cassure conchoïdale.
• Faiblement magnétique. Se trouve en masses grenues ou compactes dans les roches. Souvent en grains
• dans les sables noirs. Ilménite/14 • MINERAI DE TITANE
• Couleur noir de fer ou noir grisâtre. Trait brun.
• Cassure inégale. En masses grenues ou compactes. Parfois faiblement magnétique. Chromite/18
• MINERAI DE CHROME
•
•
• 99
•

• • • 11 Minéraux à éclat sous-métallique ou non métallique •
ayant un trait coloré •
A. Faciles à rayer avec une pointe d'acier •
Trait noir ou brun-noir •
Trait noir. Couleur noire. Tendre. Tache le papier. Très léger. • Massif. Friable. Cassure conchoïdale. Combustible. Anthraxolite, charbon •
Trait brun foncé. Couleur gris acier à noir de fer. • Cristaux prismatiques striés verticalement. Clivage parfait. • Columnaire à fibreux. Manganite •
Trait noir ou noir brunâtre. Couleur noire ou noir brunâtre. • Éclat mat. Tache souvent les doigts. Tendre, s'écrase • parfois entre les doigts. Se trouve en masses compactes, terreuses, réniformes ou concrétionnées. Psilomélane •
SYNONYME: WAD •
Trait brun ou jaune ou orangé •
Trait jaune pâle. Couleur jaune citron, parfois à reflet brunâtre. • Éclat adamantin perlé à résineux. Tendre (dureté 1 à 2). • Clivage parfait en lamelles fines flexibles, non élastiques. Structure foliée. Orpiment •
PIGMENT •
Trait jaune ou brun plus ou moins foncé. Couleur noire, brune • ou jaune miel. Éclat adamantin ou résineux. Clivage parfait. .... .. Sphalérite/4 •
MINERAI DE ZINC •
Trait brun jaunâtre ou jaune ocre. Couleur brun à noir • plus ou moins foncé. Structure nodulaire, radiée, stalactitique ou fibreuse. Dureté 3,3 à 5,5. Goethite • Si tendre, terreux, terne. Limonite/16 •
PIGMENT •
Trait jaune à brun clair ou jaune rougeâtre. Couleur • brun foncé ou rouge brunâtre. Cristaux octaédriques. • Souvent radioactifs. Pyrochlore
MINERAI DE NIOBIUM •
• • •
100 • •

•
• • • Trait orangé clair. Couleur rouge-orangé. Cristaux prismatiques
courts striés. Éclat résineux. Tendre (dureté 1,5 à 2). • Sectile. Semi-transparent. Réalgar • PIGMENT
• Trait rouge
• Trait rouge écarlate. Couleur vermillon à rouge brunâtre. • Généralement granulaire ou terreux. Tendre (dureté 2,5).
Très dense (densité 8,1). Cristaux à clivage parfait, translucides. Cinabre • MINERAI DE MERCURE
• Trait rouge sang ou brun rougeâtre. Couleur rouge ocre. • Aspect terreux ou massif. Tendre. Hématite/13 • MINERAI DE FER
• Trait rose
• Trait rose ou rouge pâle. Couleur rose ou rouge fleur • de pêcher séchée. Souvent en masses pulvérulentes
ou terreuses ou en croûtes accompagnant les minéraux • d'arsenic et cobalt. Érythrite
• Trait vert
• Trait vert pâle. Couleur vert émeraude. Assez lourde. • Se trouve en taches ou en croates fibreuses, radiées • ou tendres, parfois en masses rubanées ou mamelonnées.
Fait effervescence avec l'acide froid. Malachite/9 • PIERRE ORNEMENTALE
• Trait vert pâle. Couleur vert pomme plus foncée que le trait. • Assez tendre. D'ordinaire en taches ou croûtes terreuses, • accompagnant les minéraux d'arsenic nickélifère.
Non effervescent. Annabergite
• • Trait bleu
• Trait bleu. Couleur bleu d'azur. Assez tendre. Lourde. Cristaux avec clivage parfait. Le plus souvent en taches,
• croûtes fibreuses ou masses botryoïdes. Fait effervescence • avec l'acide froid. Azurite
• • • • • 101 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
B. Difficiles à rayer ou non rayables avec une pointe d'acier
Dépolissent ou égratignent le verre.
Trait noir ou brun-noir
Trait noir brunâtre. Couleur noire ou noir brunâtre. Éclat semi-métallique, à l'aspect de goudron, parfois terne. Très lourd (7,5 à 9,7). En masses parfois arrondies, botryoïdes ou rubanées. Ressemble à un morceau de goudron. Fortement radioactive. Pechblende Si en cristaux octaédriques ou cubiques noirs ou noir d'acier. Uraninite
MINERAI D'URANIUM
Trait brun
Trait brunâtre à blanc. Couleur brune ou noir brunâtre. Éclat adamantin ou semi-métallique. Très lourd (6,8 à 7,1). Cristaux prismatiques, parfois accolés en genou (macle). Cassure sous-conchoïdale ou inégale. Cassitérite
Trait brun ou noir brunâtre. Couleur brun-noir. Assez dure. Lourde (densité 6,7 à 7,5). Clivage parfait. Éclat sous-métallique à résineux. Se trouve souvent en masses lamellaires ou grenues, aussi en cristaux habituellement striés. Parfois faiblement magnétique. Wolframite
MINERAI DE TUNGSTÉN:-
Trait brun pâle ou jaunâtre. Couleur rouge, brun rougeâtre à noir. Éclat adamantin à sous-métallique. En cristaux prismatiques striés verticalement avec un clivage distinct, souvent accolés en genou (macle), en masses grenues ou en inclusions aciculaires, fibreuses ou longues aiguilles capillaires dans le quartz (cheveux de Vénus). Rutile
PIGMENT
Trait vert
Trait vert olive ou noir brunâtre. Couleur noire ou noir brunâtre. Éclat sous-métallique, résineux ou gras, parfois terne. Ressemble à un morceau de goudron. Fortement radioactive. Pechblende
MINERAI D'URANIUM
102

• •
•
• ® Minéraux à éclat non métallique ayant un trait blanc • ou faiblement teinté
• La plupart des minéraux de cette classe entrent dans la composition des roches ou sont classés parmi les «minéraux industriels». On y trouve peu
• de minéraux métalliques.
• • •
A. Faciles à rayer avec une pointe d'acier
Rayés par une pièce d'un cent de bronze (dureté inférieure à 3)
• Clivage parfait • • Couleur vert pâle ou blanche. Facilement rayé par l'ongle,
beaucoup plus tendre que le mica. Foliacé à clivage • parfait donnant des paillettes flexibles (non élastiques) • ou en masses tendres au toucher très onctueux, gras. Talc/28
MINÉRAL DE CHARGE
• • Dureté 1,5 à 2 (se raye à l'ongle). Léger (densité 2,3).
Couleur blanche, parfois coloré par des impuretés. • •
Cristaux tabulaires avec clivages parfaits à reflet nacré, parfois accolés en queue d'hirondelle. En masses fibreuses soyeuses ou compactes. Gypse/40
• PLÂTRE, CIMENT
• Cristaux incolores limpides à clivage lamellaire. Sélénite • Massif, dureté 3 à 3,5, déshydraté, plus lourd (densité 2,9). Anhydrite
• Dureté 2,5. Couleur blanche, parfois brunâtre. Éclat perlé. • En paillettes transparentes flexibles et sectiles avec • clivage parfait. Aussi en grains, masses feuilletées ou
sous forme de fibres cassantes. Brucite/11 • SOURCE DE MAGNÉSIE
• • Dureté 2,5. Couleur généralement incolore ou blanche,
plus rarement rougeâtre ou bleue. Cristaux cubiques. • Trois clivages à 90° (fig. 3 B). En croûtes cristallisées. • Soluble dans l'eau. Goût salé. Halite/20
ALIMENTATION, DÉGLAÇAGE
• • Goût amer. Sylvite
SOURCE DE POTASSIUM
•
•
• 103 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté 2 à 2,5. Éclat perlé. Couleur jaune citron à vert pâle. Trait jaune. Folié ou agrégats de paillettes. Fluorescence aux ultraviolets intense vert jaunâtre. Radioactif. Autunite
MINERAI D'URANIUM
Dureté 2 à 2,5. Couleur verte de différentes nuances. Se trouve habituellement en masses foliées ou en agrégats de petites paillettes flexibles, mais non élastiques (différence avec le mica). Clivage parfait. Parfois en fines particules disséminées en inclusions. Chlorite
Dureté 2,5 à 3. Couleur blanche, noire ou brun cuivré. Cristaux tabulaires parfois hexagonaux. Clivage facile et parfait (fig. 3A). Feuilleté en livrets ou en paillettes brillantes élastiques. Groupe des micas Incolore à brun pâle. Muscovite/29 Brun foncé à noir. Biotite/30 Brun ambré ou cuivré. Phlogopite Rose, violet lilas, perlé. Lépidolite Mordoré à feuillets flexibles (plastiques, non élastiques), gonflant dans l'eau en accordéon, Vermiculite
Dureté 3. Couleur noire, brun foncé ou brun rougeâtre. Trait gris-blanc. Éclat perlé à sous-métallique. Clivage parfait. Lamelles cassantes. Souvent en petites touffes d'agrégats aciculaires radiés.
Stilpnomélane
Pas de clivage ou clivage imparfait
Couleur blanche, parfois coloré par des impuretés. Léger (densité 2,3). En masses sans forme définie, difficiles à rayer avec l'ongle. Gypse/40
PLÂTRE, CIMENT, ALBÂTRE ET PIERRE ORNEMENTALE
Couleur blanche, brune, beige ou rougeâtre. En masses a éclat mat. Happe à la langue. Odeur d'argile, mais se distingue de l'argile en ne formant pas une pâte avec l'eau. Bauxite
MINERAI D'ALUMINIUM
Blanc, parfois taché de rouille. Tendre. Terreux. Odeur d'argile. Happe à la langue. Forme une pâte avec l'eau. Kaolin
CERAMIQUE
Couleur vert pâle ou blanche. Facilement rayé par l'ongle. Dans diverses roches auxquelles il donne un toucher onctueux. Talc/28
MINERAL DE CHARGE
104

•
•
• Couleur verte à vert bleuâtre. Trait blanc verdâtre. • Dureté 2, parfois 4. Éclat gras à terreux. En croûtes • concrétionnées ou bulbeuses. Si chauffé dans une éprouvette,
il y a apparition de buée d'eau sur les parois froides. Chrysocolle • PIERRE FINI.
• Rayent une pièce d'un cent de bronze (dureté comprise entre 2,5 et 5)
• Minéraux légers
• Dureté 2,5 à 4. Couleur vert olive ou jaune verdâtre. • Trait blanc. Éclat gras. Toucher gras. Groupe des serpentines • Agrégat massif ou écailleux. Antigorite • Veinules de fibres blanches ou vert jaunâtre,
faciles à séparer en s'effilochant, flexibles. Chrysotile/31 • Fibres bleues. Crocidolite • Fibres brunes. Amosite
VARIETES D'AMIANTES
• • Dureté 3. Couleur blanche ou incolore, parfois rose,
brune, grise ou bleue. Transparente ou translucide. • En cristaux rhomboédriques ou en prismes pointus • (scalénoèdres, dents de cochon). Clivages rhomboédriques
faciles et parfaits (fig. 3C). Agrégats dans des cavités • drusiques (voir fig. 7). Parfois en masses croûteuses, • concrétionnées ou sous forme de stalactites. Fait vivement
effervescence avec l'acide dilué froid. Calcite/21 • CIMENT, CHAUX
• • Dureté 3,5. Couleur blanche à jaune citron, fragments
minces incolores et transparents. Cristaux hexagonaux • en sablier à faces fortement striées horizontalement. • Clivage parfait. Weloganite
• Dureté 3,5 à 4. Couleur blanche ou jaune pâle. • Forme prismatique ou tabulaire avec un seul clivage.
Le plus souvent en cristaux aciculaires radiés ou • en masses fibreuses parfois rubanées. Vive effervescence • avec HCI dilué à froid. Aragonite
• • • • •
105 •
•

Dureté 3,5. Couleur blanche, rose, brune, grise. Clivages faciles et parfaits (fig. 3C). En cristaux, en prismes de clivage ou en masses grenues ou compactes. Fait légèrement effervescence avec l'acide dilué froid sur la masse de • l'échantillon, mais vive effervescence sur la poudre. Dolomite
SOURCE DE MAGNÉSIE
Dureté 4. Couleur blanche, jaunâtre, grisâtre ou brune. Clivages faciles et parfaits (fig. 3C). En cristaux ou en masses sans forme définie. Fait effervescence seulement avec l'acide chaud sur la masse de l'échantillon. Magnésite/22
SOURCE DE MAGNÉSIE
Dureté 3,5 à 4. Densité 2,2. Couleur blanche. Cristaux tabulaires, agrégats en «gerbe de foin». Éclat perlé sur face de clivage. Chauffée au chalumeau, s'exfolie et se boursoufle (intumescence). Chauffée en éprouvette, donne de l'eau sur les parois froides. Stilbite
Dureté 4. Couleur blanche, jaune, verte, rouge, violette, etc. Transparente ou translucide. Souvent en cristaux cubiques, plus rarement octaédriques, parfois en masses sans forme définie. Clivage parfait (fig. 3D) suivant les plans de l'octaèdre. Souvent fluorescente aux rayons ultraviolets, aussi thermoluminescente. Ne fait pas effervescence avec l'acide. Fluorite/19
SOURCE DE HF, FONDANT
Dureté 4,5 à 5. Incolore, blanc, gris ou vert pâle. Éclat perlé sur le plan de clivage. Cristaux prismatiques carrés, faces striées verticalement. Apophyllite
Dureté 4,5 à 5. Couleur rose à rose rougeâtre. Trait blanc. Cristaux prismatiques, sous forme tabulaire ou à l'état massif. Deux clivages parfaits à ± 90° révélant un éclat vitreux à perlé. Sérandite
Dureté 5. Couleur souvent verte, parfois blanche, bleue, grise, brune ou rouge. Souvent en petits fragments translucides, parfois en cristaux hexagonaux ou en masses sans forme définie. Apatite/38
ENGRAIS, SOURCE DE P205
106

•
•
• • Dureté variable, 4,5 dans l'allongement et 7 perpendiculairement
à l'allongement. Couleur bleue souvent plus foncée au centre. • Cristaux en forme de longs prismes plats. Clivage lamellaire parfait. .. Kyanite • CERAMIQUE
• Dureté 5. Densité 3,28 à 3,35. Couleur vert émeraude • à vert bleuté. Translucide. Cristaux prismatiques,
faces rhomboédriques. Clivage parfait. Formation • de buée d'eau sur les parois froides lorsque chauffée • dans une éprouvette. Dioptase • PIERRE FINE
• Minéraux lourds
• Dureté inconnue, mais tendre. Éclat mat à terreux.
• Couleur jaune brillant à jaune verdâtre. Disséminée • ou enduite sous forme de poudre, agrégats
microcristallins. Radioactive. Carnotite • MINERAI D'URANIUM ET DE VANADIUM
• Dureté 3. Couleur blanche ou jaunâtre, parfois grise,
• brune ou rouge. Clivage parfait (cristaux). Parfois en cristaux, • en forme de crête de coq, le plus souvent en masses • grenues faciles à écraser.
Barite/39 BOUE LOURDE, MINÉRAL DE CHARGE
• • Dureté 3,5. Le plus souvent de couleur bleu ciel,
parfois blanche, grise ou brune. Transparente • ou translucide. Clivage parfait. Célestite • SELS DE STRONTIUM
• Dureté 3,5 à 4. Incolore ou blanc. Cristaux aciculaires • ou fibreux radiés. Effervescence avec HCI dilué.
Colore la flamme rouge. Strontianite • SOURCE DE STRONTIUM
• Dureté 4. Couleur brun clair ou jaune miel. Trait jaune pâle • ou blanc. Éclat résineux ou adamantin. Clivage parfait. • Avec l'acide, dégage une odeur d'ceufs pourris. Sphalérite/4
MINERAI DE ZINC •
•
•
•
• • 107

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté 4. Couleur brun à brun foncé. Clivages faciles et parfaits (fig. 3C). En cristaux, en prismes de clivage ou en masses sans forme définie. Fait effervescence avec l'acide chaud. Sidérite/23
MINERAI DE FER
Dureté 5. Couleur blanche, jaunâtre, brunâtre. Éclat brillant. Translucide. Clivage distinct. Parfois en cristaux, le plus souvent en masses sans forme définie. Fluorescence blanc bleuâtre aux rayons ultraviolets. Scheelite
MINERAI DE TUNGSTÈNE
B. Difficiles à rayer ou non rayables avec une pointe d'acier
Dépolissent le verre.
Pas de clivage ou clivage indistinct
Dureté 5,5. Couleur jaune verdâtre, rouge ou brune. Éclat souvent résineux. Massif à granulaire. Forte fluorescence aux rayons ultraviolets de couleur vert jaunâtre. Willémite
MINERAI DE ZINC
Dureté 5 à 6. Densité 2 à 2,25. Sans clivage (amorphe), éclat vitreux, laiteux, opalescent, jeux de lumière. Translucide. Cassure conchoïdale. Incolore, blanc, gris, jaune pâle, brun ou bleu. Opale
PIERRE FINE
Dureté 5 à 5,5. Densité 2,27. Couleur blanche. Cristaux avec la forme caractéristique d'un trapézoèdre (voir fig. 4E) dans des cavités. Parfois en agrégats granulaires. Donne de l'eau dans un tube chauffé. Analcime
Dureté 5,5 à 6. Densité 2,6. Généralement gris. Éclat gras à l'état massif ou granulaire. Néphéline
VE:RER_E
Dureté 5 à 6. Densité 2,55 à 2,74. Couleur blanche ou grise, parfois incolore. En cristaux prismatiques allongés verticalement avec coupe basale quadratique, à l'état granulaire ou massif. Clivage à peine distinct ou cassure inégale à aspect fibreux. Souvent altéré. Scapolite
108

•
• • Dureté 5,5 à 6. Densité 2,2. Couleur bleue à bleu foncé.
Massif ou granulaire. Cassure irrégulière. Sodalite • PIERRE ORNEMENTALE
• Dureté 5,5 à 6. Incolore ou blanc. Clivable en fragments • esquilleux allongés. Fibreux avec éclat soyeux ou • en masse compacte. Associé au calcaire cristallin.
Wollastonite CÉRAMIQUE
• • Dureté 5,5 à 6. Couleur brun à noir de goudron.
Trait légèrement brunâtre. Éclat similaire au goudron. • Massif ou en grains enchevêtrés. Cassure conchoïdale • ou irrégulière. Faiblement radioactif. Allanite
• Raye le verre (dureté 6 à 7). Couleur vert pistache, • en masse informe, associé au quartz et au feldspath. Épidote
• Raye le verre (dureté 6,5). Densité 3,3 à 4,4. Couleur verte, • parfois brune ou jaune. Éclat vitreux à gras. Cristaux
prismatiques à section carrée, striés verticalement. Vésuvianite • • Un peu moins dur que le quartz (dureté 6,5 à 7).
Raye le feldspath. Couleur vert olive, parfois jaune. • Cassure conchoïdale. Le plus souvent en grains • arrondis, cristaux rares. Olivine
variété cristallisée, limpide et vert olive. Péridot • PIERRE FINE
• Dureté 6 à 7. Incolore, jaunâtre. Cristaux prismatiques • allongés, columnaires ou en masses fibreuses tenaces. Sillimanite
• Dureté 6,5 à 7. Couleur vert pomme à vert émeraude. • Opaque à translucide. Cassure granuleuse, • feutrée ou fibreuse. Tenace. Jade/53 • PIERRE FINE
• Raye le verre (dureté 6,5 à 7,5). Éclat vif adamantin. Couleur le plus souvent rouge ou brune, parfois verte, jaune rose
• ou incolore. Cristaux dodécaédriques (fig. 4C). Groupe des grenats/37/51 • Rouge foncé. Pyrope
Rouge violacé. Almandin • vert à vert émeraude. Démanto de ou Uvarovite • Incolore, jaune, vert pâle. Grossulaire
Cannelle. Hessonite • Orange à brun-rouge. Spessartine
• PIERRES FINES, ABRASIFS
• 109
•

Raye le verre (dureté 7 à 7,5). Densité 3,7. Couleur brun rougeâtre à noir brunâtre. Trait blanc. Cristaux prismatiques aplatis, section losangique, souvent interpénétration de deux cristaux pour former une croix (macle), surface altérée tendre. Staurotide
Raye le verre (dureté 7,5). Densité 3,2. Couleur brun rougeâtre, rouge foncé, vert olive. Cristaux prismatiques en forme de cigare à section plus ou moins carrée montrant souvent une croix noire (chiastolite). Sans clivage. Peut s'altérer en micas. Andalousite
CÉRAMIQUE, PIERRE FINE
Raye le verre (dureté 7). Couleur variable (incolore, blanc, gris, violet, jaune, rose, rougeâtre, noir ou bleu). Éclat vitreux. Parfois en cristaux à six faces prismatiques, terminés par une pointe à six facettes (fig. 4J, 5C), souvent en masses sans forme distincte, granulaires et blanc laiteux. Transparent ou translucide. Quartz/24/25
SOURCE DE SILICE, PIERRES FINES
Les spécimens macrocristallins de quartz limpides sont appelés cristal de roche; translucides et violets, améthyste/49; jaune-orangé, citrine; noirs ou brun foncé, morion.
Les spécimens microcristallins à éclat cireux ou mat sont appelés calcédoine; variétés rubanées en couches concentriques de différentes couleurs, agates/52; avec reflets chatoyants jaune d'or, oeil-de-tigre; verts et scintillants, aventurine; verts et fibreux, chrysoprase; verts et granulaires, prase; rouges et granulaires, jaspe.
Raye le verre (dureté 7 à 7,5). Éclat vitreux. Couleur souvent noire, parfois vert-brun, rose ou multicolore (melon d'eau). Souvent en cristaux allongés et cannelés à section triangulaire (fig. 5A) ou en masses sans forme distincte, en bâtonnets aciculaires. Tourmaline/36
PIERRES FINES
Variétés: noire, schorl; rose à rouge, rubellite; brun foncé, dravite; bleue, indigolite.
Raye le verre (dureté 7 à 7,5). Couleur jaune, brune ou grise. Assez lourd. Parfois fluorescent aux rayons ultraviolets. Radioactif. Zircon
PIERRE FINE
110

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Raye le verre (dureté 7 à 7,5). Couleur bleue à gris bleuté. Trait blanc. Cassure irrégulière. Prismes courts translucides ou en masses compactes. Cordiérite
PIERRE FINE
Rayés par le quartz
Clivage distinct
Raye l'apatite (dureté 5 à 5,5). Incolore ou blanc. Éclat vireux. Translucide. Cristaux prismatiques allongés, étroits, généralement radiés et striés, coupe basale rectangulaire. Clivage parfait. Natrolite
Raye l'apatite (dureté 5 à 5,5). Couleur généralement brune, rougeâtre ou noire. Éclat résineux à adamantin. Cristaux aplatis en forme de coin. Titanite
PIGMENT
Raye l'apatite (dureté 5 à 6). Couleur verte ou vert noirâtre. Deux clivages parfaits se coupant à 120°, en losange. Les plans de clivage ont souvent l'apparence d'une surface brillante. Groupe des amphiboles Cristaux prismatiques allongés noirs. Hornblende/34 Cristaux aciculaires ou agrégats fibreux verts. Actinolite Couleur blanche ou violacée. Trémolite Masse fibreuse de couleur brune à reflets soyeux. .... Anthophyllite, grunérite
Mêmes caractères que le groupe des amphiboles, mais deux clivages à angle droit, section rectangulaire. Groupe des pyroxènes Prismes trapus ou masses granulaires de couleur vert foncé à noir. Augite/32
Incolore, blanc ou vert pâle. Diopside Cristaux allongés de couleur vert olive ou brune. Acmite (Ægyrine) Cristaux lamellaires noirs à reflets brunâtres. Hypersthène
Raye l'apatite (dureté 6). Couleur blanche, rose, grise, verte ou rouge. Parfois teinte bleutée. Densité moyenne. Deux clivages parfaits presque à angle droit. Les surfaces de clivage sont brillantes avec ou sans lignes parallèles de macle lamellaire (fig. 6G, 6H). Groupe des feldspaths/26/27 Sous-groupe des feldspaths potassiques: Pas de macle lamellaire, blanc ou rougeâtre. Orthoclase
Treillis visible au microscope seulement. Microcline
Vert pâle à vert bleuté. Amazonite/50
111

1 1 11 11 11 11 11 1/ 11 11 0 11 11 11 11 lb I/
11 11 lb 11 11 11 I/ 11 11 1
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Sous-groupe des plagioclases: Macle lamellaire, blanc. Albite Jeux de teintes d'irisation bleutées, verdâtres et pourpres. Labradorite
PIERRES FINES
Un peu moins dur que le quartz (dureté 6 à 7). Couleur vert pâle. Clivage distinct. Souvent en cristaux longs, aplatis et striés. Spoduméne/33 Variété couleur lilas. Kunzite
PIERRE FINE
Un peu moins dur que le quartz (dureté 6 à 7). Couleur vert jaunâtre ou vert pistache. Clivage parfait. Le plus souvent en grains dans des roches ou en masses sans forme distincte Épidote
Dureté variable, 7 perpendiculaire à l'allongement et 4,5 dans l'allongement. Couleur bleue souvent plus foncée au centre. Cristaux en forme de longs prismes plats. Clivage lamellaire parfait. Kyanite
CÉRAMIQUE
Couleur brun à noir. Dureté 6 à 7. Densité élevée (6,8 à 7,1). Éclat adamantin à sous-métallique. Cristaux prismatiques, parfois accolés en genou (macle). Généralement granulaire ou massif. Cassure irrégulière. Cassitérite
MINERAI D'ÉTAIN
Couleur rouge, brun rougeâtre à noir. Trait jaune ou brun clair. Éclat adamantin à sous-métallique. Cristaux quadratiques souvent accolés en genou (macle). Clivage distinct. Parfois en inclusions aciculaires ou capillaires. Rutile
PIGMENT
Rayent le quartz
Raye le quartz (dureté 7,5 à 8). Incolore ou souvent vert, parfois blanc, jaune, bleu ou rose. Éclat vitreux. Léger. Souvent en cristaux à prismes hexagonaux (fig. 4G). Béryl/35
PIERRES PRÉCIEUSES
Variétés limpides: vert foncé, émeraude/47; bleu à bleu-vert, aigue-marine; rose à rose violacée, morganite; jaune d'or, héliodore.
112

• • • • • • • • • • •
.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dureté 8. Couleurs variables: incolore ou jaune-orangé, parfois rose, bleu ou vert. Transparente à translucide. Cristaux prismatiques. Clivage basal. Topaze/48
PIERRE PRÉCIEUSE
Dureté 8. Couleurs variées: noir, rouge, bleu, vert ou brun. Transparent à opaque. Parfois deux cristaux accolés (macle d'accolement, fig. 6D). Cristaux en octaèdres. Cassure irrégulière ou conchoïdale. Groupe des spinelles
PIERRES FINES
Dureté 9: raye le verre, le quartz et le béryl. Assez lourd. Éclat vitreux ou nacré. Sans clivage, mais plans de séparation mats. Couleur aux tons de brun, rose ou bleu, En cristaux hexagonaux, la base montre parfois des lignes parallèles de macle, ou en grains sans forme distincte. Corindon/12
Limpide et rouge. Rubis/45
Limpide et bleu. Saphir/46 ABRASIF, PIERRES PRÉCIEUSES
Dureté 10: raye facilement le quartz et le corindon. Couleur jaune pâle ou incolore. Éclat vif adamantin. Cristaux octaédriques courbés et transparents. Clivage parfait. Diamant/44
PIERRE PRÉCIEUSE, OUTILS DE COUPE
113


• •
• INDEX MINÉRALOGIQUE
•
•
• • Acanthite Ag2S p.96
• Acmite NaFeSi206 p. 64, 111
• Actinolite Ca2(Mg,Fe)5Si8022(OH)2 p. 66, 111
• Ægyrine Synonyme d'acmite p. 64, 111
Agate Variété rubanée de calcédoine, Si02 p. 21, 27, 57, • 87,110
• Aigue-marine Variété bleu-vert de béryl, gemme p. 67, 82, 112
• Albite NaAIS1308 p. 18, 58, 85, 112
• Allanite (Ce,Ca)2(AI,Fe)3(SiO4)30H p. 109
• Almandin Fe3Al2S13012 p. 25, 80, 86,109
Amazonite Variété verte de microcline, KAISi308 p. 58, 83, 85, • 88, 111
• Amblygonite LiAIF(PO4)(F,OH) p.65
• Ambre 78%C,10%0,11%H p.60,104
• Améthyste Variété violette de quartz, Si02 p. 21, 27, 56, 84, 110
Amosite
•
Variété brune asbestiforme • d'amphibole p. 63, 66, 105
• Amphiboles Groupe: hornblende, trémolite, etc. p. 13, 27, 66, 111
• Analcime NaAISi206 • H2O p. 16, 108
• Andalousite AI2Si05 p.110
• Anhydrite CaSO4 p.103
Annabergite Ni3(As04)2 .8H20 p. 101
• Anthophyllite (Mg,Fe)7Si8022(OH)2 p.63, 111
• Anthraxolite 75 à 90% C p.100
• Antigorite Mg3Si205(OH)4 p.63, 105
• Apatite Ca5(PO4)3(F,CI,OH) p. 16, 27, 70, 106
• Apophyllite KCa4(Si4010)2F • 8H2O p.106
• Aragonite CaCO3 p.105
• Argent natif Ag p.11, 21, 25, 76, 97
•
• 115 •

Arsénopyrite FeAsS p. 24, 26, 75, 99
Augite (Ca,Mg,Fe)2(Si,Al)2O6 p.16, 27, 64, 111
Autunite Ca(U0)2(PO4)2.10-12H20 p. 23, 27, 104
Aventurine Variété verte de quartz, SiO2 p. 82, 110
Azurite Cu3(CO3)2(OH)2 p. 32, 39, 101
Barite BaSO4 p.11, 15, 27, 71, 90, 107
Bauxite Mélange d'hydroxydes d'Al p.21, 104
Béryl Be3AI2(Si6O18) p.16, 67, 82, 112
Biotite K(Mg,Fe)3(AISi3O10)(OH)2 p.27, 62, 104
Bornite Cu5FeS4 p. 36, 37, 95
Brucite Mg(OH)2 p. 42, 63, 103
Calcédoine Variété de quartz microcristallin, SiO2 p. 87, 110
Calcite CaCO3 p. 16, 18, 21, 23, 26, 52, 105
Carnotite K2(UO2)2(VO4)2 •3H2O p. 107
Cassitérite SnO2 p. 18, 102, 112
Célestite SrSO4 p. 107
Chalcocite Cu2S p. 32, 96, 97
Chalcopyrite CuFeS2 p. 6, 25, 26, 35, 75, 90, 95
Chiastolite Variété d'andalousite, AI2SiO5 p. 110
Chlorite Mg3Si4O~3 •• Mg3(OH)6 p. 60, 61, 87, 104
Chromite FeCr2O4 p. 5, 16, 26, 49, 99
Chrysocolle Cu4 H4S14O10(OH)8 p.39, 105
Chrysoprase Variété verte de calcédoine, SiO2 p. 110
Chrysotile Mg3Si205(OH)4 p. 5, 11, 20, 63, 105
• Cinabre HgS p.101
Citrine Variété jaune de quartz, SiO2 p.27, 56, 110
Cobaltite (Co,Fe)AsS p.99
Cordiérite (Mg,Fe)2A14Si5O18 • nH2O p.81, 111
Corindon Al2O3 p. 13, 16, 26, 43, 80, 81, 113
Covellite CuS p.96
116

• •
• Crocidolite Variété bleue asbestiforme • d'amphibole p.63, 66, 105
• Cryolite Na3AIF6 p.26, 55
• Cubanite CuFe2S3 p.95
• Cuivre natif Cu p.11, 25, 32, 96
• Cuprite Cu20 p. 32, 96
• Démantoïde Grenat vert, Ca5(Fe,Cr)2SiO4 -
• Diamant C p. 5, 9, 25, 56, • 78, 113
Diopside CaMgSi206 p. 27, 64, 78, • 82, 111
• Dioptase Cu5(Si6018) • 6H2O p. 39, 107
• Disthène Synonyme de kyanite, AI2Si05 -
• Dolomite Ca Mg(CO3)2 p. 26, 42, 55, 106
• Dravite Variété marron de tourmaline, gemme p.68, 110
• • Électrum Variété d'or argentifère p. 75
Émeraude Variété de béryl de couleur • verte, gemme p. 82, 112
• Enstatite MgSiO3 p. 27, 63, 64
• Épidote Ca2FeAl2(SiO4)3(OH) p.109, 112
• Érythrite Co3(As04)2.8H20 p. 99, 101
• Feldspath • potassique KAISi308 p.58
• Fluorite Ça F2 p. 8, 15, 16, 18, 23, 26, 50, 84, 106
• Fuchsite Muscovite chromifère • de couleur verte p. 61, 82
• Galène PbS p. 5, 12, 16, 33, 97
• Graphite C p. 5, 11, 13, 20, 23, • 25, 31, 95, 96, 98
• Grenats A3B2(SiO4)3, A=Ca,Mg,Fe2+ ou Mn2- B=AI,Fe3+ ou Cri+ p. 16, 69, 86, 109
• Grossulaire Ca3Al2(SiO4)3 p.86, 109
• Grunérite Fe7Si8022(OH)2 ' p.111
•
• • 117
•

Microcline KAISi308
Millérite MS
Gypse CaSO4 •2H2O p. 13, 15, 27, 72, 90, 103, 104
Halite
Héliodore
Hématite
Hessonite
Hornblende
Hypersthène
NaCI
Variété de béryl de couleur jaune, gemme
Fe203
Variété orangée de grossulaire, gemme
(Ca, Na)2(Fe, Mg)4AI(Si7A1)022(OH, F)2
(Mg,Fe)SiO3
p.12, 13, 16, 23, 26, 51, 103
p. 67, 82, 112
p. 24, 26, 44, 98, 99, 101
p. 69, 86, 109
p. 6, 27, 66, 111
p. 27, 64, 111
Ilménite
FeTiO3 p. 20, 26, 45, 99
Indigolite
Variété bleue de tourmaline, gemme p. 68
Jade Variété de jadéite ou néphrite p. 66, 82, 85, 88, 109
Kaolin (kaolinite)
Kunzite
Kya n ite
Al2Si205(OH)4
Variété rose de spodumène, gemme
AI2Si05
p. 27, 104
p.65, 112
p.81, 107, 112
Labradorite
Lépidolite
Limonite
Ab50An50-Ab3oAn70 Ab=NaAISi308, An=Ca1AI2Si208
K(Li,AI)2.3(AISi3010)(O,OH,F)2
Oxydes de fer, Fe0 • OH • nH2O
p. 112
p. 65, 104
p. 47, 55, 94, 100
Magnésite
Magnétite
Malachite
Manganite
Marcasite
Micas
MgCO3
Fe304
Cu2CO3(OH)2
MnO(OH)
FeS2
Groupe: muscovite, biotite, etc.
p.12, 23, 26, 54, 106
p. 8, 16, 24, 26, 45, 47, 48, 99
p. 26, 32, 39, 101
p. 94, 100
p. 23, 98
p. 13, 20, 27, 104, 110
p.15, 27, 58, 85,111
p. 95
118

•
•
• Molybdénite MoS2 p. 5, 20, 26, 31, • 41, 96
• Morganite Variété rose de béryl, gemme p. 67, 82, 112
• Morion Variété de quartz brun à noir p. 27, 57, 110
• Muscovite KAI2(AISi3O1 0)(OH)2 p. 8, 27, 61, 104
• Natrolite Na2Al2Si3O10 • nH2O p.111
• Néphéline (Na,K)AISIO4 p.43, 108
• Néphrite Variété compacte • de trémolite/actinolite p.66, 88
Nickéline NiAs p.98 •
• O`il-de-tigre Quartz/crocidolite, gemme p. 27, 57, 110
• Olivine (Mg,Fe)2SiO4 p. 59, 60, 63, 109
• 'Opale 502 • nH2O p.27, 57, 108
Or natif Au p.11, 12, 25, 75, • 91, 95
• Orpiment As2S3 p.100 ;
• Orthoclase KAISi3O8 p. 16, 18, 25, • 27, 111
• Pechblende Variété compacte d'oxyde • d'uranium, UO2 p.102
Pentlandite (Fe,Ni)9S8 p. 35, 36, 95 • Péridot Variété gemme de l'olivine p: 49, 82, 109
• Phlogopite KMg3(AISi3O10)(OH)2 p. 27, 60, 64, • 70, 104
• Plagioclase Ab100An0-Ab0Anloo Ab=NaAISi308, An=CaAI2Si2O8 p. 58, 59, 66, 112
• Platine natif Pt p.12, 76, 77, 97
• Prase Quartz microcristallin vert mat, • gemme p.110
• Psilomélane Mélange d'oxydes de manganèse p.20, 46, 100
Pyrite FeS2 p. 11, 12, 16, 17, • 24, 26, 38, 90, • 98
• Pyrochlore (Ca,Na)2(Nb,Ta)2O6(O,OH,F) p.100
• Pyrolusite MnO2 p. 21, 26, 46, 90, 98
Pyrope Grenat rouge Mg3Al2(SiO4)3, gemme p. 69, 86, 109 41
• 119
•

Pyroxènes Groupe: augite, diopside, etc. p. 13, 27, 64, 111
Pyrrhotite Fe1_xS p. 20, 24, 26, 36, 95
Quartz Si02 p. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 25, 27, 56, 84, 87, 110,113
Réalgar AsS p. 101
Rubellite Tourmaline rose à rouge, gemme p.68, 110
Rubis Corindon rouge, A1203, gemme p. 43, 80, 113
Rutile TiO2 p.18, 80, 102, 112
Saphir Corindon bleu, A1203, gemme p. 43, 81, 113
Scapolite (Ca,Na)4(CO3,C1)(Si,A1)6S16024 p. 108
Scheelite CaW04 p.41, 108
Schorl Tourmaline noire commune p. 68, 110
Sélénite CaSO4 - 2H2O p. 8, 72, 103
Sérandite Na(Mn,Ca)2Si30$(OH) p. 106
Serpentine Mg3Si205(OH)4 p. 63, 105
Sidérite FeCO3 p. 23, 26, 55, 108
Sillimanite AI2905 p. 109
Skuttérudite Synonyme de smaltite -
Smaltite (Co,Ni)As3 p. 26, 36, 99
Sodalite Na$(AISiO4)C12 p. 109
Spessartine Mn2Al2(SiO4)3 p. 109
Sphalérite ZnS p. 16, 23, 34, 90, 98, 100, 107
Sphène Synonyme de titanite, CaTi(SiO4) -
Spinelle MgA1204 p.18, 113
Spoduméne LiAISi206 p. 9, 65, 112
Staurotide Fe2A1906(SiO4)4(O,OH)2 p.18, 110
Stibine Sb2S3 p. 5, 25, 37, 90, 97
Stilbite (NaCa2A15Si13036) 14H20 p. 106
Stilpnomélane K(Mg,Fe)$(Si,A1)12(O,OH)27 p.62, 104
120

• •
.
•
Strontianite
Sylvanite
Sylvite
SrCO3
Tellurure, (Au,Ag)Te2
KCI
p. 20, 107
p.75
p. 26, 51, 103
• • Talc Mg3Si4010(O1-1)2 p. 5, 11, 20, 23, 60,
103, 104
• Tellurures Minéraux d'Au, Ag, Te p. 97
• Ténorite CuO p.32
• Tétraédrite Cu12Sb4S13 p.96
• Titanite CaTiO(SiO4) p.111
• Topaze AI2S104(F,OH)2 p. 83, 113
• Tourmaline Schorl : NaFe3A16(OH)4(B03)3Si6018 p. 17, 20, 68, 110
• Trémolite Ca2Mg5Si8022(OH)2 p. 20, 27, 63, 111
• Turquoise CuAl6(PO4)4(OH)8 •4H20 p. 85
• Uraninite UO2 p.26, 102
• Uvarovite Ca3Cr2(SiO4)3 p.86, 109
• Vermiculite (Mg,Fe,AI)3(Si,AI)4010(OH)2. • 4H20 p. 11, 62, 104
• Vésuvianite Ca10Mg2A14(SiO4)5(Si207)2(OH)4 p. 109
• Wad Mélange d'hydroxydes de manganèse p.46, 100
• Weloganite Sr3Na2Zr(CO3)6 .3H20 p. 105
• Willémite Zn2SiO4 p.23, 108
• Wolframite (Fe,Mn)W04 p.41, 102
• Wolastonite CaSiO3 —
• Zircon ZrSiO4 p.78, 110 •
•
•
•
•
•
•
•
•
• 121
•


• • • •
, FICHE D'IDENTIFICATION
• DES MINÉRAUX
• • • N° de l'échantillon: • • • ÉCLAT COULEUR
• ❑ métallique ❑ noir • ❑ sous-métallique ❑ brun • ❑ non métallique ❑ ambré • ❑ vitreux ❑ bronzé • ❑ adamantin ❑ bleu •
❑ gras ❑ violet • • ❑ cireux ❑ vert • El mat ❑ jaune • ❑ terreux ❑ rouge • ❑ autre: ❑ rose • ❑ gris • ❑ blanc argent • ❑ blanc • ❑ incolore • ❑ autre:
• • • • • • •
• 123 •

•
•
• CLIVAGE •
❑ présent •
❑ nombre •
❑ angle •
❑ parfait •
❑ imparfait •
❑ absent •
❑ indistinct •
• MAGNÉTISME •
❑ magnétique •
❑ non magnétique •
❑ impuretés magnétiques •
•
EFFERVESCENCE AVEC HCI •
❑ à froid sur masse •
❑ à froid sur poussière • seulement •
❑ à chaud seulement • sur poussière •
❑ aucune effervescence •
•
TÉNACITÉ •
❑ élastique •
❑ flexible •
❑ sectile •
❑ fragile •
❑ malléable •
❑ ductile • •
•
• 124
•
TRAIT
❑ nettement coloré ou foncé
❑ noir
❑ gris noirâtre
❑ brun
❑ rouge
❑ vert
❑ orange
❑ jaune
❑ autre •
❑ faiblement teinté
❑ blanc
DURETÉ
❑ faible 1 à 3
❑ moyenne 3 à 5,5
❑ forte 5,5 à 7
❑ très forte > 7
DENSITÉ
❑ légère < 2,9
❑ lourde > 2,9

•
•
• • TOUCHER FACES CRISTALLINES
❑ tache le papier STRIÉES
• ❑ gras ❑ présentes
• • ❑ rugueux ❑ absentes
• ❑ happe à la langue ❑ indistinctes
• FORME DEGRÉ DE TRANSPARENCE
•• n cristalline: ❑ transparent
❑ translucide • • - ❑ opaque
• ❑ imitative
• ❑ lamellaire CASSURE
• ❑ fibreuse ❑ conchoïdale
• ❑ aciculaire ❑ irrégulière
• ❑ columnaire ❑ épineuse
• ❑ radiée ❑ esquilleuse
• ❑ botryoide
• ❑ réniforme
• ❑ rubanée •
❑ granulaire • • ❑ spongieuse
• ❑ terreuse
• ❑ stalactitique
• ❑ massive
• ❑ feuilletée
• ❑ autre:
•
•
•
•
• 125
•
AUTRES PROPRIÉTÉS
NOM DU MINÉRAL


• •
•
• LOCALISATION DES GISEMENTS
• DE MINÉRAUX AU QUÉBEC
• • • MINERAL COMPOSITION GISEMENTS AU QUÉBEC
• Acmite NaFeS1206 Assez répandue. Beaux cristaux
• (ægyrine) au mont Saint-Hilaire et • au Lac-Saint-Jean (Girardville).
• Actinolite Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 En Outaouais, canton de Thorne.
• • Albite NaAISi308 Au mont Saint-Hilaire;
à la mine Broughton • (canton de Leeds) et à • Richmond en Estrie;
à Rémigny au Témiscamingue.
• • Allanite (Ce,Ca)2(AI,Fe)3(SiO4)30H Fréquente en Outaouais.
Beaux cristaux trouvés à • la mine Yates (canton • d'Huddersfield).
• Analcime NaAISi206 • H2O Au mont Saint-Hilaire • en Montérégie.
• Andalousite AI2S105 Dans les roches cornéennes • autour des massifs de granite • du lac Aylmer et du mont
Saint-Sébastien; dans les • paragneiss du secteur des lacs • Détour et Village, au sud
de la rivière Eastmain. • • Anthophyllite (Mg,Fe)7Si8022(OH)2 Signalée à la mine Garon Lake,
près de Matagami, et • à Montauban-les-Mines, • dans le Centre-du-Québec.
•
•
•
• 127
•

Anthraxolite 75 à 90% C Commun dans les roches
du Groupe de Québec de
la région de Matane.
Antigorite Mg3Si 2O5(OH)4 Dans les serpentinites de
la région de Thetford Mines.
Apophyllite KCa4(Si4010)2F • 8H2O
Beaux cristaux trouvés à
la mine de cuivre Gaspé Copper
à Murdochville (Gaspésie) et à
la mine Jeffrey à Asbestos.
Arsénopyrite FeASS
Minéral accessoire dans
plusieurs mines d'or et de
métaux de base de l'Abitibi.
Azurite CU3(CO3)2(OH)2 Dans la zone oxydée
des anciennes mines de cuivre
de Chibougamau.
Bornite Cu5FeS4 Aux mines Acton (Acton Vale) et Saint-François (canton de
Cleveland) en Estrie; à la mine
Madeleine en Gaspésie.
Chalcocite Cu2S A la mine Harvey Hill
(canton de Leeds) en
Chaudière-Appalaches;
à la mine Acton à Acton Vale
en Estrie.
Chlorite Mg3Si4010 • Mg3(OH)6 Principale composante des
roches vertes (roches
volcaniques métamorphisées)
de l'Abitibi. Observée aussi
comme minéral d'altération
dans plusieurs mines d'or.
Chrysocolle Cu4H4Si4O10(OH)8
Dans le secteur du lac Musset
au nord de Schefferville;
à la mine Saint-François
(canton de Cleveland) en Estrie.
128

•
•
• Cobaltite (Co,Fe)AsS Signalée à la mine Ansil près
de Rouyn-Noranda et à la mine •
• Louvem près de val-d'Or.
• Cordiérite (Mg,Fe)2AI4Si5018 • nH2O Très abondante dans le secteur de Saint-Augustin sur la
• Côte-Nord (baie de •
•
Jacques-Cartier); beaux cristaux dans le secteur du lac Cuttings (Baie-James).
• •
Covellite CuS Signalée dans les mines Silidor et La Ronde en Abitibi; à la mine
• Selbaie dans le canton de • Brouillan; à la mine Madeleine
en Gaspésie.
• • Cubanite CuFe2S3 Beaux cristaux trouvés à la mine
Henderson à Chibougamau.
• • Cuprite CuS Signalée à la mine Copper Rand
à Chibougamau. •
Diopside CaMgSi206 Très répandu dans la Province de Grenville: en masses granulaires (diopsidites) ou en cristaux prismatiques dans certains marbres calcaires et skarns.
•
• • •
• •
•
Disthène Synonyme de kyanite, AI2Si05
À la mine Narco (canton de Campeau) au Témiscamingue; au lac Croche près de Fermont.
• Dolomite CaMg(CO3)2 Portage-du-Fort (Outaouais); • L'Île-du-Collège • (Témiscamingue); • Havre-Saint-Pierre (Côte-Nord).
• Enstatite- MgSiO3-(Mg,Fe)SiO3 Dans les roches anorthositiques
• hypersthène de la Province de Grenville.
• •
Grands cristaux d'hypersthène à reflets bronzés au nord-ouest du lac Saint-Jean.
• 129
•

1 1 1
Épidote Ca2FeAl2(SiO4)3(OH) Minéral très répandu. Présent dans la gangue de plusieurs gisements d'or de l'Abitibi. 1
Fuchsite Muscovite chromifère Fréquente dans les veines de verte quartz aurifères de l'Abitibi. 1
Grunérite Fe7Si8022(OH)2 Dans la région de Fermont, associée aux formations de fer.
1 Jaspe Si02 Dans les formations de fer
du lac Albanel; dans le secteur des monts Stokes en Estrie. 1
Kaolin AI2Si205(OH)4 Dans le canton d'Amherst et à Saint-lovite dans les 4 Laurentides; à Château-Richer près de Québec.
Lépidolite K(Li,Al)2 _3(AISi3010) A la mine Leduc à Saint-Pierre- (O,OH,F)2 de-Wakefield (Outaouais). ,
Manganite MnO(OH) Signalée aux Îles-de- 4 la-Madeleine.
Marcasite FeS2 Signalée à la mine Lorraine (canton de Gaboury) au Témiscamingue; à la mine. Powell Rouyn près de Rouyn-Noranda, en Abitibi. ,
Millérite NiS A la mine Orford Nickel en Estrie; à la mine Marbridge en Abitibi.
Morion Variété de quartz Dans certaines pegmatites du brun à noir secteur de Buckingham. ,
Néphéline (Na,K)AISiO4 Dans les massifs de syénite d'Obedjiwan (Mauricie), du canton de Crevier (Lac-Saint-lean) et de Cawood (Outaouais). 111
130 '

• •
• • Olivine (Mg,Fe)2SiO4 Au mont Olivine (Gaspésie). • Beaux cristaux à la mine Parker
près de Notre-Dame-du-Laus • (Outaouais).
• Orpiment As2S3 Trouvé dans des calcaires dans • le canton de Dudswell en Estrie.
• Pechblende Variété compacte Minéral présent dans les gîtes
d'oxyde d'uranium, d'uranium du lac Gayot et
• UO2 du lac Beaver (secteur des • monts Otish) dans le
Nord-du-Québec.
• • Pentlandite (Fe,Ni)9S8 Gisements dans le Grand-Nord
du Québec (mine Raglan),
• en Abitibi (mines Marbridge • et Lac Renzy) et en Mauricie
(lac Édouard). •
• Phlogopite KMg3(AISi3010)(OH)2 Très commune en Outaouais, associée à l'apatite. On trouve • aussi des massifs de roches
• très riches en phlogopite • dans le secteur de Parent,
en Mauricie.
• • Pyrochlore (Ca,Na)2(Nb,Ta)206(O,OH,F) À la mine Niobec à Saint-Honoré
(Lac-Saint-Jean) et dans
• les gisements de niobium de • la région d'Oka.
• Rutile TIO2 Ala mine General Electric • à Saint-Urbain (Charlevoix);
• dans certains grès du secteur des monts Sutton, en Estrie.
• • Scapolite (Ca,Na)4(CO3,CI)(Si,AI)6Si6024 Très répandue dans la Province
de Grenville, surtout en • Outaouais. On trouve • notamment une belle scapolite
bleue dans le secteur de
• Fort-Coulonge.
•
• 131 •

Scheelite CaW04 Fréquente dans les veines de quartz aurifères de l'Abitibi. On en a trouvé aussi en Chaudière-Appalaches près de Saint-Robert-Bellarmin (gîte St-Robert Metals).
Sélénite
CaSO4•2H20
Aux îles-de-la-Madeleine.
Sérandite Na(Mn,Ca)2Si30$(OH)
Minéral rare trouvé au mont Saint-Hilaire en Montérégie.
Serpentine Mg3S1205(OH)4 Dans les mines d'amiante de l'Estrie; à Kilmar dans la MRC d'Argenteuil, associée à la magnésite.
Sillimanite AI2Si05 Assez répandue dans la Province de Grenville, surtout dans le secteur de Sainte-Anne-du-Lac, au nord de Mont-Laurier.
Smaltine (Co,Ni) As2 Présence à la mine Trinity au sud du lac Castagnier, en Abitibi.
Sodalite Na8(AISiO4)Cl2 Mont Saint-Hilaire
en Montérégie.
Sphène CaTiO(SiO4) Signalé à plusieurs endroits en (titanite) Outaouais, principalement dans
les anciennes mines de mica des cantons de Hull et de Templeton.
Spinelle MgA1204 Spinelles bleus observés localement dans les marbres du Grenville (canton de Polette). Beaux cristaux à la mine Parker près de Notre-Dame-du-Laus (Outaouais).
132

•
•
•
• Staurotide Fe2A1906(SiO4)4(O,OH)2 Secteur de Laniel • (Témiscamingue).
• •
Stilbite (NaCa2AI5Si13036) • 14H20 Beaux cristaux trouvés dans la région de Maniwaki.
• Stilpno- K(Mg,Fe)8(Si,Al)12(O,OH)27 Dans des schistes à la mine • •
mélane Broughton (canton de Leeds) en Estrie.
• •
Sylvite Fe2A1906(SiO4)4(O,OH)2 À la mine Seleine alles-de-la-Madeleine).
• • •
Tellurures Minéraux d'Au, Ag, Te Signalés dans quelques mines d'or de l'Abitibi ainsi qu'à la mine Lac Matagami.
• •
•
Tétraédrite Cu12Sb4S13 Dans quelques mines d'or et de métaux de base de l'Abitibi, avec la chalcopyrite, la pyrite, la sphalérite.
• Trémolite Ca2Mg5S18022(OH)2 Fréquent dans la Province de • Grenville, en Outaouais (Île du • Grand Calumet, mine Bristol) et
dans les Laurentides •
•
(Lac-des-Écorces). on en a trouvé aussi dans le canton de
• Standon en Beauce.
• Uraninite UO2 Dans les pegmatites uranifères
des secteurs de Mont-Laurier (Laurentides) et de
• •
Baie-Johan-Beetz sur la Côte-Nord.
• Vermiculite (Mg,Fe,AI)3(Si,AI)4010(OH)2.4H20 Présence à Venosta • (canton de Low) en Outaouais.
•
• •
Vésuvianite Ca1 0Mg2A14(SiO4)5(Si207)2(OH)4 Beaux cristaux à la mine Jeffrey à Asbestos; à Laurel au nord de Montréal.
•
• 133
•

1
1
1
Weloganite Sr3Na2Zr(CO3)6 . 3H20 Minéral rare découvert à 1
la carrière Francon à Montréal.
Wollastonite CaSiO3 Saint-Sauveur-des-Monts 1 (Laurentides); canton de
Saint-Onge (Lac-Saint-Jean);
canton de Grenville (Outaouais). /
1 Zircon ZrSiO4 Beaux cristaux trouvés dans
le canton de Villedieu
au Témiscamingue. 1
1
11
11 11
11
I
I
I
I
I
11
111
134

•
•
•
• , RENSEIGNEMENTS • COMPLÉMENTAIRES SUR • LES SPÉCIMENS PHOTOGRAPHIÉS
•
•
•
• •
MINÉRAL (GROSSEUR EN CM)
MINÉRAUX ACCESSOIRES
LOCALITÉ D'ORIGINE
• N° 1 Graphite' - Labelle, Laurentides • (15x20)
• •
N° 2 Cuivre natif 2 (20 x 9)
Serpentine Mine Normandie, Coleraine, Chaudière-Appalaches
• N° 3 Galène' - Mine Candego, Gaspésie . (8 x 6)
• •
N° 4 Sphalérite' (9 x 13)
Chalcopyrite Mine Tétrault, Notre-Dame-de-Montauban, Mauricie
•
• N° 5 Chalcopyrite'
(18x 11) Quartz pyrite Rouyn-Noranda,
Abitibi-Témiscamingue
• N° 6 Pyrrhotite' Chalcopyrite Mine Home,
• •
(5 x 7) Rouyn-Noranda, Abitibi-Témiscamingue
• N° 7 Stibine' - Hunan, Chine • (11x6)
• N 8 Pyrite - Sherbrooke, Estrie • (1,5 x 1,5)
• •
N° 9 Malachite, (15 x 10)
limonite Mine New Insco, Abitibi-Témiscamingue
• •
N° 10 Molybdénite' (2,5 x 3)
Quartz Moly Hill, Canton La Motte, Abitibi-Témiscamingue
• •
N° 11 Brucite' (8 x 12)
- Mine Jeffrey, Asbestos, Estrie
• • 135

•
•
•
N° 12 Corindon' (8 x 1)
— Renfrew, Gutsfarm, Ontario
• •
N° 13 Hématite' (6 x 11)
Quartz Schefferville, Nord-du-Québec
• •
N° 14 Ilménite' — Girardville, Saguenay— • (6 x 5) Lac-Saint-Jean •
N° 15 Pyrolusite' (4 x 6)
— Cap-aux-Meules, Iles-de-la-Madeleine
• •
N° 16 Limonite' — Mine du • (20 x 20) lac Memphrémagog, Estrie •
N° 17 Magnétite' Biotite Oka, Laurentides • (2,5 x 3) •
N° 18 Chromite' (8 x 8)
Olivine Black Lake, Chaudière-Appalaches
• .
N° 19 Fluorite' Calcite Hunan, Chine • (1x1)
• N° 20 Halite'
(15 x 10) — Mine Seleine,
Iles-de-la-Madeleine •
N° 21 Calcite' — Port Daniel, Gaspésie • (8 x 10)
• N° 22 Magnésite'
(10 x 15) — Mine Kilmer,
Grenville-sur-la-Rouge, Laurentides
•
•
N° 23 Sidérite' (5 x 6)
Albite Carrière Demix, Mont Saint-Hilaire, Montérégie
•
• •
N° 24 Quartz (cristalisé)' — Bonsecours, Estrie (7x8) •
N° 25 Quartz (laiteux)1 (15 x 8)
— Gisement La Gallette, Charlevoix, Capitale-nationale
•
S
S 136 •

•
•
•
• •
N° 26 Microcline' (5 x 10)
— Saint-Ludger-de-Milot, Saguenay—Lac-Saint-Jean
• N° 27 Plagioclase' — Île de Nain, Labrador • (14x9)
• N° 28 Talc' — Mégantic, Estrie • (6 x 8)
• •
N° 29 Muscovite' (5 x 7)
— Grandes-Bergeronnes, Côte-Nord
r
• •
N° 30 Biotite' (5 x 6)
Augite Notre-Dame-de-la-Sallette, Outaouais
• •
No 31 Chrysotile' (10 x 6)
Serpentine Mine Bell-Asbestos, Thetford Mines, Chaudière-Appalaches
• N° 32 Pyroxène° — Ontario
• (5 x 3,5)
• N° 33 Spodumène' — Propriété Cyr Lithium,
• •
(12 x 20) Territoire de la Baie-James, Nord-du-Québec
•
•
N° 34 Amphibole (hornblende)1
Apatite Tory Hill, Gibson Road, Ontario
• (12 x 20)
• •
N° 35 Béryl' (7 x 8)
— Preissac, Abitibi-Témiscamingue
• N° 36 Tourmaline' (indéterminé)
Quartz Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord
• • N° 37 Grenat°
(10 x 7) — Laniel,
Abitibi-Témiscamingue
• • N° 38 Apatite'
(1 x 6) Calcite Sandy Creek, Otter Lake,
Outaouais
• N° 39 Barite'
(8 x 20) Pyrite Mine Niobec, Saint-Honoré,
Saguenay—Lac-Saint-Jean
•
•
• • 137

1 1 1 1
1 1
1
1
1
1 1 1
1
1
N° 40 Gypse'
(15 x 15)
— Havre-aux-Maisons,
Îles-de-la-Madeleine
N° 41 Or natif' Quartz Val-d'Or, Abitibi-Témiscamingue
N° 42 Argent natif' — Cobalt, Ontario
N° 43 Platine natif, — Oural, Russie
N° 44 Diamant' Graphite Afrique du Sud
N° 45 Rubis2 Mica Inde
N° 46 Saphir' Sri Lanka
N° 47 Émeraude2 Quartz Madagascar
N° 48 Topaze2 — Brésil
N° 49 Améthystes — Ontario
N° 50 Amazonite' Quartz Lac Sairs,
Abitibi-Témiscamingue
N° 51 Grenats — Mine Jeffrey, Asbestos, Estrie
N° 52 Agates — Gaspésie
N° 53 Jade° — Mine Poudrier, Black Lake,
Chaudière-Appalaches
1. Université Laval. 2. Musée minéralogique et minier de Thetford Mines. , 3. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 4. Collection Yves Bellemare. ' 5. Collection Robert Ledoux. 6. Collection Henri-Louis Jacob.

•
•
•
• , POUR EN SAVOIR PLUS
•
•
•
• A - Guides de collectionneurs
• • BOIVIN, D.J. Roches et minéraux du Québec: guide d'excursion pour le collec-
tionneur, Conseil de développement du loisir scientifique, Montréal, • 1985,142 pages.
• BOIVIN, D.J., et M. DI VERGILIO. Minéraux, fossiles et roches: guide du collec- • tionneur, Conseil de développement du loisir scientifique, Montréal, 1986,
132 pages.
• Thetford Mines, 1993, 78 pages.
• HOGARTH, D.D., L. MOYD, E.R. ROSE et H. R. STEACEY. Localités minéralogiques • classiques en Ontario et au Québec, Commission géologique du Canada,
Rapport divers 37, 1983, 84 pages.
• 1983, 140 pages.
• SABINA, A.P. Roches et minéraux du collectionneur: Hull-Maniwaki, Québec; •
Ottawa-Peterborough, Ontario, Commission géologique du Canada, Rapport • divers 41, 1987, 147 pages.
• SABINA, A.P. oches et minéraux du collectionneur: Cobalt - Belleterre -Timmins •
(Ontario et Québec), rév. et rééd., Commission géologique du Canada, Rapport • divers 57, 2000, 270 pages.
• SABINA A.P. Roches et minéraux du collectionneur: Kirkland Lake - Noranda - • Val-d'Or (Ontario et Québec), rév. et rééd., Commission géologique du
Canada, Rapport divers 77, 2003, 322 pages. •
• • 139
• • GAUDARD, S. Voyage au cour des Appalaches: guide des curiosités minérales de
la MRC de l'Amiante, Musée minéralogique et minier de Thetford Mines,
• • SABINA, A.P. Roches et minéraux du collectionneur: Kingston, Ontario, Lac
Saint-Jean, Québec, Commission géologique du Canada, Rapport divers 32,
• SABINA, A.P Roches et minéraux du collectionneur: Buckingham, Mont-Laurier, • Grenville, Québec, Hawkesbury, Ottawa, Ontario, Commission géologique du
Canada, Rapport divers 33, 1986, 96 pages.
• SABINA, A.P. Roches et minéraux du collectionneur: Estrie et Gaspésie, Québec; • partie du Nouveau-Brunswick, Commission géologique du Canada, Rapport
divers 46, 1992, 171 pages.

SABINA, A.P. Roches et minéraux du collectionneur: Îles-de-la-Madeleine (Québec), 'le de Terre-Neuve et Labrador, rév. et rééd., Commission géologique du
Canada, Rapport divers 58, 2003, 299 pages.
SABINA A.P. Roches et minéraux du collectionneur d'Ottawa à North Bay et Huntsville (Ontario); de Gatineau (Hull) à Waltham et Témiscaming (Québec), Commission géologique du Canada, Rapport divers 48, 2007, 260 pages.
SCHUMANN, W. Collectionner minéraux, roches et fossiles, Bordas, Pans, 1985,
191 pages.
TRAILL, R.J. Catalogue des minéraux du Canada, nouvelle éd., Commission géolo-
gique du Canada, Étude 80-18, 1983, 440 pages.
B — Livres de minéraux illustrés en couleur
Le grand guide des minéraux, Sand et Tchou, Paris, 2003, 239 pages.
BARIAND, P Minéraux Passion, Bordas, Paris, 1992, 223 pages.
BARIAND, P., et J. P. POIROT. Larousse des pierres précieuses: fines, ornementales, organiques, rééd. Larousse, Paris, 2004, 284 pages.
BAUER, J. Guide des minéraux: minéraux, roches, pierres précieuses, Hatier, Paris,
1976, 215 pages.
BÉDARD, L.P. J. LAROUCHE et P. HUDON. Guide d'identification des minéraux, Broquet, 2008, 207 pages.
BISHOP A.C., W. R. HAMILTON et A. R. WOOLEY. Guide des minéraux, roches et fossiles: toutes les merveilles du sol et du sous-sol, Delachaux et Niestlé, Paris,
2005, 336 pages.
BONEWITZ, R. Roches et minéraux du monde, Delachaux et Niestlé, Paris, 2005,
360 pages.
CÉZARD, V. Minéraux, coil. Miniguide tout terrain, Les guides Nathan, Nathan, 2008,
64 pages.
DUDA, R., et L. REJL. La grande encyclopédie des minéraux, Gründ, Paris, 1992,
520 pages.
JOHNSEN, O. Guide Delachaux des minéraux: plus de 500 minéraux, leurs des-criptions, leurs gisements, Delachaux et Niestlé, Paris, 2006, 438 pages.
HALL, C. Les pierres précieuses, coll. L'oeil Nature, Bordas, Paris, 1995, 160 pages.
MEDENBACH, O., et C. SUSSIECK-FORNEFELD. Les minéraux, Solar, Paris, 1983,
286 pages.
140

• •
• • PELLANT, C. Roches et minéraux, coll. L'ceil Nature, Larousse, Paris, 2005,
256 pages.
• POIROT, J.P. Minéralia: les minéraux et les pierres précieuses du monde, Artémis,
• Paris, 2004, 223 pages.
• POUGH, F.H. Guide des roches et minéraux, 3e éd., Delachaux et Niestlé, Paris,
• 1979, 383 pages.
• PRICE, M., et K. WALSH. Roches et minéraux, coll. Nature en poche, Larousse, Paris,
• 2006, 224 pages.
• ROBERTS, J.L. Minéraux, roches et fossiles, Broquet, 2006,128 pages.
• SCHUBNEL, H.J. Larousse des minéraux, Larousse, Paris, 1981, 368 pages.
• SCHUMANN, W. Guide des pierres et minéraux, Delachaux et Niestlé, Bruxelles,
• 2007, 384 pages.
• SCHUMANN, W. Minéraux et roches: caractéristiques, gisements et utilisation, coll.
• Guide Vigot de la nature, Vigot, Paris, 2004, 124 pages.
• SCHUMANN, W. Guide des pierres précieuses, pierres fines et pierres ornemen-
tales, Delachaux et Niestlé, Lausanne, 2000, 280 pages.
• SORRELL, C.A. Roches et minéraux: guide d'identification sur le terrain, Marcel
• Broquet éditeur, 1981, 273 pages.
• • C - Manuels de minéralogie déterminative
• AUBERT, G., C. GUILLEMIN et R. PIERROT. Précis de minéralogie, Masson et Bureau
• de recherches géologiques et minières, Paris, 1978, 335 pages.
• BARIAND, P., F. CESBRON et J. GEFFROY. Les minéraux: leurs gisements, leurs
• associations, Éditions du Bureau de recherches géologiques et minières,
• Paris, volume 1, 1984, 147 pages.
• BARIAND, P, F CESBRON et J. GEFFROY. Les minéraux: leurs gisements, leurs
associations, Éditions du Bureau de recherches géologiques et minières,
• Paris, volume 2, 1984, 151 pages.
• BARIAND, P, F. CESBRON et J. GEFFROY. Les minéraux: leurs gisements, leurs
• associations, Éditions du Bureau de recherches géologiques et minières,
• Paris, volume 3, 1984, 190 pages.
• PAYETTE ARCHOUR, F. La gemmologie, Éditions Gemma, 1987, 196 pages.
•
•
• 141
•

11 11 11 11 11 11 11 11 lb 11 11 lb 11 0 11 ID 11 11 11 fb 11 lb 11 ID II 11 11 f1 11 11 11 1/ 11 11 11 11
D - Nomenclature minéralogique
INDEX DE NOMENCLATURE BRGM, Inventaire des collections nationales de miné-
raux, Bureau de recherche géologique et minière de France éditeur, 1968,
386 pages.
BLACKBURN, W. H., et W. H. DENNEN. Encyclopedia of Mineral Names, The Cana-
dian Mineralogist, Special Publication n° 1, Mineral Association of Canada,
1997, 360 pages.
E — Collections de minéraux exposées
MUSÉE DE GÉOLOGIE RENÉ-BUREAU Pavillon Adrien-Pouliot, 4' étage, Université Laval, Québec, Québec, G1K 7P4
www.ggl.utaval.ca/musee/index.html
MUSÉE MINÉRALOGIQUE ET MINIER DE THETFORD MINES 711, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines, Québec, G6G 7Y8
www.museemineralogique.com
MUSÉE MINÉRALOGIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 650, rue de la Paix, Malartic, Québec, JOY 1Z0
www.museemalartic.qc.ca
MUSÉE MINÉRALOGIQUE D'ASBESTOS 341, boulevard Saint-Luc, Asbestos, Québec, J1T 2W4
MUSÉE REDPATH
Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, H3A 2K6
francais.mcgill.ca/redpath
MUSÉE DE LA NATURE ET DES SCIENCES 225, rue Frontenac, Sherbrooke, Québec, J1H 1K1
www.naturesciences.gc.ca
LE PETIT MUSÉE MINÉRALOGIQUE DE L'UQAC
555, boulevard de l'Université, Saguenay, Québec, G7H 2B1
mineraux.uqac.ca
CENTRE D'INTERPRÉTATION DU CUIVRE DE MURDOCHVILLE
345, route 198, Murdochville, Québec, GOE 1W0
www.cicuivre.com/fr/index.asp
MINE D'AGATES DU MONT LYALL
Route 299, Réserve faunique des Chics-Chocs, Québec
www.mont-lyall.com
142

• •
• • MINE CRISTAL QUEBEC
430, 11e rang, Bonsecours, Québec, JOE 1H0 • www.minecristal.com
• • F - Clubs de minéralogie au Québec
• CLUB DE MINÉRALOGIE ET DE PALÉONTOLOGIE DE LA GASPÉSIE • C.F. 777, Chandler, Québec, GOC 2H0 • www.mineraloetpaleontogaspesie.com • [email protected]
• CLUB D'AMATEURS DE MINÉRAUX ET DE FOSSILES DE LA GASPÉSIE 28, rue Saint-Patrick, Gaspé, Québec, G4X 2Y2
• web.cgaspesie.qc.ca/mineralogie • [email protected]
• MINÉRALOGIE DE MONTRÉAL • C.P. 305, succursale Saint-Michel, Montréal, Québec, H2A 3M1
www.clubmineralogiemtl.com • [email protected]
• CLUB DE MINÉRALOGIE DU SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN • a/s L. Paul Bédard, Unité d'enseignement des Sciences de la Terre,
Université du Québec à Chicoutimi, Saguenay, Québec, G7H 5B1 • mineraux.uqac.ca/club_mineralo_08/index_cm.html • [email protected]
• CLUB DE MINÉRALOGIE DE LA RÉGION DE L'AMIANTE • 697, rue Monfette est, Thetford Mines, Québec, G6G 7G9
pages.globetrotter. net/mi nera l ogie/
• CLUB DE MINÉRALOGIE DE QUÉBEC
• Domaine Maizerets • 2000, boulevard Montmorency, Québec, Québec, G1J 5E7
www.lecmq.org
• CLUB DE MINÉRALOGIE D'ASBESTOS • a/s Normand Desharnais
•
• • 143
• LE CLUB DE GEMMOLOGIE ET DE MINÉRALOGIE DE MONTRÉAL • C.F. 1717, succursale B, Montréal, Québec, H3B 3L3 • www.montrealgemmineralclub.ca

C.P. 487, Danville, Québec, JOA 1A0 www.bobeggs.ca/f jasbestos. htm I [email protected]
G - Expositions annuelles de minéraux
CLUB DE MINÉRALOGIE DE MONTRÉAL Salon des pierres, minéraux et fossiles de Montréal Troisième fin de semaine d'avril Centre Pierre-Charbonneau 3000, rue Viau, Montréal
MONTRÉAL GEM AND MINERAL CLUB Annual Gem and Mineral Show Troisième fin de semaine de novembre Place Bonaventure 800, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal
CLUB DE MINÉRALOGIE D'ASBESTOS Foire minéralogique d'Asbestos Troisième fin de semaine d'août Salle paroissiale Notre-Dame-de-Toutes-Joies 311, rue Lafrance, Asbestos

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Achevé d'imprimer en août 2009
sur les presses de l'imprimerie J.B. Deschamps inc. • à Québec (Québec)
• •

ISBN 978-2-551-19839-9
Il 1111 I Ill I I 9 78255 198399
Imprimé au Québec. Canada
19,95 $
Muni d'un marteau, d'une loupe,
d'un sac à échantillons et du
Guide pratique d'identification
des minéraux, le prospecteur
amateur ou l'étudiant pourra faire
des découvertes surprenantes,
aux noms exotiques... parfois
même au seuil de sa porte I
Illustré en couleurs, ce guide décrit de façon détaillée
53 minéraux que nous pouvons trouver sans trop
de difficulté sur le territoire québécois. Il traite, entre
autres, de leurs différentes propriétés physiques,
de leurs usages et de leurs modes de gisement.
Un supplément décrit également les métaux nobles,
les principales pierres précieuses de grande valeur
et les pierres fines ornementales.
Une section intitulée Tables de détermination, qui
inclut 120 minéraux, vous fournit des techniques et
des conseils judicieux pour identifier méthodiquement
vos minéraux et les classer.
• • • • • • • • • • • • • •
Ressources naturelles et Faune
KI KI Québec aa Kn
Related Documents